Rien ne fait mieux voir le temps qui passe

Rien ne fait mieux voir le temps qui passe que la rivière pleine à raz bord glissant sur une pente quasi nulle. Qu'on s'y baigne ou pas, c’est toujours la même eau (ou une autre) qui s’éloigne sans demander son reste, sans égard pour les berges ou le morceau de bois flotté qu’on lui jette pour la détourner de son cours. La rivière s'enfuit toute.
La rivière qui roule ses hautes eaux n'est pas un accident du temps, elle est une image du temps qui passe loin du temps qui tourne, comme le torrent capricieux l’est, aux abords des sources, du temps qui résiste, hésite. De l’irrésolu.
Jean Prod’hom
Sous les remparts

Les eaux épaisses du Lez frémissent comme le lait sur le point de bouillir, il est gros des pluies d’hier au-dessus de Miélandre et Teyssières, plus rien désormais ne le retient jusqu’au Rhône ; on aperçoit pourtant ici et là des crêtes d’argent, ce sont les gués aménagés par les enfants en août qui freinent son cours puissant. On se souvient de l’inimaginable, les crues qui ont noyé les flancs du bas du village ; mais les berges résistent aujourd’hui, il suffit de contourner les flaques près de l’ancienne voie ferrée, dans la boue ou les ronces. Coups de feu sur les berges, c’est encore un héron qui fait claquer ses ailes en s’élevant par-dessus les saules et les roseaux avant de disparaître dans la chênaie. Deux vieux de Grignan marqués par la fatigue et les excès promènent leurs chiens, usés comme eux, ils les ressortiront une quatrième fois lorsque la nuit sera tombée. De vieux bus stationnent dans les fossés qui longent les vignes, on les dirait accidentés ; on finit par repérer dans le fatras des sarments qu'ils taillent les silhouettes de vignerons qui passent au pied de la tour de Chamaret.

Dans la petite maison qui domine la pIscine de Grignan, au numéro 10, le vieux sage m'attend, croquant la vie assis dans un transat. Il est sous assistance respiratoire, mais ça ne le gêne pas pour traverser l’après-midi sans boussole, comme un sauvage, et tirer des bords sans prendre de riz. Il évoque ses amis que j’ai eu l’occasion de croiser ou le privilège de connaître ; et les trente ans qui nous séparent nous rapprochent curieusement. L’après-midi lorsque le temps le permet, il descend au garage, prend ses bambous et griffe d’encre son papier à la cuve.
Il revient à plusieurs reprises à sa question initiale, il aimerait que je lui fournisse une réponse, mais je ne lui répondrai jamais complètement. A chaque fois il en profite pour emprunter une nouvelle passe, celle qui se présente, et on fait une pause à Venterol ou Taulignan, à la rue de Bourg ou en Grèce, dans la Broye ou le Gros-de-Vaud. On fait la causette avec Jean-Claude Piguet, Philippe Jaccottet, Jean Dumur, Victor Desarzens, Marcel Poncet. Jean-Claude Hesselbarth n'a pas la tête dans sa poche, il parvient à chaque coup à remonter la chaîne des raisons et des images qui nous ont conduits là où nous nous retrouvons égarés, il me demande à chaque coup émerveillé : « Mais pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs ça ne vous intéresse pas. Revenons à vous. » Si bien qu'à la fin on n'a pas fait un pas, et qu'il va bien falloir que je revienne faire l’école buissonnière sous ses remparts. Saucisse au foie et gruyère salé, c’est entendu.
Il est temps parfois de ne plus compter, de ne plus vouloir mettre au pas son énergie. Ne plus hésiter à donner et à qui. Le bonhomme a de quoi faire mille tableaux et d’autres pique-niques, il a rajeuni mais il fatigue en fin d’après-midi, c'est comme si le champagne avait perdu de ses bulles, et qu’il me fallait couper dans la pâte de langue. Il est temps que je m’en aille. Jean-Claude m’offre le petit ouvrage que Jil Silberstein lui a consacré il y a quelques années.
Et puis demain c'est le 31, Philippe et sa femme vont le rejoindre pour l’an neuf. Liliane est allée acheter quelques huîtres chez Grande oreille. Sans compter que l’année prochaine il devra être en forme, des expositions importantes auront lieu, va falloir tenir le rythme. Je traverse en rentrant un bourg qui fait croire en août que tout va pour le mieux. Pas même un fantôme, je rentre à Colonzelle, à pied dans la nuit.






Jean Prod’hom
Teyssières

Perdus dans une mer de ceps et de sarments, deux tailleurs lèvent la tête avant Montbrison, la neige est tombée sur la montagne de la Lance et lui fait une drôle de tonsure. L’alternance des terres rouges, des terres ocres, le gris, les bleus de lavande, le vert des prés maigres, les peupliers, les cyprès, les jeunes oliviers, les vieux, la vigne font penser à la Toscane. Ne seraient les serres et les valats couverts de chênes verts et de pins.

On laisse une voiture près du mas de Miélandre, l’autre à Broc. Un chemin nous conduit au vieux Teyssières d’où une fumée bleue s’échappe ; une voiture belge atteste d'une présence dans le nid d'aigle qui domine la vallée du Lez ; le hameau n’est donc pas abandonné, mais on ignore de quel côté vont basculer les mas de ce hameau. On croise un vieux chien muet qui disparaît.
Sur l’autre rive une chapelle, ses portes sont closes ; pas celles de fer du cimetière dans lequel les morts ne manquent pas de place, il ne semble pas qu’il y ait eu beaucoup de va-et-vient dans le coin. On y meurt au compte-goutte et les enfants ont décidé de naître ailleurs. On a enterré le dernier citoyen il y a trois ans, un Michel qui avait une quarantaine d’années, les morts qui restent s'accrochent à la pente. Tout en haut trône un couple d’Allemands dans un lit de marbre noir, il s’agit de Wilfried et d’Anna sa femme nés dans la premier décennie du XXème siècle, morts respectivement en 76 et 97. Présence étrange dans ce cimetière, à deux pas d’un panneau placé dans le dernier virage de la route qui y conduit, sur lequel on peut lire les hauts faits des hommes du maquis de la Lance.
On a semé des fleurs artificielles dans chacune des concessions, les vraies ne sortiront pas de terre ; il y a Eglantine, Rose et Vermeille, des fleurs auxquelles on ne croit pas vraiment. Philomène, Augustine, poupées de porcelaine, Lydie, Angèle, Adelphine, noms d’anges, noms d’idiots, Florentin, Séraphin, Philidor, Alcide.
On pensait aller jusqu'aux Lunières mais on écourte, faut dire qu’on a rendez-vous. On nous attend à Taulignan pour mettre du bois en tèche.










Jean Prod’hom
Tirer les rideaux

Le fort ralentissement annoncé à la radio entre Confignon et Bardonnex ne nous l'a pas rendu plus séduisant ni ne nous a permis le l’éviter. Dedans jusqu’au cou comme des idiots. Mais comment faire autrement, déserter les grands axes lorsqu’ils ne restent qu’eux ; les leçons ne servent à rien ni l'expérience.

Sandra est au volant, j’en profite pour lire « 14 ». C’est une histoire vraie de la Grande Guerre, pas vraie du tout, racontée par Jean Echenoz, qui a lu consciencieusement les manuels scolaires. Avec l’un de ces décalages continus dont cet émule des Lettres persanes a le secret ; il fait entendre une fois encore la matière qu’on peine à voir, que les livres d’histoire ont la fâcheuse manie de faire disparaître en en déshabillant le souvenir, avant de charger celui-ci de boulets et de poncifs pour le noyer. Je propose qu’on remette à Echenoz tous ces inutiles manuels qui empoussièrent les esprits de nos adolescents et qui verrouillent l’accès à la connaissance, on s’amuserait enfin un peu.
Si comme toutes les vallées celle de l’Isère s’enlaidit, elle ne vieillit pas ; et cette jeunesse, elle la doit aux innombrables plantations de noyers qui ont remplacé dans le dernier quart du XIXème siècle les mûriers sur le déclin depuis la maladie du ver à soie et les vignes attaquées par le phylloxéra. Les noyers solides sur leur jambes lèvent haut leurs bras blancs, pas un gramme de graisse, tout en muscles et en os.
Mais personne dans les noyeraies, ailleurs non plus. Les derniers habitants de la vallée, s’il y en a, se cachent derrière des rideaux de jute. La campagne abandonnée est comme une succession de tableaux de genre que leurs modestes héros auraient désertés, scènes séparées par des haies vives et nues, les treillis n’arrêtent pas le regard, les potagers ressemblent à des cimetières. La herse a noirci la terre, le soleil troué les bois de feuillus. Cours de ferme désertes, fers et ferrailles rouillés aux quatre coins des domaines, flaques immobiles dans les chemins à ornières. Les balles de paille s’affaissent, seules quelques vaches faméliques font bouger le paysage. On sait que l’Isère ne passe pas loin mais on ne sait pas exactement où, un héron soudain remue l’air et grimpe jusqu’au ciel.
On pensait aller vers le soleil, et c'est la tempête qui nous accueille aux portes de Valence, la pluie nous plonge dans un tunnel de lavage dont on ne sort qu’après Montélimar. J’en profite pour continuer la lecture du second tome du journal de Juliet. Quelque chose a changé, les mots de neutre, commun, singulier, universel se sont substitués à ceux de suicide, souffrance, doute. Il écrit le 5 mars 1966 :
On est d'abord une unité indifférenciée dans une masse indifférenciée. Puis on se différence, on prend de la distance, s'établit à l'écart. Enfin, on s’éprouve semblable. Alors on réintègre la communauté, et la singularité s'accroît du commun.
André Gide, auquel Juliet ne semble plus guère attacher d’importance, devient au cours des années le chef de file de ces écrivains qui n’ont jamais cessé d’universaliser leur particularités sans passer par un renoncement à eux-mêmes. Au chant du moi, Charles Juliet oppose le dur retour aux origines. Je m’endors, la pluie a repris de plus belle. Elle ne nous quittera pas avant Colonzelle.
Jean Prod’hom
Ténèbres en terre froide

Remonte sur les traces de Charles Juliet déposées en son temps. Idées noires collectées dans la première partie de son journal qui court les années 1957-1964. Guère d'échappées. Et lorsqu'on a l’impression que l'horizon se dégage un tant soit peu, c'est pour mieux se refermer dans les lignes qui suivent. Les jours s'enchaînent avec la régularité d'un rouleau compresseur : honte, suicide, fatigue, désespoir, dégoût, souffrance, doute. A peine un sourire en 59.
24 novembre
Si je devais mendier, la crainte d’importuner autrui, de lui infliger le spectacle de ma déchéance, m’imposerait d’aller me poster en un coin de la ville où nul ne passerait.
Et un bel exercice d’admiration le 25 octobre 1964, long billet enjoué (le plus long de ce premier volume) dans lequel Charles Juliet évoque sa première rencontre avec Bram van Velde. Il est 18 heures, ils sont timides, alors ils vont marcher, se glissent dans un restaurant. Bram van Velde lui parle de Beckett, de sa gentillesse, de sa générosité, de Descombin qui a joué et jouera encore un si grand rôle dans sa propre vie. Le vieux peintre habite Genève, sans famille, sans appartement, sans atelier. Parfaitement seul. Parfaitement démuni. Merveilleusement libre, serein et déchiré, c’est un miracle. (Charles Juliet ne peut s’empêcher d’ajouter à la fin et entre parenthèses qu’il n’a pas été à la hauteur de celui qui deviendra son ami.)
Je peine à imaginer que c’est un gamin de moins de trente ans ans qui a écrit et ruminé ces notes, et non pas un vieillard abandonné dans un hospice. Disons qu’il lui reste toute une vie pour rajeunir. Et cette idée que les choses ne vont pas comme on le croit, que la liberté ne se gagne et que la jeunesse ne s’obtient qu’à la fin accompagne comme une espérance le jeune homme tout au long de ces sombres années. Le passé est rusé et il convient de se débarrasser des idées qui encombrent. Que l’apaisement ait un prix et qu’il se présente au moment voulu n’est pas pour déplaire aux plus vieux d’entre nous.
Jean Prod’hom
Il y a les lames de fond

Il y a les lames de fond
le bois de la Fin
le pain d’épices
les crocodiles
les ponts de danse
les faux calculs
le grain du feutre
la fonte des neiges
les alibis
Jean Prod’hom
(P. F. 16) Edmond Kaiser

L’enfant remonte l’allée à pas lents, une boule de chiffons dans les mains. Il a ramassé un oiseau qui s’agitait entre deux pavés, les ailes et les pattes prises dans un fil de nylon, ses petits yeux noirs cherchent en vain. Hommes pressés, personne n’a le temps d’aider la bête qui fait le mort ; un regard par-dessus l’épaule, rassurés que ni l’oiseau ni l’enfant ne les suit. Celui-ci s’accroupit, tire un mouchoir de sa poche et enveloppe celui-là. Une vieille lui indique devant le centre commercial l’adresse du vétérinaire chez qui ses chiens et ses chats ont leurs habitudes, tout à côté de l’ancienne poste. En voyant l’air décidé du gamin, le vétérinaire lui propose de repasser le lendemain après l’école. Qui ne parle à personne de son aventure. Le lendemain la mésange s’envole devant son regard médusé.
En rentrant, il aperçoit sur la place du Marché un homme en loques qui parle une autre langue, assis en tailleur devant un gobelet vide et appuyé contre le mur compissé de la boucherie du quartier. Le mendiant lui fait un signe et le gamin lui sourit.
Quelques années plus tard le jeune homme malingre impressionne, il a l’oeil qui tournoie sans lâcher du regard ce qu’il veut. Comme un faucon. Il écrit des lettres où percent ses colères. Ses tourments le font avancer tout droit, ne dédaignant aucun des registres de sa langue, usant tout autant de l’invective que du compliment. Il ne démord pas d’une idée simple selon laquelle la dignité ne souffre d’aucune exception. Il a tantôt la voix ronde de ceux qui savent contourner les obstacles pour raccourcir les distances, tantôt la voix tranchante de ceux que les barbelés n’effraient pas, bien décidé à faire entendre ceux à qui on a dérobé le droit d’être. Ce courage il l’a dans l’âme et dans la peau. Franchir coûte que coûte les obstacles, faire entendre les motifs de ses saintes colères, l’inadmissible, les souffrances du condamné, la solitude des orphelins, sans jamais rien espérer. Nous avons si peu de temps pour comprendre, encore moins pour agir.
Sa voix d’enfant n’a pas quitté le vieillard qu’il est devenu, elle lui souffle aujourd’hui encore la teneur des lettres qu’il adresse aux puissants. Son combat ne prendra pas fin avant que chacun ait retrouvé le sol qui le fonde et le pain qui le nourrit. La dignité de chacun. Toujours la même colère, la même rage, le même corps malingre.
Jean Prod’hom
114

La naissance d’un enfant condamne à mort ses parents. Qui ont pour tâche, dans le sursis qui leur est accordé, d’assurer la subsistance de leur rejeton jusqu’à l’arrivée de la nouvelle génération.
Il n’a jamais été question de faire la lumière sur toutes choses. Car si l’homme aménage des chemins, c’est tout autant pour sortir de la nuit dans laquelle il vit que pour y rentrer le soir. Et oublier.
A la croisée des chemins, le présent déborde de tous les côtés.
Jean Prod’hom
113

Les amateurs de plongée sous-marine reviendront sous peu à la plongée intérieure tant les fonds marins, dans leur variété même, sont ennuyeux.
Non seulement je n’ai pas lu le centième de ce qu’ont lu mes amis, mais je ne m’en souviens plus. Je vis caché.
Jean Prod’hom
Dimanche 22 décembre 2013

Les reins nus de la terre,
et l’oeil qui tourne et retourne son corps comme pâte à pain.
Ni le sifflement désespéré d’un passereau blessé au pied d’une plinthe, ni celui d’un mulot pris au piège au fond d’une commode, mais celui de la tige d’un rosier rose caressant du dehors le vieux verre du jardin d’hiver.
Des arbres habillés comme des caniches.
Jean Prod’hom
(P. F. 15) Maurice Chappaz
 Mau
MauC’est après avoir étudié le vol des mésanges et le nid des hirondelles qu’ils avaient élaboré leurs premiers plans. Dans ce village les enfants chantaient bien avant de savoir parler, et quelque chose de ce premier chant les animait lorsqu'ils tenaient leurs conciliabules sous le porche de l’église ou dans les granges, si bien que leurs sourcils battaient d’aise quand, revenant au soleil, ils s’engageaient sur le sentier des mayens.
Le régent leur avait appris dans les premières classes que le monde ne s’ouvrait pas comme un livre, qu’il ne suffisait pas de savoir lire pour y vivre, qu’il convenait plutôt de s’y glisser et de faire corps avec lui en ajoutant sa voix à l'air du temps. En remuant le moins de choses possible. Ces méthodes d’enseignement changeaient tant de choses qu'il était difficile plus tard de les distinguer des herbes hautes et des pierres dans lesquelles ils se fondaient lorsqu’ils gambadaient, de savoir avec certitude s'ils chantaient ou s’adressaient aux chèvres dont à cette époque les adolescents avaient la charge.
Le petit de l'abbaye était un de ces drôles d'oiseau parmi les oiseaux, un de ceux qui ne se laissaient pas attraper. On a beau être curé, régent ou poète, il était impossible de le retenir lorsqu'il regardait par la fenêtre les montagnes dont les cimes étaient recouvertes de neige, le troupeau qu'Armand conduisait au pré, ou les mouchoirs que le papillon agitait pour l'attirer dans son guêpier.
Le soleil rampe jusqu'au bureau surélevé, le prêtre scande des spondées et des dactyles. Mais ces reflets et les chants de Virgile ne lui font pas oublier les pâturages qu’il doit rejoindre lorsque la cloche aura sonné, l’air cru et le chemin qui ne s’arrête pas. Il sort dans le vestibule, attache ses chaussures, salue ses camarades, foule délicatement l'herbe avant d’allonger le pas. Il a hâte d'atteindre le chalet de son oncle, de prolonger jusqu’au col, de revoir ce pays immense qui se cache au-delà, avec ses vallées et ses promesses, de continuer un peu, laisser derrière lui ce qu’il croit connaître et aller vers ce qu’il ignore. Il y a des passés qui aident à avancer sur des chemins à peine tracés. Plus tard il ira au-delà, s’arrêtera sur la terrasse d’une pinte d’alpage, y demeurera jusqu’au soir, demandera l’hospitalité à un berger, se glissera sous une couverture avant de fouler l’herbe aux premières heures du jour, dans ce pays qui ne cesse de s’ouvrir à l’invisible et à l’inattendu.
Jean Prod’hom
(P. F. 14) Corinna Bille
 Corinna
CorinnaLes deux mondes dans lesquels se déroulent essentiellement nos vies coexistent. Certains d’entre nous avancent à cloche-pied dans l’idée de n’en perdre aucune miette, jusqu’à la mort. D’autres tentent de ramener ce qu’ils ont en propre à ce qui est commun à tous, en tordant le cou à leur vie personnelle ou en gonflant la panse du collectif. On ne dira rien de ceux que les circonstances ont obligés à faire le pari inverse, et qu’on croise parfois seuls et tête baissée, dans les allées de nos parcs et de nos asiles.
Restent quelques individus, rares, qui n’ont jamais su qu’il existait un autre monde que celui dont ils sont les honnêtes émanations. Qui jamais n’en ont éprouvé le manque. Elle était de ceux-là, ignorant qu’il puisse en aller autrement. Elle ne comprenait de ce qui l’entourait que ce qui venait de son coeur. Ceux qui avaient voulu la détourner de cette voie bien peu catholique n’avaient trouvé devant eux qu’un mur qui renvoyait en miettes leurs voeux de conformation.
L’écolière qu’elle était oubliait tout des heures passées sur les bancs d’école, ne faisait ses devoirs que parce que ça lui épargnait d’autres soucis. N’en voulait pas à ceux qui désespéraient de son cas. Ses parents l’aimaient et elle les aimait, ne se réjouissant que de les retrouver le soir, eux, la ferme dont ils assuraient le modeste train. Elle rentrait le bétail avec son père, écoutait les récits que lui faisait sa mère à la cuisine. Elle jouait avec les canards et les poules de la basse-cour, s’émerveillait de leurs oeufs, ramenait les plus beaux des cailloux ramassés sur le chemin. Elle ne se sentait pas plus fragile que la vie qu’elle caressait le long du jour du bout des doigts.
Tout était aventure. Des aventures qu’elle racontait à une poupée qui ne sortait pas de sa chambre. Le premier venu se serait inquiété, peut-on vivre ainsi ? Il l’aurait dite en sursis, pas elle ni ses tout proches. Elle attendait, je crois, l’être mystérieux qui ferait correspondre en lui ce qu’elle ne savait pas d’elle. Respirer ensemble, traverser et être traversé par les vents, susciter des rencontres sans s’accrocher à rien, vivre sans effraction, de bouts de chandelles. Ecouter les oracles, croiser les fous, les fonctionnaires, les ivrognes, les meurtriers, les militaires et les menteurs.
Je ne l’ai plus revue depuis cette époque où nous étions assis sur les bancs de la petite école. Cheveux blonds qui ondulaient, elle regardait par la fenêtre quelque chose que nous autres ne voyions pas.
Jean Prod’hom
Un collège à défaut d’une maison

En être à n'importe quel prix, peut-être ; c’est si difficile d'être né la veille. Inutile de te demander de renoncer et de venir du côté du pardon ; et recommencer. C'est seul, je crois, qu'on avance, incrédule comme au premier jour ; en espérant encore, les mauvais matins, qu'on pourrait en être.
Collège, racines coulées dans le béton, gaines techniques à défaut de maison. Les têtes sous cloche ne perçoivent pas les voix du dehors, il n'y a pourtant qu'un pas, sortir et entrer librement. Pourvu que ces voix ne nous abandonnent pas. Il en faut de l'innocence pour demeurer du côté des pierres.
Être divisé l’un dans l’autre. Quelqu’un – ou était-ce un autre ? – m'a fait entendre le rire dans le rire. Surtout bien dormir pour l'entendre encore demain.
Jean Prod’hom
Garder le livre ouvert

On manque d’air au réveil, chacun s’affaire pourtant et tout le monde se tait. On pourrait s’y faire. Mais l’un d’eux sort la tête du tunnel. Il demande quelque chose, à défaut d’étincelle de quoi reprendre des forces, n’importe quoi, mais quelque chose à emporter et y retourner. Le retenir, ne pas suivre son plan. Je lui offre une image qui ressemble à celle d’un tombeau ouvert, puis on parle de choses et d’autres. La salle de classe surplombe le cimetière, il fait beau dans les allées et les contre-allées, fleurs ensoleillées au-dessus du silence des morts.
Ne pas baisser les yeux. Aller se perdre ailleurs que dans ses copeaux, du côté de l’étendue, du vide auquel s’abreuve la diversité des choses qui passent d’une jambe sur l’autre, font des signes. La profusion n’est pas un labyrinthe.
Garder le livre ouvert sur la table pour ne pas se perdre. Mais garder les mains libres et lever les yeux sur le bouquet qui s’offre. Et s’égarer.
Jean Prod’hom
Ne pas broncher

Sa mère n'a jamais voulu savoir où il était, lui non plus. Alors elle l'a mis ailleurs et le voilà nulle part. Il lui raconte que tout va bien, elle se paie de mots, propos sucrés et sourires de satisfaction. Le gamin, yeux de fouine, lance des pierres et tire des lignes avec un cheveu sur la langue.
Défaire les empilements, tailler des marches. Ni forceps ni ruse. Aller, aller jusqu'à ce qu'on y soit, tout au bout. Le gamin s'abandonne à son nouvel état, il suffoque, large sourire dans une déferlante qui le fait aller en tous sens, mais en un autre sens cette fois. Le voilà quelque part et personne à qui parler. La moitié du chemin est faite.
Surtout ne pas broncher, ne rien ajouter.
Jean Prod'hom
Pauvre Zénon

On m’a conduit l’autre nuit à la guillotine. Sans raison apparente. Je ne me souviens en effet d’aucune instruction, d’aucun procès et la grâce n’est jamais venue. Me suis débattu, moi l’innocent, jusqu’au pied de l’échafaud.
Mais il a bien fallu à la fin que je m’y fasse, je me suis donc ressaisi, longuement sermonné. J’y suis parvenu à force de patience : je me ferai trancher la tête et j’irai rejoindre en toute connaissance de cause l’autre rive.
Le couperet allait tomber lorsque je me suis réveillé, déçu d’être demeuré si loin encore de ce dont j’avais été, je le croyais, si proche.
Jean Prod’hom
(P. F. 13) Arthur Maret

Qui sont donc ces hommes qui veulent installer le paradis sur terre ? L’adolescent fait ses devoirs en écoutant distraitement la radio, puis tend l’oreille en direction de la voix grave qui sort du poste. C’est un vieil homme qui raconte ses premiers pas, orphelin de père, commissionnaire sitôt sorti de l’école obligatoire, puis vendeur dans une maison de commerce, voilà comment le vieil homme démarre dans la vie. Un monde les sépare, le gamin ignore tout de ces ateliers d’handicapés et de cette société coopérative que son aîné a fondés, de ces maisons familiales de retraite qu’il a ouvertes. Le vieil homme est né dans un village au-dessus du bourg, a oeuvré dans les années 30 comme syndic du chef-lieu, socialiste et chrétien. Kezaco ?
L’adolescent lève soudain la tête, le bronx ça l’intéresse. En novembre 1932, Le vieil homme et ses amis se réunissent au cercle typographique, c’est leur stam, quelqu’un les a avertis de ce qui s’est passé au bout du lac, une tuerie, treize morts, plus de soixante blessés graves. Ce sont de jeunes recrues qui ont tiré sur des syndicalistes manifestant contre des fascistes. Le vieux et ses amis veulent montrer leur soutien aux ouvriers de la ville du bout du lac, ils se rendent en cortège jusqu’à Saint-François, silencieux. L’adolescent connaît bien l’endroit, mais il ne comprend pas le détail de l’affaire : communistes, fascistes, socialistes, syndicalistes, radicaux, qui est avec et contre qui ? De jeunes recrues débouchent tout à coup de la ruelle Saint-François, matraque levée, foncent sur le cortège et tapent comme des sourds. Il ne comprend pas tout, mais c’était visiblement chaud.
Le vieux apprend au jeune que les magasins restaient ouverts le soir, qu’on tolérait des semaines de travail de 65 heures. Les vacances n’étaient pas payées, on estimait que les ouvriers n’avaient qu’à se reposer pendant les périodes de chômage. La ville regorgeait de taudis, de chômeurs et de vieux dans le besoin. Et même que Bellerive n’existait pas, c’est ce vieil homme qui en est à l’origine, à l’origine aussi de Montchoisi.
Le lien est fait, l’adolescent est allé cet été se baigner à Bellerive, avec Anne; ils ont promis de se retrouver cet hiver sur la glace de Montchoisi pour y tracer main dans la main les boucles qu’ils veulent se passer au doigt, ah! les gamins. Puis ce sera la fin de l’école obligatoire : commissionnaire ou vendeur, flexographe ou mégatronicien. Tout recommence.
Jean Prod’hom
Lemmes 12

Peu de différences en somme de l'école aux vacances : On y fait l’Afrique, l’Océanie. Le tourisme, les régimes alimentaires, la lutte des classes. Les transports maritimes et les récits de voyage, la restauration et la digestion, Cuba, les Maldives, la Bretagne et le change. À quand l'amour et le mur ?
Les sacs à dos font de nos élèves des mules dociles. Besoin ni de fouet ni d’oeillères.
Maître et fonctionnaire, la quadrature du cercle.
Jean Prod’hom
Cisco

Qu'un cheval souffrant de conjonctivite bénigne devienne en quelques mois un cheval aveugle ne présageait rien de bon. Il va guérir, avait dit le vétérinaire à la nouvelle propriétaire, il n’en a rien été, les uvéites se sont succédé, il a fallu accepter le verdict. A commencé ce jour-là une aventure qui ne se distingue guère des autres, au moins en apparence, car un cheval aveugle ça ne saute pas aux yeux. Il s'appelle Cisco, j'ai entendu son nom avant de faire sa connaissance, samedi passé, le jour tombait. Gwenaëlle l’a accueilli à Fey il y a 10 ans, obligeant ses hôtes et ceux qui allaient la rejoindre, hommes, femmes, enfants et chevaux à faire de la vie avec lui une autre vie, habitée par une question qu’il leur poserait à toute heure du jour et de la nuit. A moins de s’en séparer.

C'est dans une dépendance de l’écurie que Gwenaëlle en a parlé. Gwenaëlle c’est l’initiatrice de l’école de L’enfant Takhi. Elle et Cisco ont ensemble arpenté les lisières de Fey, ses bois et ses chemins de terre, longé la Menthue et le Talent, dans un coin du pays de Vaud aux noms rugueux : Echallens, Bercher, Vuarrens et Peyres, Possens, Villars-Mendraz, Dommartin, Rueyres, Boulens, des noms de chêne, de châtelains cossus, de baronnies et de foyards. Gwenaëlle a aidé son protégé à faire ses premiers pas dans la cécité, dedans et dehors, avec d’autres chevaux qui voient clair. Lui, il l’a aidée, c’est sûr, à porter son attention sur cet espèce de silence qu’on oublie si souvent lorsqu’on croit comprendre et dans lequel les aveugles se déplacent avec aisance. Elle lui a appris à prévoir ce qu'il ne verrait pas, à ne rien brusquer, à trotter sans mors. Elle lui a enseigné patiemment un lexique sommaire : lever, baisser. Et attention, le mot par lequel on avertit du danger ceux qui sont faits d’une même substance mais qui sont armés d’attributs différents. Quelques mots seulement, mais qui suffisent à passer partout s’ils sont soutenus par une attention continue. Gwenaëlle me dit tout cela en tenant du bout des doigts des rênes invisibles qui me font relever la tête d'étonnement. C'est un cheval de tête, dit-elle, et les autres chevaux le soutiennent.
C'est autour de Cisco que l'écurie à vécu depuis 2004, c'est autour de lui qu'un spectacle se prépare ce soir dans une petite capite en face des écuries, la nuit est tombée. Gwenaëlle aimerait que la fête ait lieu sous chapiteau, qu’il y ait son protégé et les autres, mais aussi la danse, le jonglage, la comédie, la musique, des acrobaties, et un peu de cette histoire imperceptible qui rampe dans nos nuits, le rêve de l’étrange lumière qui éclairent ceux qui ne voient pas. Des projecteurs nous feront voir quelques-uns des fragments de notre nuit.
C’est la cécité qui devrait guider l’aventure, mais aussi la confiance que cet handicap appelle et le coeur qui l’anime. Avec d’autres chevaux, Stella, Valdine ou Calao. Et des enfants qui s’étonnent en souriant de ce miracle.
Lorsque je sors avec Louise et Lili de cette séance d'informations, on ne voit rien. J’entends une voix qui rappelle les chevaux, des silhouettes précédées de leurs noms traversent la nuit, pas de Cisco. Il est dans son box, sous la lumière d’un néon, sa robe se confond avec le crépi, invisible. Il s'approche lorsque je l’appelle, m’aurait-il entendu ? je m’inquiète de cette confiance qu’il me témoigne, je devine qu’il ne voit rien. Il me regarde, tend son museau, ne m’interdit pas de le regarder. Il y a un mystère, me montrerai-je assez digne d’honorer ce qu’il ne voit pas ?
J’ai rencontré tout ce petit monde samedi passé, il y avait Elsa, la fille de Gwenaëlle, qui découvrait de nouveaux amis, donnait son nom à chacune des parties du visage des gens qui lui étaient familiers. Il y avait toute l’équipe qui a décidé de se lancer dans cette aventure. Je me réjouis de les retrouver dans quinze jours. Au Riau, je suis allé jeter un coup d’oeil sur le site de L’Enfant Takhy, j’y ai trouvé sur la page d’accueil un extrait du Zhuang Zi de Tchouang-tseu.
«Les chevaux ont des sabots pour les porter par-delà le gel et la neige, et des poils pour les protéger du vent et du froid. Ils mangent de l’herbe et boivent de l’eau, et galopent en faisant voltiger leur queue. Les manoirs et les grandes demeures les laissent indifférents… Lorsqu’ils sont contents, ils se frottent les naseaux. Lorsqu’ils sont furieux, ils font volte-face et se décochent des ruades. Telle est la nature des chevaux.»
Je ne peux m’empêcher d’évoquer la suite de ce chapitre 9. Tchouang-tseu y raconte comment Pai-lao apprit aux hommes les violences faites aux chevaux – fers, tonte, bride, entrave, parc – qui conduisirent un tiers des bêtes à mourir prématurément. Les hommes affinèrent plus tard les tourments de leurs protégés : dressage, endurcissement, galop par escadrons, ordre et mesure, le mors et la cravache eurent raison de la moitié restante.
Jean Prod’hom
La terre a la couleur de la molasse

La terre a la couleur de la molasse et la dureté du silex. Les labours se soulèvent raides, désordre de cristaux boueux et immobiles. Le ciel est froid, plus haut et bleu qu’en novembre, lambeaux de neige tombée la semaine dernière, flaques sombres, buvards aveugles qui tiennent à distance le ciel, les nuages et les feux du soleil. On ne joue plus.
J’aperçois Alfred, Daniel et Jean-Paul près de chez eux, ils sont de retour ou sur le départ, un rendez-vous ou une tâche urgente. Tout le monde passe en coup de vent, la campagne n’a ni tache ni répondant.
Cinq jours pourtant que le soleil s’est installé au-dessus des habitants du Riau, alors que le brouillard rampe sur le lac. Mais il y a quelque chose d’inentamable qui nous empêche d’aller au-delà de ce qui apparaît. La terre s’est encroûtée, la sève s’est dérobée. Il n’y a que les haies qui gardent autour d’elles un peu de vie, une variété et une souplesse que les branches nues des frênes et des hêtres n’ont pas à cette saison, et je comprends mieux le plaisir dont parle Trassard à couper les herbes et les ronces à leur pied. Monte de la Broye, qui cherche son chemin dans un épais brouillard, le grondement sourd des voitures qui vont à Berne ou à Lausanne.
En-bas un coeur noir et blanc secoue les parois d’un interminable tunnel. Ici en-haut les fontaines sont généreuses, mais elles auront besoin pourtant de la journée pour se débarrasser des morceaux de glace qui collent à leur nez. Je cherche la prise d’eau du canal de la mécanique, on pénètre facilement les bois qui longent la rivière mais je n’aperçois aucun signe d’anciens travaux. De la fumée sort de la cheminée du Château, mais tous les volets sont clos. Les branches du tilleul font un bruit d’os, le potager a l’allure d’un cimetière abandonné. Ici et là traînent de vieilles machines agricoles, qu’on devait venir chercher le lendemain, mais qui passeront un hiver encore à attendre dans leur rouille. A l’ombre cliquètent des guirlandes de verre cassé. On s’étonne plus loin de la vivacité du gui dans les pommiers d’un ancien verger, il a fait d’immenses bouquets dans lesquels nichent des perles vivantes gorgées de soleil. C’est sûr, la terre grise de molasse prendra ce soir les teintes de la pierre d’Hauterive.
Jean Prod’hom
Il y a les dissidences

Il y a les dissidences
les faillites
le club Med
il y a l’insaisissable
les ordures
les bousculades
les facilités
la fausse monnaie
il y a les circonstances de sa naissance
Jean Prod’hom
(P. F. 12) Jeanne Hersch
 Jeanne
JeanneLa femme est grande, l’homme petit, sans enfant et causeurs devant l’Eternel ; ils réconcilient, elle juive lui chrétien, les innocents du bout du monde dans leur asile de fortune. Ce sont de sales années.
Ils ont accueilli il y a quelques semaine une petite orpheline venue de l’autre côté de la frontière. Elle écoute leurs voix depuis la chambre du fond du couloir. Elle tend l’oreille et comprend toujours mieux qu’il y a dans leurs paroles, leurs rires leurs silences dont elle se sent exclue, dans ce qu’elle ne comprend pas quelque chose à comprendre mais qu’elle a perdu.
Elle les rejoint dans le salon où ils lisent. Il s’aiment, pas de feu dans la cheminée, ce n’est pas la saison. Elle s’approche prudemment, demeure debout quelques instants avant de s’accroupir, elle fait un petit tas de brindilles dans le foyer, ajoutent quelques pives qui traînent dans un panier. L’homme qui l’a vue lui donne deux pages d’un journal qu’il a froissées et lui tend une boîte. Elle frotte la première allumette qui se brise, la seconde ne suffira pas. La femme regarde la fillette avec sollicitude, le feu prend. Mais il n’y a pas de gros bois sous la main, le feu tousse et s’éteint, la boîte d’allumettes est vide, elle court au jardin, le ciel est gris, elle n’a plus rien.
Comment raisonnablement continuer quand tout s’est arrêté, trouver une place, retrouver un peu de la liberté dérobée, et vivre avec. Elle ne sait plus où aller, n’a plus accès à ce qui dépasse nos vies, reste en-deçà d’elle-même.
L’orpheline aurait voulu participer à la fête, mais elle n’a plus à sa disposition qu’un peu de solennité et l’usage de la raison. Elle sent confusément qu’elle a laissé quelques chose qui n’a pas même la forme d’un vieux souvenir, ni sa force, restée en arrière de son âme. Son corps peut-être.
Jean Prod’hom
Dépaysé chez soi

Dans Première neige, Maupassant raconte le destin d’une femme mariée à un gentilhomme normand, solide et rustique, né pour se contenter de ce qu’il est, sera et fera là où il est né et mourra, ne voyant en celle qu’il a épousée que l’une des pièces de son bonheur sédentaire.
Cette nouvelle de 1883 fait la part belle à la jeune dame et met sur le compte de la surdité du bonhomme son ennui et le sombre avenir qui lui est promis.
Incapable d’enfanter, que lui reste-t-il ? Ni espoir ni espérance tandis qu’un feu bien nourri suffit à celui qui fait chambre à part. « Qu'est-ce qu'il te faut pour te distraire ? Des théâtres, des soirées, des dîners en ville ? Tu savais pourtant bien en venant ici que tu ne devais pas t'attendre à des distractions de cette nature ! »
Sourd à ses incessantes demandes il faudra la maladie pour qu’il consente à l’envoyer dans le Midi. Elle y revit alors, regarde le vaste ciel bleu, si bleu, voit et revoit assise sur un banc qu’elle ne quitte plus le massif de l’Esterel, les fidèles îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, les villas dormantes. Sédentaire et heureuse dans un monde immobile, comme son gentilhomme de mari là-bas dans son château normand. Sous le même ciel.
J’entends l’avertissement. Est-on condamné à rêver aux terres lointaines qu’on ne rejoindra que lorsqu’on en aura fini. Ou se satisfaire de la terre qui nous a vu naître. Mais est-il bien raisonnable de croire qu’on peut faire du proche un lointain et du lointain un tout proche. Voir ensemble dans l’étrangeté d’où l’on vient l’étrangeté où l’on va. En s’y retrouvant. Dépaysé chez soi.
Jean Prod’hom
On n’en sort pas

On n’en sort pas, le réel est hors d’atteinte, inutile de vouloir trop s’en approcher. Ni espérer pouvoir s’en extraire. Être bien accompagné et accompagner, c’est ce qu’on peut faire de mieux.
Lorsqu’il fait soleil et que la neige demeure sur les flancs de Brenleire et Folliéran, je fais halte dans la véranda où trois chaises entourent une table ronde, y suis à cette occasion pas loin de moi-même. Ce compagnonnage dure une petite heure et c’est bon. On se réconcilie, on parle un peu, en ne bougeant les lèvres qu’à peine, tandis qu’une guêpe ou un bourdon s’acharne contre la vitre. Celui qui est en moi lâche un peu de sa surveillance, je veille de mon côté à ne pas m’enflammer à son insu, on se modère. Il me tance une dernière fois, pour rire, avant de laisser la bride sur mon cou. On s’abandonne les mains croisées, le dedans et le dehors se serrent la main.
Aucune ombre, les écharpes d’inquiétude qui s’accrochaient à mes talons traînent sur le carrelage de la cuisine et l’hiver qui s’est levé cette nuit fait son oeuvre sur les sommets enneigés. Me voici coupé du dedans et à l’abri du dehors, désorienté, sans rien à faire d’autre que tendre l’oreille et fermer les yeux, comme les paysans d’hier qui prenaient un peu de bon temps sous le couvert de la mécanique à l’arrivée des mauvais jours : les champs étaient labourés, les pommes de terre rentrées, la bise pas encore levée.
Les lauriers sont à l’abri, des feuilles multicolores jonchent la plate-bande, l’orange des roses jauni d’or. Le soleil entre à l'horizontale, pas de travail en vue, il y a bien assez à faire tous les deux réunis. Faire se rapprocher nos deux voix de soi-même jusqu’à ce qu’elles ne s’étonnent plus l’une de l’autre, se confondent. Silence. Il n’y a en réalité pas grand chose, un phrasé ponctué de simples, je devine une danse immobile et transparente. Pas surpris de ma présence. Si nous ne nous perdons pas de temps en temps l’un dans l’autre, nous sommes perdus.
Derrière les vitres piquées par le mauvais temps, les événements qui se succédaient au pas de charge s’enlisent. On reste tous les deux en arrière avec un panier de pommes cueillies tout à l’heure, une tèche de bois, une jardinière. Il y a vraiment de belles prisons. Le silence descend l’échelle et nous soulève, le peu que je suis encore se défait et devient toujours moins, jusqu’à disparaître, vide et sans horloge. Ne pas bouger, le moindre geste détruirait tout.
Peut-on dire autre chose que ce qu'on sait obscurément. Écrire dépasse de beaucoup ce qu'on est, sans qu'on soit capable jamais de mettre la main dessus. Mais il nous tire, rend meilleur, purifie ce qui reste en retrait, nous aide à trouver l’invisible axe de notre être au monde.
De là où tu es, vois-tu ce dont je te parle, de ce détour à l'occasion duquel on se perd au plus lointain de ce qui est, de cet asile que je caresse parfois du bout des doigts, à deux pas d’une mélancolie qu’il me faut bien concéder au moment de quitter les lieux. Mais rejoindre le train du monde ne constitue plus une défaite.
Nous vivons dans une boîte transparente où rien n’entre ni ne sort, mais où chaque chose fleurit, lentement, chacune pour soi au midi des autres. On n’en sort pas et j’y retournerai.
Jean Prod’hom

Publié le 1 novembre 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez Virginie Gautier (Carnet des Départs)
Adolescere

Une amie dont je réprouve la propension à excuser les oublis de son fils et à exaucer tous ses désirs, à qui je fais comprendre qu’il aura vraisemblablement à payer à la fin la facture de son laxisme, me répond sans se démonter que c’est précisément pour ces raisons qu’elle sera toujours là pour lui.
Arthur s’enfonce toujours davantage dans le fauteuil près du poêle.
- Je crois bien que je vais monter une startup.
Le temps passe.
- Faudrait d’abord que je trouve un copain.
Plus tard, dans le même fauteuil.
- Possible finalement que la bible ne soit qu’un roman pris un peu trop au sérieux.
Long soupir.
- Comme tant d’autres choses.
Jean Prod’hom
111

Tu crois pouvoir t’envoler, et finalement tu retombes sur terre sans savoir nager.
On espère toute sa vie que les mots mis en file indienne mènent quelque part. En vain.
Rechercher l’élargissement de la conscience ou sa suppression, c’est en définitive la même chose. Surtout à la fin.
Jean Prod’hom
(P. F. 11) Roland Béguelin

Un mètre trente à peine, chétif et pâle, genoux cagneux et boutons sur le front. Un cérébral morveux, premier de classe, sans fronde, la langue lisse, un peu moqueur, admiré par les vieilles dames qu’il sait complimenter. Pas susceptible pour un sou mais habité par un incompressible orgueil qui le condamne à piquer une colère de temps en temps.
Le gamin veut être au premier rang, déteste la violence mais allume les mèches; s’il peut concevoir le coup fourré, il ne l’imagine que loin de sa vue. Il cache sa faiblesse congénitale derrière une cascade de civilités et des jeux de mots. Dernier descendant d’une famille de la grande bourgeoisie locale sans fortune, le gamin est condamné à faire avec et pour des gens qui ne lui ressemblent pas.
Il polit seul dans sa chambre les mots qui doivent simultanément tenir en respect les garçons et séduire les filles. Ils ont beau ne pas l’aimer, le détester même, ils le craignent et ne peuvent s’empêcher de lui adresser des sourires auxquels ils se trouvent assujettis, jusqu’à se méprendre sur leurs propres sentiments, prêts à se glisser dans la peau de ceux qu’ils ne sont pas. Ce gamin est un serpent, il rassemble autour de lui tout son petit monde, lui le camarade providentiel en toutes circonstances, celles nées de la nécessité et du hasard.
S’il est doté d’une faible puissance de calcul, il jouit d’une belle capacité à digérer les encyclopédies et les manuels scolaires. Il médite le soir sur les deux cartes de son livre d’histoire représentant les empires coloniaux au lendemain du Traité de Vienne et à la veille de la Grande Guerre. On devine chez ce garçon la présence d’un petit caporal qui ne s’épanouira que dans une grande cause. Mais il hésite: rameuter ses troupes pour une guerre de conquête ou se glisser dans la peau du héros d’une guerre d’indépendance. Il travaille chaque soir à surmonter cette contradiction. Sans humour. Quoiqu’il en soit c’est décidé, il changera le cours de l’histoire, au moins celle de son village, de sa région peut-être. Le stratège en herbe rédige ce soir son premier article pour le journal local.
Jean Prod’hom
Il y a le passif transitoire

Il y a le passif transitoire
la natation synchronisée
les joints de culasse
il y a la dignité de l’homme
les oeufs
les barbelés
il y a les murs porteurs
l’adaptation au milieu
les saucisses de veau
Jean Prod’hom
110

Je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur mais par nécessité.
Si je n’ai rien écrit plus tôt c’est parce que je n’avais rien à dire. C’est pour cette même raison que je me suis mis à écrire chaque jour.
Essaie sans y parvenir de concevoir le lien qui m’unirait, si j’avais un frère, au beau-frère de ma belle-soeur. Me perds lorsque je m’y attelle dans un immense territoire de terre sèche, à égale distance de ceux que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve et des miens que je crois bien connaître, un territoire qui a la consistance des limbes.
Jean Prod’hom
Credo

Je crois, je crois aux vertus de l’agnosticisme qui maintient au coeur de l’homme d’aujourd’hui la foi étonnée et naïve des idiots, qui projette en tout temps la possibilité même d'un au-delà à la laïcité – dernier avatar du monothéisme. Qui ne tranche pas mais suspend, maintenant sous ses feux hésitants un avenir dont il ignore tout. Qui ne succombe pas aux tentations de l’oubli et considère avec bienveillance les idoles de nos cultes familiaux. Je crois aux vertus de l’agnosticisme, ce coeur spirituel du courage, le courage des hommes, des plantes et des bêtes qui regardent sans bien comprendre se lever et tomber, goutte à goutte, le jour et la rosée.
Jean Prod’hom
(P. F. 10) Bertram Schoch
 Bertram
BertramDes poupées de tous les pays au garde-à-vous sur les rayons d’une étagère, un morbier, des pièces de domino égarées dans les méandres d’un tapis d’orient, une carte du monde piquée d’épingles au-dessus d’une table encombrée, ne le cherchez pas, l’adolescent n’est pas dans sa chambre.
Penchez-vous par la fenêtre, vous l’apercevrez dans le jardin, assis contre un tilleul dans l’herbe et les pissenlits, perdu dans un labyrinthe de pensées sans queue ni tête. Vous le verrez branler du chef avec la régularité d’un balancier, l’adolescent souffre. Une dépression s’est levée sur le golfe de Gascogne, les circonstances le talonnent, ne le lâchent pas, ne lui laissent rien, pas même une envie ou un souvenir. Les allées et venues de la vermine dans la pelouse l’effraient, le vent siffle, le chant des oiseaux dans le cerisier l’exaspère. Le monde entier pèse contre sa poitrine, l’écrase, l’épuise.
Comment arrêter cette vague qu’une drogue sournoise a soulevée, comment parviendra-t-il à renverser les signes sans perdre l’équilibre? La chose se présente d’elle-même lorsqu’il soupire, tout près des aigrettes d’un pissenlit, les akènes portent des fruits que le vent propulse au-delà de ce qu’il peut voir, plus loin encore, en direction de l’océan. L’adolescent revit, il se sent soudain le centre des forces du monde. Il n’y avait qu’à prendre les choses par l’autre bout, le voici d’un coup à la source de ce qui est. Il suffisait d’un seul soupir, d’un geste pour infléchir l’orientation des choses. L’adolescent sent alors que le manque qui le détruisait se comble, et que ce manque ne suffit plus à contenir ce dont le monde est gros et qu’il tient dans la main.
C’est lui qui est à l’origine de la dépression sur le golfe de Gascogne, qui sera demain à l’origine de la haute pression sur les Açores, les chicanes au centre ville et les bastons au centre sportif, c’est lui. La puissance du gamin grandit.
Il laisse le tilleul, titube avant de rejoindre son bureau, écarte le désordre et note dans un cahier tous les événements qui lui parviennent, les décrit, imagine avec précision les effets qu’ils ont sur les habitants de sa ville et les gens du quartier. L’histoire qui l’a conduit là se déploie ailleurs, dans toutes les directions et atteint d’un coup les moindres recoins du monde. Il note le passé et le futur, leurs liens, découvre leur nécessité. Tant qu’à faire il va plus loin, il guérira les hommes, distribuera des médailles et des récompenses, redistribuera les richesses. Il s’attaquera aux brigands, jettera des sorts, dénoncera les hérésies, il imposera la vérité, rendra impossible les malversations, mènera une croisade dont personne ne saura rien. A moins qu’un jour quelqu’un ne découvre ses cahiers et les lise : la vague que la drogue sournoise a soulevée l’a dévasté.
Jean Prod’hom
109

Drogues, hépatite, délires, prostitution : je lis depuis quelques jours le récit d’une adolescente qui raconte son inexorable et lente descente aux enfers. Commence la mienne en m’avisant que je n’en ai lu que la moitié.
Il se débarrassait de ses vertiges en leur ménageant une petite place dans des poignée de mots dont se saisissaient ceux qui en manquaient.
Vivre avec son temps, j'en suis ; le bref, c’est fait.
Jean Prod’hom
Lettre à l'éditeur

Reçois ce jeudi 28 la lettre d’un éditeur, la seconde en peu de temps. Une gentille lettre dans laquelle il me dit qu’il découvre aujourd’hui sur la toile ce que j’écris. Un peu par hasard, précise-t-il ; il me confie ensuite que ça l’épate et lui plaît. Une phrase tout particulièrement me ravit, ce que j’écris le rend joyeux, voilà des mots qui font du bien, on en voudrait plus souvent des comme ça, ils nous invitent à donner davantage, à lui et aux autres. Cet homme que je ne connais pas me dit aussi son amour pour Henri Calet, on devrait faire un groupe, décidément Henri Calet nous manque. Il me dit aussi ses affinités avec les pierres.
Je suis allé voir sa maison, une petite maison en apparence, qui réalise de petits livres pas si petits que ça, une maison qui dure et fait peu de bruit. Un travail soigneux et un catalogue qui fait rêver. Il me demande si je ne désire pas publier un livre, qu’il serait heureux de me rencontrer. Moi aussi. Mais je crains de le décevoir et je prends peur. Car ce que j’ai, je le porte, je n’ai rien d’autre, ne cache pas sous une pile de documents un manuscrit qui attend. Ce site est tout ce que j’ai et je dois bien m’en satisfaire, c’est le fragile de mes jours, en contrepoint de la vie que je mène, à la mine au Mont et au Riau. Avec des élèves, Sandra, mes enfants, deux chats et un chien. Je ne peux pas plus.
Un livre oui, mais un autre livre. Et comment ?
Jean Prod’hom
108

Tandis que le milan fait un pas de deux avec son ombre, l’homme écrase la sienne à chaque pas.
C’est la saison où les merles faisaient autant de bruit que les hommes, mais seuls les premiers s’envolaient.
Me prends parfois à penser comme une mule qui aurait perdu ses oeillères.
Jean Prod’hom
107

Quoi qu’on en dise, chacun est bien obligé d’avoir réponse à tout.
Faire entendre, à qui veut l’entendre, ce qu’on ignore.
Dépaysé chez soi.
Jean Prod’hom
106

- Est-ce vrai ? Oui ? On s'était pourtant bien habitués.
Je peine à en appeler à l’arbitraire.
Plus on commence tôt plus ça dure, évidemment.
Jean Prod’hom
(P. F. 9) Marie Métrailler
 Marie
Marie- Que l’éternité s’offre à nous, toute nue, à nous qui sommes limités dans le temps, de part en part, c’est un cadeau n’est-ce pas ?
Elle n’a pas dit les choses ainsi, mais peu importe, ses copines ne l’ont pas écoutée, une fois encore, et l’ont renvoyée à sa solitude. Alors la petite raisonneuse s’est tournée vers la pile de livres dans lesquels elle cherche une idée de Dieu, simple, universelle et aimable qui la libérerait d’une crainte qui ne la quitte pas.
Elle tombe sur un recueil de récits, de ceux qu’on racontait à la veillée dans les Alpes au siècle dernier, au printemps et en automne, tandis que sous le lumignon les femmes filaient la laine blanche et les hommes taillaient des figurines de bois, longs récits mélancoliques interrompus par la visite des morts endimanchés, procession d’hommes et de femmes en blouse et capuche blanches, réclamant qu’on prie pour eux pour les délivrer et écourter leurs peines.
La gamine interrompt sa lecture, croise ses mains qu’elle dépose à l’angle de la table. Inutile que nos morts défendent notre cause, notre pays est assez solide, il suffit de s’ouvrir aux forces cachées, à ce que personne ne veut voir, il suffit de labourer nos croyances, fluidifier nos idées fixes. Elle regarde le soleil se coucher sur les montagnes de la vallée, une vallée en déshérence. Laisser entrer le sel, le fer et le riz, et laisser filer notre eau. Donnant donnant. Ne pas gaspiller nos forces pour rien, ce qu’on fait a de la valeur.
Elle a un bouclier devant les yeux, derrière lequel bout sa résistance et que ne parvient plus à franchir la haine de ceux qui veulent la faire taire en la soumettant à leurs arriérés. Un masque de résistance fermé à toute propagande, jamais un rire, ni un sourire. Résister et y parvenir pour passer outre et aller au-delà.
Jean Prod’hom
Un nouveau monde

Le mousse se plaint des règles que l’on applique dans la maison : pas d’écran avant la fin du petit déjeuner, plus d’écran après 18 heures 30, tandis que des jurisprudences savamment négociées ponctuent l’entre deux. Mais cette fois c’en est trop, Arthur fomente une révolte. Pensez donc, c’est l’heure de lever le pied et il est en train de réorganiser son village. Son village ? Un village sur Clash of clans, un jeu de stratégie. Le but est de construire autour d’un tilleul une église, une épicerie, un cimetière, des latrines. C’est aussi attaquer les ressources des autres villages, créer un clan et beaucoup, beaucoup d’autres choses. Arthur me montre un dessin, c’est le plan de son niveau hameau, le temps presse, son truc est super, il est est à deux doigts de la catastrophe. Je le crois.
- Je n’ai pas assez de remparts et de fortifications pour le protéger efficacement. On ne pourrait pas faire une exception ?
Il est 18 heures 30, l’exode rural n’est décidément plus qu’un souvenir.
Je suis né à la Source, le matin ou le soir, plus personne ne le sait, ceux qui le savent sont morts. C’était au mois d’août, le 6 de l’année 1955, je n’en sais pas plus, c’est amplement suffisant.
Nous recevons ce soir un faire-part qui nous réjouit, une petite cousine est née. Le père et la mère précisent l’heure et la minute, 8 heures 07, je fronce, comme s’ils savaient ce que naître veut dire. C’est tout un monde qui disparaît soudain, le travail de l’horloger, l’imprécision les roues dentées. Et je ne dispose d’aucun moyen pour me consoler et m’opposer à ce pathétique.
Je n’aime pas ça, la naissance confine à un punctum.
Je regrette chaque jour davantage la disparition des baptêmes, des confirmations, des communions, des doubles naissances, des fondations et des refondations.
Jean Prod’hom
Néocolors

Sonnerie encombrée, puis silence qui se prolonge dans les tempes, bruits de pas lointains. La maman de Michel ouvre la porte et me souhaite la bienvenue, voix douce, elle semble parler une autre langue et habiter un monde à l’autre bout du couloir qu’elle ira rejoindre lorsqu’elle m’aura accompagné jusqu’au salon. De la musique sort d’un bahut encastré dans une grande bibliothèque, du piano peut-être, le battant est ouvert et on aperçoit le disque noir qui lance quelques éclairs ; discipliné, le bras se soulève, il fait sombre.
Michel me regarde à peine, il dessine. Partout sur la table des néocolors qui roulent et butent contre des obstacles indifférents, petits morceaux en désordre.
Michel m’a invité à dessiner, son père est là, la pipe à la bouche. Il regarde ravi l’engagement de son fils qui remplit de grandes feuilles, à grands traits, à raz-bord. Il piaffe, bouche avide, lèvres épaisses, je le regarde de biais. Je ne comprends rien, le père a disparu dans l’ombre. Michel emporte tout sur son passage, sans s’arrêter, sans lever les yeux. Ce devait être un samedi, nos deux mondes se cotoyaient mais ne se touchaient pas.
Jean Prod’hom
Je me souviens d’avoir dormi dans les soutes

Je me souviens d’avoir dormi cette nuit-là dans les soutes d’un sommeil poisseux et m’être dit au réveil que je ne ressemblais pas à celui que j’avais laissé dans le ventre de la nuit. Je me souviens m’être levé avec passablement d’entrain, d’avoir suivi les traces que j’avais laissées la veille et avoir mis de l’ordre dans la cuisine. Je me souviens que c’était samedi, que Lili avait organisé au cours de la matinée un parcours de trial pour sa sœur et qu’Arthur s’était rabattu sur la trottinette. Je me souviens du jardin dans lequel pour la première fois de l’année nous avions pris le petit-déjeuner, je me souviens que nous avions, Sandra et moi, remis quelques points sur les i, avec toujours la même double intention, celle d’éviter à nos enfants de nous avoir toujours sur le dos et de nous assurer qu’ils voleront bel et bien un jour de leurs propres ailes. Je me souviens qu’Arthur est allé vendre des billets de tombola au village et que les deux filles ont imaginé les pas de danse que Louise exécuterait à l’occasion du prochain spectacle scolaire. Je me souviens d’un film sur la bataille d'Italie, du débarquement des alliés à Salerne en septembre 43 et de leur entrée dans Naples, de la foule en liesse.

J’ai quitté le Riau, suis descendu à pied jusqu’aux Censières par l'étang. Le fœhn avait faibli et l’air était doux, le tapis d’épines chauffées depuis la mi-journée donnait un avant-goût de l'été. Je me souviens des anémones, des myosotis près du nouveau réservoir, des merisiers en fleurs. Je m’étais dit qu’il ne fallait jamais oublier que le Riau est à près de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, que le printemps avance comme la marée et que notre regard est toujours dépassé par les nouveautés. Je me souviens des quelques gouttes de pluies qui m’avaient fait cesser de ratiociner et hâter le pas. Je me souviens que le passage subit d’un chevreuil ne m’avait pas surpris, mais le fait qu’il soit seul en ces lieux et à cette heure m’avait paru étrange. Les gouttes de pluie avaient redoublé, lourdes et gaies, sans qu’elle parviennent à transpercer mes habits. Je me souviens avoir modifié mon programme et demandé à Sandra, au téléphone, qu'elle me prenne lorsqu'elle descendrait au Petit Théâtre avec les enfants. Je me souviens m’être arrêté plus tard devant le portail peint de la cathédrale, j’y ai paressé assis sur une marche de molasse, séduit par l’élégance des apôtres et les scènes de la Dormition. Je me souviens de la chapelle réservée aux pèlerins de Saint-Jacques, ils étaient deux ce jour-là, l’un se reposait le front appuyé contre un banc, l'autre avait remis de l'ordre dans son sac à dos avant de réajuster ses bâtons.
Il y avait du soleil sur l'esplanade, la Savoie était toute proche, je me souviens du verbe « ratiociner » auquel j’avais songé peu auparavant, d’une tache d’argent sur le lac, à l’avant de Saint-Sulpice. Je me souviens m’être dit que la ville était un peu morte et que les vies ici étaient comme suspendues à quelque chose qui ne passe pas ou passe à peine. Je me souviens des cloches qui s’étaient mises à sonner à 18 heures et qui m’ont ramené de très loin une autre manière de considérer le temps, celle qui fut mienne alors que je n’en savais rien et qui me file entre les doigts lorsque je la crois captive.
Jean Prod’hom
(P. F. 8) Jenny Humbert-Droz

Elle avait espéré qu’elle n’éprouverait plus jamais cette impression de fin du monde, de tristesse et de déception, mais de dignité aussi qui planait en fin de journée lorsque les Italiens rejoignaient le dortoir que leur employeur mettait à leur disposition. Ils étaient des milliers dans la construction et l'hôtellerie, dans l'agriculture, pendant neuf mois loin de leur épouse et de leurs enfants.
Il y avait un gros chantier à côté de chez elle, on y travaillait à la construction de la route nationale. Elle se souvient de ces petits groupes d’hommes silencieux qu’elle croisait lorsqu’elle rentrait en fin d’après-midi de chez sa grand-mère, avec leur vieux sac de sport en bandoulière et un peu de boue sèche sur le visage. L’adolescente n’imaginait pas la suite, la fatigue, la promiscuité dans les cabanons, l’amitié aussi.
Elle se souvient surtout de l'un d'eux qui lui racontait alors que le soir tombait, dans un sabir rocailleux, à deux pas des baraquements qui jouxtaient la cure, un peu des choses de son pays : le soleil d'où il venait, l'ombre, les trois enfants qu'il avait laissés à Castel del Piano, les châtaigniers, les champignons, les serpents, le lac de Trasimène qu’on apercevait du sommet du Monte Amiata.
La petite avait une douzaine d'années, il ne lui disait rien de son exil, mais tout en lui en parlait pourtant, Se mêlait en effet à l’immense douceur de ses récits un désarroi qu'elle comprenait mal et sur lequel personne ne s’interrogeait, pas même son père, pasteur, lorsqu’elle lui parlait de Gino. Pourquoi n'était-il pas là-bas en Italie avec les siens, ou eux avec lui ? Pourquoi ces baraquement et cette solitude. Pourquoi ce silence et cette gentillesse ?
Elle s’était mise à comprendre, sans disposer des mots, l'iniquité de la situation, à deviner l'indignité de leurs hôtes, le silence sur lequel reposait cette conspiration et la prospérité des employeurs. Quelque chose se défaisait du côté des siens, elle percevait cette fausse note qui obligeait chacun à boucher ses oreilles, mais elle engrangeait aussi la bonté généreuse de ces hommes et le soleil qui soutiendrait demain ses luttes.
Et cette grâce des gens qui taisent leur souffrance et sourient au passant lui revient à fleur de peau lorsqu'elle croise dans la campagne l'un ou l'autre des employés agricoles du village qu’elle habite aujourd’hui, venus de Macédoine ou du Montenegro, plus solitaires encore aujourd’hui que jadis, enfermés dans leur langue et leurs souvenirs, 12 mois durant, sans même disposer de ces 3 mois qui obligeaient autrefois ceux qu’on appelait les hirondelles à retrouver un peu du soleil qu’ils avaient laissé derrière eux.
Jean Prod’hom
Profils

Lili s’inquiète des dangers que son frère court en tournant dans l’huile bouillante les donuts dont il est aujourd’hui devenu le spécialiste.
- On devrait en inventer qui n’ont qu’un seul côté.
Arthur, un portable dans une main et un DVD dans l’autre, se saisit tant bien que mal d’un yoghourt à la framboise. En repoussant du genou la porte du frigidaire, il heurte du coude le plan de travail. Il gémit en se jetant dans le fauteuil près du poêle.
- On se fait trop mal dans la vraie vie.
Louise est ravie de la jolité du monde, mais déplore la salité de ma voiture.
Jean Prod’hom
Funérailles de Joffre

Gustave Roud s’est trompé, la transmission intégrale des spectacles, visuelle aussi bien que sonore, n’a pas rendu la description parlée superflue. Léon Zitrone et Stéphane Bern n’ont pas cessé de nous le rappeler. Mais Gustave Roud a vu juste en écrivant le petit texte qui suit et qui montre que rien ne vaut l’écriture pour dire l’événement qu’a constitué pour nos régions reculées l’arrivée de la radio, qui a mis Paris à portée de nos pas. Qu’ici aussi, dans le Jorat, on s’est tu lorsque le cercueil du maréchal Joffre a passé sur sa prolonge et que le cortège, chose impensable, a traversé nos chambres basses. (JP)
« Un seul déclic et la chambre basse tout à coup résonne de la rumeur d’une foule immense, mais de cette rumeur très particulière de l’attente, faite du contrepoint de mille phrases interrompues et reprises indéfiniment sans qu’un silence total ou des tumultes subits en rompent la monotonie. Puis une voix toute proche se dessine sur la confusion de l’universel murmure ; elle décrit, détaille, commente le spectacle dont seul l’écho aveugle nous parvient et qui est celui des funérailles de Joffre.
Cette formule de « reportage » (comme l’on dit) par T.S.F., où la voix d’un commentateur se conjugue au déroulement sonore d’un événement pour lui assurer un rendu instantané aussi parfait que possible, n’est pas nouvelle, et l’on peut prévoir le temps où une transmission intégrale du spectacle, visuelle aussi bien que sonore, rendra superflue toute description parlée. Telle qu’elle se présente maintenant, avec sa superposition du direct et de l’indirect, semblable retransmission, il faut bien le dire, est déjà quelque chose d’hallucinant. Cette brutale mise en communication, cet espace qui se substitue d’un seul coup à votre espace, cette petite chambre campagnarde qui contient Paris, ce temps qui annule votre temps – car là-bas c’est midi et ici treize heures, et les deux chiffres contradictoires s’énumèrent ensemble – tout aiguise l’imagination et la rêverie. On oublie sans peine tout le mécanisme qui sert de support et de guide à cette chose en train de se produire, là-bas vivante, vivante ici. D’ici, dit la voix, je commence à distinguer le cortège du côté du pont Alexandre III. Le ciel s’éclaire (on le voit s’éclairer). Voici le lord-maire de Londres, ou du moins il me semble le reconnaître tel que je l’ai vu récemment lors de mon séjour dans la grande capitale avec son manteau rouge. M. Chiappe, préfet de police ; il se mouche. Les tribunes se garnissent. Voici le prince de Brabant. Je commence à entendre les fanfares (et presque tout de suite, en effet, de la houle sonore émergent quelques cris de clairons). O cortège ami, que tu es lent à te rapprocher ! Etc., etc… Le rôle du coryphée (dont nous nous amusons à transcrire ici quelques phrases, parce qu’elles indiquent bien sa tâche, qui est, par une suite de détails familiers qui se juxtaposent, de suggérer un tout sans cesse modifié) va diminuant d’importance à mesure que se rapproche le cortège funèbre, et le vent glacé qui se lève (nous dit-il, – on sent aussitôt sa morsure sur son propre visage) paralyse peu à peu sa parole. Et le fantôme de cortège traverse lentement la chambre, le pas des chevaux sur la chaussée couverte de sable, les cuivres qui éclatent et s’éteignent, les tambours anglais comme un gong intermittent, l’infanterie en marche, cette espèce de halètement rythmique des pas scandés, l’artillerie, et le cercueil enfin sur sa prolonge tirée par six chevaux noirs. Une atmosphère est recréée dans sa totalité ; faite de tristesse, de grandeur et de gloire, – avec mille diversions familières, comme cet assaut de photographes trop audacieux auxquels une lointain voix irritée crie : Non, non non, non ! Et déjà, d’une voix liquide, Barthou commence : Monsieur le Président de la République…
Il nous plaît de souligner l’instant où une invention devient assez parfaite pour faire oublier les moyens dont elle se sert et ne nous laisser songer qu’à ses réussites. Ce « reportage » de toute évidence en est une. »
Gustave Roud, « Funérailles de Joffre »
in Ecrits à Carrouge, Fata Morgana, 2011
Publié dans Aujourd’hui le 15 janvier 1931
(Les obsèques du maréchal Joseph Joffre ont eu lieu le 7 janvier 1931)
Je me souviens d’avoir marché sur l'asphalte

Je me souviens d’avoir marché sur l'asphalte plus de deux heures, entre le village et le Riau, et d’avoir souffert des lombaires le lendemain matin, tandis que je terminais le Dictionnaire amoureux de Schifano sur Naples et que je lisais les premières pages du beau livre que Fernandez lui a consacré. Je me souviens du sentiment qui m’a saisi lorsque j’ai pris conscience qu’ils parlaient au fond de la même ville, d’une ville restée au bord de l'histoire, un sentiment qui ne m’a pas quitté et que je suis allé vérifier à deux reprises sur place.

Je me souviens du fœhn qui a soufflé tout au long de cette journée de fin avril et de la tempête qui a conduit les responsables à interrompre la grande patrouille des glaciers, je me souviens de m’être endormi au milieu de l’après-midi à deux pas d'un cauchemar qui ne payait pas de mine, d’avoir pu m’en extraire mais d’être demeuré une bonne heure dans la glu. Je me souviens d’avoir préparé une mayonnaise pour le soir, puisque c’était l'anniversaire de Sandra et que les petits avaient demandé de pouvoir manger une fondue chinoise. Je me souviens qu’on a joué en famille à un jeu de stratégie et que les filles se sont couchées après 23 heures, je me souviens de ce vendredi-jà. Je me souviens que Louise avait réintégré son ancienne chambre après qu’on eut attrapé la souris qu’Edelweiss avait ramenée et qui avait provoqué un sacré remue-ménage. Je me souviens que Lili avait décidé de dormir porte fermée parce qu’elle avait la certitude qu’il n’y avait plu aucune souris à l’intérieur mais que Louise trouvait qu'il était plus important de dormir porte ouverte, avec le risque qu’une souris passe la nuit dans sa chambre, sous son lit ou ailleurs, peu importe puisqu’une souris n’a jamais fait de mal. Je me souviens qu’Arthur avait considéré cette discussion avec un certain recul. Je me souviens d’une phrase – Quand il pleut, ce bruit de clavier sur les vitres me pousse devant l’écran, là où je ruisselle, incapable – que j’ai recopiée ce jour-là et des hortensias que j’ai pris en photo devant le hangar alors que la nuit tombait.
Jean Prod’hom
(P. F. 7) Philippe Jaccottet

C’est une petite chambre sans allure, murs nus et fenêtres grandes ouvertes, remplie des odeurs âcres d’un feu de sarments, de vieux ceps, de brindilles et de feuilles mortes. L’enfant qui a levé la tête de la revue qu’il parcourait avec avidité observe avec une lenteur qui étonne la campagne que des fumées bleues enveloppent. Les tenons de la chaise grincent et tordent les pailles du placet. Il est debout, rien ne lui appartient vraiment dans cette chambre, il en sort, il s’assied sur les escaliers qui descendent jusqu’au chemin qui conduit au plantage. Le vieux qui brûle les restes de taille lui fait un signe auquel il répond de la main. Ils n’aiment pas parler ; ce qu’ils aiment par-dessus tout, c’est ne rien avoir à ajouter à ce qui est. Une impression traverse soudain l’enfant, comme une flèche, une sensation de pureté qui dure, croît, avant de s’éloigner, de prendre ses quartiers plus loin dans la campagne et se mêler aux chants des cigales et des grillons.
Il descend les ruelles du village en ne touchant à rien, traverse les herbes sèches de l’ancien camping jusqu’à la rivière. Marc et Jeannot refont le gué, les pluies d’avril ont tout emporté. C’est sur le dos de la rivière que Marc et Jeannot traversent l’été ; lui fait la petite main, amène des pierres, obéit, demeure en-deçà, à l’abri. Les travaux n’ont guère avancé quand la nuit tombe mais il faut rentrer.
Lorsqu’il parvient au clos de la Bastide, tout est comme neuf, le vieux n’est plus là, il ne reste qu’un tas de cendres. L’enfant marche entre les oliviers, sans assurance mais sans inquiétude non plus, ses paupières battent lentement, il ne songe à rien. Rien n’arrête son regard qui s’attarde, c’est l’heure. Les yeux plus pâles que bleus, il se réjouit demain du gué et du rayonnement de la rivière. On ne dispose que de peu de temps pour saisir ce qui file entre les doigts.
Il se couche la fenêtre ouverte, pas besoin d’enfermer le monde dans une prison, il suffit de le garder à sa portée, de laisser aller et venir les odeurs. Demeurer reste le seul chemin qu’on peut faire soi-même. Le prix à payer est faible en comparaison.
La chaise et son placet, la table qui leur fait face veillent lorsqu’il s’endort, acceptent sans contrepartie qu’il se taise. Ils seront une aide précieuse lorsque l’enfants saura écrire et que le moment sera venu d’en témoigner avec l’oeil de l’aigle et la légèreté du papillon.
Jean Prod’hom
(P. F. 6) Jacob Sumi

On ne le voit pas tout de suite au milieu de la bande, il n’est pourtant pas comme les autres. Quand on lui demande de s’expliquer, il dit avec des mots qu’il mâchouille qu’il n’y peut rien, qu’il y a une centaine de petits bonshommes qui rigolent dans sa tête. S’il ne connaît pas précisément leur nombre, ce n’est pas qu’il n’a pas essayé de les compter, c’est parce qu’ils s’agitent sans discontinuer dans les bulles de savon et les tas de billes qui occupent le volume arrière de son crâne. Alors il est bien forcé lui aussi de rire, et ses rires le secouent de la tête au pied. Il porte une casquette à visière orange avec le nom d’un moulin industriel sur le devant.
Au réfectoire, il est assis au bout de la table et, tandis que ses camarades mangent l’assiette fantaisie, il mange des pâtes froides dans un vieux tupperware. Il regarde la carafe d’eau et son verre, tous les deux à moitié pleins, pas toujours mais presque. Il les regarde avec un sérieux qui inquiète, alors les petits bonshommes cessent de rigoler dans sa tête.
Il se frotte l’oeil avec son avant-bras, des pâtes glissent et s’accrochent à un T-shirt en bien mauvais état. Il n’a jamais froid, n’est jamais malade, rien n’est long dans sa vie dont la voie est toute tracée : les bois et les rivières dans l’entreprise d’un oncle éloigné, c’est sûr, il sera aide-bûcheron.
Il y a eu des malheurs dans sa famille, son grand frère s’est pendu, il y a l’alcool et il y a cette douleur à l’oeil qui ne le quitte pas. Si désagréable que parfois, s’il le pouvait, il l’ôterait avec une petite cuillère. Il n’a jamais tué une bête, n’a jamais eu l’idée de voler si bien qu’on pourrait ses demander pourquoi c’est toujours lui qu’on montre du doigt quand il y a une embrouille dans le quartier. Le matin avant d’aller à l’école, il boit un verre de lait.
Ce qu’il aime c’est l’été, quand on entend dans la cour qu’entourent de hauts immeubles la musique et les nouvelles que diffusent par les fenêtre ouvertes de petits postes de radio. Et quand les gamins du quartier descendent au centre-ville, il reste près de la caisse à sable sous l’érable, même s’il pleut, seul, reposé. Sur le qui-vive pourtant lorsque quelqu’un s’approche : il pourrait réveiller les petits bonhommes qui font la sieste dans sa tête.
Jean Prod’hom
Lorsque la mine ne laisse rien voir du jour

Lorsque la mine ne laisse rien voir du jour, lorsque le ciel menace de se refermer sur elle, lorsqu’elle se sent alourdie par les petites misères qui s’accumulent et gonflent comme l’avoine dans la panse de ceux qui ruminent, défaite par ses manques et les incompétences des gens qui l’entourent, atterrée par l’état de tant d’enfants en déroute pour lesquels elle ne peut que peu et qui ne veulent rien, lorsqu’elle a courbé l’échine devant les mirages que brandissent les maîtres chanteurs, il lui suffit de sortir, de monter dans sa voiture, de rouler en écoutant la litanie des autres misères sur le chemin de la Bérallaz qui plonge dans la nuit, le bouchon qui ne se résorbe pas entre Morges et la Maladière, l’accident près d’Yverdon, les promesses des fieffés menteurs de Genève, la suffisance des journalistes, il lui suffit, dit-elle, de s’éloigner de ce tohu-bohu pour que la malédiction se détourne et qu’il ne lui reste rien d’autre qu’un immense et bel abandon. La vie redevient une douce énigme, elle se remet à sourire près de Montheron, vivante, sans ramasser le bois noir qui nourrit les enfers. Elle désespère sans personne à ses côtés, légère, la neige tombe, elle roule. Personne n’en saura rien. A part toi qu’elle me dit, et elle revit.
Jean Prod’hom
105

- Pourquoi, demande Lili, quand je lève la main droite devant la glace c’est la gauche qui se lève dedans ? Pourquoi, lorsque je tourne le dos au miroir, je tourne aussi le dos à moi-même ?
Les représentations du monde le font naître en nous en séparant et nous invitent à le rejoindre dans et par la représentation.
C’est ensemble que l’âme et les nuages naissent dans une flaque d’eau, que les cieux se détachent de la conscience universelle pour rejoindre le ciel et que l’existence se trouve réduite à une peau de chagrin.
Jean Prod’hom
Lorsque le vent de novembre

Il y a, lorsque le vent de novembre a pris ses quartiers et a chassé les dernières averses de l’automne, lorsque la neige s’est établie sur l’échine du Moléson et que les champs sont labourés, il y a quand le soleil du milieu de l’après-midi a embrasé les mélèzes du village des Italiens et que le froid a fait cailler deux larmes au coin des yeux, il y a dans le Haut-Jorat une nudité plus nue que la nudité. Corps déplié qui scintille à l’intérieur de soi et entre les choses.
Et on voudrait que cette nudité aux larges bras se prolonge, comme un point d’orgue qui ferait oublier un instant la malle aux windjacks et le campement des mauvais jours.
Jean Prod’hom
Wikipedia avertit

Je lis dans Wikipédia que l’auteur de l’article sur le « temps » ne cite pas suffisamment ses sources. Certaines sections sont à «vérifier », d’autres à « recycler ». Eternel refrain.
L’auteur de l’article sur le « futur » est lui aussi épinglé. Il est trop évasif sur les siennes. C’est moins étonnant !
Quant à l’article sur le « passé », il est étrangement bref. Idem pour « instant présent », mais ça s’est plutôt normal !
Quasiment rien sur l’ « origine du monde ». Plus tard vraisemblablement, quand on en saura plus.
Jean Prod’hom
Jean-Claude Hesselbarth | La Rivière II

Des papiers, il y en avait de toutes les qualités. Louis de Jaucourt en dénombre plus de 50 espèces dans l’Encyclopédie dont il énumère le petit nom : Grand-Soleil, Grand-atlas ou Petit-atlas, Grand-Jésus, Petit-Jésus, Petit-royal, Royal et Grand-royal, A la cloche ou A l’écu, Grand-cornet… Plus de cinquante de ces papiers pouvaient être obtenus en cinq qualités différentes : fin, moyen, bulle, fanant, ou gros bon. Les papeteries étaient situées près d’une rivière, à la chute d’un torrent, précise Jaucourt dans l’Encyclopédie.

Les pattiers amenaient au moulin les chiffes et les nippes, les guenilles et les chiffons qu’ils avaient collectés. Triés pour ne garder que le chanvre et le lin, ils étaient entreposés un certain temps dans un pourrissoir, lacérés ensuite, battus, broyés par des maillets armés de tranchans, brassés avant qu’on ne plonge un châssis dans une cuve pour que le papier s’y fige. Qu’on dessine sur des hardes récupérées ou des vêtements de seconde main ne me déplaît pas, on n’enfile pas un complet-veston à l’atelier.
C’est d’abord le papier, ostie ou page meringuée du Félix Gaffiot, boîte à oeufs qui me remue lorsque je considère l’encre de Chine de Jean-Claude Hesselbarth que j’ai chaque matin sous les yeux. Avant que la petite plume d’acier et le bambou taillé baignés d’encre ne me fassent parvenir le couinement qui a accompagné les outils dans la creuse du lit de ce jeu d’ombres et de lumières intitulé Rivière II (1982).
Un peu moins de 34 centimètres de large sur un peu plus de 50 de haut, comment calculer précisément la largeur d’un rêve ou d’une rivière ? Un peu moins si l’on soustrait les rives qu’envahit l’eau noir de tunnel.
Rivière à la bannière frémissant au vent, lumières, ombres et frondaisons, personne ne sait très bien où commencent et finissent les choses. Blason coupé avec les dents, décousu, on appelle drapeaux les chiffons d’où l’on tire le papier à la cuve. Recommencer, par dessus et par dessous, ronciers, pointes acérées du robinier, bambous, et puis ce flottement du sens et de l’orientation. Il est 10 heures, personne dans les rues, c’est jour de rentrée, jour d’école buissonnière, René est à la rivière.
Ah ! j’oubliais, Jean-Claude Hesselbarth fêtera ses 90 ans l’an prochain.
Jean Prod’hom
Il y a les sursis concordataires

Il y a les sursis concordataires
la rase campagne
les arrière-boutiques
Il y a la chirurgie esthétique
les frigidaires
la peinture à l’huile
il y a les salles d’attentes
la rigidité des cadavres
les portes closes
Jean Prod’hom
La dernière pierre (Pays perdu)

L’ouvrier agricole s’était dit qu’il la reprendrait lorsqu’il aurait fini de traire, la remiserait dans l’armoire de l'écurie, celle qui ferme mal. Et puis, parce que le ciel était chargé, que l’orage menaçait et que la pluie risquait bien de revenir, il avait changé d’avis et l’avait accrochée à la chevillette de la porte de la mécanique. De fil en aiguille, la capuche était restée là, personne ne s’en était formalisé, on l’avait oubliée.

Lucien est mort et la capuche de ciré jaune lui a survécu. La patronne, veuve alors, a remis le domaine il y a quelques années, la ferme n’abrite plus aucune bête, plus aucune âme n’emprunte le chemin de terre qui conduit aux anciennes mines de la Beune d’où l’on tirait la molasse des temples et des encadrements des portes et des fenêtres de la région.
La capuche a rejoint le gros de l'insignifiance, solitaire et lointaine, comme guettant dans l’ombre le soleil, d’or à l’aube, vert-de-gris le soir. Prisonnière de la soie, elle retient derrière une barrière de ronces et d’orties un peu de la vie qui l’a désertée. J’imagine Lucien, la chemise à carreaux boutonnée jusqu'au coup, les allées et venues de la veuve, les myosotis de son tablier qui s’effacent, la cour déserte.
Trois hivers passeront, trois automnes et ses pluies. Plus de vaches aujourd’hui dans l'étable, oubliées les fragrances de la bouse et du foin, la tèche de foyards est sur le point de s’effondrer. La capuche de toile cirée est pourtant sur le point de parler, désigne ce qui insiste en dépit des ruines.
Avant que tout ne disparaisse, ce quarteron de mélancolie, rude et brutale, s’accroche à la chevillette de la mécanique, avec les odeurs d’un feu d’automne, le silence tapi au fond de l’étable vide, la vie qui repiquerait, sale mais austère. L’esprit du lieu s’ébroue et réveille cette nature morte, secouée par les sonnailles du voisinage, ravie par le murmure assoiffé de l’eau sur le miroir de la fontaine dans lequel les nuages passent.
Et, jusqu’à ce que le godet des engins de démolition ne l’emporte et la jette parmi les gravats, les bris de molasse et de verre, cette promesse, la capuche la tiendra, la promesse de ce qui se maintient sans personne, voisine des jours clairs, des riens qui font lever la tête, des justes misères, de la beauté festonnée des décharges, de Lucien et de la veuve dont le souvenir sécrète un bonheur sans limite, éloigné du pire, donnant à voir sans qu'on le sache vraiment, aveugles que nous sommes, ce dans quoi nous sommes plongés, l’incompréhensible qui nous unit à eux.
Jean Prod’hom
Âmes noires

Âmes noires
et fausse bile
porteurs de bières
bennes à dépouilles
signataires de saintes alliances
marchands d’horreurs
Négociez
annexez
mais du balai
laissez ce morceau de pré
Jean Prod’hom
Il y a les initiatives populaires

Il y a les initiatives populaires
les crayons gris
le détroit de Malacca
la piraterie
il y a en France le sénat qui ne sert à rien
le roquefort bien plus utile
il y a ta petite mine
ma petite amie
la petite arvine
Jean Prod’hom
104

Fenêtre qui s’ouvre sur le dedans et sur le dehors, fenêtre insolite sans toit ni murs.
Difficile lorsque tu campes sur le tranchant du couteau ou que tu franchis le col de maintenir ensemble et par le milieu la fin et le commencement. Comme s’il fallait trancher.
Formule ramassée ou court propos sans bride, c’est la même chose.
Jean Prod’hom
103

La peinture figurative joue de son incapacité à orienter ses objets dans le temps, condamnée depuis toujours à les placer dans une embrasure, ou sur un rebord de fenêtre. En deçà ou au-delà. Même les natures mortes. La peinture non-figurative et la photographie ont suivi le mouvement.
Jean Prod’hom
Nicole Gaillard | Lucian Freud | Hotel Bedroom

Lucian Freud (1922-2011)
Hotel Bedroom, 1954, Beaverbrook Art Gallery (Canada)
« Que l’on décrive cette expérience visuelle comme l’impression d’entrer dans la fiction, ou celle, inverse, de voir un personnage en sortir et prendre passagèrement une densité quasi réelle, le rôle imposé au regardeur est toujours celui d’un témoin par principe indésirable, conduit à s’éprouver tel puisqu’il a sous les yeux l’évidence d’une relation à deux qui, en son essence même, tant à la clôture et à l’exclusion de toute tierce présence. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 282
Nicole Gaillard | David Hockney | Mr and Mrs Clark and Percy

David Hockney (né en 1937)
Mr and Mrs Clark and Percy, 1970-1971, Tate Galllery (London)
« Le vase de lys agit ainsi comme le marqueur le plus patent d’un scénario présent en filigrane, celui d’un moment où s’échappent des paroles importantes – seul élément caractéristique de l’épisode religieux susceptible d’être transféré à la scène peinte par Hockney, me semble-t-il. Somme toute, le choix de réactiver chez le spectateur les habitudes réceptives liées à l’Annonciation contribue à perturber en le complexifiant, le processus de réception d’une peinture qui se présente au premier abord comme un simple portrait. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 271
Nicole Gaillard | Edward Hopper | Room in New York

Edward Hopper (1882-1967)
Room in New York, 1932, Sheldon Museum of Art (Lincoln)
« Yves Bonnefoy le dit mieux que personne : « Exemplaire de ce qu’il [i.e Hopper] épie aux confins de l’âme et du silence du monde, cette femme de A Room in New York, 1932, qui, près de son mari qui lit intensément son journal, a posé, ou va poser, un doigt, rien qu’un doigt, sur le clavier du piano, pour écouter les vibrations de la note, belle métaphore d’un grand possible, celui qui manque à la vie. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 246
Nicole Gaillard | Otto Dix | Mélancolie

Otto Dix (1891-1969)
Mélancolie, 1930, Kunstmuseum (Stuttgart)
« Emprisonné, réduit à l’état de pantin, acculé au seul désir de se dissoudre dans la nuit orageuse teintée de feu, l’homme endosse ici le rôle de la victime dépossédée de sa dignité originelle par une partenaire sans scrupule, à qui il suffit de se dénuder pour prendre au piège sa proie. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 231
Nicole Gaillard | Max Beckmann | Man and woman

Max Beckmann (1880-1938)
Man and woman, 1932, Collection particulière (Lackner)
« Voilà donc le divorce accompli que j'évoquais plus haut. Les partenaires se sont tourné le dos, se sont réparti les deux dimensions de l'espace reçu, comme se négocie le partage des biens communs lors d'une procédure de divorce: "Je reste ici, tu vas là-bas", et, corrolairement: " Je vais là-bas, tu restes ici. » Aucune surprise dans ce partage où la femme s’attache au proche et au connu, tandis que l’homme ira découvrir le lointain, pas plus que dans l’attribution des positions contrastées, elle couchée, lui debout. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 192
Nicole Gaillard | Ernst Ludwig Kirchner | Das Paar vor den Menschen

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Das Paar vor den Menschen, 1924, Kunsthalle (Hamburg)
« … d’autre part, le besoin, même pour un artiste qui s’est défini dans la rupture avec l’art du passé, de se confronter aux grands thèmes véhiculés par la tradition iconographique. Les enfants terribles sont aussi des héritiers. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 186
Nicole Gaillard | Oskar Kokoschka | La fiancée du vent

Oskar Kokoschka (1886-1980)
La fiancée du vent, 1914, Kunstmuseum (Bâle)
« Le mouvement lyrique de la composition en arabesques, la symphonie des bleus, l’allure irréelle et merveilleuse de la scène abritent en leur sein un corps étranger, cet homme qui semble ne pas pouvoir se laisser aller au repos ou à l’apaisement. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 163
Nicole Gaillard | Félix Vallotton | La Chambre rouge

Félix Vallotton (1865-1925)
La Chambre rouge, 1898, Musée cantonal des Beaux-Arts (Lausanne)
« Il convient sans doute de mentionner ici les ambitions littéraires de notre peintre, dont la production écrite, peu connue, comporte cependant quelque pièces de théâtre et trois romans ; on peut voir dans cet intérêt actif pour l’écrit un facteur qui contribue à expliquer le caractère fortement narratif et dramaturgie des Intérieurs. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 135
On reste à distance, mais on reste : ce qui nous perturbe dans l’oeuvre est aussi ce qui nous retient, force notre attention.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 139
Nicole Gaillard | Henri Matisse | Conversation

Henri Matisse (1869-1954)
Conversation, 1908-1912, Musée de l’Ermitage (Saint Petersbourg)
Bien que nous soyons beaucoup plus près des personnages …, il y a comme une vitre entre eux et nous qui donne à cette conversation une dimension à tout jamais énigmatique : on a là un effet assez analogue à la focalisation externe des narratologues, soit ce procédé qui consiste à maintenir le lecteur à distance des personnages, à filtrer l’information, à ne rien livrer de plus que ce qu’un observateur extérieur et neutre pourrait constater… Matisse fait mine de nous introduire mais nous maintien sur seuil.
Matisse fait mine de nous introduire mais nous maintient sur le seuil : le spectateur en quête de narration est tout à la fois retenu et déçu.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 127
Nicole Gaillard | Edward Munch | Homme et femme

Edward Munch (1863-1944)
Homme et femme, 1898, Bergen Art Museum (Bergen)
Aucune concession à l’anecdote ici.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 95
Nicole Gaillard | Gustave Caillebotte | Intérieur, femme à la fenêtre

Chemins, taches rousses des sédums, lianes des clématites sauvages, chaleur du soleil couchant.
(Noté d'abord cela, pour ne pas oublier l'intensité singulière de ces instants.)
Aussitôt après :
Ces taches rousses sur les rochers - comme on parle de la lune rousse –, comme des morceaux de toison, de la toison du soleil couchant ; et puis ce lien entre chemins et chaleur, une chaleur émanée du sol…
En dépit de ma bonne volonté, je ne parviens pas à donner le moindre crédit à ce mot placé là, émanée, dont la voyelle finale, lourde et émoussée, me détourne de ce chemin d’où monte, comme une invisible vapeur, une chaleur couleur de terre. Tout s'y refuse.
Surgit pourtant dans le même temps, comme pour remplacer ce mot qui m’est refusé, une image venue de très loin, un pâturage au fond d'un vallon traversé par le Triège, atteignable par un chemin caillouteux à double ornière depuis le Trétien, ou par un sentier depuis le col de Fenestral au-dessus de Finhaut, mais qu'on rejoignait en famille de la Creuse en suivant un sentier au pied du Luisin. Vallon profond qui s’étend dans une herbe maigre, épais tapis de tourbe avec des linaigrettes et des carex, moquette mitée par le ruissellement d’innombrables petits cours d’eau qui se rejoignent et se séparent comme des coraux. Ravivée l'été passé par quelques balades, l’image de cet alpage s’impose, écarte le vilain mot, malvenu, couvert d’une épaisse couche d’étain, avant que je ne reprenne, à la sortie de ce vallon dont j’aurai parcouru les beautés, en aval, intacte, la lecture des pages de Philippe Jaccottet.
et le chemin, une sente plutôt qu'un chemin, "la sente étroite du Bout du Monde" mais justement pas du Bout du Monde : d'ici, de tout près, sous les pas. (Non dans un livre.) Tendre trace silencieuse laissée par tous ceux qui ont marché là, depuis très longtemps, traces de vies et des pensées qui sont passées là, nombreuses, diverses, traces de bergers et de chasseurs d'abord – et il n'y a pas si longtemps encore –, puis de simples promeneurs, d'enfants, de rêveurs, de botanistes, d'amoureux peut-être...
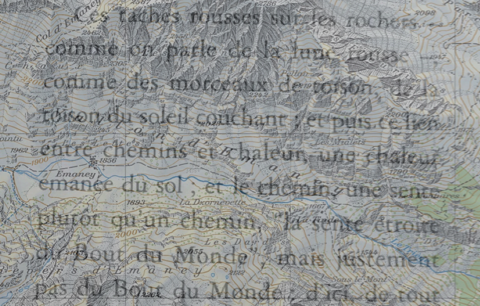
On se rendait à pied au fond de ce vallon dès l'aube pour être de retour à midi, avec le beurre et la crème que nous achetions au berger, avec les petits fruits aussi que nous cueillions en chemin, myrtilles surtout pour lesquelles notre mère vouait une véritable passion. Le sentier qui longe le Triège s’en éloignait lorsqu’on reprenait en début d’après-midi celui qui nous conduisait à la Creuse, laissant derrière nous le pâturage d’Emaney qui avait illuminé cette journée sans que personne ne le sache encore, le vallon d’Emaney vers lequel on lèverait la tête, plus tard, comme en direction d’une énigme. On croisait d'autres habitués, silencieux, qui marchaient comme nous avec mille précautions, parce qu’on se croisait à peine sur ce sentier qui se faufilait entre mélèzes et arolles, aulnes et bouleaux nains, genièvre, sariette et rhododendrons, et de lourds blocs de granit brûlant qui l’obligeaient à se contorsionner.
Si l’image de cet alpage, de ce vallon et de tout ce qui les entoure s’impose à moi aujourd’hui, c'est en raison d’un nom que je n’ai pas cessé de répéter à la place du mot que j’ai répudié, Emaney, avec à la fin, tout au fond du vallon, cette voyelle qui ouvre ses bras et son assiette, inscrivant au coeur d’un texte les lignes souples d'un autre temps, à la fois morceau du monde, ici, tout près, dans un pli de la mémoire, trace d'enfant qui n'a rien perdu de son intensité, quelque chose du dehors qui s'installe sans crier gare dedans, une poche sans fond mais aussi, comme le dit Philippe Jaccottet dans Couleur de terre, la stupeur d'avoir été simplement là, sans savoir ni comment ni pourquoi, à Emaney, avec non pas la chaleur qui montait des chemins, une chaleur émanée du sol, mais la force invisible d’un vallon, l’imperceptible émané d’un nom.
Jean Prod’hom
Nicole Gaillard | Pierre Bonnard | L'homme et la femme

Pierre Bonnard (1867-1947)
L’homme et la femme, 1900, Musée d’Orsay (Paris)
L’hypothèse d’une scène inscrite dans un miroir est d’ailleurs évoquée pat Timothy Hyman, qui relève la présence d’une sorte de cadre le long du bord gauche, finissant en arrondi dans le coin inférieur gauche… Si miroir il y a...
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 56
Nicole Gaillard | Edouard Vuillard | Le prétendant

Edouard Vuillard (1868-1940)
Le prétendant (Intérieur à la table à ouvrage), 1893, College Museum of Art (Northampton)
La jeune femme de droite est la soeur de Vuillard, Marie, et le jeune homme, Kerr-Xavier Roussel; le couple va se marier peu après, en juillet 1893, soit la même année que celle figurant au bas du tableau, et Vuillard semble avoir activement travaillé à cette union...
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 36
![]()
Ici, nous sommes au contraire témoins d’un instant précis, fixé au passage, dont nous reconstituons intuitivement l’avant (l’absence de l’homme), et l’après (son mouvement pour s’avancer dans la pièce, refermer la porte derrière lui, s’adresser à sa fiancée). Mais au fond, d’où tenons-nous la certitude de ce déroulement ? Ne peut-on aussi bien imaginer que le jeune homme soit en train de sortir de la pièce, jetant un dernier regard d’adieu à la jeune femme ?
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 40
Nicole Gaillard | Edouard Manet | Dans la serre

Edouard Manet (1832-1883)
Dans la serre, 1879, Alte Nationalgalerie (Berlin)
Que nous apprend en effet la peinture spécialisée. Qu’il s’agit du « portrait d’un couple, M. et Mme Jules Guillemet, propriétaires d’un magasin de mode réputé, au 19 rue du Faubourg Saint-Honoré, et amis du peintre ». Cette indication transforme radicalement, à première vue, la compréhension de l’oeuvre : nous avons à faire avec un couple officiel, les alliances ne dissimulent aucun mystère, ni tentation d’adultère, ni mariage de convenances entre un homme mûr et une femme aux sentiments réticents.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 20
Gustave Roud | Philippe Jaccottet
Gustave Roud
Si ce qu’on appelle « un prix littéraire »…
in Gustave Roud, Lectures, Editions de l’Aire, 1988

Philippe Jaccottet évoque, dans le Plan-fixe que lui a consacré la TSR en 1978, sa rencontre avec Gustave Roud et le rôle que celui-ci a joué dans sa vie. Il se souvient, parmi d’autres choses, de cette soirée du 27 juin 1941 à l’occasion de laquelle les étudiants de Zofingue ont décerné leur prix au poète de Carrouge.
Jean Prod’hom
L’Ignorant | Philippe Jaccottet

Plus je vieillis et plus je croîs en ignorance,
plus j'ai vécu, moins je possède et moins je règne.
Tout ce que j'ai, c'est un espace tour à tour
enneigé ou brillant, mais jamais habité.
Où est le donateur, le guide, le gardien ?
Je me tiens dans ma chambre et d'abord je me tais
(le silence entre en serviteur mettre un peu d'ordre),
et j'attends qu'un à un les mensonges s'écartent :
que reste-t-il ? que reste-t-il à ce mourant
qui l'empêche si bien de mourir ? Quelle force
le fait encor parler entre ses quatre murs ?
Pourrais-je le savoir, moi l'ignare et l'inquiet ?
Mais je l'entends vraiment qui parle, et sa parole
pénètre avec le jour, encore que bien vague :
« Comme le feu, l'amour n'établit sa clarté
que sur la faute et la beauté des bois en cendres... »
Philippe Jaccottet, L’Ignorant, Gallimard, 1957

Ai trouvé sur le WEB, chemin faisant, les premiers vers de L’Ignorant, lus par l’auteur, voix d’ailleurs et d’un autre temps. Le poète est décidément un revenant, son poème se referme sur un silence auquel je joins ma voix, silence rapatrié comme d’outre-tombe. Commémoration ou transsubstantiation.
Jean Prod’hom
102

N’ai rien contre les hors-d’œuvre, ni contre les chefs-d’oeuvre ou les maîtres d’oeuvre. Encore moins pour les bonnes œuvres. Mais termine à l’instant la lecture d’un long texte semi-savant dans lequel le mot apparaît, tout nu, aussi souvent que la copule, plus obscène si cela se peut que le cul de la poule que dessinent les lèvres de ceux qui le prononcent d’un air emprunté derrière les barreaux de leur prison.
Jean Prod’hom
Le style comme expérience | Pierre Bergounioux

Pierre Bergounioux
Le style comme expérience
Editions de l’Olivier
penser / rêver
2013
Cet opuscule est comme un supplément au Bréviaire de littérature à l’usage des vivants. Un peu moins de soixante-dix pages pour courir l’histoire de l’homme et de la littérature. Saluons l’exploit. Et disons-le tout net, il y a des raccourcis qui font du bien.
Entreprise si brève, si insaisissable qu’elle invite le lecteur à la parcourir une seconde fois pour s’assurer que les choses pourraient effectivement s’être déroulées ainsi et relever quelques-unes des traces que la lecture de ce petit livre laisse immanquablement derrière elle.
1. C’est aux capacités cérébrales insuffisantes de l’homme que l’on doit la naissance de l’écriture, incapable de contrôler par sa seule mémoire ce dont il est s’est accaparé en asservissant ceux qui travaillent la terre.
2. L’homme a fait de l’écriture l’instrument de sa domination sur l’homme avant qu’elle ne devienne son expression et le véhicule de sa liberté.
3. Ecrivant, l’esprit voit ce sur quoi il agit sans le savoir lorsqu’il ne fait que parler.
4. L’écriture traversée deux fois par l’arbitraire représente le monde sous deux aspects, l’étendue (le nom) et le temps (le verbe). Le récit s’en suit sans jamais renier ses origines, celles de l’inégalité et de l’exploitation. Le style aussi, dans un monde dissocié entre ceux qui sont dépouillés du produit de leur travail et du sens de leur être, et ceux qui en disposent en en fournissant la légende.
5. La bourgeoisie urbaine remplace l’aristocratie terrienne de la fin du XVIIIème siècle, mais rien ne change. Ni la première ni la seconde ne sont impliquées dans l’action, ses batailles et ses travaux ; elles ne peuvent en rendre compte, précisément parce qu’elles s’en sont retirées pour chroniquer les exploits de héros dont elles ne savent rien, dans une réalité qu’elles rationalisent mais qui leur fait défaut. Jamais le narrateur ne se demande s’il n’est pas à l’origine de cette réalité seconde détachée des travaux des champs.
6. Ce sera au Stendhal du troisième chapitre de la Chartreuse de Parme de rapatrier la perspective des acteurs dans le récit, de redonner vie à ceux qui sont plongés dans le tumulte de Waterloo, faire entendre l’incompréhension de Fabrice del Dongo, ce jeune soldat qu’il fut lui-même, petit sous-lieutenant derrière Bonaparte.
7. De ce côté-ci du Pacifique, le roman se repliera sur lui-même et s’égarera dans de « petites mythologies privées » incapables de rivaliser avec la puissance descriptive des sciences sociales. Le roman est mort, il ne peut qu’affirmer sa propre impossibilité. Joyce « n’a rien à dire qu’on ne sache déjà »; Kafka « s’interdit de conclure » ; Proust raconte le temps qu’il a perdu à trouver ce qu’il aurait à raconter, et cette quête sans succès sera ce livre.
8. Il reviendra à un homme jeune, né dans une succursale européenne (qui a brûlé les étapes du processus de civilisation et dans laquelle la ségrégation sociale ne joue pas à plein) libérée du projet révolutionnaire, de recoller le divorce fondateur en faisant entendre le bruit et la fureur qui accompagnent ceux qui font l’histoire, en prenant conscience « de la distorsion imprimée par l’histoire à la narration ». Renversement formel par lequel Faulkner accueille ceux qui agissent. Premier acte en direction de la mise à disposition de chacun des ressources économiques et symboliques.
9. « Le plaisir stylistique demeurera, s’il est bien l’augmentation personnellement éprouvée du monde emporté par le mouvement historique, et il sera purifié du poison que l’inégalité y a répandu depuis l’origine des sociétés. »
(Reste la question du style à laquelle ce petit ouvrage à ma connaissance ne répond pas, sinon en creux.)
Jean Prod’hom
Le réel est hors d’atteinte | Virginie Gautier

Le réel est hors d’atteinte, n’aura jamais la précision d’une miniature.
Petite image d’enfance. Garder le vague, fermer la main. Déployer des sortes d’antennes.
Voir à peine.
Une vague fantôme déferle. J’aperçois au travers la lumière du soleil et quantité de bulles. Elles me remontent dans le corps. Elles me remontent dans la bouche. Je vais parler par l’eau qui monte, moi que le réel submerge. Sur les Amers, les Brisants, parler par l’eau. Dans l’ourlet de la vague, en flots. Dans l’écume.
(si je flottais dans ses rouleaux les cheveux comme une algue le corps noyé alors je serais le réel hors d’atteinte)
Tout est allongement.
Je recule d’un pas, de deux puis trois. J’attends entre les grunes à marée descendue que la mer me revienne plus douce. Je pêche mes mots près d’une barque. Près d’une barque je pêche le réel hors d’atteinte, je ne remonte rien, reviens seulement avec l’odeur de l’eau.
(vaguement vaseuse)
L’hypnotique ressassement du réel hors d’atteinte. Je reste dehors avec ma miniature. Petite image d’enfance faite de couleurs fines dissoutes dans le songe. Une vague fantôme déferle. Je parle avec la mer. Je la tiens à distance.
Virginie Gautier

« Qu’on y oeuvre par le milieu », c’est à Virginie Gautier que je le dois. Où qu’on soit. Insoumissions, intérieurs, extérieurs ou miniatures, côté cour ou côté jardin. Ouvrez son Carnet des Départs.
Je la remercie ici de m’accueillir là-bas, dans le cadre du projet des vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre. Et d’autres vases communicants ce mois-ci, inventoriés là. Un grand merci à Brigitte Célérier.
(P. F. 5) Gaston Teuscher

Dans le compartiment d’à côté, un garçon tourne le dos. La vitre est recouverte de buée, il y fait glisser l’index de sa main droite, puis approche sa tête pour y coller son oeil. Le temps est humide, le wagon désert. Il dit quelques mots incompréhensibles, tend son bras à nouveau, taille une nouvelle ouverture par laquelle il regarde. Son titre de transport est glissé dans une pochette transparente qu’il porte à son cou, elle oscille comme un pendule. Le contrôleur passe sans s’occuper de l’enfant, c’est un habitué. Celui-ci reprend son jeu, il ne reste bientôt que des lambeaux de buée qui ne tiennent plus leurs promesses, il s’en débarrasse avec la manche. On le voit hésiter, il regarde à l’avant de la rame, à l’arrière, quel gâchis.
Il ouvre alors la serviette ouverte sur le siège voisin, dont il sort une feuille et des crayons de couleur. Même jeu des lèvres, il trace des lignes et des formes qui ressemblent à un paysage. Sans lever la tête. Il n’explique rien, mais fait voir ce qu’il y a. Apparaissent des silhouettes auxquelles il répond, un train qui passe, les couleurs qui changent, le paysage qui l’a ébloui, celui qu’il découvre.
L’enfant fait une pause, mange un petit sandwich au jambon, le savoure jusqu’à la dernière miette avant de reprendre son dessin, rien de plus beau que ce paysage qui apparaît derrière la buée. Ça pourrait durer, aussi longtemps qu’il le faut pour que les choses adviennent, ici, ou sur les escaliers devant la maison, ou dans le couloir de l’appartement. Une vie dont on tournerait les pages. Les lèvres de l’enfant s’animent, incapable de retenir tout ce qu’il voit, alors il dessine encore.
Plus tard le gamin se souviendra de ce qu’il découvrait ainsi dans le train, plein de cette bonne fortune qu’il poursuit aujourd’hui en rêve, sans chez soi, travaux chez les autres, de quoi gagner quelques sous et régler les inévitables embrouilles. Un couvert contre un coup de main. Être le dernier au bal, prendre le train de minuit ou attendre celui du matin. Prêt à tout et à n’importe quoi, toujours en route, avec pour unique souci celui de retirer la buée qui recouvre le monde en crayonnant sa vie.
Jean Prod’hom
(P. F. 4) Georges Simenon

On ne l’aperçoit pas au fond de l’un des fauteuils rouges du premier rang du Rex. Tout est bien rangé : sa veste brune matelassée à ses pieds, avec par-dessus une casquette et l’étui de ses lunettes. Il ne cède rien des accoudoirs qu’on partage communément avec ses voisins. Il pioche dans un petit sachet, en attendant le début du film, des bonbons qu’il croque. Des copains tout autour s’agitent, s’affairent pour un rien. Caché derrière les montures épaisses de ses lunettes, menton dressé, le gamin n’est pas avec eux, les odeurs des velours vieillis et les taches d’humidité sur les crépis défraîchis l’ont jeté dans une rêverie tropicale.
Ce n’est pas seulement une histoire qu’il vient chercher là, mais de la lumière et le vent du large. Les lourdes tentures s’écartent. Son visage se marbre d’impressions qui dansent autour de ses rétines. Il retient tout, le sérieux et le bénin, comprend qu’au delà de ses journées il y a un monde, des virées imprévues, des ciels rouges, des obligations plus légères, des usages qui ne sont pas les siens.
C’est ici que le gamin prépare le cinéma de sa vie, écoute avec passion l’histoire de Philémon et Baucis et celle des Chevaliers du ciel, enregistre le sourire de la mariée et les conseils du forgeron à l’enfant qui n’a pas de père.
C’est avec la même passion qu’il s’endort les soirs d’été, lorsque la lumière faiblit, et qu’il suit sur les boiseries de sa chambre l’ombre dansante des feuilles du platane qui viennent se joindre aux ancolies de la tapisserie.
Jean Prod’hom
(P. F. 3) Constantin Regamey

Il est comme un sou neuf assis sur un banc du square, à l’écart, une chemise blanche et un gilet de jersey. Les enfants de son âge jouent au bord de l’étang avec leurs reflets et des bouts de bois. Il tend l’oreille parce que ça le repose des langues dans lesquels il a baigné depuis sa naissance. Ses yeux font des bonds, s’agitent dans ses orbites mais ses mains reposent l’une sur l’autre, le vent brasse dans son dos les feuilles de l’automne. Il a le regard de la chouette égarée dans le jour, ses pensées qu’ils superposent vont à l’aveugle. La jeune femme qui l’accompagne lui dit quelques mots en allemand.
On imagine le garçon couché sur un riche tapis d’orient dans un salon d’ors et de stucs, penché sur une planisphère, détaillant en tous sens les régions qu’il a traversées, leurs capitales, la Crimée, la Suède, Tallinn ou Kiev, les ambassades et ses brèves rencontres. Orphelin au front bombé, la vie lui pèse. Il engrange pourtant, sans s’inquiéter, ce qu’il lui faudra bien un jour oublier.
Lorsqu’il se lève il hésite, tâtonne avant de mettre la main sur une canne blanche, il marche à quelques pas de la dame qui l’accompagne, avec les yeux ouverts sur une nuit faite des pièces d’un puzzle dont on peine à concevoir la découpe, apaisé de ne rien avoir à ajouter.
Jean Prod’hom
(P. F. 2) Alice Rivaz

On aurait pu imaginer qu’elle souffrait d’une conjonctivite s’il n’y avait eu au fond de ses yeux cette esquisse de sourire et le bouquet de lys blancs sur la cheminée. Et puis personne ne la voyait, accroupie sous le piano à queue noire, avec un livre qu’elle tenait enveloppé dans sa jupe à fleurs. Pan de mur jaune, échiquier sur la table ronde, la petite est cachotière, elle a dans une poche la lettre d’un de ses amoureux. La fenêtre est ouverte sur le jardin.
Quelqu’un songe au pied de l’immeuble à l’enfant qu’elle fut, tend l’oreille au bruissement de l’été, sourit sans regret aux bouts de romans qu’elle a écrits tout au long de sa vie, à son amour, à ses chagrins. C’est un prélude de Chopin, son visage s’illumine, tout semble si facile. Elle sourit de ses mensonges, monte en épingle les choses heureuses. Les murs qui l’entouraient se sont écroulés il y a bien longtemps, les épreuves traversées n’ont plus d’importance.
Elle continue sa route avant que la musique ne s’arrête, avant que n’apparaisse une hésitation sur le visage de l’enfant. On entend dans la descente de la chêneau les restes de l’averse du matin. Il y a tellement de choses qu’on ne dira pas, un nuage passe dans sa main, le vent seul touche à cette épure. Dans le jardinet un homme coupe quelques roses tandis que la femme passe, rassemblant d’une main, comme les miettes après un repas, les morceaux de sa vie dans son beau visage uni. Il y a des jours où les choses se font sans que personne ne placarde ses états d’âme.
Jean Prod’hom
(P. F. 1) Jean-Claude Hesselbarth
 -
-La ruelle s’anime, le gamin se dresse immobile sur le perron du vieil immeuble, les habits de son grand-père sur le dos. Il alterne, la tête dans les pavés et les pieds dans le ciel. L’enseigne de la boîte de nuit clignote, un talon aiguille et les restes de la nuit traînent dans le caniveau. Une échelle est appuyée contre la façade un peu plus loin, le gamin a les cheveux en brosse, ses deux grandes soeurs ont déjà quitté la maison.
Un camion descend avec deux éboueurs sur le marchepied. L’enfant a deux yeux noirs, il fait tinter quelques pièces de monnaie qu’il garde au fond de l’une des ses poches. Il jette un coup d’oeil à la boutique du fleuriste qui sort ses roses et ses chrysanthèmes, à celle du glacier qui allume ses frigos et ses néons. Le gamin répète un poème qu’il devra dire bientôt. il peine à parler, ses mains l’aideront. C’est avec elles qu’il maintient vivant le morceau de oui qu’il garde enfermé quelque part.
Il a ouvert ce matin le dictionnaire à la page des icônes, il pense que c’est mieux ailleurs. Mais il craint qu’en quittant sa rue il ne revienne pas, qu’il s’égare et ne retrouve pas son chemin. Ou qu’il aille plus loin encore, parce qu’ailleurs c’est mieux. Alors, chaque fois qu’il le peut, il digresse sur le perron, immobile, droit comme une prière.
Jean Prod’hom
Avec Thierry Metz

Reprends depuis quelques jours, à petites doses, les septante-sept textes écrits cet été entre Colonzelle et le Riau. En me demandant si je fais bien.
Maintiens, mais en les déplaçant quelquefois, les septante-sept fragments que j’ai retenus des lettres de Thierry Metz. En les écourtant parfois. Avec la certitude que ce qui a soutenu cette entreprise ne tient plus que par un fil à ces quelques mots indiqués en italique. Car si ceux-ci l’ont soutenue, ils en ont aussi différé l’accès. Je m’efforce maintenant de préserver, et c’est l’essentiel, l’étendue de ce que je ne saurais dire autrement, c’est-à-dire le silence sans lequel on n’entend rien, d’élaguer ce qui encombre, avec le risque qu’il ne reste plus grand chose à la fin.
J’aimerais encore, lorsque chacun de ces septante-sept morceaux tiendra debout, les filer d’un trait en m’assurant que l’ouverture creusée en chacun d’eux ait la dimension qui convient pour laisser passer une ficelle de chanvre brut, qui aura à creuser encore, de l’intérieur, le ciel d’un bivouac.
Jean Prod’hom
State | Paolo Woods et Arnaud Robert

Les photographies que Paolo Woods présente au Musée de l’Elysée pourraient faire croire qu’Haïti est un immense patchwork aux couleurs de l’Afrique faufilé par la conscience économico-religieuse de l’Occident. Il n’aurait pas tout tort. Mais il ne comprendrait pas pourquoi tout cela tient ensemble. Le texte d’Arnaud Robert qui accompagne cette belle exposition déplie avec lyrisme ce que chaque image réunit et encadre.

Paolo Woods | Musée de l’Elysée
Je devine désormais pourquoi les Haïtiens, surpris d’avoir renvoyé les colons chez eux, tutoient les dieux. Méfiants pourtant, ils attendent depuis 1804 leur retour. Dans une touffeur qui fait douter de tout. Ils les attendent la main au canon sur le parvis de la citadelle Laferrière, avec des Casques bleus sur les toits qui les encadrent. Voici le paradoxe, les colons sont dans la place, dans leur dos, et tout le monde le sait. Comment dès lors et pourquoi faire quoi que ce soit ? Quoi d’ailleurs ?
Les Haïtiens ne sont pas là où on croit, vivent dans un espace parallèle, à côté d’un président qui se promène avec une casquette de seconde main sur la tête et un portable à 10 dollars. Il y a quelque chose de mystérieux, personne n’écoute personne, chacun s’oppose à chacun, on se convertit, se reconvertit, le chef de la police lance une ligne de vêtements, le médecin importe des voitures, on échange sa place, le directeur du Bureau national d’ethnologie est aussi un prêtre du vaudou, le chansonnier devient président. Et ça tient un jour, on recommence et on renonce le lendemain, sous les yeux complices de l’ONU et des ONG qui se prennent au jeu.
Il y a si peu et tout est si vif aux Cayes qu’il n’y a rien à ajouter. La volonté de stabilisation est un voeu fou, il n’y a rien à stabiliser. Les Haïtiens vivent dans une jungle de connexions, ni légales ni illégales, qui connectent l’enfer au paradis. Les terres changent de main, les cadastres se juxtaposent sans jamais s’empiler. Haïti est le laboratoire d’une interminable transition. Au carrefour on joue au loto. Et ce qui pourrait être un cauchemar – et qui l’est – devient récréation continue. On y sent l’odeur de l’essence et de la liberté, l’odeur de la foule et de l’insouciance, des cadavres et des épices. Quel avenir quand il n’y en a plus. On ne l’imagine pas, on le fait.
Et puis il y a, lorsqu’on s’attarde sur la carte de ce bout d’île, la naissance d’un rêve : Port-de-Paix, Petite-Rivière, Mont-Organisé, Cabaret, Belle-Anse, Limonade et Marmelade, Petit-Goave et Grand-Goave, un tableau de Préfète Duffaut, le sourire de Dany Laferrière, un air de comptine qui fait oublier le sang versé pour rien.
Jean Prod’hom
Entre Paris et Corcelles

Entre Paris et Corcelles s’étend un territoire immense parsemé de villages malingres et de petites villes un peu folles, recouvert de friches et de bois, de prés et de pâturages sans personne, qui rappellent au passager du TGV lorsque la nuit tombe que l’homme n'est ni tout ni partout.
On aura tôt fait de l’oublier. Et voyez-vous, de le savoir ce soir au Riau me fait du bien.
Jean Prod’hom
Midi au square du Temple

Quelques vieux du quartier, assis sur les bancs décatis du square, habillés de vieilles hardes qu'ils portent jour et nuit somnolent ou lisent. De l'autre côté, trois ménagères à l’ombre d’une haie bavardent, les bras croisés sur des blouses et des tabliers tachés qu’elles ne quittent pas.

Passe en trottinant un homme bien enveloppé, suivi d'une lourde dame, la quarantaine ; ils courent en boucle, tous d’eux revêtus d'un haut et d'un bas de training ; ils sont en sueur, grimacent, s’époumonent, souffrent comme on n’osait jadis le faire que chez soi ; le troisième a des allures de Buster Keaton ; il accompagne, en training également, le duo qui peine ; le solide gaillard serre dans chacune de ses mains deux bouteilles d'eau qu'il tient comme des chandeliers et qu’il tend à ses deux clients chaque fois qu’ils passent devant le buste de Bocquillon-Wilhem, fondateur en 1833 des Sociétés chorales.
C’est un de ces coachs que chacun se targue d'être pour ses contemporains et dont la société est envahie dans quelque domaine que ce soit : accompagnateur, consultant, conseiller financier, dans un monde qui vire à l’organisation semi-privée de toutes ses activités. Au nord du square une vieille chinoise en pyjama fait une réussite sur une borne interactive que la mairie du 3ème arrondissement a installée pour le bien-être de chacun. Un homme dans la fleur de l’âge, bien mis, traverse le parc d’un pas vif en répétant : «Je te l’avais bien dit, je te l’avais bien dit. » Je ne vois personne à ses côtés, il téléphone.
Si tous s'ignorent c'est parce qu'ils se connaissent bien, se croisent ici tous les jours et fréquentent sans se saluer les mêmes couloirs de l’administration communale. Les autorités ont soigné le décor : roses trémières dans la rocaille, terre retournée au pied d'arbres étiquetés, canes et canards pataugeant dan la mare ceinte de basses clôtures de fer.
L’espace public ressemble toujours davantage à un grand parc protégé – où les activités de nature privée sont venues rejoindre les activités communément admises –, entouré de grilles protectrices en fer de lance relevant sans qu’on se l’avoue d’une instance psychiatrique généralisée.

Il n'y a guère que les enfants qui nous rappellent que la psychiatrisation du monde n’est pas achevée. Circonscrits à l’intérieur du square du Temple par un second grillage au fines mailles, ils jouent au paradis ou aux gendarmes et aux voleurs, suivent les pigeons qui passent au-dessus de leur tête.
En sortant du square, je rattrape à la hauteur du numéro 102 de la rue du Temple deux adolescents. Ils fuient. En training et en baskets. Ils ont certainement fait le mur.
Jean Prod’hom
Insurrection au lycée Victor Hugo

Théodore Delacroix me ramène à Eugène Géricault, je n’y puis rien. Le Radeau de la Méduse n’a jamais cessé de côtoyer dans mon esprit la Liberté guidant le peuple et mes insurgés ont toujours eu l’allure de naufragés, le sourire en plus, l’anéantissement en moins ; on se dresse, lève la tête, on agite son mouchoir ou une bannière afin d'attirer l'attention. Regardez, regardez la terre nouvelle et la justice qui se lèvent à l’horizon. J’ai souvent pensé que la liberté avait pour domicile un radeau à la dérive.

Comment sortir de l’étouffement dans lequel nous plongent mer et vie sociale. En entassant des cartons, des chiffons, des poubelles ou des pavés, radeau de fortune sur lequel on grimpe pour mettre la tête hors de l’eau et respirer. En se coupant du passé et des ports, en faisant table rase, voici venir les heures chaudes, il n’y a plus de marche à suivre, plus de portulan. On bricole ; la faim, la déshydratation et la folie menacent. Mais rien à dire là-dessus, une bonne manif ça fait du bien.
Lorsque le lycée Charlemagne apparaît au coin de la rue de Sévigné, les insurgés du lycée Victor Hugo les saluent, rires et cris. Mais les deux groupes ne se mêlent pas, on ne mêle pas le 3ème arrondissement au 4ème, le marais au marais Charlemagne à Hugo. Aucun des groupes ne veut que le sien se dilue dans une entité qui entamerait sa liberté et son indépendance. Les insurgés de la première heure sont contre toute centralisation, ils veulent vivre entre eux le nouveau monde et la justice, sur le radeau qu’il ont bricolé, avec leurs couleurs et leurs bouts de chandelle.
Les lycéens ont fixé sur la façade du lycée Victor Hugo plusieurs calicots de toile et de carton contre le ministre de l’Intérieur et les expulsions, tout autour d’une plaque en dur, silencieuse et fixée dans la brique, qui rappelle que, de 1942 à 1944, plus de 11000 enfants ont été déportés de France par les nazis, avec la participation active du gouvernement français de Vichy, assassinés dans les camps de la mort parce que nés juifs. Plus de 500 de ces enfants vivaient dans le 3ème, nombre d’entre eux ont fréquenté le lycée Victor Hugo.
Et que ceci a à voir avec cela. D’une manière ou d’une autre.
Jean Prod’hom
Calet mon ami

Du sommet de la tour Eiffel – vieille bourgeoise vêtue de dentelle de Paris – la ville semble bien petite. On distingue à l’oeil nu les feuillus qui l’ourlent et l’empêchent de déborder. Voir si petite et d’en-haut cette ville qui m’a tant effrayé autrefois sur un pont de bois du Bois de Vincennes me réconforte. Il fait un soleil d’automne et je resterais bien ainsi perché à démonter ces maisons pierre à pierre, ausculter les puits sombres de ces archipels et leur seconde vie sur les toits.
Les filles ne voient pas l’affaire sous cet angle et veulent accompagner leur mère aux Galeries Lafayette. On prend le RER jusqu’à Javel ; coup d’oeil à la réplique de la statue de la Liberté sur l’Île des Cygnes, pont de Grenelle, la Muette. On se sépare à Chaussée d’Antin La Fayette. Je décide, coup de tête, de ne pas quitter la rame de la ligne 9. Jusqu’à Montreuil.

A cause de trois petits textes d’Henri Calet : Mes copains, De bonnes nouvelles de Montreuil et Mes petits amis de Montreuil publiés par Combat et Réforme en 1947 et 1948, écrits pour donner un coup de main aux Amis des Enfants de Paris, une association que Robert, Serge, Marie-Claude et quelques autres fondent à la sortie de la guerre pour sauver le plus d’enfants possible, des enfants qu’ils attrapent lorsqu’ils se sont endormis sur les marches des stations de Pigalle, Anvers ou Barbès après le passage du dernier métro. Et que les animateurs de cette association emmènent jusqu’à Montreuil où ils ont mis la main sur une maison, inhabitée depuis le commencement du siècle. Un chantier qui nécessite du matériel, de l’argent et de l’aide. Calet offre la sienne en leur promettant d’écrire des articles appelant chacun à participer à cette aventure, c’est tout ce qu’il peut faire.
Il y a dans ces trois petit textes de Calet, comme dans tout ce qu’il écrit et touche, une grâce bienveillante qui réconcilie avec la vie et ses hôtes le plus récalcitrant des hommes.


Qu’est devenue cette maison, c’est cette question qui m’amène à Montreuil. J’hésite : Porte ou Mairie de Montreuil. Décide pour la seconde et me trouve devant la mairie. Je ne connais pas cette ville de banlieue mais quelqu’un me souffle qu’elle n’a pas changé. Emprunte le boulevard Paul Vaillant-Couturier, sans trop espérer, pensez donc, plus de 100 000 habitants, 10 000 maisons peut-être. La rue de l’Eglise est charmante, guigne à travers la baie vitrée de la Maison des Femmes de Montreuil, des femmes partout, faut pas s’étonner. J’entre, une permanente me sourit, je lui souris. Lui demande si elle sait où se trouve la maison qui a accueilli il y a soixante ans les Amis des Enfants de Paris qu’Henri Calet a soutenus. Non je n’ai pas d’adresse, elle me conseille alors de passer à la Mairie et de prendre contact avec les archives. Mais madame, demain c’est loin. Une autre fois.
Je me fie à ma bonne étoile, le soleil aussi qui réchauffe les rues Danton, Mirabeau, Désiré Charton dans laquelle des artistes dressent un fausse souche de bois mort. Je crois toucher au but lorsque je tombe à l’extrémité de cette même rue sur la Résidence Rochebrune. Pour l’insertion vers l’autonomie. Mais à y regarder de près, cet immeuble ressemble plus à un squat qu’à une maison d’accueil, et son architecture indique à l’envi qu’elle n’existait pas au milieu du siècle passé. Je renonce donc mais prends du bon temps, le soleil ne tarit pas d’éloges cette ville de banlieue qui a capté la vie et le sang du centre de Paris. Traverse une seconde fois la rue de l’Eglise et reprends le métro à la Croix de Chavaux. Reviendrai à Montreuil. Promis.

Retour au Riau, retour au texte même, à tout hasard. Tombe alors, comme il se doit, sur ce qui me manquait, l’adresse de la maison des copains de Calet que celui-ci mentionne à la fin de son article, au cas où des gens bienveillants voudraient bien leur envoyer ou apporter quelque chose, à tout hasard : 150, avenue du Président-Wilson.

Google earth
Google earth fait le reste. L’autre jour, lorsque je me dirigeais vers la Croix de Chavaux, j’ai passé tout près de la maison des Amis des Enfants de Paris, je ne l’aurais pas reconnue. Je l’imaginais moins haute, les fenêtres ouvertes et les façades blanches. Avec des cris tout autour, un chien mais sans grille ni portail. La maison des Petits amis de Montreuil est devenue méconnaissable.
Jean Prod’hom
Calligraphie au cimetière Montparnasse

Drôle d’ambiance l’autre matin dans la 12ème division du cimetière Montparnasse, loin de la surveillance de Charles Pigeon ; une pierre est roulée sur un tombeau vide, personne aux alentours. Plus loin un homme allongé s’affaire sous une ombrelle qui le dissimule, je m’approche ; il tient un pinceau, repasse en noir les lettres et les chiffres délavés des noms et des dates gravés sur le marbre. Il pleut.

Je le salue, il se redresse, on parle de tout et de rien comme il convient de le faire dans de tels endroits. Avant de s’engager sur une piste plus sérieuse.
Des transports routiers l’homme a fait le tour, il a commencé il y a quelques mois une formation en cours d’emploi de graveur sur pierre ; il y apprend la taille, la gravure, la calligraphie, le dessin de médailles et de blasons. Il compte rester chez son patron d’apprentissage pendant quelques années encore, le temps de parachever ses connaissances. Alors ce sera la province, marre de Paris, la Normandie peut-être, il y a du boulot dans la branche.
L’homme vante les mérites de la vraie gravure, la gravure manuelle ; il liste les défauts de la technique du jet de sable incapable de creuser la pierre en V, seul profil qui assure aux inscriptions une bonne résistance au temps. Il faut que l’eau s’écoule, la taille en V y contribue. Il est vrai que la lettre E résiste moins bien que la lettre I, c’est ainsi. A nous les calligraphes de faire réapparaître la lettre E lorsqu’elle disparaît, cette lettre est notre bénédiction. Il m’emmène dans la division 11 pour me montrer un bon exemple de ce qu’un homme de sa trempe sera capable de graver bientôt dans le marbre.
C’est l’heure de se quitter, j’hésite à lui demander encore quelque chose, un geste en passant, remettre une couche sur les E de la tombe de Beckett qui s’effacent, à deux pas de celle qu’il restaure. Et puis non, l’homme a assez de boulot, et il y a tant de E qui disparaissent.
Jean Prod’hom













Lemmes 11

Elle se plaint en salle des maîtres de la faiblesse de ceux dont elle a la charge, de leur incapacité à faire tenir ensemble ce qu’elle leur enseigne avant de lancer ceci : «Les connaissances de nos élèves ressemblent chaque jour davantage à des pans incomplets de briques dont il manquerait le premier rang.»
S’obstiner à leur demander d’empiler des parpaings est en effet un non-sens ; la connaissance n’a rien à voir avec un bunker, elle est un objet qui vit précisément de ne pas avoir de toit ; elle perd la boule lorsqu’on le lui impose et s’abîme par le bas, c’est sa manière à elle de dire non, de ne pas se laisser enfermer dans un sujet lui-même captif.
Jean Prod’hom
Il y a le pavé des rues piétonnes

Il y a le pavé des rues piétonnes
la nuit quand il pleut
les nuances de gris
il y a les concours de circonstances
les contrecoups
l’embrayage
il y a l’hypnose
le vin cuit
les glaciers et les devantures des fleuristes
Jean Prod’hom
Qu’une inépuisable, inexorable absence

A la fin plus rien n’est jouable. La pente est si raide qu’on n’essaie plus de remonter ses peines, en cet endroit où elles se mêlent à celles des autres, se réchauffent et cueillent les fruits de leur courage, celui d'avoir su remonter leur fardeau. Il dégringole les jours, plus bas encore que tout camp de base. Lui est devenu impossible de penser pouvoir un jour encore faire un avec lui-même, avec les autres et les alentours. Champs de chaume, hôtes anonymes, interminable allée de gravier.
Qu’une inépuisable, inexorable absence.
A force de retirer chaque mot superflu, il ne lui était resté que le silence.
Jean Prod’hom
Visage qui s'endort

Le bruissement d’une aile multicolore avertit que le ciel n’est plus à l’abri, ça entre et ça sort. Un homme couché sur un bûcher se réveille, sans question ni réponse, ne sait quoi faire de son désarroi, sinon marcher et pousser devant lui encore un peu de cette lumière qu’il a portée. Je me réveille de mon côté à la lisière d’une châtaigneraie, à deux pas des vignes d’Entagnes, des coques sur la tête et des brins d’herbe sous la main.
Visage qui s'endort.
A l’aube l’alouette lance son chant, quelque chose s’émeut plus qu’à l’ordinaire, tu pianotes du bout des doigts quelques mots illisibles. Un immense chagrin descend la vallée. On ne dansera pas ce soir sur la place du village.
Jean Prod’hom
On parle un peu de tout et de rien

Il n'est parfois plus temps d'écrire, libre ou sous contrainte, ou de se justifier, de ressusciter le passé ou rêver l'avenir, d'ouvrir ou de claquer les portes. Mais plus simplement de résister aux côtés de ce qui résiste, le lierre qui s'accroche, la coque de noix qui fait le gros dos. Pagayer avec les idiots.
Quelquefois tu viens me voir, tu t'assois. On parle un peu de tout et de rien.
Pourquoi les livres sont-ils souvent si longs. Que coûte un filet d'eau et à quoi les reconnaît-on. Que disent les bêtes, et leurs plaintes sont-elles formellement recevables. Que pèse un hortensia, et où commence-t-il.
Jean Prod’hom
Je ramène une constellation

S’il revenait au raisin de se gorger de soleil, aux baisers de mêler nos salives, s’il revenait aux sous-bois d'offrir un abri, aux bêtes d'y garder leurs secrets, au soleil de brûler nos plaies. S’il revenait aux lisières de se rire de la raison, aux lois d’enseigner la patience, aux chiens de se faire les dents, aux os de résister. S’il revenait au rire de faire douter la justice, à l'hiver de faire bon accueil à la bruyère, aux sorbiers la fête aux merles, aux heures d'être plus discrètes.
S’il revenait au mauvais temps de fournir mille alibis, aux erreurs d’introduire au pardon, s’il revenait au bon sens d'interrompre cette litanie, il reviendrait à cette ritournelle de faire de ces si un là.
Je ramène une constellation.
Jean Prod’hom
Mon seul présent

Le seul mot dont l’enfant dispose pour apprivoiser l’absence ne suffit pas. S’en ajoutent d’autres, l’enfant grandit. La détresse disparaît alors sous des piles de récits et de boniments.
Survient un jour l’appel inverse, dédire le livre et toucher terre, brasser la terre maigre et les mots premiers, jusqu’au rocher. Se réjouir de la zone de rupture et suivre le filon, au fleuret et à la massette, bégayer la galerie.
On ignore tous la même chose, chacun le sait. Comment dès lors offrir à notre ignorance la place qui lui revient, comment lever les traces de sa présence en usant des mots qui la recouvrent et la manquent. Retourner la bougie, la mèche et sa flamme, éclairer un peu de ce noir qui bouge dans le fond, sans début ni fin, lisière dont on ne sort pas, qu’on entre ou qu’on sorte du bois.
J’écris une philosophie. Inachevée et inutile.
Mon seul présent.
Jean Prod’hom
Pour franchir une frontière

Je suis à l'étage, tu es au salon. Pas d'alignement ici mais des décrochements ; la pente n’est jamais nulle, il y a des hauts et des bas. On roule côte à côte dans les vallées qui joignent le nord au sud ; on marche seul, ou main dans la main, d’ouest en est, le long de sentiers qui, je le crains, disparaîtront un jour. Qu’y pouvions-nous, il y avait matière à davantage.
Pour franchir une frontière.
Nos temps n'ont pas même origine. Ils se superposent et coulissent comme des plaque tectoniques. Lorsqu’elles se rejoignent, on boit un thé. J’ai trouvé un passage secret qui traverse l'épaisseur des pages d’un livre. Chacune d’elles en protège l'accès. Je glisse sur ses parois, bivouaque sur d’étroits replats, passe à la ligne, invente des rampes d’escaliers, saute de bloc en bloc comme au eu de l'échelle.
Je tourne aujourd’hui le dos à l’idée d'entretien infini, sans abandonner aucune des vertus cardinales. Je ne suis pas du coin, débouche au-delà du point à la ligne et prends l’ascenseur.
Jean Prod’hom
Comme un parfum

Silence, tu as fait le pas. Assez payé ton dû, assez ravaudé les barreaux de ta prison. Au diable les soutraitances et les fidélités abstraites, au diable les récits qui maintiennent en état nos certitudes. Tu as remisé les filets. Je décroche moi aussi de ma propre langue, me dégage d’une lévitation qui m’abaisse, claudique. Pas d’oeuvre mais des passages ; la première est un poison inodore, les seconds sont des cols.
L’hydre s’agite, la menace s’étend, à quoi bon s’en défendre. Rejoins le labyrinthe, les mots ne se plient pas à la volonté de la phrase et à ses ronds de jambe. Dire et veiller comme dans un rêve. Je te suis sur ces équilibres subtils où la raison se rétracte, où le dehors remonte de dessous et le dedans le suit dehors. Je sors déchaussé dans le chaos des mots rugueux, souffle sur la langue et ses pouvoirs latents pour faire entendre une voix qui porte l’odeur de l’eau et du pain d’épices. Comme un souvenir.
Comme un parfum.
Jean Prod’hom
Le soir si je peux

La vie dépend-elle de la liberté en ce sens que celle-ci permet de faire le choix de renoncer à celle-là ? Ou alors la vie est-elle une donnée primordiale, essentielle, qui préexiste à tout exercice de la liberté ? demande Tristan. Tu as choisi.
Je lis désormais tes poèmes, des poèmes vivants, délivrés, qui font entendre ce qui fut, en deçà et au-delà de ta mort.
Le soir si je peux.
Jean Prod’hom
Ce pourrait être un visage

Quelques fruits oubliés dans un compotier, une ambiance de nature morte, personne sur la place. Tu longes le pot-au-noir, taille un poème à bout de bras dans lequel souffle la fraîcheur des cales. Tu croyais qu’un seul mot aurait pu suffire pour soulever la chape et faire danser la place. Sans y toucher. Et c’est une image du vent qui vient, celle de la manche d’une veste oubliée sur le rebord d’une fenêtre, celle de linges blancs flottant à l’étendage.
Ce pourrait être un visage.
Celui d’un inconnu, le mien peut-être, ou le tien, indiscernable, car les choses ne font qu’une malgré les apparences, plongé dans un milieu qui ne renvoie à aucun au-delà de lui-même, s’étend comme le jour lorsqu’il se lève, un jour mitoyen. On y voit danser de petites particules d’immortalité et on entend dans un transistor le tube de l’été.
Jean Prod’hom
Qu'y a-t-il derrière ce qui n'a plus de sens

Effrayant, du pain sur la planche en pagaille, dont se saisissent chaque matin de solides gaillards bâtis pour écoper. Les ordres se chevauchent, les sous-chefs se bousculent, chambard de cris et de peines, évitements, amoncellement de détails, têtes présentées sur des plateaux. Une vague de justifications jusqu’au soir, l’extension diffuse de l’inarrêtable.
Qu'y a-t-il derrière ce qui n'a plus de sens?
Une plate de Bretagne le ventre pris dans la vase. Un ponton. Le passage d’une corneille. De la tourbe et de la bruyère. Guère plus et c'est bien.
Jean Prod’hom
Et croître

Les orpailleurs sont étendus dans le pré où le vent chantonne. Sans partition. Tu me dis que la poésie justifiée est un avatar de la technique et me demande pourquoi on se dope de contraintes supplémentaires. Il suffirait de ne pas raidir les lignes de fuite avec des barres de fer, les laisser flotter comme des étendards. Echapper aux griffes, aux crocs. Respirer. Lever la tête et creuser.
Et croître.
Et aller comme un fruit sec, comme une fève ou un marron qui franchirait dans ta poche le détroit de Corinthe ou le canal de Panama.
Jean Prod’hom
Je reste où c’est le moins profond

Il est plus difficile de concevoir le moins que rien que le rien lui-même, et y demeurer.
Se glisser par l’ouverture du portail disparu qui claquait à ciel ouvert. sur un pan incliné, Flotter à mi-pente, entre le durable et le passager, en maintenant du jeu pour aller assez loin et n’y être pas rejoint. Se garder de ne pas s’y retrouver enfermé ou d’y être arrêté, intrus ou brigand, non je n’ai rien à déclarer, oui c’est mon domicile. Tout se désencombre, c’est un panorama immense qui se présente, des limbes frémissantes où rien vraiment ne se termine ni ne commence.
Je reste où c’est le moins profond.
Jean Prod’hom
J'avais besoin de l'écrire

Glissade ou déraison, le temps ça ne passe pas, j’en atteste. Il est tel que je l’ai laissé à Riant-Mont, avec ses hauts et ses bas, j’avais 10 ans, arbres et racines accrochées au talus. J’entends de nouvelles chansons sous les fenêtres ouvertes des studios modernes, on a bien changé quelques tuiles au pigeonnier et remplacé les escaliers par une place de parc.
Quelques chose résiste pourtant là où je reviens, passe et veille comme une racine. Bien sûr le décor s’est obscurci et la poussière recouvre les feuilles de houx, mais quelque chose expire et inspire en-dessous. J’ai pelé l’oignon, l’accessoire colore le ciel, ne me reste que le radeau immense et vide sur lequel je me dresse, le silence tendu sur lequel je marche. J’ai besoin de l’entendre.
Toujours ce mouvement de la bête qui tombe sur le dos avec le ciel au-dessus de la tête et qui se retourne avant qu’il ne soit trop tard. La porte s’entrouvre et le jour vient, ne pas s'engouffrer, ne pas avoir à tomber de trop haut. Rapprocher ce qui passe de ce qui dure jusqu’à les confondre. Personne sur le banc au pied duquel l’enfant se jouait de la mort en criant sur sa draisine accident mortel. Plus de draisine mais le jardin qui n’a pas bougé.
J'avais besoin de l'écrire.
Jean Prod’hom
Il y a quelque chose autour de nous qui ne sert à rien

Il y a des pommiers dans le verger, de vieux pommiers. Eux et moi nous sommes très d’accord mais nous nous ignorons cordialement. Le lierre, les mousses et le gui nous paralysent année après année.
Il y a le lac. Il y a le soleil et ses ombres qui dansent sur les crépis bleutés de l’ancien lavoir. L’eau clarine à la verticale de l’anche de fonte, pierres chenillées et fers grépés, bouteilles d’eau en équilibre sur la pierre ronde et inclinée du rinçoir, je vis sous la dépendance de mots qui ne sont pas les miens, mots d’absents, de fonteniers et de lavandières. Assis sur le banc de grès, je me souviens des paroles du prêtre de Poliez : « Une vie ça se cherche, lorsqu’on l’a trouvée c’est fini. » Ce n’est pas assez.
Il y a quelque chose autour de nous qui ne sert à rien.
Jean Prod’hom
Sinon...

La barque est pleine. De soutiens et d’encouragements, d’idées, de projets. Que d’aisance, de talent, de facilités. Mais pour quel océan ?
La haute mer, la mort les gens n’en veulent pas, églises et campagnes vides, messe sèche. Se ressaisir à temps.
Sinon...
Jean Prod’hom
(CQR) Tu es celle qui veille

Quelque chose de court, quelque chose de léger, quelque chose de facile à emporter. Il pleut sur Dizy, je te fais parvenir les légendes de notre voyage avec le mousse. Promis, je ne dépasserai pas les bords de la carte. On y voit les bois de Ferreyres et, au fond, la carrière jaune. A quoi bon nous encombrer. (P)
Tu es celle qui veille.
Que d’amour il m’aura fallu pour que ma langue se délie, que de silences pour que je réduise ma voilure.
Jean Prod’hom
Le petit cheval de mer

J’ai reçu l’autre jour un gentil mot. D’habitude je n’en dis rien, je les glisse dans une boîte d’où je les ressors pour les suçoter lorsque le mauvais temps rend la vie amère. Elle s’appelle Elisabeth.
Le soin que je mets à écrire, dit-elle, lui fait penser « au soin qu'on met à pincer les tomates, à répondre à l'enfant, à faire bien son métier. » Je trouve que c’est joliment dit. Elle tenait autrefois un blogue que les circonstances l’ont amenée à laisser en friche. Je suis allé voir, ça vaut le détour, il s’appelle La pêche à la baleine.
Voici ce qu’elle écrit après : « Je me demande si le fait d'accepter une nouvelle fois d'être émue par les mots d'un autre n'est pas un signe qu'il faudra m'y remettre. » C’est beau, non ?
Et puis il y avait un cadeau attaché à cet envoi, un petit cheval de mer. Une occupation de gamin qui me plaît bien et qu’elle présente ainsi : « Coquillages et bouts de truc : vous aurez compris que le jeu, la note juste, est de ne rien déplacer, ni une algue ni un grain, de ce que la mer a amené. » J’ai bien compris et je dépose votre cheval au pied de mon brise-lames.
Portez-vous bien vous aussi.
Jean Prod’hom

Juste ce qu'il faut

La vieille ne cherche plus à mettre la main sur ce qui se suffit à lui-même, elle conçoit des motifs à l’emporte pièce et les brode sans tambour ni trompette, des napperons aux vides si lâches que le soleil ne s’en aperçoit pas. A l’angle de la véranda une araignée tisse sa toile.
Ne rien avoir à sacrifier pour ne pas avoir à gonfler ce qu’on est, une table ronde pour poser la théière, une fin d’après-midi, des fruits et le chat qui dort, les enfants du parc qui s’envoient en l’air sur un tapecul, aucune vérité n’est apparente. Rien n’est caché de ce côté-ci, ni de ce côté-là. Mais quoi alors ?
Juste ce qu'il faut.
Jean Prod’hom
Tout s’est déplacé d’un coup

Ne pas fermer l’oeil, reprendre, saluer encore ce à quoi j’ai attaché mes jours. Faire tourner une fois encore la clé qui a assuré l’équilibre de ce que j’ai, lisant, vécu, avant qu’il ne disparaisse dans son propre axe. Refaire le trajet qui y a conduit, étape par étape. C’est cela peut-être que traduire, dans sa propre langue ou dans une autre.
Accepter alors, parce que je tiendrai ma promesse, que ce qui fut à l’avant de moi s’estompe et que ce que j’ai écrit s’éloigne, tandis que se dresse un nouveau chantier que je ne soupçonnais pas et qu’il me faudra mener à terme.
Tout s’est déplacé d’un coup.
Les accès de l’amont et leurs abords se sont resserrés, je ne sais rien de l’aval, rien de ce nouveau paysage que je survole dans un avion de papier, pétales d’un autre ciel. Mon embarcation est retenue depuis soixante jours, j’ai parcouru les trois quarts de mon périple, je vois la fin. Je perçois le souvenir qui pâlit, le détachement qui s’installe, comme une brume, et le dehors qui perce, comme la pointe d’une aiguille. Reprendre bientôt chacune des apories, les réorienter vers ce qu’elles contiennent. Charger en attendant une vingtaine de sacs dans la nacelle avant de couper les fils et l’envoyer au ciel. Ne rien garder si je veux demain aller encore les mains nues.
Jean Prod’hom
Ce qui aura lieu ne sera qu’un récit de nomade

L’enfant exilé au fond de lui-même rassemble, avant qu’il ne se disperse dans la rumeur des réfectoires, ce qu’il a entrevu dans le prolongement de septembre.
Choses que l’on ne voit pas
Le temps qui passe
Une partie de soi-même
La vie
L'air, qui est pourtant très important
Le passé et le futur sont bien plus grands que le présent, pourtant on ne voit que le présent
Le vent tout puissant
Un bébé qui n'est pas né
Et pourtant pas un vieillard qui vient de mourir
Les problèmes
Celui qui veut être vu
Difficile de faire taire les mots à l’intérieur du langage ou de les en éloigner. Je voudrais avancer à lents coups de rames en ne gardant que quelques verbes aux allures primitives, ceux qui nous font respirer lorsque notre chemin nous déroute. Je suis un amateur d’éphémère et de paperoles.
Ce qui aura lieu ne sera qu’un récit de nomade.
Jean Prod’hom
Pour aller où je veux

Le réveille-matin les fait fuir chaque matin. Inutile toutefois de prendre rendez-vous avec eux, ils sont là lorsque je me fonds le soir dans leur pâte noire. Ils portent d’autres noms, endossent d’autres formes, s’animent et se confondent avec leurs masques. J’ai été cette nuit premier de cordée, me suis attardé auprès d’un gardien de quartier, j’ai laissé des empreintes dans un espace où les connexions se chevauchent et les perspectives s’incurvent, où les relations mises à plat se métamorphosent en emboîtements de nuages mous. Impossible de distinguer l’araignée de la toile. Le marionnettiste serré de près par les fils de sa poupée se retourne mollement dans ses bras, l’un et l’autre ignorent qui des deux rêve.
J’accueille chaque nuit les insomnies d’un rêveur, mais à la première vague les traces de ses aventures s’effacent, à perte de vue. Impossible de retenir quoi que ce soit lorsque le jour me tire par la manche, je suis nu. Ses aventures liquides ont rejoint au pied de la lune celles des enfants, des chats et des chiens. Nous avons chacun assuré la partie d’un même rêve, à l’image de l’entretien sans fin que les hommes mènent sur la terre. On se partage la déception de ne pas comprendre.
Je sors la tête de l’eau, fais une balade, quelques courses, de quoi assurer ma subsistance. Jusqu’au jour où je ne me réveillerai pas, sans savoir alors si c’est l’insomniaque que j’ai accueilli qui s’est éclipsé, ou si j’ai été capable de me hisser sur les berges de l’autre rive.
Pour aller où je veux.
Jean Prod’hom
Fond qui restera blanc

Si nous acquérons des savoir-faire, rédigeons des mémoires, lisons des modes d'emploi, si nous assurons les mises à jour et les révisions de nos parcs techniques, c’est pour être suffisamment outillés lorsque viendra le moment de faire demi-tour pour remonter par les galeries du langage aux abords du bing bang, jusqu’à la chape de silence dans laquelle les fers de nos édifices et de nos institutions trouvent leur ancrage. Condamnés toutefois à reprendre la pelle et la pioche quand nos outils sophistiqués s’avèreront inutiles pour saisir l’état d’âme qui nous animait lorsque nous avons décroché il y a un million d’années. Comprendre un peu de ce qui s’est passé, de ce qu’on a laissé au carrefour sans nous retourner, la frondaison à laquelle nos chevelures se mêlaient, le ciel et la terre dont nous sommes faits, les êtres chétifs que nous sommes restés et que les bêtes fuyaient déjà. On n’a pas avancé d’un pas.
Fond qui restera blanc.
Le présent est sans aspérité, sans le moindre bord auquel s'arrimer. Mais les appendices du passé et de l’avenir, l’un plein à ras bord, l’autre aussi maigre qu’une peau de chagrin, ont permis de réduire notablement l’étendue du présent, avec en bruit de fond le tintamarre des orgues de la raison orchestré par le dieu des Horaces.
Jean Prod’hom
Ecrire n'est qu'un toucher

La grue de l’entreprise de travaux publics montre le sud sans y croire vraiment, les nuages plus décidés filent vers le nord, lâchent soudain à la verticale le grain de la côte atlantique. J’ai repris aujourd’hui un à un les tessons placés dans de vieilles casses d’imprimerie. Brouettées ramenées du pied des brise-lames de Bretagne. Les ai déplacés dans le meuble Bisley bleu rapatrié en août, jeté la paperasserie qu’il contenait. Laisser venir, sans aller contre.
Ces pierres domestiques ont même origine que les mots nés des fosses, brassées dans la même eau. Les reprendre une à une pour faire entendre leur respiration, la leur et celle des doigts qui les pincent. Double respiration, double opacité, même chantier. Faire entendre la mer, retrouver les mains qui les ont laissé glisser. Quelques mots nus, limpides et fuyants. Rien à endiguer, rien à ajouter.
Ecrire n'est qu'un toucher.
Jean Prod’hom
Sans qu'on s'en aperçoive

Rien ne s'ouvre du dedans, un bouchon de cire assure la fermeture du dehors, recouvert par les restes du chant d'un vieux grillon. Il pleut. S’appuyer contre le rebord de la fenêtre et prolonger les heures qui s'empilent tout autour, avec l'odeur de la pluie mêlée à son claquement sec sur les feuilles des feuillus. Les enfants lisent à l’étage des bandes dessinées dans leur sac de couchage. Le tonnerre a fait éclater nos destinations.
Sans qu'on s'en aperçoive.
Ne rien troubler avant que la fatigue ne me jette de l’autre côté. Un café. C’est la fin de l'après-midi, rien à empaqueter, me coucher perpendiculairement à la pente pour ne pas être entraîné. Déferlement d'eau, pneus sur le bitume. Quelque chose de vivant pourtant fait la planche dans ce déluge.
Jean Prod’hom
Le grain moulu de trois mots

Enseigner la ponctualité, la répartition des tâches, les lourdes charges, les conformations, les liens d’hospitalité. Ou les chemins de traverse, la désobéissance, la vie solitaire, la mauvaise herbe et l’impossible classification des champignons. Les deux.
C’est ainsi seulement que nos enfants nous tourneront le dos, sans tout comprendre, avec quelques images contradictoires, peu importe lesquelles, dont ils tireront des plans, un film ou une vie, et sur lesquelles ils reviendront un jour s’ils le veulent, pour infléchir le cours des choses et faire un peu de lumière sur ce que nous n’avions pas vu venir. Tenir haut la clé des champs.
Le grain moulu de trois mots.
Jean Prod’hom
Demain je n'aurai pas fini

Lis aujourd’hui la cinquante-troisième lettre que tu as adressée à ta bien-aimée avant d’aller marcher dans les bois. J’aiguise l’arête qui donne à chacune d’elles l’équilibre de l’épi, suis les pentes jusqu’au bas de la page, remonte le dos blanc accompagné de ce que je ne comprends pas.
L’alléger encore, en replier les bords, la déposer plus loin, sur du papier ou sur un banc, et qu'un passant s'il le veut l’emporte pour redéployer d’hésitation en hésitation l'inachevé qui l’habite. Y retrouver tes pas, apercevoir les miens ou tracer une nouvelle voie.
Demain je n'aurai pas fini.
Seul au bord du lac un tesson dans la main. L'eau et le sable ont donné un visage à ces morceaux de la vaisselle du monde. Inutile désormais d’en appeler à l’archéologie ; oubliée la velléité de reconstituer le plat ou l’assiette dont ils proviennent. Je me satisfais de cet inachevé poli par l’eau et le vent, l’acte sans fin de la disparition. Je regarde ce soir quelques-uns de ces morceaux de paradis, apaisés.
Jean Prod’hom
Et loin dans la campagne
On arpente l’intérieur de volumes en creux,
on ne sait pas où est le bout de la nuit là-dedans.
(François Bon à Alain Veintstein, Du Jour au lendemain)

Se réveiller à l’intérieur du sommeil, là où la nuit se retire et fait son lit. Y occuper tout l’espace, du choeur au berceau. Je m’affaire dans le ventre de cette cathédrale entourée d’une eau épaisse et noire dont je suis l’involontaire servant. J’entends alors deux ou trois mots en ronde-bosse oscillant sur un socle de pâte préverbale.
Un insomniaque orchestre mes rêves du dedans, tu y es peu présente. Je t’évite ainsi de me rappeler au réveil ce que j’y ai laissé. Je ne saurais te dire qui dort quand je dors, ni où tu es, nous ne logeons pas dans les mêmes quartiers. Mais lorsque je m’éveille dans le noir, j’entends ton coeur résonner tout à côté, derrière l’un des murs mitoyens des cellules de notre nuit.
Et loin dans la campagne, un hululement.
Jean Prod’hom
Pensée qui remonte à chaque pas

Lever le couvercle. Découvrir sous la dalle de granite les innombrables galeries que la vermine a creusées et que l’air libre comble. L'homme s'active au-dessus, creuse les siennes à ciel ouvert, n’hésite guère, varie les vitesses, se décale, cherche à rejoindre celui qui le précède, prend de l’avance ou du retard, se perd, traîne boulets et projets. Certains relèvent une carte, d’autres font des listes. Panique chez les corneilles. Leur cri à la cime de l’hêtre est un cri de détresse.
Je leur tends une grappe de raisins sur une assiette. Elles retiennent leur souffle un instant, plongent et s’envolent la bouche pleine, il suffit que nous levions les yeux vers le ciel pour baisser les armes.
Pensée qui remonte à chaque pas.
Jean Prod’hom
Tu me fais comprendre

Il vient du bout de l’allée, s’assoit en face de moi. Aucune indication sur son visage sinon les soucis de la veille et la fatigue du jour. Un visage sans prise, sans carte, un visage aussi nouveau que celui d’un nouveau-né.
Pourtant, quelques mots sur le temps suffisent, une voix, un grain. Une dérobade, un sourire, sa main et, d’un coup, tout se met en place, pour toujours. Ce que j’entendrai lorsque il ne sera plus là, ce dont il se souviendra lorsque j’aurai disparu. Ce que nous laisserons tous deux à ceux qui resteront, des simulacres, des petites perceptions qui flotteront autour d’eux comme l’ivraie dans le vent.
Tu me fais comprendre. Et je comprends.
Jean Prod’hom
Le reste n’est que l’histoire d’un petit village

Songer à tous ceux qui ont aimé la terre donne le vertige. S’en est-elle une fois avisée ? Les hommes éconduits la mettent en pièce pour lever son secret.
Elle demeure entière.
Le reste n’est que l’histoire d’un petit village au bord d’une rivière.
Jean Prod’hom
Ta venue était la mienne

Ta venue était la mienne.
On a gardé les pieds sur terre, construit notre vie comme une voie de chemin de fer, en déposant devant nous ce qu’on avait sur le dos. On a bâti des maisons, tracé des balades, fait des enfants. A l’estime, en bricolant des amarres passagères, avec le soin des démineurs et l’insolence des demi-dieux, l’oeil sur le doux et l’amer.
En honorant plus tard ce à quoi on tournait le dos, la jeunesse, les rêves, les plans foireux, les promesses en l’air, les contrées lointaines.
Le réel est hors d’atteinte. Inutile d’attendre.
Jean Prod’hom
Journée qui n’en finit pas

Assez pris les devants, cherché des raccourcis, fait des miracles. Assez marché sur l’eau. La bouée est au garage, aucun billet sur le coeur, nulle parabole en mémoire cache.
Journée qui n’en finit pas.
J’avance sur les fers et le bitume, dessous la terre ne respire plus.
Jean Prod’hom
Tu entends : il n'y a qu'un oiseau.

La vieille fait un mot fléché. Elle n'écoute pas, alors il ne dit rien, regarde la ligne d’horizon par dessus le verger, tend l’oreille sans cligner les yeux.
Ils n'ont pas d’enfants mais des amis viennent parfois leur rendre visite. Aujourd’hui ils sont seuls, deux infirmières fument une cigarette à l'angle de la terrasse de l'établissement. Le kiosque est fermé, le repas sera servi dans le réfectoire.
Tu entends : il n'y a qu'un oiseau.
Jean Prod’hom
Pourquoi si peu

Un moment le matin lorsque la rosée et le vent jeune s'attardent sur le pré et la peau, et qu'on a la naïveté, le courage aussi de ne pas subordonner sur le champ notre vie à ce qu'elle devrait être. Entre midi et deux lorsqu’une venelle parallèle au boulevard nous conduit au feu qui couve ; deux ouvriers cassent la croûte sur le rebord d’une fontaine, à l’ombre, le visage sec.
Le soir dans le jardinet, une anisette et quelques olives tandis que le jour brûle ses dernières forces sur la grille du barbecue.
Pourquoi si peu.
Jean Prod’hom
Tu es celle qui verse l’eau

Les avalanches bousculent les prévisions, jamais l’inverse ; tu répétais en souriant que l’orage n’était que par accident un mot de cinq lettres, tu nous racontais aussi qu’enfant tu entrouvrais les portes, celle du logis verrouillée par la peur, celle de la nuit aveuglée par les livres.
Sortir la tête de dessous le lit, reprendre son souffle, par paliers, c’est-à-dire en empruntant les marches sans contre-marches de l’escalier qui monte de la cave. A contre-sens. Jusqu’au bout. Là où le regard embrasse la mer, la terre et le ciel tout entiers. Ne pas plonger. Ils sont tous là en bas sur le rivage. Les rejoindre par le sentier qui zigzague dans la lavande. Ne toucher à rien.
Tu es celle qui verse l’eau.
Jean Prod’hom
Qui respire

Le vif est sans limite, mais sur le seuil la rhétorique veille. Ajouts, remplacements ou omissions volontaires, raccourcis, sous-entendus, ruses par lesquelles on laisse supposer que ce qui manque pourrait être comblé, par lesquelles on se retranche en retranchant, par lesquelles on allonge le cercle de ses amis. Or le manque surgit en même temps que le monde dont nous sommes absents. Ce manque que relaie la poésie nous prépare à débouler sous le ciel.
Qui respire.
Il est 4 heures, l’enfant a la bouche pleine, pain et chocolat, la tête ailleurs. Une phrase encore, il lève les yeux, le voici dehors avec la liberté aux pieds. Sans assistance.
Jean Prod’hom
Il y avait de l’encre

Accepter l’invitation et entrer. Sans se retrouver captif du tableau des regrets sur lequel s’ouvrent si souvent les fenêtres du dedans. Sortir donc, en boutant le feu aux brindilles laissées dans un coin du jardin.
Y poser d’emblée le repentir sur sa pointe, l’élaguer jusqu'au détachement. Ne rien ajouter, ni ponts ni chaussées, le silence n’est pas une ellipse, il maintient debout les êtres qu’il unit et sépare.
Rien ne peut être dit autrement que dans l’obscurité d’un puits de lumière, il n’y pas de coïncidences, pas d’autres issues, écrire noir sur blanc en frappant deux silex.
Il y avait de l’encre.
Jean Prod’hom
Dès l'aube

Soulevé dans le creux d’une vague, mené à ceux qui le veulent bien et qui passent sans avertir. Tout le monde sait tout mais comment le dire, comment prendre acte du regard millénaire de chacun et garder la piété primitive. Reprendre le dialogue interrompu avec l’invisible.
Dès l'aube.
La nuit qui tombe n’est pas une défaite. Ne pas se débarrasser de ce qu’on ne sait pas, ne pas perdre la trace de ce qui n’est plus. Nos vies sont constituées du vivant des morts et du verbe. Déchiffrer ce monde premier et danser sans compassion autour de ce qu’on remettait à plus tard, se retrouver sur un front toujours plus large. Ecrire et lire sont des cérémonies qui nous mettent du bon côté, on n’y rencontre ni avance ni retard.
Jean Prod’hom
De quoi faire un nid

C’est jour de rentrée, quelques enfants remontent pieds nus la Valleyre. Dans la cour, les hommes du sérail se dissimulent derrière une pile de cahiers des charges en jouant solidaires à un deux trois soleil. On va au mur, chacun pour soi. Ils sourient, n’ont rien fait, nous moins encore.
Ouvrir la porte, laisser entrer dans la maison les mots et les silences qui poussent derrière chacune de tes lettres. Ceux du dehors, immense et solaire dont tu es resté l’hôte prévenant, ceux qui doublent la peau de nos vies refroidies, ceux qui chantent. Le lyrisme des désespérés.
De quoi faire un nid.
Jean Prod’hom
Il y a le reste

Il y a l’être en tant qu’être, bien sûr, le paon qui fait la roue, le paon qui tue, il y a la chambre des enfants, les squales, les réserves, les dépenses, le négociable, les aires de dépose. les quincailleries, les petits calculs.
Il y a le reste.
Mais il y a aussi ce qui vient après le tout, et après le reste du reste, lorsqu’il n’y a plus qu’un rien qui nous attache solidement à la vie : une rampe d’escaliers, un rebord de fenêtre, tes lettres, ton journal, ton absence, l’ombre d’un ancien canal, la roue d’un moulin.
Jean Prod’hom
Si tu le veux

Le sorbier n’atteindra pas le ciel, c’est sa manière à lui de consentir sans trembler. On a beau dire et faire, quelque chose barre la route que l’homme suit, et ce quelque chose il l’y a mis, et ce quelque chose est tout autant la fin que la route qui y conduit. Qu’il soit infini ou sans issue, le chemin divise, rien ne recollera les talus.
Être de nulle part et aller nulle part, remiser les échelles, demeurer inconnu dans son aire, l’arbre plutôt que la bête, la candeur plutôt que la peur. Un verger, un enfant y cueillera un jour des fruits.
Si tu le veux.
Jean Prod’hom
Ecriture qui ne peut pas se contenter d’écrire

L’indigent, les coudes sur la table, bataille derrière les brouillards qu’écarte le soleil de l’arrière-été, il est assis contre un arbre avec un papier et un crayon. Il ressemble à un déménageur, chemise à carreaux lie de vin, petites mains boudinées, doigts-hochets. Les enfants sont à l’école, leur mère à l’autre bout de la ville. Le chien a commencé de gros travaux qu’il ne terminera pas, il s’endort.
Nous sommes tous absents, aussi absents que ce dont on s’absente, voici ce qu’il se dit au retour, ni le vide ni le plein ne débordent de leur place, personne ne répond à nos demandes, nos vies sont des draps qu’on déplie.
Difficile de dire ce que c’est que dormir, ou voler, ou marcher, tout autant écrire où s’échangent ce que je fais de mes mains et ce que tu prends. Je cherche ce matin un peu de réconfort auprès des arbres qui m’épaulent. M’inquiète de ne pas m’être assez méfié des concessions, des pièges de la prétérition, de ne pas avoir pris assez de distance avec les propositions finales et leurs conséquences. Je quitte la cuisine.
Ecriture qui ne peut pas se contenter d’écrire.
Jean Prod’hom
Pendant une heure ou toute une vie.

Pluie et boue et seul face contre mur porte fermée.
De l’autre mère terre et soeur lune, le cantique de frère soleil, les étoiles et frère vent, l’air, les nuages et le ciel serein, soeur eau, frère feu, fruits et fleurs diaprées, herbes et pardon, une fenêtre ouverte.
La rédemption tient à un fil.
Pendant une heure ou toute une vie.
Jean Prod’hom
Et seulement du bout des doigts

Ne pas retoucher aux morceaux, nouer le proche au lointain, par le milieu, le fil d’acier à l’horizon, comme les hirondelles le font chaque année en suivant le tracé de l’ancien canal.
Et si personne n’entend, en parler encore, plus bas. Eux. Sans toi.
Et seulement du bout des doigts.
Jean Prod’hom
Je sais que tu penses au petit, à sa mort

Le tram arrive de la gare à la hauteur de l’hôtel du Nord, le néon clignote. L’inconnu dans l’allée a la tête dans le sac, va et vient sur un damier avec de la sciure dans la tête, s’assied sur un banc sans s’ébrouer. Il va somnoler comme hier et avant-hier jusqu’au soir dans cette embarcation de fortune, à l’ombre d’un platane qui le met à l’abri des restes de lui-même. Son nom est celui d’un étranger, il ne répond pas, ses mains ne lui appartiennent plus, elles demeurent à l’intérieur des manches de son veston rapiécé.
Tenir debout, personne n’y croit plus, car l’homme n’a pas la tête à calculer les forces en présence, il respire sans fil à plomb, se voile la face lorsqu’on allume les réverbères.
Cet homme est un saint, me disais-tu, il séjourne sur un monticule de vertus, les yeux secs, étranger au jeu des questions et des réponses. Il se rend d’une seule traite jusqu’à la tombée de la nuit, se couche sur le paillasson de l’école Cadichon. Le dernier tram revient à l’angle de la place du Centenaire, les réverbères s’éteignent.
Je sais que tu penses au petit, à sa mort.
Jean Prod’hom
Là : un oiseau pourrait se poser

Les ouvriers ont tourné le dos aux pelles et aux pioches, cherchent l’ombre, les cloches de l'église lâchent alors leurs douze coups. Deux sonneries prennent le relais, les enfants se pressent hors du collège et quittent la cour, à la hâte, comme les aigrettes d’un pissenlit. T’as beau chercher, il n’y a bientôt plus personne, des ruines. On entend dans le lointain le bruit d'une fourchette contre une gamelle et on devine le vent dans le gréement des ombellifères. Partout une respiration, creuse et profonde, un souffle au large bord qui pousse le silence bien au-delà de ce qu'on peut entendre.
J'avais 10 ans et habitais Riant-Mont, j’étais seul comme seul un gamin peut l'être, la chaine des raisons avait lâché, mes héros s’étaient éclipsés, plus de oui mais, plus d’histoires, seul aux prises avec un dimanche vide, sur une place immense que je crois reconnaître aujourd’hui. Il est midi, ma tête finit de se vider. Le silence se met à grésiller comme un vieux 33 tours, le lointain s’élargit au-delà des limites du chantier. J’ignore bien comment la routine reprendra la main sur cette fondrière.
Là : un oiseau pourrait se poser, sans crainte.
A 13 heures un innocent jette la première pierre, puis un deuxième et un troisième, d’autres terminent les travaux, la paix se rétracte, les camions ouvrent alors leur gueule.
Jean Prod’hom
Par ceux qui désignent la lune

La table de formica est appuyée contre le vieux pétrin, recouverte par de la paperasse, des commandements de payer et un verre vide. Les sourires des visages qui trônent sur la commode ont fait des locataires de ce deux pièces des exilés dont j’aperçois dans le quartier la chevelure et l’inaltérable beauté. Aimés par ceux qui les croisent, les comètes, les oubliés, par ceux qui n’ont rien à perdre, ceux qu’un rayon de soleil fait vivre une fois pour tout, par les amateurs de rédemption, les anges.
Par ceux qui désignent la lune.
Ils tiennent le coup.
Jean Prod’hom
En faire un monde

J’entends une sirène qui me rappelle l’urgence d’aimer les vivants, de repousser la mort sans me soumettre à sa menace. Mais elle me rappelle aussi ce à quoi elle m’oblige : inventer, chaque jour et de toutes pièces, c’est l’autre urgence.
La mort est le signifiant d’un manque. Quant au reste il n’a pas de nom ; de moindre puissance il vit les fenêtres ouvertes, se faufile et a la couleur de l’imprévu, chante comme un oiseau. Je l’habille avant de le remettre à l’eau et il file. J’ai fait mon travail.
En faire un monde.
Jean Prod’hom
Vie reste vie | Mort reste mort

Tu te penches vers le visage de l’absent qui s’efface lorsque tu t’approches de son secret. C’est ainsi que tu mesures la distance qui te sépare d’eux. Et moi, lorsque je me retourne pour m'assurer que le poisson arc-en-ciel que je croyais avoir saisi est bien dans la nasse, vivant, il me glisse des mains et s’éloigne, comme ces taches de lumière que je ne lâche pas derrière mes yeux fermés et qui rejoignent à grandes enjambées le ciel et les étoiles. Le chant est la trace d’un silence qu’on ne retient pas, il ne fera pas fléchir la loi.
Vie reste vie
Mort reste mort
Sisyphe et les Danaïdes perçoivent l’écho du chant d’Orphée dont la voix s’est tue. L’effroi des bêtes sauvages et les durs rochers, les chants des oiseaux nous rappellent sa mort. Les arbres prennent le deuil en octobre, les ruisseaux grossissent de leurs propres larmes au printemps, le beurre du chèvrefeuille ne parvient pas à les consoler. Ne te retourne pas tant que tu le peux, c’est ce temps qui fait le poème, les fragrances du lilas reviendront plus tard.
Jean Prod’hom
D'un coq à l'autre nous marchons

Trop souvent je vais et viens, sors de mes rêves pour me glisser sous les fourches de la raison, loin de la terre au coeur de laquelle je plonge les mains, dos tourné et remue. Pas le temps de descendre dans le puits, tout juste bon à maintenir intact le chemin qui me ramène le soir au rêve et à la nuit.
Dessous le ciel brûle et la terre tremble.
D'un coq à l'autre nous marchons vers ce qui aurait pu être une source.
Jean Prod’hom
Tu fais du café

Le soleil guigne derrière la chaîne des Vanils, s’engage sans but sur la route qu’il a tracée il y a longtemps déjà, une route simple dont il ne se plaint pas, un arc. Je me lève, les ombres jouent un air d’accordéon, aucun autre signe dans le ciel. Va falloir faire l’âne, aller en tous sens, payer mon écot. Pas d’échafaudages pour décoller du mur. Pas de mur non plus. Faire tourner la noria et commander du bois.
Se garder des grandes surfaces, le vrai relève du même. Jusqu’à épuisement. S’y faire.
J’allume une cigarette. Tu fais du café.
Jean Prod’hom
Nous dormons près d'un rêve que l’arbre a refusé

Suis-je seul à m’agiter ainsi, à passer à travers le jour, fait et défait par une inquiétude qui suit le calendrier des marées. L’écriture et la marche seules pour quitter le four et calmer le jeu.
Tu peines à te réveiller, goges dans un mélange indécis, à mi-distance de l’indifférence des plantes et l’inquiétude des bêtes.
Nous dormons près d'un rêve que l’arbre a refusé.
Jean Prod’hom
Qu'ainsi rien ne se referme

Tourner, tourner par cercles concentriques. Larges, plus larges, prendre ainsi la tangente.
Chaque jour.
Qu'ainsi rien ne se referme.
Jean Prod’hom
Veiller à ce qu’il ne manque rien

Distinguer les voix du dedans des voix du dehors, sans s’interdire de prolonger celles du dedans dehors et celles du dehors dedans. En veillant cependant à laisser ici et là les traces de notre passage, comme Poucet, pour dire que nous ne sommes pas seuls dans cette autre langue, que d’autres ont passé avant nous et ne se sont pas perdus, mais aussi pour à la fin rebrousser chemin et maintenir ainsi, aussi intacte que possible, l’étendue où l’énigme aime à se retirer.
Veiller à ce qu’il ne manque rien.
Ni la fatigue de l’homme ni la candeur du monde.
Jean Prod’hom
Je ne suis qu’un abord, sans appui

Trier, écarter, déplacer. Repousser les limites de l’incompréhension aussi longtemps que je le peux. Un rais de lumière, une oscillation, un bruit de clé, voici que le poème se met en branle, s’organise à mes dépens, danse les yeux fermés, dans le lointain d’abord avant de se glisser sous mes pieds.
Un poème n’est pas un poème, il est ce qui te livre au hasard et à toi-même, t’oblige à puiser ailleurs, à te transporter là où tu ne songeais pas aller, au milieu de ces blancs et de ce vide qui donnent vie aux choses, libérées soudain. Rien à quoi se tenir, au milieu de rien, tout se tient. Tu le disais :
Je ne suis qu’un abord, sans appui.
Mais ça je ne l’ai su que plus tard, au passage des cigognes. Confiance et fidélité.
Jean Prod’hom
T'en confier l'écriture

Le quartier est bouclé, la raison sans faille. Pas une brique d’air à Taulignan, difficile de soulever un coin du voile, il pleut.
L’eau coule en bas les génoises, pas de chenaux mais des dentelles, d’où ruissellent en torsades une ribambelle d’éclats de verre.
T'en confier l'écriture.
Jean Prod’hom
Écrire c'est te différer

Écrire c'est te différer. En restant où tu es.
Démêler, affranchir, déprendre. En redonnant à chaque chose la place qui lui revient, à chacun son visage et son tourment. De l'avoir fait occuper la place où écrivant je n'étais pas, avec dehors ce qui s'impatientait dedans.
C'est le printemps du monde que traverse le canal d'Aulières, les têtes sont vides.
Jean Prod’hom
Par quoi se fait le jour

La mer traverse le milieu du tableau, fine lamelle de zinc retenant le bleu du ciel. Dessous du gris à perte de vue, quelques taches de couleurs vives au premier plan. Les bateaux sur leurs béquilles ne bronchent pas, leur ventre grince. Les goélands ont mis en pièces la bande son, du silence à perte de vue.
Mais sitôt que la lune aura tourné le dos, le vent ramènera la vague et la mer se redéroulera.
Par quoi se fait le jour.
Jean Prod’hom
Petite cuisine

Envolé le mistral, sur la place on réapprend à parler, un maraîcher décharge une camionnette. Lui parviennent d'en haut, fenêtre ouverte, les voix d'un enfant et de sa mère mêlées aux nouvelles du monde que distille un antique transistor.
Petite cuisine où règnent le pain et les pâtes.
La veilleuse du tourment vacille, mais sous la peau de cuir un cœur bat.
Jean Prod’hom
Et puis : quoi

Le bonhomme sortait de son chapeau, le soir, deux ou trois choses dont il avait maintenu la tête hors de l’eau et qu'il avait roulées tout le jour à l'arrière de ses paupières. Elles s'affichaient animées derrière les miennes. Mais incapable de saisir dans mes mains, du premier coup, ces larges ensembles, je répétais à voix haute le nom de leurs parties à la lueur d'une lampe de poche, juste avant qu'une coulée d'encre ne les emporte, noire, une coulée sur lesquelles on soufflait, parce que c'est ainsi que les enfants inventent leurs vies, que les choses se précipitent les unes vers les autres, à tout hasard.
Et puis : quoi ?
Le banc est sous le couvert, les imprimés s'empilent sur la table, l'eau est coupée, l'atelier désert, l'épreuve passée. La lune est seule dans le ciel.
Jean Prod’hom
Où filtre un rayon de lune

C'est au fil à beurre qu’il fendait la nuit. Il y avait creusé des niches et dressé des autels portatifs, qu’il a fleuris aussi longtemps qu’il a pu, pour désengorger le trafic des humeurs.
Poèmes à larges anses.
Où filtre un rayon de lune.
Jean Prod’hom
(CQR) Construire une cathédrale

Construire une cathédrale ?
Plus le temps.
Plus envie.
Les enfants s'étaient baignés dans la rivière, le soleil jetait par poignées ses paillettes parmi les pierres du gué, tu croquais une pomme et nous avions convaincu la nuit de retarder sa venue. (P)
Jean Prod’hom
Tu me demandes si ça va

Tu me demandes si ça va.
Je suis allé ce matin jusqu'au fond de l'impasse de l’Abreuvoir, personne n'y va plus, les derniers locataires ont mené l'aventure jusqu'au bout, les déchets s'amoncèlent, les voisins ignorent même qu'il y eut là autrefois une impasse, et bien avant encore une passe.
Le canal n’a plus de nom. La girouette du clocher indique la direction du vent à contre cœur. Plusieurs concessions perpétuelles réputées en état d'abandon font l'objet d'une procédure de reprise dans le cimetière du village, la caserne est fermée. Comment dès lors pourrait-il en aller autrement. Ne t'inquiète-pas.
Jean Prod’hom
Car tout peut encore s'esquisser

Aucun mot pour désigner le vide autour duquel s'articulent nos fables et la succession de nos jours. Pas de mot non plus pour décrire la stupeur de la raison lorsque l'inattendu la paralyse. Le mistral penche ce matin en tous sens, la plaine cherche son assiette et des morceaux de récits passent en coups de vent. Fallait bien pourtant que je me fixe quelque part, placer un pont en garde à vue, y attacher une boucle, puis deux, trois, qui feraient tenir ensemble la miniature, et auxquelles viendraient s'agréger indéfiniment ce que nous avons sous les yeux et nos ignorances.
Car tout peut encore s'esquisser dans les marges, dans les blancs.
Je marche avec un ruban à la boutonnière, un papillon et une libellule blasonnent le talus, je reconnais les lacets d'une majuscule d'un vieil incunable. Le déferlement s'ouvre comme une fleur.
Jean Prod’hom
(CQR) Ne laisser dans la main que le noyau du jour

Tu me conseilles de tourner la page, c'est ce que je fais. Quelques mots chaque jour, paire ou brelan, phrases réduites, allégées de ce qui va sans dire, deux fois trois mots. À la longue, ça ne fait pas un pli, ni un livre ni une vie, mais quelque chose qui leur ressemble.
Ce matin j'ai nourri les moineaux, me suis assis sur le banc pour donner forme à ce qui n'en avait pas, m'y suis pris comme une araignée. L'imprévisible s'en est mêlé. J'ai pris les devants, talonné par l'envie de bien faire, ai tourné les mots dans tous les sens avant de mettre debout la page. Manière à moi de nourrir les dieux, écran ou rempart à ce qui menace.
Une heure ou deux en fin de journée à goûter l'air d'après l'averse, avant que je ne m'avise que tout est à reprendre, l'incompréhensible ne se satisfait pas de mes mots. (P)
Ne laisser dans la main que le noyau du jour.
Sortir. Je croque dans le verger deux cerises noires. (P)
Jean Prod’hom
Que montrer d'un silence?

Le silence des vivants est doublement articulé, pas celui des morts. C'est pourtant lorsqu'ils réapparaissent au détour d'une pensée, sur un dressoir ou dans un coin du ciel que les visages de ceux que l'on ne reverra pas font entendre dans un silence énigmatique ce qu'ils ne parvenaient pas à dire de leur vivant.
Que montrer d'un silence?
Ses peuplades dans le réel?
Elles sont légion les réalités qui vont leur bonhomme de chemin, silencieuses, à l'écart du réel : le canal que je longe, le tilleul de la place, le vendeur d'abricots, un poème. Je vais moins seul de savoir les mondes qui nous séparent et me tourne vers vous comme un revenant.
Jean Prod’hom
Ce n'est que cela une maison

D'un côté l'étendue où coexistent les bêtes, les vivants et les morts, sans toi ni moi, des bois, des palais, des ruines et d'innombrables feux immatériels. De l'autre des notaires peu scrupuleux qui s'affairent, falsifient l'ordre des successions, bataillent pour un bout de pré, une section ou un quartier.
Le ciel s'obscurcit, les nuages passent sans s'arrêter. Un homme assis sur un banc peine à réconcilier l'écume de ses jours avec l'étendue de l'océan. Chacun se réjouit pourtant de son ombre et cherche dans le regard de celui qu'il croise la confirmation de son existence.
Ce n'est que cela une maison.
Jean Prod’hom
(RP) Nous traversons chaque jour le regard de l'ange

Nous traversons chaque jour le regard de l'ange...
Aucune requête mais un point fixe, une croix autour de laquelle nous risquons notre vie et qui nous oblige à prendre le large. (P)
L'ange passe comme cet inconnu que j'aperçois en novembre dans l'encadrement de la fenêtre de derrière et qui jette un coup d'oeil de mon côté. De qui sommes-nous les hôtes? (P)
Jean Prod’hom
(RP) Le reste est de chaque jour

La mort n'a aucune place hors de nos vies, bourdon elle accompagne nos réponses collectives, socle sur lequel on bâtit nos maisons, invente des théorèmes, usine des verroteries. Inutile de vouloir trop la forclore, inutile de vitupérer les impies. (P)
Les précautions les plus sophistiquées ne suffisent pas. Gare alors, la mort remonte la chaîne des raisons comme un inarrêtable mascaret, ronge les conventions et inonde nos ruisseaux. (P)
Le reste est de chaque jour, presque nu.
Jean Prod’hom
(RP) Entrer et sortir à chaque mot

La raison retient dans ses mailles les contours des océans mais laisse filer l'interminable vague et l'application des marins, ils ont laissé à quai leur visage, leur famille, le grain de leur voix, les vieux portulans. N’ont emporté que la peur dont aucun suaire ne conservera l'empreinte. (P)
Le poète a ravaudé large, au risque de laisser passer les fantômes qui vont et viennent à leur guise sur la scène en montrant du doigt les absents. (P)
Entrer et sortir à chaque mot, comme d'une maison.
Jean Prod’hom
(RP) S'en faire un lit

Le matin, il ne chassait pas la pensée qui obsède, ne la nourrissait pas non plus, la laissait dans sa mandorle lorsque cela se pouvait. Je ne connais pas d'autres voies pour disposer d'une cour et d'un jardin. (P)
Prendre ta main, rentrer à la maison, tout faire pour sortir de nos quelques pensées, s'en faire un lit.
Et rejoindre avant la nuit le delta dans lequel le passé dégorge ses remèdes et ses poisons. C'est le moindre mal, ce qu'on peut espérer : une allée, les saisons, ce qui ne nous appartient pas. Et puis, et puis il y a demain. (P)
Jean Prod’hom
Parmi les objets derrière son visage

Le vrais morts ne se démontent pas, les vrais morts veillent derrière le visage des vivants qui, s'éloignant, prennent un coup de vieux.
Un mort, ça vit avec un sourire d'ange.
Nous, nous sommes où il s'efface parmi les objets derrière son visage.
Jean Prod’hom
Quelque chose ne vient pas

Une double couche de laine dans le haut du crâne interdit tout échange thermique. Les mots font demi-tour un peu après la luette et redescendent jusqu’à la vésicule biliaire.
Quelque chose ne vient pas.
Le ciel ne s’en formalise pas.
Jean Prod’hom
(CQR) Où aller s'il suffisait d'aller

Tu attends le retour du chalut, rongée par le sel, avec ta vie ailleurs.
Au Pérou, en Amérique et tout recommencer, tu as beau dire, ce n’est que le dehors d’une même prison. (P)
Où aller s'il suffisait d'aller ?
Jean Prod’hom
(CQR) Jusqu'au sommeil ? Jusqu'aux tournesols ?

Un prix exorbitant, tu ne l’imaginais pas, hors toute mesure, pour que ta vie se défaisant découpe sur les ruines des digues, à deux pas des vieux chromos, dans les rondeurs des voyelles et des consonnes, une maison sans tire-fonds. Je bégaie, c’est ma langue, celle qui accueille le tout venant, le canal de la mécanique et l’église ovale, les virgules, le jeu subtil des prépositions, le manque et ce qui ne reviendra pas. (P)
Jusqu'au sommeil ? Jusqu'aux tournesols ?
Miné aux abords de l'aphasie, première étape lorsqu'on remonte du bing bang, mais si loin, et la sensation d'être plus loin encore. Tout au fond de la nuit que tu creuses à la lueur d’une fenêtre entrouverte, ou dedans avec une chandelle, une vallée qui déborde soudain le dormant de la fenêtre. Je suis bien vivant, un répit dans lequel je m’aventure, de l’autre côté et avec toi. (P)
Jean Prod’hom
(RP) On attend quelque chose

On attend quelque chose.
Je pensais qu’un événement oublié – quelconque, négligé – viendrait du dehors et remettrait tout en place, comme avant, en mieux peut-être on ne sait jamais. Toi tu me disais que les travaux du dedans restaureraient les anciennes voies d’accès ou en aménageraient de nouvelles. (P)
On a fait les à-fonds chaque jour, les dimensions du rêve se sont réduites, on va et vient à l’air libre, chacun pour soi, sans rien gauchir parce que notre confiance grandit. On n’est pas de trop, n’est-ce pas ? (P)
Jean Prod’hom
(CQR) On n'a qu'un peu de terre dans la voix

Les récits que tu lisais tenaient à distance les leurres qui les hantaient, les digues ont lâché. Il te faut désormais considérer les histoires côté cour, personne n’en sait rien.
Plus besoin de clé, les fenêtres et les portes sont grandes ouvertes. Les serre-livres ne retiennent que le souvenir du bras du père sur l’épaule du fils, grâce scellée au milieu des bris. (P)
On n'a qu'un peu de terre dans la voix. Pour s’y coucher. Avec eux.
Jean Prod’hom
(CQR) Seul contre son âme un homme ne pèse pas lourd

Seul contre son âme un homme ne pèse pas lourd.
Chaque jour j’écoute et parle, même geste. Et ce que je dis n’est rien d’autre que ce que je vous dois. J’ouvre au vent la maison du dehors pour nous mettre un instant à l’abri des cris du dedans. (P)
Et je dure quand bien même il est trop tard. (P)
Jean Prod’hom
Oui, mais Monsieur Berset, à quoi ça sert la politique ?

- Comment t’appelles-tu ?
- Louise.
- C’est un bien joli nom.
- Oui, mais Monsieur Berset, à quoi ça sert la politique ?
- Et bien, ça sert à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. C’est ce je dirai d’abord ce soir sous le grand chapiteau à l’occasion de notre fête nationale, à tes parents et à tous ceux qui viendront. J’essaierai de leur donner du courage car nous vivons une période mouvementée, instable, et les adultes ont tendance dans ces situations, un peu par crainte, à se replier sur eux-mêmes, à parler du passé : « C’était mieux avant. » Pas seulement en Suisse, dans les pays qui nous entourent aussi. Et personne ne sait quand les choses vont s’améliorer. Dans certains pays, plus de la moitié des jeunes ne trouvent pas de travail. Alors bien sûr, ici, nous nous portons mieux que chez nos voisins, et je le leur rappellerai, ça fera du bien à mes concitoyens. Mais tout n’est pas pourtant si rose chez nous, toute personne de plus de cinquante ans qui perd son travail a de la peine à en trouver un autre. Sur ce type de problème, un conseiller fédéral comme moi ne peut pas agir seul, les pays sont obligés d’agir ensemble. Pour agir chez nous, on ne peut ignorer ce qui se passe ailleurs, dans un monde où tout va si vite, dans lequel l’Europe cherche sa place, et au milieu de cette Europe la Suisse aussi, la sienne, C’est difficile de trouver des équilibres. Mais nous devons tous nous mobiliser pour intégrer chaque personne, de 7 à 77 ans. On ne peut pas se permettre de laisser de côté ceux qui sont dans des difficultés, c’est un des éléments qui a assuré le succès de la Suisse, sans jamais perdre de vue que nous ne sommes pas seuls. Voilà ce que je dirai ce soir sous le chapiteau. Et demain on devra répondre à tous ceux qui nous interrogent sur le fonctionnement de nos banques, la crise de la dette, l’échange automatique de données, la transparence fiscale,...

- Je comprenais un peu au début, mais maintenant...
- Comment t’appelles-tu ?
- Lili.
- Et bien, Lili et Louise, je vais essayer de dire les choses plus simplement. Disons que certaines personnes, parce que la vie est difficile, préfèrent ne pas affronter le présent, se rappeler le passé, les serments du Grûtli, la belle époque de la guerre froide, le monde était divisé en deux, les communistes et les capitalistes. Tout a bien changé et nous devons accepter ce changement. Mais les nouvelles réalités n’ont pas surgi de nulle part, il y a un lien évident entre le passé et le présent, et le passé est plein d’enseignements, il est le creuset de valeurs qui sont essentielles. Ce soir je parlerai de 1830 et de la paix du travail, de 1848 et du fédéralisme, de la démocratie directe, du plurilinguisme, des choses simples sur lesquelles repose notre pays et que tu comprendras mieux demain à l’école. J’évoquerai les capacités industrielles de la Suisse du XIXème siècle dont le développement a été presque aussi rapide que celui du Royaume-uni, ses capacités d’innovation sur le plan technique et scientifique. Mais je dirai ce soir aussi notre confiance et notre audace comme notre respect des traditions. Ce point est essentiel, une constante dans notre histoire, notre pays a vu naître aussi bien des constructeurs de ponts et des ingénieurs que des figures critiques. Tout progrès doit en effet être considéré d’un oeil froid, sévère même, sceptique, mais ce scepticisme ne doit pas coûter plus d’énergie que le progrès lui-même. La foi en l’avenir et les égards que l’on doit à notre passé sont les piliers de notre pragmatisme.
Je parlerai aussi ce soir d’un défi majeur, celui de l’évolution de la population, on doit se réjouir de vivre toujours plus longtemps en bonne santé, mais cet événement considérable dans l’histoire de l’homme nous oblige à nous engager dans des réformes importantes pour que nos assurances sociales restent performantes, il en va du lien entre les générations.
Je leur parlerai enfin d’une question qui fâche, de la politique suisse à l’égard de l’Europe, quelques mots seulement, immanquablement un peu vagues, je leur parlerai du pragmatisme qui commande nos actions. Aujourd’hui nous ne sommes pas menacés, aucune raison dans ces circonstances de rester sur la défensive, nous pouvons nous montrer sûrs de nous, créatifs et actifs, sans nous enliser dans nos mythes, en tirant du passé des sources d’inspirations qui nous permettront d’avancer. Ne pas fermer les portes, ce ne serait pas une attitude digne. Voilà !
- Comme tout cela est difficile !
- Pas tout compris !
Jean Prod’hom
Les "cheneviéres" de Corcelles-le-Jorat

La culture du chanvre, diabolisée dans les années 60 mais remise à l’honneur dans les années 90 par des agriculteurs qui peinaient à survivre, jouissait autrefois dans la région et jusqu’à la dernière guerre de faveurs et de soins qui en attestaient le prix. De cette culture à Corcelles-le-Jorat ne restera bientôt, je le crains, que le nom des Chenevard et de leurs descendants. Et une trace dans les archives. Les cheneviéres ont en effet l’honneur d’être désignées dans le relevé de 1852 par un nom spécifique, à côté des prés, des champs, des jardins et des bois.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat, A la Grange ès Roud
Les cheneviéres sont des parcelles qui jouxtent les habitations. Elles ont en 1852, comme les jardins, une valeur fixe dans le cadastre, 1522.50 francs la pose, tandis que la valeur des prés, des bois et des champs varient selon leur situation. La chenevière est travaillée à deux pas de la maison sous étroite surveillance, pour s’assurer qu’aucun oiseau ne détruise les précieuses graines, qu’aucun animal ne fouisse la terre retournée préalablement, fumée et hersée, tapée au moyen de larges planches au milieu desquelles était fixé un manche en bois. Il fallait, précise l’auteur de l’article de l’Encyclopédie de Diderot, que toute la cheneviére soit aussi unie & aussi meuble que les planches d’un parterre. Attendre ensuite, simplement attendre en empêchant la mauvaise herbe d’étouffer la croissance du chanvre.
On semait le chenevis au mois d’avril ou de mai, le jour de la Saint-Urbain, ni trop serré ni pas assez – il faut observer un milieu, qu’on atteint aisément par l’usage, avertit l’Encyclopédiste –, puis le pousser dans la terre à la herse ou au râteau.
On arrachait en septembre les fagnes par poignées qu’on mettait en gerbes dans un pré fauché. Dès le lendemain on les étendait et on les retournait régulièrement durant une vingtaine de jours, c’était le rouissage. On remettait les fagnes en gerbes et on les conduisait en char dans une remise où elles étaient entreposées.

Au printemps suivant, on terminait le séchage, au four s’il le fallait, avec les risques d’incendie que cette opération entraînait, raconte un vieux Broyard en 1931 dans la Feuille d’Avis, puis on procédait au broyage pour en tirer la filasse. On plaçait une poignée de tiges entre les deux longues et solides mâchoires de chêne du batioret qu’on ouvrait et fermait lourdement. Les gosses collectaient dans les débris les fils afin de faire la ficelle pour les liens, licols, cordeaux, cordes de chars, longes. Plus tard dans l’année, le sérancier passait pour carder le chanvre qui serait filé l’hiver suivant.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat, Vers chez les Chênes, 1852
M’aura suffi d’une petite matinée pour faire l’inventaire des cheneviéres de la commune :
Vers Chez Porchet : 51.60 toises
A la Grange ès Roud 95.50 toises
Vers chez Charbonney 54.45 toises
En Gilletaz : 58.60 toises
Es Garres : 46.30 toises
A la Mollie : 37.25 toises
Vers chez les Chênes : 88.97 toises et 142 toises
Es Tailles : 75.75 toises
Au Chalet d’Orsoud : 44.50 toises
Vers chez Porchet : 64 toises, 39 toises et 40 toises
Praz à L’Armaz : 34.55 toises
En Rachigny : 46.95 toises
Et en tirer comme un poème : 919.42 toises, c’est-à-dire 8274m2, c’est-à-dire un peu moins de 2 poses, et le beau nom de cheneviére écrit par un géomètre consciencieux.
Jean Prod’hom
Il y a les fleurs bleues du lin

Il y a les fleurs bleues du lin
la maladresse
le raisin pressé
il y a les ouvriers agricoles
les chenevières
la piquette du jour
le préfet ceint de l’écharpe verte et blanche
il y a les coups foireux
la scabieuse et la sauge
Jean Prod’hom
L'envers d'une ligne de désir

Cela fait un bail qu’on dépose chaque matin nos enfants au bas du Torrel, là où s’arrête le bus scolaire, tout près d’un pont qui enjambe dans l’ombre vert sombre le ruisseau du Riau. Le chemin mène à la mécanique, un bâtiment en retrait dans lequel les paysans d’aujourd’hui logent quelques têtes de bétail, entreposent une ou deux machines agricoles et des balles de paille.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
C’était un ensemble comprenant autrefois un logement, avec devant un demi-rond d’herbe tendre, un carré de bettes, du fenouil et du persil. A l’arrière une grange et une écurie auxquelles s’adossait un couvert abritant une scierie et une machine à battre le grain, avec une vaste place de terre battue pour entreposer des chars, stocker le bois, manœuvrer. En 1852 ce domaine appartenait à Jean Rémi Steiner.

Plus trace de la fontaine indiquée sur le plan, plus trace non plus de l’eau détournée du ruisseau par un canal, 250 mètres plus haut, sous la Mollie Cheiry. Une trace seulement sous la peau du pâturage, comme l’envers d’une ligne de désir, celle d’une ancienne passion, la courbure d’un rêve dont les lèvres n’en finiraient pas de se refermer, pure cicatrice sans bord, sourire d’aquarelle à ciel ouvert au-delà de tout repentir.
Jean Prod’hom
Quelque chose ne vient pas

Il y avait en contrebas du cimetière de Gillabert, le long de son ruisseau, une tannerie appartenant à Alexandre Philippe Ramuz d’un peu plus de 9 toises. Suis redescendu ce matin les pieds dans l’eau, en amont de l’ancien chemin qui monte Vers chez Porchet, à la recherche des restes d’une arrivée d’eau dont la dérivation devait se trouver à l’entrée du bois, à cent mètres de là, au pied du Champ Borgey que le ruisseau de Gillabert contourne. Aucune trace du bâtiment inscrit en 1852, ou si peu, une pierre peut-être et une trifurcation en mauvais état qui pourraient faire partie de la petite entreprise d’autrefois.

Continue dans le lit du ruisseau de Gillabert dont les lueurs troubles ressemblent à celles de l’Argens, cette rivière du Var à laquelle René Boglio s’abandonne le temps d’une matinée, laissant au silence des rentrées scolaires les ruelles de Correns fendues par le soleil. René ne s’est pas dégonflé, a jeté du pont son cartable dans la rivière, René s’en fout, René n’ira pas en classe. A l’appel de l’instituteur a répondu celui de la rivière. Ses souliers prennent l’eau qui monte jusqu’à la taille. Que les autres s’occupent de leurs affaires, je m’occupe des miennes les bras en croix, René nage dans la lumière du temps volé, danse avec une vipère d’eau, suit son ombre trouble dans la rivière, René a perdu ses souliers, il croque une figue, se douche sous une cascade. Mais René ne perd pas la raison, personne n’en saura rien, il retrouve ses souliers et son cartable, rejoint ses camarades, il s’est passé une éternité.
Je laisse la tannerie derrière moi, René sourit, René nage, absent pour personne, le cartable et mes projets au fil de l’eau, faites donc des théories, on n’entend rien sous le bruit du vent et des grillons, de l’eau, je glisse comme sur une barque caressée par les branches souples des saules, persiennes ajourées, voix indistinctes piquées par le bleu des libellules et le blanc des papillons. Je croise de petits affluents qui rient lorsqu’ils se jettent dans dans le ruisseau la tête la première, jusqu’au menton, une flûte enchantée se mêle aux tourbillons, dérive des sentiments. René croque une figue, c’est pas une heure pour rentrer, dit la lavandière, nous sommes en 1956 et je viens de naître.




M’arrête à l’auberge, personne n’a entendu parler de cette tannerie. Je rentre avec le sentiment d’être en retard, Sandra sourit, elle s’en va avec Lucie, les enfants et Oscar tremper leurs pieds dans la Carrouge. Chacun son tour. Regarde le film de Jacques Rozier. René a ramené une vipère dans son cartable, je ramène de cet enchantement un gourdin de salon.
Jean Prod’hom
,
Histoire du cimetière de Corcelles-le-Jorat

Chaque commune du canton de Vaud tient entre ses murs quelques-uns des éléments de son histoire, dans des armoires ignifuges ou de simples casiers si la place manque, clés à la bonne franquette, tant mieux. J’ai passé ces dernières semaines quelques journées dans l’une des deux salles de classe du collège de Corcelles-le-Jorat que les enfants ont abandonné depuis peu, une salle au bord de l’abandon, un ameublement sommaire, un massicot, un rétroprojecteur, de vieux ordinateurs, quelques bannières mais une fraîcheur que les vieux bâtiments conservent comme leur vrai trésor. Je ne suis pas du métier mais j’aime me laisser envahir par des questions idiotes qui viennent tout naturellement lorsqu’on leur laisse le temps de sortir des cartons et des vieux registres de comptes. J’y suis retourné ce matin pendant que Sandra, Louise et Arthur étaient au marché et que Lili nourrissait sa passion pour les chevaux.

Ai tourné les premières des 44 pages du Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat levé en 1851-1852, avec l’intention initiale d’inventorier les fontaines. Me suis égaré finalement dans les fours à pain, les latrines et les porcheries, les pressoirs et les chènevières. Sans rien de bien solide. Mais chaque heure passée avec ces documents permet de mieux les apprivoiser, j’en ai fait l’expérience encore une fois ce matin lorsque je suis tombé sur une information cherchée depuis longtemps et à côté de laquelle j’avais passé jusque-là. C’est à la page 23 du Plan, un rectangle longe le chemin de la Moille au Blanc à Corcelles, il porte le numéro 58. Dans le Renvoi , on peut lire à côté de ce nombre : Cimetière à la Commune de Corcelles. Tout s’éclaire, les pièces du puzzle se mettent en place. Voici.
1.
Les Corçalins enterrent leurs morts autour de leur église, plus précisément au nord, sur une place désignée en 1852 comme Ancien cimetière (29) avec la Remise de la pompe à feu tout près (32). C’est ainsi dans la majorité des communes vaudoises jusqu’en 1803, les morts font bon ménage avec les vivants au centre du village, près de l’auberge et de l’église, le four à pain et le pressoir.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
2.
A la fin de l’Ancien Régime, en 1810, Corcelles doit mettre à exécution l’arrêté du 16 janvier 1812 promulgué par le Petit Conseil du Canton de Vaud et déplacer son cimetière hors du centre du village. Corcelles ne s’exécute pas immédiatement. C’est seulement le 16 avril 1834 que la Municipalité, sous la présidence de Jean Louïs Henry Chenevard, s’exécute en entreprenant après discussions des travaux à Gillabert (58).
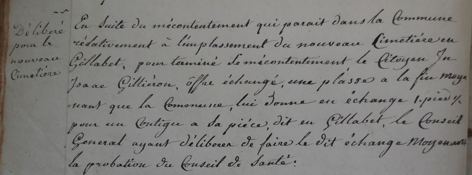
Registre des délibérations du Conseil général : 3 mars 1834

Registre des délibérations du Conseil général : 16 avril 1834

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
3.
Le 28 septembre 1907, l’achat d’un terrain pour agrandir le cimetière est mis à l’ordre du jour par la Municipalité qui a fait des demandes d’achat auprès de divers propriétaires, les morts manquent de place. Louis Porchet refuse en indiquant que la pièce de terre convoitée en Verniaux n’est pas propice pour un cimetière (correspondance du 31 août 1907), Emile Gillééron n’est pas disposé à céder la sienne en Champ la Pierre (correspondance du 27 août 1907), un seul y consent, c’est Louis Chenevard, au lieu-dit au Publoz, un champ qui, vu sa proximité du cimetière actuel est reconnu d’après sondages propre à l’usage auquel il est destiné. Le Conseil après discussion, au bulletin secret, par trente-et-une voix contre une, donne plein pouvoir et accorde le crédit nécessaire à la municipalité. Nous en sommes là, le cimetière n’a pas migré depuis.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
Le cimetière de 1907 est bien inscrit dans le Plan de 1851, mais c’est un ajout.
Je quitte l’ancien collège et sa fraîcheur, descends dans le lit du ruisseau. Plus trace de l’ancien champ de repos, mais un pré aux herbes folles. Cherche la prise d’eau de l’ancien canal qui alimentait une tannerie dont personne ne parle plus, ne trouve que le ruisseau de Gillabert dont je descends le cours jusqu’au chemin – route aujourd’hui – qui monte Vers chez Porchet, l’eau fraîche me monte à la tête, avec dessous les pieds l’épaisseur de mon ignorance, par dessus laquelle j’ai tendu un fil sur lequel j’avance pas à pas, émerveillé.
Jean Prod’hom
101

Ils sont légion les performers qui reviennent des enfers ou s’y rendent, expérience limite ou mort imminente, vie en aquarium ou macération lente. Trop tôt souvent. J’aurais préféré qu’ils insistent et creusent plus encore leur galerie au risque d’y rester et d’être admirés pour leur obstination.
Bernadette L. est morte, culte et tintamarre, gueules ouvertes et mort passepartout, grilles et haies. Mais tohu-bohu assez efficace pour creuser ailleurs un peu de silence dans le silence. Foule dense et modeste dans l’église de Corcelles, Henri s’éclipse sur la pointe des pieds. Je me souviens, Pauline m’avait enchanté, Henri avait construit le poulailler qui a mis nos poules à l’abri du renard des années durant avant que celui-ci, comme il se doit, ne croque la dernière.
Le papa d’Arthur, l’autre Arthur, avance d’heure en heure, de jour en jour, de saison en saison. Comme moi. Mais sans personne ni devant ni derrière lui.
Jean Prod’hom
Si loin parfois

Si loin parfois, si loin parfois du lieu dans lequel on souhaiterait être, non pas pour y rester mais pour s’en éloigner, pas à pas, et renaître au monde-choses dans lequel on fut sur le point d’être, à la première heure, pour la première et dernière fois.
Rien n’y fait, ni piaffer ni céder le pas, ni décrocher ni ruser en essayant de s’y rendre par l’autre côté.
Attendre donc, si loin parfois, dire et redire cette brève litanie, sésame qui ouvre le monde-choses. Où qu’on soit l’air revient avec le vent, l’éventail se déplie à la dimension de l’horizon et une immense rumeur noue de dégaine en dégaine le lointain avec le proche couchés dans leur plus grande largeur.
Jean Prod’hom
Crise de subsistance à la BNF

Bonheur de tomber ce matin sur le site de la BNF, qui accueillait début 2013 Pierre Pachet et Claude Reichler dans le cadre d’une série de conférences sur l’histoire du climat, mises en ligne pour tout un chacun : « Les baromètres de l'âme » météorologie, journal intime et connaissance de soi. Pierre Pachet y évoque la première Rêverie de Rousseau avant de commenter le fragment 107 de la série 23 des papiers non classés de Pascal :
Le temps et mon humeur ont peu de liaison. J'ai mes brouillards on beau temps au-dedans de moi; le bien et le mal de mes affaires même y fait peu. Je m'efforce quelquefois de moi-même contre la fortune. La gloire la dompter me la fait dompter gaiement, au lieu je fais quelquefois le dégoûté dans la bonne fortune.
Non! dit Pascal, il n’y a pas de parallélisme des barométries du ciel et et du coeur.

Claude Reichler évoque ensuite les changements – qu’annonce le fragment 107 – qui ont eu lieu au début du XIXème siècle dans la compréhension des relations entre les intempéries du coeur et celles du ciel, il s’en réfère à Maine de Biran pour qui l’homme est aussi imprévisible que le plus imprévisible des événements météorologiques, je suis nuage, tout échappe à ma pensée mobile, je suis un être ondoyant, divers et sans consistance, heureusement équipé d’un noyau durable qui me permet de juger des variations continuelles de mon être phénoménique.
Belle heure donc, qui en enfante une seconde lorsque je m’avise d’une autre conférence mise en ligne par la BNF, indiquée en marge et prononcée par Emmanuel Le Roy Ladurie, en conclusion de ce cycle intitulé Climat et météorologie. Nouvelle belle heure donc, curieuse, au cours de laquelle le vieil historien file allègrement l’histoire du climat du Moyen Âge à nos jours, sans notes en raison de sa vue déficiente.

Rien de bien nouveau depuis 1315, dit en substance Le Roy Ladurie, un peu désabusé, une succession d’événements météorologiques aux effets identiques jusqu’au milieu du XIXème siècle : crises de subsistance, famines ou disettes, manques de céréales surtout, qui sont à mettre en rapport avec les pluies excessives de certaines années, au printemps et en été, les gels insistants et continus de certains mois de janvier et février, sachant pourtant que le blé aime bien un petit coup de froid en hiver. Il y a aussi les échaudages, c’est-à-dire les sécheresses excessives, mais sans effets catastrophiques la plupart du temps. Il faudra attendre le XVIIème pour qu’une réelle politique du ravitaillement soit mise en place en France.
L’historien minimise la portée du petit âge glaciaire, le refroidissement n’a en effet jamais dépassé 0,6 degrés entre 1350 et 1846, tout juste une petite fraîcheur en plus. Quelles qu’aient été les variations profondes du climat, les crises de subsistance se sont succédé mais ont moins eu d’effets sur la mortalité de nos ancêtres que les guerres, celle de Cent Ans par exemple ou la grande et les petites pestes.
Cette succession de crises, Le Roy Ladurie ne s’en souvient plus précisément, elles finissent par l’ennuyer, elles se répètent, il aimerait écourter sa conférence. Il est bientôt midi, je l’aide donc en accélérant le défilement de l’enregistrement. Surgit alors une page sur laquelle on m’indique que trois conférences m’attendent encore sur la question du climat, à l’occasion desquelles onze hommes brillants se sont exprimés, le vertige me prend. Je cherche en haut de la page un peu d’aide pour en sortir au plus vite, je clique sottement sur l’onglet Conférences en ligne, une conférence sur Molière m’est proposée, Molière l’escroc, le maquereau et le vaurien, bougrement intéressant mais je ne veux pas pour l’instant m’enfoncer dans ce guêpier mais en sortir. Repère deux nouveaux onglets : Toutes les conférences et Dernières conférences. Clique imprudemment sur le second : 16 conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Me retire précipitamment, clique sur le premier : apparaissent les titres des cycles de conférences classées par intervenant, par thème ou par date, des centaines de conférences passionnantes datant pour les plus anciennes de 2001. Me sens pris, comme obligé si je ne prends garde de camper à la BNF et de sortir hors de la fosse à bitume, une à une, chacune de ces conférences, il y a de quoi faire.
Mais il est midi, malheur à moi si je suis pris. Je presse sur la touche tout à droite du clavier, celle qui m’a sauvé plus d’une fois, je compte jusqu’à sept pour m’échapper de ce piège. J’entends alors du bruit dans le jardin, c’est Arthur qui passe la tondeuse, je le rejoins pour m’attaquer à d’autres oeuvres, basses et utiles, qui se répètent sans s’empiler, désherber les plates-bandes comme les jardiniers à la BNF, pour m’alléger et alléger mes jours, recommencer à zéro.
Jean Prod’hom
Aigle

Christine, Moulin d’Aigle, 21 juillet 2013
Dimanche fin d’après-midi, toutes les fenêtres sont ouvertes, il fait à Aigle un cagnard à préférer les enfers. La rue du Bourg, étroite et profonde, offre un refuge si frais que les tenanciers rançonnent sans difficulté les passants.
Tout au bout, à l’est, la rue du Bourg est barrée par une route qui penche en direction du Rhône, elle longe une paire de rails, celles qui reliaient en 1900 la gare d’Aigle au Grand-Hôtel détruit en 1946, celles qui mènent aujourd’hui aux Diablerets. Plus bas une banque sans grand caractère a remplacé l’hôtel Victoria sur la terrasse duquel une inconnue a fait la noce au mois de mai 1910 tandis qu’une de ses amies se soignait aux Bains de Lavey.
La maison d’en face n’a guère changé, les propriétaires ont réduit la largeur du balcon, le lampadaire n’existe plus, le muret du jardin est sectionné en plusieurs parties, une barrière fortifiée a remplacé la haie, l’arbre a vieilli et le lierre ne le lâche plus, mais les charpentières sont intactes.

Une cinquantaine de mètres plus bas s’ouvre une cour d’où s’élance un bâtiment large d’épaules, un ancien moulin qu’alimentait le bief de la Monneresse. Un moulin en sursis qu’occupent aujourd’hui des peintres, des musiciens, des vidéastes, bref de la mauvaise graine en situation précaire, mais de la graine résistante, de la graine qui chante.
Il y a Antoine, Anaïs, Olivier, Christine, et tous ceux qu’on n’a pas vus parce qu’ils ne voulaient voir personne, l’endroit est immense. J’ai passé la fin de l’après-midi avec eux, on a mangé des filets de féra qu’Antoine a préparés, on a mangé un gâteau au chocolat parce que le fils de Christine fêtait ses vingt-trois ans.
A la fin ils ont chanté en français, en anglais, en portugais tandis que la nuit entrait par les fenêtres grandes ouvertes. Je les ai quittés à un plus de vingt-deux heures, ce sont vraiment des gens pleins d’amour, pleins d’envies, avec pleins de projets, fragiles, comme appuyés à des bâtons de chaise.
Antoine, Moulin d’Aigle, 21 juillet 2013
Usez mieux. ô beautés fières,
Du pouvoir de tout charmer :
Aimez, aimables bergères ;
Nos coeurs sont fait pour aimer.
Quelque fort qu’on s’en défende,
Il y faut venir un jour ;
Il n’est rien qui ne se rende
Aux doux charmes de l’amour.
Songez de bonne heure à suivre
Le plaisir de s’enflammer :
Un coeur ne commence à vivre,
Que du jour qu’il sait aimer.
Quelque fort qu’on s’en défende,
Il y faut venir un jour ;
Il n’est rien qui ne se rende
Aux doux charmes de l’amour.
Molière, Cinquième intermède de la Princesse d’Elide


Jean Prod’hom
La barre à mine

La chaux brûle mes paupières, la poussière met tes gencives à vif, avec au fond du gosier un goût de pierre, un goût de fer. Nos corps trempent dans la saumure, cockpit de camion, bras disloqué, un seul grillon. Il est midi, l’enfant a les lèvres sèches devant la porte ouverte du vieux frigo, le jour peine à tenir debout entre pelle et pioche. Personne ne songe à demander une rançon. Chacun pour soi dans ce brasier, les bras tombent. Monosyllabes passés au feu, mélange de souffre et de tabac. Derrière les herbes sèches une caravane, derrière la caravane la barre à mine que plus personne ne cherche.
Jean Prod’hom
Exploitation de la pierre

Lorsqu’on quitte le bourg sinistré de Dizy et qu’on remonte de la Tine de Conflans en direction de Ferreyres, le village se met en boule et s’agrippe pour éviter de rouler dans le lit de la Venoge, il somnole dans cette blondeur confiante et lumineuse que lui offrent ses pierres de calcaire jaune et le soleil. On revit, une mère joue avec son enfant sur la nouvelle place de jeux qui jouxte l’ancienne route de la Sarraz, deux femmes papotent sur celle de Moiry déserte à ces heures.

S’ouvre au bout de celle qui conduit à la vallée d’Engens, à l’arrière du village, un pays qui surprend celui qui s’y aventure, le dépayse en le propulsant sans avertir sur des terres dont il est le familier, c’est sûr, mais ailleurs, plus au sud, dans la Drôme ou le Gard, à cause de la pierre qui affleure et mite des clairières au sol maigre, reliquats d’anciens esserts que les chèvres et les moutons maintenaient ouverts. Les taillis ont gagné la partie, et avec eux les frênes et les charmilles, les buis et les chênes, courts et noueux comme leurs cousins verts des Cévennes, qui alimentaient au Moyen Âge les fours à chaux et à fer des Bellaires.
Mais c’est aussi ici, au nord de Ferreyres, dans les bois d’Echilly, que le promeneur est invité à imaginer le travail aveugle et titanesque de ces collectifs anonymes qui ont exploité la pierre, caché aujourd’hui derrière les buis, les chênes et notre ignorance.

On peine à s’imaginer les faits et gestes des carriers qui montaient dès le XVème siècle à la perrière, comme on disait, fendre la pierre jaune de Ferreyres – cousine de celle de Hauterive –, la tailler, l’acheminer jusqu’à Romainmôtier, La Sarraz ou Ferreyres, plus loin ensuite. On estime à 30 000 mètres cubes la quantité de pierre extraite de la Carrière jaune qui garnit d’or, aujourd’hui encore, les encadrements des fenêtres et des portes des maisons de la région, ou qui contient l’eau des fontaines publiques comme celle des riches particuliers.
C’est dans la seconde moitié du XVIIIème siècle en effet que les communes du pied du Jura engagent des carriers pour remplacer les bassins en bauderons et les auges de sapin ou de chêne par des bassins de pierre. Le maître David Robert est l’un d’eux, nous apprend Paul Bonard dans son ouvrage sur les Fontaines des campagnes vaudoises, il vient du Locle et épouse en 1720 Moyse Cugny de Ferreyres, il demande la bourgeoisie de La Sarraz – qui ne fait qu’un avec Ferreyres – contre la taille d’un bassin. Les faits sont établis, David Robert travaille à Cossonay et la Sarraz, mais aussi à Penthalaz et à Romainmôtier où il réalise en 1724 la chèvre en pierre du vieux bassin en bois, Paul Bonard évoque tout cela.

Cossonay, photo de Sylvie Bazzanella
Mais on sait si peu de choses de ces vies minuscules, j’imagine David Robert entouré d’une équipe d’ouvriers, Il dispose d’une petite forge pour y fabriquer et y réparer ses outils, les aiguilles, les broches et les ciseaux, les marteaux, massettes, piquoirs et martelines, il remarque un matin de bons morceaux de calcaire dont il compte tirer les panneaux du bassin octogonal commandé par la commune de Cossonay, qui remplacera l’ancienne fontaine devant l’église, j’ignore comment ils s’y prennent pour fendre ces panneaux, j’imagine qu’ils les taillent à même la carrière. Plusieurs jours. Cossonay est à plus de sept kilomètres, il s’agit de choisir le meilleur itinéraire, sortir du bois les lourds panneaux en les soulevant d’abord par un jeu de leviers et l’emploi de crics, en les faisant rouler ensuite sur des billes, de sapin j’imagine, plusieurs jours. S’être assuré des services d’un charretier, manoeuvrer l’équipage, quelques jours encore, acheminer les pièces du bassin sur la vy, puis les conduire à Cossonay sur des chemins à double ornière, conduire les chevaux, tirer dans les côtes, retenir dans les dérupes, décharger les panneaux, les cimenter avant de les cramponner aux angle et aux jointures avec de la ferraille, installer la chèvre, des jours encore, j’aimerais des détails, plus de détails, mais où les trouver ?
Au-delà de la Carrière jaune, plus loin, les foyards se mêlent aux chênes, quelques chèvres ont fait la fête au recrû, elles ruminent à l’ombre d’un grand frêne, tout autour une prairie sèche le nez dans le ciel, comme à Colonzelle sur le plateau du Pâtis, avec dessous l’ancienne carrière d’extraction de pierres meulières.
Jean Prod’hom
CXXIII

Deux arrosoirs pris de trois quarts de chaque côté d’une grille d'évacuation, deux nains fumant une pipe aux extrémités du rebord de la fenêtre, deux lions rugissants sur le seuil de la petite maison, la date de 1881 gravée sur le linteau. La porte s'ouvre, deux bras et deux jambes, deux oreilles et deux mains, la propriétaire souffre d'un strabisme du tonnerre de dieu.
Marie-Noël est partie cet hiver dans l’hémisphère sud pour parfaire son bronzage. Deux semaines. Elle considère au retour, défaite, le blanc laiteux dessous ses bras qui ne s’en va pas.
Lorsque deux vieilles pies surveillent ses faits et gestes Jean-Rémy rit, il avertit la police quand il s’agit de petits vieux.
Jean Prod’hom
Cette route sur la carte il n’y avait rien au-delà

Chaque communauté du canton de Vaud a dessiné sur son territoire, dès 1812, un espace clos et fermé pour enterrer ses morts à respectable distance des habitations. Tandis que les villages et les campagnes se métamorphosaient tout au long des XIXe et XXe siècles, les cimetières ont été l’un des points fixes des communautés. Ces constructions d’un séjour pour les morts au voisinage des vivants ne me lassent pas et m’invitent à me pencher, comme un primitif, sur mes rapports avec la mort, en-deçà de mes croyances et de mes voeux seconds, à même les manières de vivre et les silences des anciens auxquels chacun obéit qu’il le veuille ou non en marchant. Au notaire qui assure l’ordonnance des successions et des partages, j’ai voulu conter ici une ou deux choses habitées par une temporalité qui ne se partage pas en minutes.
On dit que la mort n’en fait qu’à sa tête, façon de dire, la mort c’est d’abord un coup de tonnerre de l’autre côté du langage, un éclair sur lequel l’imagination bute. A vrai dire, mort ne veut pas dire grand chose, les morts si, ils constituent l’avant-garde des vivants et font écran à l’inconcevable. Que ferions-nous sans eux ? Les morts sont les alliés des vivants contre la mort, celle-ci est intraitable, mais il est possible de s’arranger avec ceux-là. Inutile de les interroger là-dessus, ils ne répondront pas. Les vivants qui ont signé les premiers traités sont nos ancêtres, on les rejoindra sous peu, c’est avec nous que ceux qui viendront ensuite auront alors à traiter.
On peut entrer dans un cimetière mais il est impossible d’aller au-delà, il n’y a pas d’au-delà du cimetière. C’est comme un seuil, un pas de plus et on n’en reviendrait pas. Les cimetières sont de véritables forts qui nous gardent du noir de l’outre-tombe.
C’est dire que les morts sont du côté des vivants. On vit avec la mort mais ce sont nos morts qui nous la rappellent. Impossible de la déloger du monde des vivants, mais impossible de la laisser faire à sa tête. Le cimetière est le lieu des morts placés-là pour montrer du doigt ce qui n’a pas de nom, au-delà duquel il n’y a précisément rien. Le cimetière indique le lieu au-delà duquel il ne convient pas de s’aventurer. Tout simplement parce que l’au-delà se définit par cette impossibilité-là.
Le cimetière est un un incident topologique dans lequel les morts font les morts. S’ils n’étaient pas là ils seraient ailleurs. Salutaire qu’ils ne prennent pas toute la place, interdit d’en sortir. Supposons un instant le retour d’un mort, bien mort, personne n’en veut, n’est-ce pas ? Disons d’emblée qu’un mort qui reviendrait n’est pas un mort, un mort ça ne revient pas.
Il ne faut pas se méprendre, le cimetière n’est pas un amer indiquant un danger. De danger il n’y a pas, rien dans les fosses ou si peu, personne n’est dupe. Le cimetière est une bouée à laquelle les vivants s’amarrent, reliée par un filin à un corps-mort, le chemin du cimetière est cette amarre. La communauté est attachée au séjour des morts comme à un corps-mort, empêchant qu’elle s’abandonne au vent et se perde au large. Le chemin qui mène au cimetière et qui en revient est le canal qui maintient tendu le dialogue des vivants et des morts. C’est en conduisant les morts au cimetière qu’il se retend et qu’on s’assure de sa solidité.
Chez les morts ça bouge mais bien moins que sur la mer, ça bouge à cause du roulement et des désaffectations partielles qui évitent une croissance démographique incontrôlable des morts. C’est dire que les morts meurent une seconde fois lorsqu’ils rejoignent la communauté des ancêtres qui n’ont plus de nom. A la communauté des vivants répond donc celles des anciens, bien plus nombreux que les vivants. On aurait pu faire avec un plus petit espace encore, mais il en faut un pour abriter le laboratoire de nos alchimies. Sans l’alchimie que les vivants font subir aux morts, on ne survivrait pas, tout serait confusion. Mourir n’est pas exclusivement l’affaire des morts, c’est aussi l’affaire des vivants, les mort l’ignorent, mais nous savons-nous que nous sommes vivants ?
La vieille était assise sur le banc, je la connaissais bien depuis qu’on se croisait sur le chemin des Tailles et qu’on s’entretenait de choses et d’autres. Ce jour-là elle m’avait parlé du cimetière près duquel nous étions, de la mort qui la guettait et de ceux qu’elle allait bientôt rejoindre. Elle avait vécu toute sa vie à Pra Massin au Cachet-dessus. Je l’avais écoutée avec attention, elle parlait lentement avec du silence tout autour. Ce jour-là, j’ai mieux compris pourquoi il convenait de faire une place aux morts. Sitôt rentré j’ai rédigé quelques notes, on s’est revus plusieurs fois, elle parlait de moins en moins. Elle disait en plaisantant qu’elle ne voulait pas qu’on s’attache trop, puisqu’il allait falloir qu’on se détache. J’ai repris ces notes il y a quelques jours pour donner une forme à ce que j’avais cru comprendre, cette paix un peu effarée que les silences et les mots simples de cette vieille dame m’avaient procurée en m’obligeant à revenir sur l’inconcevable. Aujourd’hui la vieille est morte, son cadavre est derrière le mur du cimetière contre lequel est appuyé le banc sur lequel je suis assis, je regarde tout autour le village et Cachet-dessus, la route qui y conduit et le segment qui s’en sépare pour remonter jusqu’ici. Je vais mieux, j’ai parlé de la mort, des morts surtout, il le fallait. La vieille de Pra Massin est bien vivante en arrière de moi, c’est un peu elle qui parle, nos voix se mêlent, me pousse à aller de l’avant et à risquer ces mots, je suis un tard venu.
Depuis le temps, c’est comme si je voyais les choses de loin et d’en haut, mais aussi à ras de terre avec la tête qui se défait. Me reste accroché je ne sais ni où ni comment ce que je tiens des miens qui se faisaient entendre sans trop en dire sur les pas de porte, d’étage à étage ou par la fenêtre. On ne parlait pas tellement de nos affaires avec les morts, mais elles étaient là, bien là, et on faisait ce qu’il fallait en s’aidant, simplement, en faisant comme on a toujours fait. Mais ce que tout le monde savait sans avoir besoin de le dire, c’est que pour continuer à vivre, il fallait bien les mettre quelque part nos morts, pas n’importe où, ils nous en auraient voulu, et un mort qui vous en veut c’est comme un ongle incarné, ou une maladie chronique, il ne vous lâche pas.
Je viens de temps en temps jusqu’ici, je regarde le village et Cachet-dessus. Tout ce qu’on voit aux alentours, c’est eux qui l’ont fait, c’est le travail de nos morts bien vivants encore, si on regarde bien on reconnait leurs visages. Ce sont eux aussi qui nous ont faits et qui continuent à nous faire, mais il fallait qu’ils meurent pour qu’on mette le pied à l’étrier, sinon c’est nous qui serions morts d’abord, eux ensuite et la mort aurait gagné la partie. Quand je monte ici, je fais un tour parmi les tombes, enlève quelques mauvais herbes. Je souris aussi à la vue des pierres tombales, des arrangements floraux, de l’abandon parfois, ça a fini par leur ressembler. Je ne leur parle pas, mais je pense comme je l’ai toujours fait, avec eux à mes côtés. Je sais qu’ils sont morts, mais ça ne m’empêche pas de vivre avec eux, c’est-à-dire avec leur absence.
Sur le moment c’est incompréhensible, si impensable que parfois ça dure plusieurs jours, plusieurs mois. La mort du mort c’est pour le vivant comme une mort pointée, un impensable qui peut se prolonger indéfiniment. Les vivants doivent à leur tour faire mourir celui qui est mort et retenir ce qui est vivant, c’est de l’alchimie, c’est plus long que de mourir soi-même et laisser faire les autres, il faut du temps. Et faire les gestes justes pour ne pas succomber à l’effroi et trouver une réplique l’inconcevable. Non pas s’y résigner mais y répondre. Dans nos villages, aller au cimetière, y déposer nos morts, en revenir, c’était notre réplique. Nos cimetières sont juste à la distance qu’il faut, à pied s’entend, ni trop loin ni trop près, à la distance juste.
Quand quelqu’un mourait au village personne ne faisait le mariole, les croyants, les catholiques, les agrariens, les socialistes, les radicaux, on montait tous le chemin du cimetière côté à côté, il ne serait jamais venu à l’idée de quiconque de mettre tout ça en cupesse, sans compter que personne n’aurait su exactement où glisser le levier, le jour de l’enterrement, ce que pensait chacun n’avait aucune espèce d’importance, on partait de l’église, ou parfois du domicile de celui qui était mort et on le portait jusqu’au cimetière. On faisait la plupart du temps le voyage en deux fois, du domicile du mort à l’église, de l’église au cimetière, avec le cercueil à bout de bras, il tanguait à l’avant du cortège comme une barque. Le dernier bout, c’est le chemin du cimetière, tous nos morts passaient par là, qu’ils viennent du village ou de Cachet-dessus. Pour les gens de passage qui demandaient où se trouvait le cimetière, on disait à l’entrée du village, pour nous je crois qu’il a toujours été à la sortie.
On le déposait dans la fosse, le pasteur disait quelques mots, personne ne l’écoutait. Mais personne ne lui en voulait, parler c’était sa manière à lui de se taire. Ce qui se passait n’avait rien à voir avec ce que chacun d’entre nous croyait. Il s’agissait d’abord de se débarrasser de ce corps, de rendre à la terre ses parties lourdes, quant aux parties subtiles qu’on allait rapatrier, on devinait qu’elles se mêlaient déjà aux nôtres. On revenait au village par petites ou grosses grappes avec l’assurance que le mort était bien mort et qu’il ne reviendrait pas. Le chemin qui nous ramenait ne charriait pas les mêmes choses à l’aller qu’au retour. On ne redescendait pas le chemin sans rien, mais avec quelque chose, quelque chose en creux, qui ne tenait pas dans une boîte, quelque chose qui ne prenait pas de place dans nos mains vides.
Le cortège était un vrai tambour de machine à laver, le cortège bougeait dans tous les sens, le drap délicat était à l’avant, à l’arrière c’était plus raide, mais c’est ceux de l’arrière qui poussaient ceux de l’avant. Je crois, si on met à part le premier rang du cortège, le gros de la communauté portait dans son coeur ces journées, on était tous ensemble, les travaux s’interrompaient dans le village, on aurait dit que l’horloge du clocher n’avait plus ni grande ni petite aiguilles, à l’arrière ça causait, aussi bien de ce que le mort avait emporté que de ce qu’on allait retenir et ramener.
Il y avait dans l’air quelque chose qui nous rendait modestes et radieux, l’air luimême peut-être qui circulait entre nous, la place que le mort nous avait laissée et qui se multipliait tout autour. Ce n’est pas qu’on tournait ou dansait autour de ce vide qu’il nous avait laissé comme autour d’un arbre de mai, ce n’était pas un vide, mais du vide, du vide qui se distribuait en chaque point de l’espace, comme du temps qu’on ne compterait pas. Il y en avait partout et pour tout le monde, on levait alors la tête dans le ciel et on voyait ce rien de lui qui vivait en dedans de nous, même mort. Rien besoin de croire.
L’air frissonnait, aucun de nous n’était exactement là où les autres l’attendaient, quelque chose de nouveau nous obligeait à reconsidérer notre place. Il y avait du jeu entre les choses, dans notre tête aussi. On débordait de notre niche habituelle, on cédait notre place comme au jeu du taquin. On apercevait aux alentours l’invisible vitalité du défunt, son visage éclaté, partout sa présence. Nos ancêtres délivrés de la pesanteur dansaient eux aussi, j’ai la chose devant les yeux. Notre ciment était fait du vide laissé par le mort, ça n’étriquait pas, c’était invisible et ça portait. Certains se disaient à l’intérieur d’eux-mêmes que de rejoindre le monde des morts, c’était faire une fois quelque chose de bien pour les autres, et ils avaient moins peur. Ça ne consolait pas, mais ça montrait qu’il y avait quelque chose qui nous dépassait de tous les côtés. Et c’est l’un des nôtres qui nous le montrait, sans qu’il le veuille, en quittant sa place parmi les vivants et en rejoignant le lieu où ceux qui l’avaient précédé l’attendaient. On disait parfois en plaisantant que si le mort avait été là, il aurait regretté de ne pas être de la partie.
Le vide que fait un mort c’est quelque chose qui se répercute jusqu’au ciel, comme un caillou jeté dans l’eau qui coulerait à pic, mais dont les effets se prolongeraient à l’infini. Il y a juste le caillou qui ne bouge pas, il s’est détaché de notre communauté, mais il vient en retour écarter les limite de la vie, repousser la mort et donner un peu de place à nos travaux et à nos jours.
Ce sont les morts qui nous ont faits, nous font et nous défont, c’est le grand jeu des générations, des héritages sans testament et de la vicariance tracé à même le sol et dans l’ordinaire de nos jours, auquel des générations se sont conformées sans qu’il ne soit écrit quoi que ce soit à son propos. C’est l’écriture d’avant l’écriture, l’égale de ces semainiers dont personne ne songe à discuter le nombre de tiroirs. Mais qui est devant ? Qui était avant nous ? Qui est à l’avant de nous ? La vieille de Pra Massin n’a jamais rien regretté, les gens du village ne sont plus les mêmes, disait-elle, ils ont amené du sang neuf, d’autres habitudes et d’autres usages. Quelques-uns conduisent leurs morts ailleurs et les y laissent. Les choses vont si vite que tout le monde ignore où demain nos morts vivront. Les communautés erreront peut-être sans amarres, heureuses, entre néant et illusion. Quoi qu’il en soit on ne peut rajeunir la manifestation de la vie avec du gris sur du gris, on peut cependant reconnaître au crépuscule que le gris laissé par l’histoire brûle encore de mille feux, puzzle géant, blé, orge et seigle sépia, prés verts et coquelicots, noir de bitume et gris souris.

Publié le 3 mai 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez François Bon (Tiers livre) .
Jean Prod’hom
Dizy - Vallée de Joux

Bientôt huit heures et branle-bas le combat dans la salle de l’ancien café de Dizy où nous rejoignons les deux Bataves de la veille qui se préparent pour une nouvelle étape, chaque année une vingtaine de jours pour rejoindre Rome. Je déjeune à pleines dents, mais pas question pour Arthur de mêler son couteau et sa cuillère à ceux des autres, qu’ils passent ou qu’ils restent, si bien qu’Arthur jeûne. Tous à la même table, pèlerins et employés de la ferme, noires du Togo, crème de Chine, orange d’Amsterdam, rousses d’Irlande et blancs de Londres. On est les derniers à quitter les lieux.
Dizy
Cimetière
Bois du Prieuré
Ferme du Bois de Fey
Le Veyron
La Tine
La Venoge
Ferreyres
La carrière de calcaire jaune de Bellerive
Bois des chênes d’Echilly
Four à fer des Bellaires
Four à chaux
Envy
Sinjin
Rouge Bou
Juriens
Voiture du boisselier de La Praz
Café du Jura de Nelly à La Praz
CImetière
Combe du Renard
Côte de La Praz
Chalet Lyon (1257)
Boutavent Dessus
Pré de Joux
Crachin
Col du Mollendruz
Restaurant du col
Pétra Félix
Communal du Pont
Sagne Vuagnard
Le lac de Joux
Le Pont
Il est 18 heures, la pluie redouble, on attend le train de 18 heures 30 pour le Day et Lausanne. Encore un hamburger au Mac do de la gare, et puis le M2 jusqu’aux Croisettes. On trouve une borne sur laquelle s’asseoir en attendant Sandra, on en a plein les jambes.
Et voici que celui à qui je répète depuis plus de treize ans qu’il convient de remercier les gens qui offrent un peu de leur temps ou de leur argent, ou même un peu de ce rien qui fait tant de bien, voici donc que celui que j’aurais voulu remercier pour ces deux belles journées en sa compagnie me précède d’un rien.
Jean Prod’hom
















Riau Graubon - Dizy

Il est 8 heures, encore frais, départ pour la Vallée. Peu de mots, on se l’était promis avant l’été. Aller au plus court, direction ligne d’horizon, ce qu’on a sous les yeux. Disons en deux étapes, Arthur et moi.
Riau Graubon
Messelly
La Corbassière
Jorat de l’Evêque
Route des Paysans
Jorat d’Echallens
Maupas
Froideville
Epicerie du Mille-Feuilles
Fontaine de Froideville
La Rustériaz
Bottens
Le Château
La Tuilière
Le Talent
Malapalud
Assens
L’église d’Assens
Terrasse de l’Epi d’Or
Boulangerie Fornerod
Bois d’Orjulaz
Chevrine près de Boussens
Sellerie Rochat
Bournens
Fontaine de Bournens
Cimetière de Bournens
Pont sur l’autoroute
Penthalaz
Piscine de la Venoge
Orage
Funiculaire Cossonay-Gare-Cossonay
Achat du pique-nique à la Migros de Cossonay
Tuilerie
Bois du Sépey
Arrivée à Dizy
Refuge de la Venoge
A 18 heures, avec trente kilomètres dans les jambes et le feu dans le ciel, Arhur demande :
- Dis papa, C'est quoi le plus proche de nous. Les pieds ou la tête ?
Jean Prod’hom
















Au Riau

Passe la journée à l’ombre, dans l’ancien collège, y consulte les archives de la commune de Corcelles-le-Jorat avec une idée fixe mais sans méthode, en sors épuisé. Le cimetière de Corcelles a bel et bien été décollé de l’église et déplacé du centre du village au milieu du XIXème siècle. Plus précisément entre 1834 et 1837, années durant lesquelles différents travaux ont été réalisés, les comptes communaux en attestent : niveler le terrain, poser des coulisses, voiturer le sable et les cailloux pour le hangar - qui n’existe plus -, descendre à Lausanne acheter des fermentes – chez Francillon –, charpenter le couvert de l’entrée,…

Mais de ces heures passées à faire la taupe, je ne ramènerai ce soir qu’une image, celle tirée du Plan de territoire de la commune levé en 1851 et 1852. On y voit là où j’habite aujourd’hui, une étable rose et une remise sans nom ni chiffre, avec derrière un chemin de terre qu’empruntait le propriétaire d’alors, Jean-Pierre Porchet. On aperçoit sa ferme, une ferme avec son habitation ouverte au sud et à l’ouest, puis son rural constitué d’une grange, d’une écurie et d’une remise, un grand jardin et deux places de terre battue devant et derrière – avec côté midi une fontaine. Un peu plus loin à l’est un étang.
Cette ferme n’existe plus, elle a brûlé, on raconte qu’un char cité par deux chevaux l’a quittée le soir de l’incendie bourré jusqu’à la gueule de meubles et d’ustensiles.
L’étable et la remise d’en face ont pris de l’importance, un peu plus encore lorsque le propriétaire qui nous a précédés les a rachetées, a rehaussé le toit et créé un appendice pour des enfants qui n’y ont jamais habité. Nous avons récupéré il y a une dizaine d’années la part d’eau qui nous revenait, trouvé un bassin de granite, le trop plein alimente aujourd’hui un petit étang creusé au fond du jardin.
Pour le reste, les fermes, le blé, l’orge, les pommes de terre et les betteraves sont les mêmes, le ciel aussi. Et le ruisseau du Riau serpente dans les bois comme autrefois même s’il coupe plus tôt la nouvelle route qui monte à la Moille-au-Blanc, peu avant la poche herbeuse dans laquelle s’enfonce sans disparaître le tracé de l’ancien chemin.
Jean Prod’hom
Pacoton



Les prés s’écaillent, tas de barres, tas de rouille et volets clos, la mécanique déborde, des fils de fer sortent raide d’une boîte d’Ovo, les araignée prises au piège sèchent et cassent à côté d’une poignée de clous orphelins, la vie fait vis sans fin à Pacoton.
Pas de taille cette année, ni essence là où scies et fils se sont succédé à l’établi, on huilait les gonds en toute fin de saison, jetait des fagots et des taillés dans le four à pain, personne ne saura le nombre exact des bouteilles bues à Pacoton. Je marche sur les jours d’une autre saison, on a brûlé les outils de l’autre siècle, skis de bois sans bâtons. Seuls les légumes du potager chantonnent encore au-delà du jour fixé par le jardinier, picoti picoton, ne restera de cette chanson qu’un linteau de molasse avec écrit 1865 dessus, près de la cheminée d’un salon bourgeois.
Jean Prod’hom
Eric Chevillard manque à l'appel

La rédaction et la publication quotidiennes de mes billets m’auront permis de découvrir quelques-unes des innombrables affections de l’âme que celle-ci est amenée à endurer lorsqu’on lui demande de suivre une règle aussi contraignante somme toute que celle de saint Benoît. Mais elle m’aura aussi conduit à vouer une admiration sans borne, presque religieuse, pour les triptyques quotidiens d’Eric Chevillard. La variété de ces petites proses d’une ou quelques lignes et la légèreté avec laquelle chacune d’elles s’ouvre, fleurit et se clôt n’ont pas cessé de m’émerveiller et de m’interroger. L’homme disposerait-il de nègres ou d’une martingale à esbroufe, d’un automate syntaxico-sémantique ou d’un vieux secret ?

Or voilà que nous voici dimanche et deux fois trois billets du bonhomme manquent à l’appel, ceux d’hier et d’aujourd’hui. Je m’inquiète d’abord avant de constater bien vite que ce n’est pas la première fois, ce diariste a posé des lapins à plusieurs reprises déjà, chaque fois un dimanche : les 30 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2012, le 2 juin 2013. Va pour dimanche mais samedi ? Je fais quelques conjectures sans grand intérêt, sans grand enthousiasme non plus avant d’entendre distinctement la leçon que mon héros m’a adressée, l’admiration toute religieuse que je lui vouais se transforme alors en compassion. Tout n’est donc pas si facile, la mayonnaise parfois ne prend pas, le regard peine à se fixer ; derrière ces paraboles légères et leurs courbes aériennes il y a un homme besogneux, me voici guéri, Eric Chevillard ne rédige pas ses triptyques comme j’effeuille une marguerite ou compte les 807 brins d’herbe de ma pelouse, les trois petits foyers ont chaque jour besoin de conditions particulières et d’une flamme qui parfois manque.
En attendant la livraison du prochain triptyque de Chevillard je livre ce billet, assez satisfait d’être au rendez-vous, mais avec le désir coupable de détourner en ces lieux, avouons-le, ses habituels lecteurs.
Jean Prod’hom
Rue-Cité-Devant

Inutile de mettre le monde sens dessus dessous ou de proposer à l’autre un regard décalé sur les choses si celui pour lequel on le fait ne les saisit pas lui aussi en se décalant. C'est seulement alors que, au-delà de la performance, ce à quoi ni l’un ni l’autre ne songeaient peut-être se met à jouer le grand jeu, fait tourner les têtes en y instillant une image dans laquelle l’homme perd pied et l’ordinaire un peu de sa gravité.
Jean Prod’hom
Mise en rose

Les cercles de fer cliquètent, les douves mises en rose par le tonnelier ne sont plus étanches, les pétales des coquelicots tombent comme les pièces d’un mikado. Saint Vincent s’est absenté avec tous les dieux, c’est désormais à nous de resserrer jour après jour les feuillards de saule pour faire vieillir le vin. On a beau dire, mais les dieux nous ont laissé laudes et vêpres, matines et complies ; à n’importe quelle heure du jour nous pouvons aller chercher un peu d’eau et donner à boire au bouquet des champs, faire tenir ensemble les douves de notre embarcation et montrer aux dieux, au cas où ils reviendraient, que nous avons pu faire sans eux. Ravis, ils s’assoiraient à nouveau parmi nous. Mais à leur juste place.
Jean Prod’hom
Retourner à Bellelay

On a parlé de choses et d’autres, de nos enfants, un peu de musique, de la difficulté de mener à bien nos entreprises lorsqu’elles viennent du dedans et qu’on souhaiterait pouvoir les toucher du dehors, de nos années de fous, des choix qu’il faut faire, de la sagesse qui nous maintient en vie. C’était dans la cave voûtée de la cafétéria de l’asile des incurables de Bellelay comme on les appelait autrefois, devant une salade, puis devant un café sur la terrasse, ensoleillée, mais battue par la bise qui pique un peu à plus de 950 mètres.

Lui c’est Antoine, on s’est connus à Riant-Mont, nous étions des gamins, il habitait une belle propriété cachée sous les arbres dont on apercevait les dessous lorsqu’on redescendait du Petit Parc. On s’y est croisés une ou deux fois avant de se perdre de vue, tout s’explique, il est né une paire d’années après moi, et les années comptent double à dix ans.
Il aura fallu un enchaînement de circonstances pour qu’on passe un bout de la journée ensemble entre Tavannes et Porrentruy, à l’intérieur d’un enclos dont il est inutile de fermer les portes, au bout d’une route qui ne mène nulle part, lieu habité à l’extrémité des terres, charme discret, un peu vieilli, sans contrepartie, charme comparable à celui des villages construits sur des promontoires que le temps érode, qui les a protégés autrefois et qui les aliènent aujourd’hui, silence de cire, Villarzel, Dommartin, Essertines ; finistères oubliés par les passants eux-mêmes. Car on ne passe pas à Bellelay, on y reste ou on rentre chez soi avant d’y revenir.
On se quitte, Antoine retourne aux orgues de son saxo, mais il reviendra à Bellelay en septembre 2014 avec Monteverdi pour fêter le tricentenaire de la reconstruction de l’église abbatiale.
Jean Prod’hom
CXXXI

Dans le café enfumé de cette petite ville sinistrée de la Broye, Klaus m’est apparu comme sur une scène d’un mauvais théâtre, fardé à l’excès, une perruque sur la tête, des pattes d’oie creusées au coin des yeux, le teint blafard, le regard voilé, les joues tombantes, la peau piquée, les dents savamment avariées. Mais il a suffi de quelques secondes seulement pour que cet ami que j’avais perdu de vue pendant plus de trente ans réapparaisse comme un jeune premier sous ce déguisement de mauvais goût qui est celui des ans.
Je lui répète la même chose, deux fois, trois fois, quatre fois, avant de m’aviser qu’il a peut-être perdu la raison, ou qu’Alzheimer est passé par là, ou qu’il est tout simplement sourd. A moins que ce vieil ami, plus sagement, ait renoncé à écouter celui qui radote en face de lui.
C’était à l’heure du café et de la déconfiture.
Jean Prod’hom
Fous de Dieu

Le 15 septembre 1797, racontent le Père François Berbier et Cyrille Gigandet, c’était un vendredi, les représentants de la République française, après avoir copieusement bu et mangé, pénétrèrent dans les chambres des chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré à Bellelay pour mettre la main sur tout ce qui était à leur convenance. L'arrêté d'expulsion précise que chacun des trente-huit chanoines ne put emporter que les effets à son usage. On garda huit chanoines en otages, et on fit accompagner le dimanche les trente autres par des gendarmes en zone neutre.

J'en imagine quelques-uns d’entre eux dans cet espèce d'entonnoir de pâturages qui descendent en pente douce le long de la Sorne jusqu’à la Birse, avec pour seuls bagages quelques habits et deux ou trois livres sous le bras, un gendarme à leur côté, laissant derrière eux la fine fleur de l’armée révolutionnaire – sous les ordres de Gouvion de Saint-Cyr – pillant ce qui pouvait l’être, plaçant des scellés sur ce qui ne le pouvait pas. On ne commença l'inventaire des biens des Prémontrés que lorsque le bâtiment fut vide.
Une fois les vingt-cinq pensionnaires et les huitante-neuf domestiques de l’abbaye renvoyés, un autre silence s'est installé à Bellelay qui, je crois, ne l’a jamais quitté malgré le chant des rossignols et les affectations passagères de ses bâtiments : hôpital, écurie, brasserie, verrerie. Cet étrange silence, et ce quelque chose qui est comme abandon ont été pris au piège dans la coque vide de l’église, les marécages et les tourbières qui l’entourent.
C’est en 1894, lorsque l’Etat de Berne a racheté les lieux pour en faire un asile d’incurables (plutôt qu’un pénitencier), que la solitude et le silence se sont fait entendre à nouveau à Bellelay, ramenés par des hommes et des femmes venus de nulle part, aliénés, fous de Dieu sécularisés, fils et filles sans père ni mère, sans abbé ni abbesse. Les premiers sont peut-être arrivés en longeant la Sorne, ou sont montés de Tramelan, des proches les ont accompagnés, les orphelins encadrés comme il se doit par des gendarmes.
Le silence, l’abandon, la solitude habitent aujourd’hui les couloirs déserts des trois étages du logis principal, pris au piège derrière les portes fermées des chambres, bureaux vides, salles d’animations désertes. Un bruit de clé soudain, une porte s’ouvre, unité de psychiatrie de l’âge avancé 2, une infirmière en sort, un visage sur une chaise roulante, un bruit de fond, désordonné, des remous, un regard d’une violence inouïe, désarroi. Et le silence à nouveau qui se referme sur lui-même.
Antoine Auberson, Bellelay, Repérages, 9 juillet 2013
Lui vit à Saint-Imier, fume et boit du coca sur la terrasse ensoleillée du réfectoire, il n’a pas de livre, il raconte et ne raconte pas, né à Courfaivre, il travaille dès la fin de son école dans une usine à vélos, pendant deux ans. Mais il se dispute avec son patron, bien d’accord qu’il fasse chaque jour une pause, il en a le droit, mais qui exige qu’il la fasse en travaillant, pour ne pas perdre de temps. Aide ensuite un paysan de Courfaivre histoire de s’occuper, est employé quelques mois dans une entreprise de nettoyage, chez Emmaüs enfin. Sa vie semble s’arrêter là, il se fait hospitaliser une première fois à dix-neuf ans. Cela fait trois semaines qu’il est là, il monte de Saint-Imier à Bellelay régulièrement, des séjours de trois semaines ou plus, depuis plus de vingt-cinq ans, il en aura quarante-sept ans la semaine prochaine. C’est comme s’il racontait tout cela pour ne pas s’en souvenir.



Antoine Auberson, Bellelay, Repérages, 9 juillet 2013
C’est lundi, des jardiniers râtèlent l’herbe du parc, une débroussailleuse chasse le soleil, la gardienne fait un mot fléché à l’entrée de l’église abbatiale, la porte est ouverte. S’échappe une étrange musique, longue phrase dans laquelle le silence se dédouble, l’église est vide, le silence fait tache d’huile. Comment revenir à Bellelay ? Et d’où ? Et quoi dire de nulle part, il n’entend pas, il est blessure, il est demande, demande sans fond. J’aime ce nom de Bellelay.
Jean Prod’hom
CXXX

Barthélémy avait abusé de stupéfiants. Il raconta plus tard qu’il s'était pris pour une carotte, puis pour un éplucheur, enfin pour une carotte et un éplucheur.
C’était le beau temps, les tagueurs réalisaient leur oeuvre dans un esprit de totale liberté, les catalogues de leurs graffitis étaient financés par le contribuable et réalisés entièrement par les photographes des polices municipales.
Il y a du grabuge, démêle-toi.
Jean Prod’hom
Dans un quatrain de Follain

Conférence de fin d’année ce matin, tout l’établissement babille dans le hall des pas perdus, c’est la foule des grands jours. Règne un brouhaha qui faiblira mais ne cessera pas, il y a tant à dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Les lunettes à soleil dressées sur le front de quelques-unes nous rappellent qu’il fait beau dehors. On se penche un bref instant sur les incivilités des tout petits, on convient des cadres à fixer autour de leur irrépressible agitation. On les voudrait au fond immobiles, en rang d’oignons à côté d’un citron, d’une poire et d’un pot de fleurs, nature morte, nappe verte et lumière profonde au temps du cinéma muet.

Il y a le réseau, le réseau-réseau, le réseau-ressources, les remises au pas, les appuis, la dynamique négative, le redoublement, le soutien institutionnel, belle grappe de langue, on se grise. On passe en revue les classes : la 201, la 303, la 402, la 403, pas de 807 cette année. On salue les enseignants à la retraite, on évoque les situations qui en appellent d’autres, et puis il y a les refus, les accords, les validations. On a installé de tout nouveaux filets de sécurité, on accorde encore des faveurs mais les privilèges ne seront pas rétablis. La dyslexie, le dyscalculie, les dyspraxies, les dysphasies, la liste s’allonge, demain tout mal aura son mot. J’apprends que le multi-âge est banni.
On ouvre l’enveloppe, la boîte des horaires, celle des généralités et des compléments, formellement ou concrètement, celle des mises à niveau, des réorientations, des effectifs réduits, et des options spécifiques. La vendange est belle, je m’étonne pourtant de nos certitudes collectives et je devine derrière le ronflement du lexique une assurance qui vacille.
On nous rappelle que les mamans ne seront plus obligées de fourrer les cahiers de leurs enfants fabriqués par des prisonniers. Je l’ignorais mais le journal de la fonction publique de l’Etat de Vaud nous l’apprend, les cahiers utilisés en classe sortent des ateliers des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. Dix détenus travaillent huit mois durant à la confection du million de cahiers (15 types en 4 formats différents) distribués dans les classes à la fin de l’été. Le journaliste de La Gazette de 2004 note que le pécule qu’ils reçoivent en échange permet d’améliorer l’ordinaire des prisonniers et d’acheter des cigarettes. Echange de bons procédés, je souris, un cahier de géo contre une clope.
Plus délicat, je crois entendre soudain les échos d’une vieille querelle sur le rôle de l’école dans le redressement moral des enfants. Une parabole. Voici. De deux frères jumeaux en tout point pareils, le premier avait fait tout ce qui lui avait été demandé au cours de sa scolarité, il avait été poli, était venu aux appuis, jamais en retard, avait fait des efforts considérables, volontaire, besogneux même. Malheureusement le bon bougre à bout de souffle avait raté d'un demi-point l’obtention de son diplôme. Ne fallait-il pas aider cet être désarmé ? L’institution veille, elle sait reconnaître ce qui doit l’être, le gamin le méritait, elle lui a octroyé ce qui lui manquait. Son frère jumeau n'avait quant à lui rien fait de bon depuis le début, avait été désobéissant, moqueur, jamais coiffé, crâne, devoirs non faits, menteur, buissonnier, au diable les efforts, soldeur, m’enfouteur et j’en passe. Comme on peut s’y attendre le garnement avait raté l’obtention de son diplôme, d’un demi-point, le conseil des sages ne lui a pas octroyé ce qui lui manquait. En vérité je vous le demande, lequel des deux avait un avenir, l’enfant à bout de souffle qui avait été sans faillir à l’image de ce que commande l’institution ou celui qui était plein de force de n’avoir rien fait et qui rappelait à l’enseignant celui qu’il aurait aimé être : courageux, indiscipliné, naïf, confiant. L’institution a tranché, petit vaurien, tu partiras les mains vides, sans papier, sans diplôme, héros si tu le veux dans les Ardennes, dans un récit de Dhôtel ou dans un quatrain de Follain.
L'année s'est bien passée je crois. Les vacances feront du bien à tout le monde. Mais j’ai au fond un peu peur, j’aimerais qu'on me réconforte, qu’on me persuade que tout cela est encore solide. J’entends une voix qui me souhaite de très loin le meilleur en m’avertissant du pire.




Jean Prod’hom
Bascule

Dans deux ans Michel fermera sa boutique, une boutique placée à l’angle de la route de Lausanne et celle de la Blécherette. Cette fin a été annoncée il y a une trentaine d’années déjà lorsque les paysans ont cessé d’engraisser les deux cochons qu’ils bouchoyaient alors en octobre et en avril, mais aussi lorsque les exigences liées aux mesures d’hygiène ont pris le pas sur le bon sens. On n’abat plus à Coppoz, l’échaudage, l’épilage et l’éviscération se font dans des abattoirs industriels. Ici on débite la viande saignée ailleurs et on prépare la charcuterie. Ce matin Michel gaine les 18 mètres de l’intestin d’un cochon, préalablement gratté et retourné, et l’enfile à l’embout du poussoir d’où sort la pâte de viande préalablement hachée et salée. Plus de tripier, les boyaux se vendent au mètre chez des spécialistes, un ami lui donne un coup de main.
Michel aidait son père sur leur domaine des Buchilles et bouchoyaient d’octobre à avril dans les environs. D’autres que lui offraient le même service dans le coin, Marcel aux Planches, d’autres au Petit-Mont et au Grand-Mont, il y avait de la concurrence, c’était avant que les paysans des petits domaines tombent aux mains des gros paysans. Mais il offrait ses services au-delà de la commune du Mont, à Cery d’abord, pour abattre les porcs engraissés dans les boitons de l’asile psychiatrique. On y nourrissait plus de huit cents cochons par année, Michel s’y rendait le lundi et le mardi. Mais il n’y travaillait pas seul, un autre boucher l’accompagnait, et un tripier qui préparait les boyaux. Les hôtes du lieu faisaient le reste, préparaient les lots, mettaient en sac, étiquetaient. Michel a exercé aussi ses talents à Forel, à Oron, et jusqu’au bout du lac, Genève, Carouge et Meyrin. En ce temps d’avant la bascule, les cochons faisaient plus de deux cents kilos, on les abat aujourd’hui à quatre mois, cent vingt kilos maximum.
Michel a mangé du cochon toute sa vie, du sang le matin que sa femme faisait revenir à la poêle, de la fricassée à midi, de la saucisse à rôtir le soir. Il n’avait pas fait de check-up depuis 11 ans, Michel rit des résultats du mois passé : pas de cholestérol.
Les promotions commencent à 10 heures, je n’étais jamais entré dans ce local, me demande si l’un ou l’autre des élèves qui vont recevoir tout à l’heure leur diplôme y a pénétré une seule fois, ou a même imaginé ce qui s’y passait tandis qu’il apprenait à raconter, à compter, à écrire. Raconter et écrire quoi ? Le monde ancien n’en finit pas de se terminer, le nouveau tarde à se lever clairement.
Jean Prod’hom






Ça sert à ça la langue

Mots de fin de saison, usés, collés au palais, racines coupées, à peine des mots, impossible de s’en défaire, trop désarticulés pour les saisir entre les dents. Les détacher pourtant, par la force, les détacher de la nuit du dedans, par la bouche, et les écrire avec la langue, ça sert à ça la langue, se débarrasser des coques vides. On les croyait quelconques alors qu’ils repiquent sitôt jetés, lancent un premier éclat avec dedans un surcroît d’expérience, c’est une bande de coquelicots qui squattent un champ de pois sous les Terreaux. Un contexte strict qui ne les empêche pas de secouer leur tête rouge, une image de défaillant prise au hasard, inégale à elle-même, en plan, oisive et persistante.
Jean Prod’hom
Mon nouveau collège

Oeuvres vives et oeuvres mortes, des caissons étanches, écubier et guindeau escamotés, mais ni gaillard d’avant ni gaillard d’arrière, ni proue ni poupe, ni gouvernail.
- Parés à appareiller ?
- Parés.
- Conditions météorologiques ?
- Temps calme.
- Voiles ?
- Affalées.
- Filets ?
- Relevés.
- Ecoutilles ?
- Fermées.
- Corps morts ?
- En place.
- Bouées ?
- Prêtes
- Ancre ?
- Jetée.
- En route !
- Où ?
- A quai !
Jean Prod’hom
100

Paul appelle littérature tout texte qui tient debout lorsqu’on lui boute le feu.
On a remplacé le problème du mal par celui de l’identification exhaustive de tous les maux.
Ils ont soixante ans et font des mots fléchés dans le parking d'un monde parallèle, jouent au foot derrière un grillage, rôtissent à plat ventre, gros et gras sur le sable. Les cygnes jeunes et vieux se tiennent à l’écart de cet indigent spectacle en maintenant le plus longtemps possible leur tête au fond de l’eau.
Jean Prod’hom
Une doctrine à double foyer

Hier, on a démarré la journée avec les batteries à plat, sans disposer de chargeurs ou d’une voiture de service, on a dégotté finalement une pente, mais tard, très tard si bien qu’il nous a fallu mettre les bouchées doubles. C’est que, la veille, on était rentrés tard de la fête organisée par la commune du Mont-sur-Lausanne dans la grande salle du Petit-Mont. Belle soirée, silence entendu sur le job, on a voulu croire avant l’été que tout allait bien, que l'école de septembre ressemblerait à celle de juin, qu’il suffisait de prolonger les lignes vers un hypothétique point de fuite et de ne pas se demander s’il pourrait en aller autrement. On a montré dans ce domaine comme toujours de la bonne volonté et plein d’idées.

Tous, les architectes comme les politiques, les fabricants de tables, de chaises, de pupitres, de cahiers, de livres, tous, les enseignants et les élèves, les secrétaires et les concierges se tiennent la main pour parer à l’injonction qui leur est faite de prendre acte des nouvelles conditions objectives de nos vies. Sourires chez les professionnels, comme on dit, prêts à payer le prix pour ne pas avoir à se coltiner les effets de la mutation à laquelle nous convient nos vies réelles. On n’a pas évoqué vendredi soir les établissements des Pays-bas qui ouvriront l’année prochaine leurs portes de 7 heures 30 à 18 heures 30 avec pour seule obligation que les élèves soient présent de 10 heures 30 à 15 heures. L’enfant gère son planning comme il l’entend. Il y a par contre beaucoup moins de vacances imposées. L’établissement est fermé uniquement pendant les fêtes de fin d’année. En ce qui concerne les vacances, rien n’est imposé. Ce sont les parents et les enfants qui décident. Que les responsables des onze écoles de ce type les appellent des écoles Steeve Jobs n’est pas pour nous rassurer, mais l’idée que des gens répondent sur le fond à cette déclaration du même Steve Jobs selon laquelle il est absurde que le système éducatif américain repose encore sur le modèle suranné de professeurs debout devant leur tableau noir avec à la main leurs manuels scolaires n’est pas pour nous déplaire. On en est ici très loin encore, sachant que la clé de cette affaire ne relève pas essentiellement des moyens financiers et des outils mis à notre disposition, mais du courage de chacun de tout reprendre à zéro, de fixer les élémentaires priorités et d’agir bien plus comme des gamins pleins de bon sens que comme des professionnels imbus de leurs compétences et de leurs droits.






La cérémonie commence à 13 heures 30, on sera les derniers sur les lieux, la Yaris en bout de file avec les cloches qui sonnent dans le court campanile carré qui chevauche le petit faîte de l’église elliptique de Chêne-Paquier. Est-ce un choix délibéré des deux amoureux que d’avoir choisi cette église de 1667 pour se jurer fidélité, une église des origines secondes du protestantisme dans le pays de Vaud, sortie des mains de l’architecte Abraham Dünz ? Une église ovale avec une disposition en large dès l’origine, seul exemplaire de ce type si on excepte l’église d’Oron en ovale aplati construite elle aussi par Abraham Dünz peu après avoir terminé celle de Chêne-Pâquier (mais qui trouvera une utilisation en long au moins au début du XIXème siècle), ovale donc, ovale ovale, tout nu, sans contrefort ou porche avancé.
Toujours est-il que, samedi en début d’après-midi, la cérémonie s’est déroulée elle aussi sur un plan elliptique, on a en effet tourné autour de deux foyers, le premier qui maintenait dans son orbite un peu lâchement le nom des oeuvres vives de Dieu et les paroles de l’Ecclésiaste, le second qui tenait en laisse le pasteur amoureux de cette rhétorique de la persuasion et du divertissement utilisée en d’autres lieux, pour maintenir les brebis dans leur enclos. Un vitalisme donc conjuguant un contenu doctrinaire secondaire, relativement pauvre, obéissant aux lois du discours publicitaire, avec de l’énergie brute, positive, prioritaire, que transmettent avec doigté les animateurs d’aujourd’hui, chargés à bloc, qui ne se départissent jamais d’une certaine bonne humeur et d’un sourire confiant, presque carnassier, quand bien même le ciel leur tomberait sur la tête. Pasteur donc, habillant ses dires non pas d’images au sens classique, les protestants demeurent iconophobes, mais de figures rhétoriques colorées, images encore qui, de connexion en déconnexion, admission, explosion compression, décompression, promettent que la fête sera vraiment belle.
Mais ce que j’ai appris hier au retour de Chêne-Pâquier, c’est que malgré Dünz Ier, les prédications, les promesses, les agapes, les mousses au chocolat, les sucreries et le soleil, on oublie souvent l’essentiel. Avant que le cortège des voitures coiffées d’un plumet blanc ne parviennent en effet à Donneloye, là où un chemin vicinal conduit à une ferme foraine, un petit groupe d’enfants se tenait là, au carrefour. Cinquante voitures avaient déjà passé et personne n’avait jeté de bonbons aux riverains comme le veut la tradition. Les enfants se tenaient immobiles, oubliés, aussi stupéfaits que s’ils avaient été les témoins d’une catastrophe dont nous aurions été les victimes et, tandis que nous nous éloignions de ces spectateurs ébahis, ils nous offraient dans une autre langue le sourire qui nous manquait, comme s’ils voulaient compatir avec notre souffrance silencieuse et nous libérer d’une dette. Ils disaient merci de n’avoir rien reçu, oubliant même ce qu’ils étaient venus faire à ce carrefour et dans l’ignorance de ce qu’on leur devrait désormais.
Jean Prod’hom
Un raté qui doit poursuivre

Louis Soutter, Personnage et guirlande de fleurs,1935
On annonçait hier au village la mort d’un des leurs en précisant de qui il était l’époux ou l’épouse, le père ou la mère, le frère ou la soeur, pour que les vivants puissent identifier celui qui allait manquer et entreprendre sans tarder les travaux de raccommodage. Mais on annonce ce matin aux gens du village la mort d’un gamin. Pas de réparation possible, l’enfant quitte les vivants par l’arrière, l’événement menace tout le village, ronge ses bords. Une mort qui ne mite pas le tissu mais le défait en tous sens, la commnauté d’un coup stérile et orpheline.
On ne sait pas très bien quoi dire au morts du cimetière. Impossible de leur demander d’accueillir ce gamin puisque ni son père ni sa mère ne l’ont précédé, impossible pour les morts de le laisser entrer puisque ce serait ouvrir la porte à des vivants, ceux dont il est le fils ou la fille. On ne mélange pas les morts et les vivants, disent de concert les uns et les autres, dans une même langue mais pas du même lieu.
Que faire de cet enfant qui n’aura pas tenu sa place, auteur d’aucune transmission chez les vivants et condamné à rejoindre avant l’heure le monde des morts, désormais prénom orphelin dans un coin du cimetière, vivant parmi les morts, un disparu qui erre, entre deux eaux, accepté nulle part, dans les limbes, un raté qui doit poursuivre (Cummings).
Jean Prod’hom
Le temps s'ouvre et se ferme comme un accordéon

L’oeuvre aboutie est voisine du suicide. Modgliani s’est tué parce qu’il ne pouvait supporter l’insuffisance de son oeuvre, comparée à la grandeur de son désir. Il existe des sages qui ajoutent lentement à leur oeuvre, il existe des Dieux qui meurent de leur impuissance. Je n’ai rien fait, je n’ai fait que rêver, imbécile. Mon Dieu je vous aime et vous supplie.
Ouvre l’oeil à 7 heures la tête pleine, retourne dans le tambour jusqu’à plus de 10 heures. Premier matin de vacances, c’est-à-dire premier matin à ne pas avoir besoin de me demander comme chaque matin de quoi les enfants ont réellement besoin, ne pas avoir à saisir les urgences devant lesquelles il est judicieux de les placer, ne rien faire, ou qu’ils s’ennuient, attendent, se taisent, placer des obstacles, prodiguer les premiers secours, écouter, dire deux mot, aller au plus court,...
Décide de descendre au marché avec Sandra et les trois petits, de m’éclipser vers l’une ou l’autre des manifestations que Lausanne propose. Plusieurs vernissages ont eu lieu hier, le XVIIIème siècle dans les collections du Musée des Beaux-Arts, Miró à l’Hermitage, mais il y a aussi l’exposition que le Mudac consacre aux sacs en plastique, Louis Rivier et Marcel Poncet au Musée historique, Amadou et Pierre Bataillard à l’Espace Arlaud. Me décide pour le Musée historique à cause d’une peinture sombre qui veillait au fond d’un couloir au Carillet à Pully et qui me revient à l’esprit.
Les amis et les petits enfants de Louis Rivier sont à l’étage, ils parlent haut et fort, comme l’autre jour, bénéficiant aujourd’hui encore de ce que leur ont laissé ces grandes familles bourgeoises et protestantes de Jouxtens-Mézery et de Mathod. Les Rivier et les de Rahm traversent notre temps en chevauchant des points d’orgue, honorant les héros de leur lignée peints sous les traits des princes toscans, amis des arts et des hommes, invisiblement généreux dans les jardins de leur château.
Au sous-sol désert un Socrate, défiguré comme de juste par l’un des fondateurs de la Société d'art religieux de Saint-Luc et Saint-Maurice, Marcel Poncet, défenseur de l'art sacré en Suisse romande, le prince Mychkine, une lettre de Louis Soutter que Marcel Poncet a mis sur les rails de la peinture, une gravure tourmentée de Jacqueline Oyex, deux autoportraits, une bouteille et un citron, assiette verte, napperon bleu, nappe rouge. J’aperçois dans une vitrine des poèmes de Jean Follain, aux éditions de La Rose des quatre vents que le catholique genevois a illustrés. Jean Follain réapparaît sur un écran de télévision dans une courte séance tournée, peut-être, dans la maison Saint-Christophe de Vich. Poncet y fait le clown entouré d’enfants.

A la fin du livre que Jaques Chessex et Valentine Reymond ont consacré au peintre et verrier, il y a une photographie réalisée à l’ouest du Bois de Chênes entre Vich et Genolier, près de la Baigne aux chevaux. On y voit Philippe Jaccottet et Marcel Poncet, mais aussi Jean-Claude Piguet tout jeune alors que j’ai assisté une année durant à l’université de Lausanne, un peu par hasard, à l’occasion d’un séminaire qu’il avait conjointement organisé au début des années quatre-vingts avec Pierre Gisel autour du requiem, et plus particulièrement du War Requiem de Benjamin Britten. Le monde se rétrécit soudain et le pavé sur lequel je pose le pied en sortant du musée se souvient. Est-ce ainsi qu'on se cherche des racines ou est-ce ainsi qu'on les trouve, parce que le temps soudain se confond avec lui-même, s’ouvre et se ferme comme un accordéon.
Jean Prod’hom
Marie-Noël

Elle traverse la cour en faisant basculer ses pesanteurs de gauche à droite et de droite à gauche, comme une oie, une oie gonflée à bloc mais sans canetons, suçotant continument le mot de respect qu’elle postillonne au visage des quidams comme un chien pisse au pied des buissons. Héritière des kapos aux lèvres fines et à la croupe de pouliche, elle tient serré dans la main droite un trousseau de clés, se dandine si lourde et si sotte qu’on la préférerait attelée. Marie-Noël est le prototype de la suffisance et de la bêtise universelle, enfant gâté de la tertiarisation, avatar couinant la satisfaction, elle est née du croisement de la prétention et de la frustration. Les institutions qui l’engagent ont tôt fait de le regretter, mais trop tard, la donzelle est une procédurière, difficile de s’en débarrasser.
Marie-Noël est la vice-présidente d’une association qui prône le couvre-feu, elle a épousé un concepteur de gendarmes couchés qui l’a quittée traumatisé quelques mois après son mariage, elle anime des ateliers foireux dans une haute école. Elle en impose en posant des lapins, brasse eaux claires et eaux usées, se saoule le vendredi et le samedi soir.
Marie-Noël est la meilleure amie de Jean-Rémy, une amie de la première heure. Ils aiment aujourd’hui l'art vrai et le piano quand il est bien joué, ils gonflent le premier août des ballons de toutes les couleurs, satisfaits de participer ainsi à la restauration des valeurs. Marie-Noël et Jean-Rémy constituent le plus sombre des continents.
Jean Prod’hom
L'autofictif 1961

Une épingle suffit à fixer l’éphémère.
N’existent somme toute que deux espèces d’écrivains, écrit Chevillard (L’autofictif, 1961), celle qui conçoit la littérature comme l’art de relater au plus juste notre commune expérience du monde…, et l’autre qui la conçoit, au contraire, comme un geste de séparation, d’affranchissement, et l’art d’ordonner une représentation du monde originale.
Il conviendrait pourtant d’ajouter que c’est en rédigeant au plus précis les actes de cette expérience universelle que plusieurs écrivains de la première espèce s’en sont affranchis le plus résolument et en ont fait voir une représentation inédite. Et qu’à vouloir offrir une représentation du monde originale, la plupart des écrivains de la seconde n’ont fait que mesurer, sans la surmonter, la résistance que leur ont opposée les principes d’identité, de non-contradiction et du tiers exclu.
Là où il n’y a pas de code, on le frise.
Jean Prod’hom
Dommage

Ai rencontré ce midi au bois du Four deux vieux dégingandés bavards et sourds. Double rame de haricots sans queue ni tête offrant à qui veut fruits et sommaires. N’ai pas su déchiffrer le secret qui nourrit les cosses de ces deux experts.
Jean Prod’hom
On touche du bois

Matinée au CHUV, le test au synacthène réalisé il y a un mois montre que les glandes surrénales de Louise répondent tout à fait normalement au stress et sécrètent la quantité de cortisol qui convient. Pour le reste tout va bien, on touche du bois, les paperasses qu’on est invité à compléter ne constituent pas aujourd’hui une corvée, on se réjouit d’écrire oui ou non en face des questions qui nous sont posées, elles font même un peu sourire. Le service de pédiatrie, qui ressemble en temps de crise à l’antichambre du cercle le plus sombre des enfers, n’est pas loin dans ces circonstances d’avoir les allures d’une chocolaterie où l’on accueillerait les enfants du paradis au pays des merveilles, on aimerait même que notre séjour se prolonge pour revoir le gamin qui a disparu sur son tracteur à l’autre bout du couloir, suivre encore un instant les allées et venues des infirmières et des médecins, écouter le bruissement de la vie là précisément où elle hésite.
Et puis la bienveillance des médecins, le temps que mettent les professeurs à la disposition de nos enfants pour qu’ils comprennent ce qu’il en est, saisissent au mieux leurs intentions et leurs actions en leur donnant des explications suffisamment sommaires nous permettent à nous aussi de nous rassurer et de savoir un peu mieux ce qu’il faut en penser.

Il est un peu plus de onze heures et quart lorsque nous quittons le CHUV, je reconduis Louise à Vucherens où elle va pique-niquer et répéter le spectacle de fin d’année, elle refuse comme d’habitude de prendre une aspirine. On compte les balises anti-gibier à ultrasons posées l’année dernière entre le Chalet-à-Gobet et le bout du plateau de Sainte-Catherine, près de cinquante, chargées de tenir à distance les chevreuils, les renards, les blaireaux, les hérissons et leur épargner ainsi de se trouver nez à nez avec les quarante tonnes circulant sur la route de Berne. La campagne est devenue pour le bien des bêtes, et c’est tant mieux, un immense zoo entouré de grillages parfois invisibles. Mais si les hommes se sont révoltés (et se révoltent encore) à l’encontre des murs de pierres que certains d’entre eux ont dressé pour en séparer d’autres de leurs parents et de leurs amis, ils acceptent tous aujourd’hui sans broncher le mur infranchissable qu’ils dressent entre eux et les bêtes.
M’arrête au retour sur la colline de Vucherens, relève la date de 1839 inscrite sur le tympan du porche du cimetière près de la chapelle érigée en 1737. Cette date renvoie-t-elle à l’adjonction de ce porche ou à la création du cimetière ? A un agrandissement ? Existait-il avant 1737 un cimetière ailleurs, près de cette chapelle dont parle Marcel Grandjean, incorporée à une maison communale dans le village ?
Je monte au pas le raidillon de la Moille Cherry, une bossette à lisier me précède, tuyaux hirsutes dressés sur la tête, que le chauffeur fera traîner tout à l’heure sur les prés, évitant ainsi de repeindre le printemps à l’ammoniac, en passant comme autrefois 20 000 litres de lisier à la moulinette. On se sépare au tilleul, le convoi monte en direction de la Moille-au-Blanc.






Aujourd’hui encore il m’apparaît que les choses vivent en paix côte à côte, sans lien de subordination, avec en chacune d’elle un monde, comme devant la forge de Vincent Desmeules à Ropraz où je m’arrête un bref instant après avoir déposé Lili et Mylène à l’arrêt de bus : des abeilles bruissent à l’entrée d’une ruche bleue, à l’abri sous des plaques de fer, rouillées, brutes, inertes, d’un autre âge, d’un autre règne.
Jean Prod’hom
99

Il n’y a qu’un pas du réel à l’imaginaire et toutes les portes sont ouvertes. Il n’en va pas de même au retour.
A la fin, l’homme s’est toujours fort bien satisfait des situations à propos desquelles il jurait qu’on ne l’y prendrait pas.
(S’isoler pour être moins seul.)
Jean Prod’hom
Faire un livre

Le grondement sourd qui nous parvenait ces derniers jours de la soufflerie des greniers de la Moille-au-Blanc s’est tu, l’herbe est sèche. Si Freddy a entamé hier un second passage dans le pré à Max, ce matin la faucheuse est bâchée, il a plu toute la nuit. Le vent est tombé, les fenêtres sont fermées, on ne verra pas les enfants avant huit heures, tout est en place pour un dimanche pot-au-noir. Des bruits il y en a, mais le vide que le vent a creusé depuis qu’il est tombé les maintient séparés les uns des autres, dans une solitude presque désespérée : un grillon se noie, les bris d’un merle de cristal, les cris d’une corneille ou un âne qui brait, à moins qu'il ne s'agisse d'un pic sur une vieille plaque d’éternit. Douceur, désolation, mais sans risque et sans heurt, sans contagion. La pluie soudain reprend et s’abat sur le toit, on ferme les velux, on se retire, nous de notre côté et la campagne du sien.
On boit un café, Sandra lit, Louise nous rejoint. Je relève mon courrier, un gentil mot de François Bon sur Tiers Livre, ce n’est pas la première fois et je m'en réjouis. Me réjouissent également ces mots des lecteurs qui me parviennent : Justine, Murielle, Julien, Yvan, Sylviane, Brigitte, Murièle, Alexandre, Francis, André, Anna, j’en oublie.
Bientôt cinq ans. Un billet chaque jour, chaque jour ouvrable d’abord, quotidien depuis juillet 2012, des billets qui donnent un rythme à mes journées, parfois bien plus. Observer, comprendre, aimer, tout et n’importe quoi, ce qu’on finit par regarder, d’autres couches, d’autres cercles. Même si – et c’est l’une peut-être de ses leçons essentielles – écrire n'est pas tout, tout au plus un attribut, j'entends par attribut ce que l'intellect perçoit de la substance.
Je tente de placer au bon endroit le numéro ISSN qu'une dame de la BNF m'a envoyé la semaine dernière. Malgré les conseils avisés de François Bon et Christine Genin je n’y parviens pas et y renonce assez vite, il n’y a pas le feu. Même chose avec Prolitteris, Claude qui m'avait encouragé il y a 6 mois à adhérer à cette société chargée de veiller aux droits d'auteur, a réitéré ses encouragements l'autre soir sur le seuil de la librairie Basta, avec d’autant plus de raisons qu'on a reparlé de ce livre qu'on va faire ensemble.
Il me dit où il en est, ce qui pourrait constituer le centre de ce livre, et j’imagine les cercles qui en feraient le tour, toujours plus larges. Et cette idée de faire un livre – Je ne sais pas si tu as déjà envisagé de réunir un choix de tes textes dans un livre en papier ; si ça te tente, je serais très intéressé à les publier – je ne m'y suis pas fait immédiatement, mais je peux aujourd’hui le concevoir à condition qu’un maître d’oeuvre aux reins assez solides prenne l’initiative des travaux. Ce maître d’oeuvre m’obligerait ainsi à reconsidérer ce qui existe aujourd’hui dans les limbes, et à concevoir des cercles inédits susceptibles de m’accueillir moi et mon purgatoire, mes enfers et mes paradis.

Comme chaque dimanche depuis quelques semaines, Louise et Lili descendent chez Marinette lui donner un coup de main, nettoyer le parc de l’âne Ziggy et Sahita le poney, Sandra les accompagne. Arthur, qui a été privé d’écran toute cette semaine, part en trombe avec Oscar remplir sa tâche dominicale, fait le petit tour au pas de course, revient à 10 heures sonnantes. Il se cale devant l’ordinateur pour jouer et aménager la plate-forme Minecraft qu’il souhaite administrer avec sa soeur.
Passe en coup de vent chez Marinette qui prépare un thé, pour avertir Sandra et les deux filles qui ont nettoyé les box et ramasser les crottins du parc que je descends en ville au Musée historique de Lausanne où je compte m’arrêter dans quinze jours avec les élèves de la 11. Les gardiens du musée coopèrent si bien qu’il ne me faudra que quelques minutes pour régler l’affaire. Monte au deuxième étage jeter un coup d’oeil à l’exposition consacrée à Louis Rivier dont je ne connaissais en fait que la Mater dolorosa de Bottens, étape naturelle du pèlerinage qui va de Corcelles à Echallens. Y reste finalement deux bonnes heures, Louis Rivier y apparaît entre deux mondes, pseudo-idôlatre au coeur de la communauté protestante fâcheusement iconoclaste, dernier artisan de la générosité discrète de la grande bourgeoise vaudoise avant son déclin.
Lausanne est immobile, bien droite dans le vent, les yeux fixés sur le lac, il y a du monde sur l’esplanade de la cathédrale, peu de Lausannois. Une femme cachée derrière un niqab me rend songeur, elle photographie les alpes françaises de l’autre côté du lac, les toits du quartier de la Palud, son mari ou son ami, les jardins de l’Evêché, mais que voit-elle ?
L’homme fait lui aussi quelques photos, les Alpes, les toits, les jardins, pas un regard pour elle, moi si, et elle pour moi.
Jean Prod’hom
98
Aussi nécessaire pour un père d'accepter que son fils descende du carrousel sur lequel lui et les siens tournent depuis des générations que d’accepter qu’il fasse sien celui qu'il a enfin quitté.
Les mailles des filets de protection des enfants sont si serrées que même les plus petits ne peuvent s'enfuir.
Prenons garde à ce que nos gamins nourris au grain ne décident de prendre leurs jambes à leur cou et rejoignent Victor de l’Aveyron dans un asile de sourds-muets.
Jean Prod’hom
Basta

Il a tellement plu hier matin sur le Jorat qu'il a fallu renvoyer les joutes sportives de Thierrens au Mont. Lorsque le ciel s'est calmé, on a perçu une sourde déception. En écho cette balade, fraîche consolation le long de la Valleyre. Les pensées des petits ont tôt fait d'aller au-delà, on évoque le Flon, la molasse et les cathédrales, le Rhône, plus loin Marseille, bientôt les vacances. De minuscules fraises des bois roulent au pied d'un parterre d'oeillets, fines paupières au teint rose jambon, découpées comme des cils : dianthus superbus. Le Jura réapparaît derrière les vapeurs d'eau.
Si, nous explique un tout malin, on l'appelle foyard, c’est parce qu'il finit en bois de chauffage dans les foyers de nos cheminées. Le nichoir fixé sous ses lourdes charpentières semble inhabité. Qui sont donc ses locataires ? Je prends contact sur le champ avec l’universitaire qui a laissé son numéro de téléphone là-haut sur la maisonnette : on l’a installée pour les chouettes hulottes, mais il n’y en a pas eu beaucoup ce printemps, à cause du mauvais temps, du froid et du manque de nourriture, inutile d'insister, et si des petits avaient éclos, ils voleraient à cet instant de leurs propres ailes.
On refait dans la tête la balade, mais à l'envers, en dégringolant pédagogiquement le chemin des Neuf-Fontaines. Je raconte à ces gamins comment, par un infime recul et l'application de l'une ou l'autre des techniques rappelées par l'historienne britannique Frances A. Yates dans son Art de la mémoire, chacun d'entre nous est capable de garder en soi ce qui tend à s'en échapper.
On termine avec les élèves de la 11 la projection du film de Daniel Vigne sur les aventures de Martin Guerre qui a défrayé la chronique au milieu du XVIème siècle, une affaire déroutante qui aurait pu conduire Martin à la folie si Martin avait été Martin. Mais, Martin, tu n'es pas Martin, tu es Arnaud du Tilh, si ressemblant que tu nous a trompés, tu en sais autant que Martin sur sa propre vie, plus même peut-être. Martin Guerre, tu n’es pas Martin Guerre, tu es Arnaud le diable, Arnaud l'usurpateur. Arnaud du Thil est pendu le 16 septembre 1560 à Artigat pour fraude et adultère.
Cette affaire me rappelle une psychiatre qui m'avait averti, la veille d'une sortie, que sa fille ne participerait pas à la course d'orientation que mes collègues et moi avions soigneusement organisée, parce que, disait-elle, en remettant à chaque groupe un téléphone portable, on disait très clairement mais à notre insu que les élèves couraient de réels dangers. En conséquence sa fille resterait à la maison.

Il fait nuit lorsque je sors du collège, il n’est pourtant que 16 heures 30, le ciel est à nouveau très chargé. Je descends en ville, parque la Yaris près du Musée de l'Art Brut, vais et viens sous la pluie, le long de la rue du Maupas et la rue de l'Ale avant de rejoindre sous un parapluie et des trombes d'eau la librairie Basta où les éditions Antipodes vernissent ce soir quatre nouveaux livres.
Nous ne sommes pas très nombreux mais je reconnais plusieurs visages, Murielle descendue de la médiathèque du Mont rend les lieux plus familiers.
Un comédien lit des extraits de trois ouvrages universitaires qui traitent respectivement de la naissance socio-historique de l'assurance chômage en Suisse entre 1924 et 1982, du débat autour du génie génétique entre 1990 et 2005 et des rapport de la Suisse avec l'Algérie entre 1954 et 1962. Il est curieux de percevoir dans la bouche ronde d'un comédien les ressorts rhétoriques du genre, leur sous-couverture, l'étanchéité des caissons, les ligatures qui se referment en bout de respiration, les connecteurs qui paradent, les suffixes à discrétion, l'invisible pâte dont la raison enrobe ses motifs aux armatures d’airain. Un alexandrin parfois, égaré, puis une assonance qui relance le propos de gouttière en gouttière, de cheneau en cheneau jusqu’à ce que l’essence s'écoule de l’alambic, goutte à goutte, dans les nappes profondes de la conscience.
Je lirai le quatrième ouvrage, celui de Nicole Gaillard, Couples peints, Esthétique de la réception et peinture figurative.
La librairie est minuscule, les gens polis, on se croirait sortis d'un film de Rivette, d'Eustache ou de Rohmer. Jean-Pierre Léaud est là, les mains dans les poches, il fait chaud, Michel Legrand fredonne l’air des Parapluies de Cherbourg et Godard grommèle. Michel Sautet a fait un saut pour dire bonjour, bonjour sourire, on parle tennis et football, Dziga Vertov, masculin féminin. Tout le monde est un peu saoul à la fin, ce sont des choses qui arrivent, des choses de la vie avec Michel, Diane, Claude et les autres. Les années 70.
Jean Prod’hom
97

En pensant naïvement que l’image qui était apparue dans la vitrine pensait ce qu’elle-même pensait, elle s’était condamnée à la plus extrême des solitudes.
Jean Prod’hom
Trapèze et chute libre

Il en faut de la volonté pour pencher la tête et retrouver sous le badigeon immanquablement gris des jours ouvrables, ne serait-ce qu’un instant les couleurs d’origine, il en faut du courage pour suspendre les trajectoires que des disciples de Laplace semblent imposer à chacun d’entre nous et prendre la tangente. Je n’y parviens qu’à moitié, avance actif et docile jusqu’à midi en anticipant les désagréments des jours prochains. Nous avons, les élèves de la 11 et moi, étêté les piles qui menaçaient au sommet des étagères en mettant le surplus à la benne ou dans des cartons, en vue du déménagement qui va nous conduire dès le mois d’août prochain dans le nouveau bâtiment scolaire. J’en profite pour verser tout ce que j’avais cru bon garder des années durant dans la poche sans fond de l’inutile. On entrepose ce qui est à garder dans l’ancienne salle de sciences. La classe 11 reprend une existence indépendante à mesure qu’on la libère, les élèves rentrent chez eux avec des livres et des boîtes vides sous le menton. De six heures à midi sans discontinuer, une seule trajectoire, de porte à porte, comme suspendu à un trapèze tenu par une main invisible.
Chute libre ensuite au Riau où je me couche une bonne heure, ramolli, avant de corriger assis devant un café les vingt-deux dernières copies de l’année.
Je suis debout à cinq heures et on va, avec Sandra, sur le chemin qui conduit au refuge de Corcelles, on décide de prolonger notre escapade, une piéride bat des mains, on la suit une bonne centaine de mètres. Me reviennent en mémoire celle qui m’avait précédé tout un matin sur un chemin de l’Emmental entre Eggiwil et Trubschachen, cette autre qui m’avait ouvert tout l’après-midi un allée royale dans les bois au nord-est de Chinon. Prise en écharpe par Sandra et moi, la nôtre décide d’aller de son côté sans cesser d’applaudir. De l’autre côté du chemin les abeilles travaillent dur, on les entend entrer et sortir des huit ruches cachées par les lourdes branches des foyards. On parle de choses et d’autres, de cette fin d’année scolaire et de nos enfants, on passe par le chemin creux. On s’emballe en évoquant les mardis de la rentrée, c’est un peu tôt, il est préférable de se taire.
Jean Prod’hom
A l'étuve

Une ribambelle de moineaux est née ce matin, en noir et blanc, personne ne les a vus mais je les ai entendus, ce sont eux qui ont donné le signal en soulevant les quatre coins du drap noir. Sur le toit un rouge-queue a agité sa crécelle, j’ai remisé sous l’oreiller les franges grises de la nuit. Je me suis levé, une nichée de canetons a plongé dans l’étang, ils ont pris un peu d’avance, premier air, première risée.
C’est la seconde fois cette année que je sors avant six heures en bras de chemise, la fraîcheur a pris les devants et hydrate mon visage. Partirais volontiers sur les berges de la Broye ou sur les rives du Léman, sur la terrasse du café du village ou plus haut, du côté des Vanils, ou plus loin, là où la marrée monte. Avant qu'il ne fasse trop chaud.
Curieuse scène, une fouine que je prends d’abord pour un écureuil, plastron blanc, vient à notre rencontre sur le chemin de la Moille-au-Blanc. Oscar ne la voit pas. Elle, elle l'entend et prend une voie de garage. Lorsqu’on passe à côté du roncier où elle a disparu, le chien s'agite, aboie mais il n'est pas dans le coup. Je me retourne un peu plus loin pour lui faire un signe au cas où elle aussi voudrait m’en faire un. Je ne vois que les cytises, ils sont en fleurs, grappes lourdes, grosses larmes, jaunes sur le vert pâle des merisiers.
Descends au Mont écouter des élèves qui feront tout au long de la journée la démonstration qu'ils sont à même de construire une intervention d’une dizaine de minutes adressée à un public réel sur un sujet de leur choix, mais qui feront également la preuve qu’il ne sont pas prêts à quitter le giron dans lequel ils ont été nourris parfois trop chichement, pour aller écouter ceux qui pourraient les informer ou se plonger dans des livres trop longs à leur goût. Ils ont pour la plupart picoré sur internet, sans se méfier de ce dont on les avait avertis et prendre les précautions qui conviennent. On aura mâché toute la journée une bouillie souvent informe dont au fond ils ne se satisfont pas eux-mêmes, puis on les quitte en espérant qu'ils comprendront bientôt en-dehors de l’école ce qu'ils n'ont pas voulu ou pu comprendre au-dedans.
Mais on aura été à la même enseigne tout le jour, tous, à l’étuve d’abord, écrasés ensuite dans un immense brasier irrespirable. Personne n’a demandé son reste lorsqu’on a tiré le rideau, chacun s’est éclipsé pour plonger dans l’une ou l’autre de ces fontaines que chacun abrite secrètement.
Jean Prod’hom
Oscille sous le fléau et plie sous le joug

Sale journée aujourd’hui, une mauvaise nuit, les premiers moustiques, la lecture du petit opus de Jean François Billeter sur le silence millénaire de la Chine (Chine trois fois muette, Editions Alia, 2010), l’abattement des élèves dès 8 heures, le soleil qui n’avertit pas, les grondements du chantier tout à côté, le racolage où qu’on soit, les simplifications outrancières, l’inadéquation de nos moyens.
Suis-je le théâtre de cette noirceur, ou cette noirceur habite-t-elle les choses ? Hésite sur la réponse à donner, oscille sous le fléau et plie sous le joug.
Me dépêche de quitter la mine lorsque je le peux, en me réjouissant de me retrouver à 870 mètres au-dessus de la mêlée et en espérant que cela suffira à transfigurer le reste de ma journée.
D’apercevoir la nouvelle acquisition de Sandra tirée de la benne aux déchets encombrants et déposée au pied de l’érable, d’entendre les éclats multicolores de Louise sitôt la porte ouverte, d’apercevoir Arthur qui fait ses devoirs en souriant, de goûter à la fraîcheur des pierres de taille du Riau m’incline à penser que je suis à l’origine de cette noirceur excessive.
Sans trop me réjouir pourtant, je n’exclus pas en effet que la crainte et le pessimisme de Billeter ne soient fondés. Que reste-t-il dans cette société qui ne soit soumis à la logique économique ? Ce lieu mis à part, peut-être, où je me replie, où il m’arrive encore de vivre comme ceux qui sont venus avant moi et, je l’espère, ceux qui viendront après, s’ils maintiennent intact l’altérité sur laquelle reposait le possible et que nous croyions sans prix, mais à laquelle s’est attaquée depuis peu la raison marchande. Ecrire et résister.
Jean Prod’hom
Le champ de blé vert

L’image d'un jeune homme qui a tout laissé, décidé et silencieux. Il a mis la poésie sur orbite, hors d’elle-même et sans lui, pas le temps, il y avait la mer.
Sous une aubépine, des iris.
Sur la tête un tout nouveau chapeau de paille, ai cherché tout le jour un chemin sur lequel m’engager, aucun n’allait nulle part.
Jean Prod’hom
96

Les musiciens tâtonnent, les peintres campent de l’autre côté du miroir, les sculpteurs dressent au centre des giratoires une foule de dieux malingres, les architectes conçoivent des abribus étanches, les cuisiniers préparent des amuse-gueules. Aux raconteurs d’histoires la difficile tâche d’éclairer ce charivari, en lui redonnant une nuit, des ombres avec des bouts de chandelles.
Jean Prod’hom
Perle de culture

Un chardonneret
une bague au doigt
un collier au cou du chien
la laisse autour du mien
Jean Prod’hom
CXXIX

Le géant suédois du meuble Ikea à reconnu que des prisonniers politiques ont fabriqué certains de ses meubles dans les années 1980 en Allemagne de l’Est. Des spécialistes tentent aujourd’hui de déterminer si les guides de montage contenaient des messages secrets.
Une fois que rien n’est fait c’est beaucoup plus difficile de commencer qu’une fois que quelque chose n’est pas fini.
Jean Prod’hom
95

Il ne faut au bout de la phrase qu’un peu de soleil et un peu d’air, et un peu de vent, pas grand chose, comme ces bêtes nues que réchauffent dans la clairière les rayons du dernier soleil.
L’Universel, c’est ainsi qu’Henri Thomas appelait le chat qu’il avait trouvé épuisé dans un champ. Un vieux chat avec lequel il ne parlait pas et qu’il écoutait à Anglemont ronronner contre lui, la nuit, pendant les pluies d’automne.
Même s’il est plusieurs c’est toujours le même chevreuil qu’on aperçoit à la lisière du bois Vuacoz, universel et singulier.
Jean Prod’hom
Surveiller mais quoi ?

L’isolement dans lequel les institutions de formation plongent nos enfants dans l'intention de s'assurer qu’à la fin ils détiennent et gèrent chacun pour soi ce qu'ils ont projeté de faire entrer dans leur tête, les a conduites à élaborer des moyens toujours plus sophistiqués et coûteux de contrôle et de coercition, avec pour corollaire la fragmentation des objets susceptibles d’être identifiés, la normalisation des réflexions et des méthodes sur lesquelles ces établissements sont capables d'exercer leur contrôle. Rien n’entrera dans la tête d’un enfant qui ne puisse en sortir de manière décidable, tel aura été le mot d’ordre de la formation.

Cette manie d’isoler chaque enfant, de circonscrire l’objet de connaissance en énumérant chacune de ses propriétés, d’en contrôler le traçage de son input à son output, de l'écriture des programmes à la certification de sa présence en fin de scolarité, tourne à la farce lorsqu’on en évalue les résultats et si l’on sait que personne n’a jamais été assuré que ce qui entre, loge et sort de la boîte noire est bien ce qu’on souhaitait y mettre. Cette manie est le résultat d'un vieil atavisme qui nous ramène aux temps obscurs où l'homme allait crédule au confessionnal, tremblant d'être mis à jour par celui qui détenait la vertu qui lui faisait défaut. Le pêcheur allait tremblant, seul, se faufilant comme un vers de terre, persuadé qu’il était un bon à rien, désireux par-dessus tout d’être moins seul et d’une seule chose, d’avoir près de lui un compagnon de son espèce.
Les aptitudes de nos enfants au travestissement – pour ne pas parler de falsification ou de déni –, leurs stratégies d’évitement, le soin qu’ils mettent à éviter l'inconnu qui les entoure et à contourner les obstacles qui leur font craindre le pire trouvent leur terreau dans la solitude à laquelle l’institution les condamne. Il est temps d'ouvrir les portes et les fenêtres, que chacun retrouve le bon larron, les vertus de la copie, de l’imitation et du compagnonnage.
C'est en effet lorsqu’on dégagera l’enfant de l’idée qu’il est seul avec lui même que les objets de connaissance retrouveront une consistance égale à ce qu'il est, en lui, hors de lui, avec les autres et qu'il parviendra à accepter à la fois ce qu'il a en commun avec ceux de son espèce et ce qu'il a en propre, bien moins que ce qu’on lui fait croire, un grain de voix, un rire, un tournis, une occasion d’occuper un lieu avec devant lui d’autres paysages. Il apprendra alors que la solitude qui l'habite, unique en son site, peut être douce s’il n’a pas à y répondre autrement qu'en y persévérant, petite mélodie, naïve expression.
Jean Prod’hom
Magasins du monde

Passe en fin d’après-midi par le bazar d’une multinationale où j’ai pris l’habitude de me ravitailler en capsules de café. J’entends couler le Tibre et l’Arno devant les rayons colorés, rêve à Roma, Volluto, Ristretto et Arpeggio, Capriccio et Livanto, Cosi. La caissière a pourtant tôt fait de refroidir mes ardeurs, elle a l’humeur noire lorsqu’elle présente chacune des vingt boîtes de dix doses au lecteur qui saisit les informations du code-barres. Pas drôle son job ! J’imagine alors d’autres détresses à l’autre bout du monde, l’exploitation forcenée d’un paysan indien, colombien ou brésilien, assoupi un instant sous le cagnard, qui reçoit à l’instant le signal de débit envoyé par ma caissière et qui se met sur le champ au travail, flux tendus obligent.
Les gens attendent, à moi maintenant de me relier au terminal de paiement électronique, et par lui à ma banque pour transférer de mon compte au compte commerçant la somme qui s’affiche. Le dispositif ne précise pas comment introduire ma carte, aucun schéma, débrouillez-vous. J’essaie à tout hasard de la glisser comme elle vient, sans me poser de question. Le lecteur la refuse. La caissière me regarde alors d’un oeil noir, intenso, et aboie : Dans l’autre sens ! Je la retire donc et mime du poignet les deux possibilités qui se présentent à mon esprit, avec le sourire. Mais je ne parviens pas à amuser la donzelle qui répète sans bienveillance ce qu’elle a déjà dit : Dans l’autre sens !
Malheureusement la manœuvre précédente m’a fait oublier le sens dans lequel je l’avais introduite en premier lieu si bien que je me retrouve avec quatre possibilités. Me sens aussi creux qu’une coque vide, souhaite vraiment que la caissière cesse de me regarder comme un repris de justice, me réconforte et me donne enfin un coup de main. Rien, je l’exaspère. J’ai beau lui confier silencieusement mon désarroi, elle ne bronche pas, me voici un moins que rien.
Elle m’arrache soudain la carte que je tenais au bout des doigts et l’introduit dans le lecteur. Je rêve qu’elle se trompe elle aussi, qu’elle se ridiculise. Mais non ! me voilà défait, la journée qui s’était bien déroulée jusque-là branle sur ses fondations et je bascule de l’autre côté de l’humiliation. Je suis prêt à l’injurier, je bous, la colère monte, hésite à lui envoyer ces foutues capsules de café à la figure, les lui faire avaler, elle étoufferait, je serais emprisonné puis jugé. Je profiterais de la tribune qui me serait ainsi offerte pour dénoncer l’entente illicite des vendeurs de terminaux de paiement électronique, je mettrais en évidence les effets paralysants de la gestion des marchandises en flux tendus, je scierais les barreaux des codes-barre, clouerais au pilori la pratique mortifère de l’usure, les banques, le petit crédit, l’avidité crasse des multinationales et l’hypocrisie du grand capital.
Les cris des enfants dans le jardin de la garderie, les iris qui baignent leurs pieds dans l’étang, les deux bergeronnettes qui trempent les leurs dans une flaque ne parviennent pas à dissiper ma colère. Il me faut réorienter mon héroïsme, songer à un autre coup, à ma mesure, diminuer ma consommation de cafés, remonter la cafetière italienne qui traîne à la cave et acheter en d’autres lieux ce cadeau des dieux.

Jean Prod’hom
Coup double

Cheveux blancs en pétard, Johann Schlupp remplit deux seaux de copeaux qu’il tire de l’un des dix ou douze tonneaux bleus entreposés devant l’étable, c’est ainsi qu’il rafraîchit la litière de ses vaches.
Né dans le canton de Soleure, Johann Schlupp arrive à Tramelan en 38. D’abord la montagne de Jeanbrenin avant d'occuper cette fermette sise à la sortie de Tramelan sur la route qui mène à la carrière Huguelet. Deux vaches aujourd’hui, une mère et sa fille, la vieille qui a seize ans a fait trois fois coup double. Johann précise qu’il n’a jamais tiré de lait d’une vache de toute sa vie, les mères dont il s’est occupé ont toujours nourri leur veau dont il faisait ensuite commerce. Johann me raconte sa première belle affaire, son premier taureau acheté lors d’une foire dans le canton de Soleure, pour 2000 francs, revendu 3000 en Allemagne un mois après.




Il faut savoir que cet expatrié parle allemand à ses vaches, c’est resté sa langue maternelle, dit-il, et celle de son bétail. Il est neuf heures, Johann m'offre la goutte, sa voisine qui passe par là lui fait de gros yeux dont il se moque, elle lui rappelle que c’est elle qui a fermé les poules la veille au soir, qu’il avait oublié et qu’il était dans un sale état. Il rit et insiste, s’explique, j’ai 89 ans, pas un seul jour sans un ou deux verres de rouge, ou un verre de cidre, alors vous voulez me donner des conseils ?
En face de la fermette du Soleurois le jardin d'un marbrier où traînent des pierres tombales, des noms et des prénoms, aux limites de la profanation. Parmi eux Raoul Voumard, mort en 1949 à 25 ans, rejoint par son père en 1976 et Jeanne sa mère en 1985.
Le soleil qu'on n’attendait pas pousse de côté les nuages et les tiendra bien à l’écart toute la journée, malgré deux échecs, en début d'après midi et à quatre heures.





Jean Prod’hom
Etranglement de la durée

Le battant de la cloche de l’ancienne école de la ville de Tramelan frappe les dix coups de dix heures à dix heures, suivis par les dix coups de l’église comme si, venus de loin, ils avaient mis du temps à venir jusque-là, à l’étage de l’hôtel de l’Union où les enfants dorment, silence.
Pas longtemps : un nouveau coup au quart, tout proche, il vient de l’école, deux à la demie, puis trois aux trois quarts. Il me reste quinze minutes pour m’endormir avant un da capo ma foi trop prévisible. Trop tard ! Tout recommence à onze heures avec un léger déplacement du chariot sur la droite, les onze coups de l’église répondent aux onze coups de l’école, et puis un coup au quart, deux à la demie, trois aux trois quarts. Rien ne suspendra cet étranglement du temps sinon le passage du train pour le Noirmont et le bruit de la porte qui claque derrière les derniers clients du restaurant.
Minuit sonne deux fois, une tourterelle turque se joint au concert : croche, noire, noire pointée, phrase de neuf, dix, onze ou douze mesures, puis silence de longueur équivalente, l’imagination fait le reste : un triangle pour souligner les minutes et les baguettes d'une caisse claire pour battre les secondes.
La nuit aura été trop courte pour que je m’assure des intentions de la tourterelle et de sa bonne foi. Mais coup de sac à l’aube, deux corneilles filent sur Délémont en criant leur rage, s’échappent comme deux condamnées à la perpétuité.
Jean Prod’hom
Il y a le romantisme noir

Il y a le romantisme noir
le jeu des ombres
les coffres-forts
il y a les clans
la prise de Constantinople par les Turcs
il y a le doute méthodique
la belle rive
le plomb
les saules
Jean Prod’hom
Alliance du périssable et de l’immortel

Le sentiment d’une solitude déchirante et d’une certaine incommunicabilité du monde était parfois donné par la vue d’une brouette vide encore chaude de la fumure transportée. Le jardinier s’en était allé boire : il se pouvait qu’il ne revînt jamais. Je me disais que je lui avais quelquefois parlé. A bien réfléchir, il se pouvait que je lui aie dit cent mots.
Les oiseaux passaient à tire-d’aile, les horloges sonnaient et les ombres s’allongeaient sur le sol blanc.
Le jardinier n’était pas mort, il n’avait eu qu’une attaque. Il ne parlerait plus et resterait sur un banc devant sa porte et des mouches en pleine vie marcheraient dans ses mains sur lesquelles tremblerait l’ombre dentelée des feuilles pacifiques.
Jean Follain, Canisy, Gallimard, 1942

Jean Follain consacre en 1942 quatre-vingts pages au bourg dans lequel il est né et à la reconstruction duquel il s’attèle, morceau par morceau à peine regroupés. Avec sa parentèle, la maison où il vécu, la quincaillerie, des friches, les chemins de traverse, des champs, l’église, l’Hôtel du Pichet. Un pays aux limites de l’inculte, du stérile, de l’immobile, Canisy, un village normand comme il s’en fait d’autres à deux pas du chaos et de la confusion. L’alliance du périssable et de l’immortel, comme chez André Dhôtel, mais avec des contrastes taillés à la hache et un mystère en guise de serre-joint, un mystère qui fait tenir ensemble ceux qui ont ont été amenés à partager ce pays, mais aussi le mystère rapatrié en chacun d’eux, oubliés dans les ruelles de la mémoire, avec le vide et le silence qui les sépare, la nuit qui les réunit. Enigme à laquelle on touche lorsqu’on lève la tête, ciel immense, mystère qui traîne au pied des haies et qui, dans les cafés et les souvenirs, réunit les dignités muettes en les liant à leurs devoirs. A Canisy on n’entend pas la vie marcotter, les correspondances s’aboutent comme des boîtes sur les rayons des épiceries.
Le battement d'ailes d’un papillon a provoqué une immobile tornade, un enfant suit des yeux le responsable que rien n’accable, une jeune fille folâtre à ses côtés, un vieillard s’éloigne pour des raisons que tout le monde ignore mais qui sont à l’origine de l’accalmie. A Canisy le mieux voisine avec le pire, le quelconque avec le quelconque, ça ou rien, ça et rien, l’habitude a le visage de la rareté.
Et chacun des jardins du bourg est comme un monde plein de plantes, plein de jardins ; chacune des plantes pleine d’étangs et de poissons, chaque poisson plein d’écailles et de reflets. Tout tient ensemble sans que rien ne communique car rien ne vient du dehors, tout est déjà dehors, tout est déjà dedans, agrégats de simples. Etrange immobilité de l’être, personne ne sait plus si les hommes s’en vont ou reviennent, les choses sont laissées à elles-mêmes, solitude déchirante, tableau à peine vivant d’un tremblement entre deux états du monde rapporté dans un grand mouchoir blanc.
Il y a du Leibniz et du chaos chez Jean Follain, comme si le papillon qu’imagina Edward Lorenz s’était égaré dans les lacunes de la monadologie et assurait ainsi, et seulement ainsi, l’équilibre du monde lorsque le temps ralentit.
Jean Prod’hom
CXXVIII

L’homme s’époumone à transformer le provisoire en définitif.
A l’époux le chapelet, à sa femme les petits pois.
N’y peux rien, vois un coq, pense à l’âne.
Jean Prod’hom
Murs nus et foutripi

Assis sur les bancs de Cité-Devant ou Cité-Derrière, il n’était pas rare qu’ils s’entretiennent le soir venu des vertus de l’éthique et des vices de la morale, de leurs spécificités respectives, en précisant naturellement et avec le plus bel aplomb que la position qui caractérisait leurs actions, toutes et en toutes circonstances, relevait de l’éthique la plus pure et tenait à respectable distance les approximations de la seconde, enlisée, souvent aveugle, toujours étroite.
Les bancs ont disparu, la ville a changé, l’affectation des bâtiments aussi ; les hommes ont entamé de nouvelles discussions et de nouveaux travaux. Beaucoup ont aménagé dans les appartements aux murs nus de l’éthique une espèce d’espace, cagnard ou dépense, qui abrite le foutripi d’une morale provisoire, chargée d’aller et veiller au chevet de l’immaculée qui s’endort.
Jean Prod’hom
Impossible métier

Une quinzaine d'années pour offrir à nos enfants la possibilité de rattraper l’inimaginable retard pris à leur naissance et les familiariser avec les outils sophistiqués que les générations précédentes ont conçus en un peu plus de 4000 ans ans et déposés à leurs pieds : cadeaux obligés.
Mais quinze ans également – moins certainement – pour montrer à nos enfants comment ralentir leur course et ramasser, étonnés, les trésors qu'ont oubliés leurs aînés dans leurs course effrénée : le lys et la mélancolie.
Jean Prod’hom
CXXVII

Examen de guitare ce matin à Oron. Belle performance de Louise qui me rapporte souriante et ravie les propos des membres du jury.
- Ils m’ont dit que j’irai loin.
- Loin ?
Dix ans et demi ? Me quitter ? Déjà ?
Le malheur s’acharne, Louise est invitée le même soir à sa première boum. Elle va danser dans le garage de Louhane avec Jérémie, Ewan et les autres. Comment l’arrêter pendant qu’il est encore temps ? Connaît-elle au moins le métier des parents de ses prétendants ?
« Papa, ! c’est bien Jésus qui a posé en premier son pied sur la lune ? » me demande Lili avant de s’endormir. En voilà une qui a encore besoin de moi.
Jean Prod’hom
Les Mystères de l'UNIL
Deux grosses dizaines de chefs, quatre colonies de post-docs et une soixantaine de doctorants, une quarantaine d’administrateurs et de techniciens constituent le Département d’écologie et évolution, mais l’ombre des anciens planent aussi, dinosaures de leur vivant, on aperçoit quelques traces des deux cents chercheurs qui ont collaboré à cette aventure collective. Pas simple de distinguer les techniciens des docs ou des post-docs, à moins de le leur demander.

Lui c’est Richard Benton, du Centre intégratif de génomique, le chef d’un petit groupe de 17 personnes qui se penchent sur le système sensoriel de la drosophile, son odorat et ses goûts. Il est accompagné d’une technicienne formée à l’Ecole Cantonale Vaudoise de Laborantins et Laborantines Médicaux et d’une post-doc formée à Oviedo.
S’ils nous apprennent que ces mouches ont un faible pour le sucré et le vinaigre, pour la lumière et l’altitude, ils nous font voir aussi que les recherches, si elles répondent évidemment à des impératifs méthodologique et à des outils toujours plus sophistiqués, ressemblent bien plus à des épisodes d’un roman écrit à plusieurs et à l’allure de l’escargot, avec des rebondissements imprévus, des ellipses, des accélérations et des ralentissements bienvenus, qu’au dressage pseudo-scientifique que l’école inflige rituellement à nos élèves.
On notera encore chez Richard Benton, né à Edimbourg, une timide ironie qui pourrait passer pour un manque de savoir-vivre si elle n’avait fait la preuve qu’elle était avec le travail obstiné, la désobéissance, l’humour et l’indépendance d’esprit la seule voie attestée de l’invention et de la nouveauté. Les peintres qui peignent, les écrivains qui écrivent, les chercheurs qui cherchent sont de la même famille, ils ont le même sourire et le même regard habité, ils font ce qu’ils ont décidé de faire avec un sérieux sans faille, sans jamais se prendre exagérément au sérieux.
Poète, romancier, chercheur ? Ce profil, je l’ai rencontré en fin de matinée dans les sous-sols du Biophore. Pierre Million fait partie de l’équipe de Tadeusz J. Kawecki qui se penche, elle aussi, sur la drosophile. Ce doctorant escamote modestement l’histoire de formation trop complexe qui l’a amené dans ce laboratoire, mais raconte celle que les chercheurs du groupe écrivent autour de la mouche, collectivement : passionnant !
Il y a bien sûr la teneur de cette aventure, les leurres que ces Ulysse de la connaissance placent sur la route de leurs drosophiles issues d’une lignée de plus de 100 générations, les pièges qu’ils leur ménagent pour savoir si elles seront capables d’apprendre à leurs congénères ce qu’elles ont appris sous la contrainte et à force d’essais et d’erreurs, des subterfuges que le chercheur utilise lui-même pour ne pas perdre son temps en travaux fastidieux.
Mais il y a aussi le regard attentif de ce jeune chercheur étonné par ce qui l’entoure, le dénuement de son visage, un peu poète, un peu égaré, ses mains vides, la langue qu’il utilise, précise, avec les parfums du pays du Gard, pour dire au plus près des choses somme tout assez simples. Tout autour des boîtes et des cartons vides.
Avant de conclure, tous ces chercheurs savent-ils qu'ils doivent une fière chandelle à l’un des miens, aventurier et paysan d’Ecublens qui a vendu autrefois une partie de son domaine au canton et à la Confédération ? C’est en effet sur les terres de l’oncle Gaston que se dresse aujourd’hui le Biophore.
Et la drosophile à qui on aura par ruse fait goûter à la pomme de la connaissance sera-t-elle capable d’avertir ses congénères qu’il existe pas loin de leur lieu de résidence des fruits qui pourrissent au pied d’un vieux pommier que mon oncle Gaston avait planté il y a plus de 50 ans dans un immense verger aujourd’hui disparu ?
Jean Prod’hom
Il y a les drosophiles

Il y a les drosophiles
les prévisions météorologiques
le calcul littéral
il y a les sablés bretons
les post-docs
le sirop d’érable
la main dans le sac
il y a les les retours de manivelle
le repos qu’on s’octroie
Jean Prod’hom
La philosophe

J'ai craint pour l’équilibre mental d'une philosophe qui avait, dès la première heure, juré fidélité à une manière de penser le monde à laquelle elle voulait rallier ceux qu'on l'avait chargée d'initier. Elle le faisait sans relâche, aveuglément, sans s’apercevoir de la solitude qui grossissait en elle et du désert qu’arasaient ses étranges litanies.

Elle passait près de nous sans tourner la tête, regardait le monde avec une naïveté consternante, en élevant de part en part de cette alètheia qu’elle disait traquer de hautes buttes incultes qui dérobaient à sa vue l'existence même de ce qui avait motivé l'engagement de ses prédécesseurs, le dévoilement, au prétexte que seules ces garde-fous et un travail incessant pouvaient l’éloigner des distractions qui font écran à la vérité.
Non pas qu'elle se trompât, égarés nous le somme tous peu ou prou, mais qu'elle succombe à une double ignorance et qu’elle oblige ceux qui l'entouraient à feindre qu’ils étaient avec elle dans la partie, alors qu’ils manquaient simplement de ce courage élémentaire qui leur aurait permis de l’avertir du danger qui la guettait, ne lui offrant qu’un silence molletonné dans le boudoir de ses certitudes, voilà qui était inacceptable.
Elle était dans sa filière, avait fixé le cadre et le cap de ses espérances, arrimée comme une désespérée à quelque chose qui l'empêchait de tomber, une pensée qui ronronnait de section constante, toute altérité mise à ban, une pensée qui étranglait son corps de la tête aux pieds jusqu’à la rendre invisible.
La philosophe courait un double danger : demeurer aveugle, sourde et muette, ou succomber à la folie en entendant soudain le chant des sirènes. On n’avait plus le choix, les plus courageux ont fui.
Jean Prod’hom
Langage porte-greffe

Me semble parfois perdre de vue le propos, m’en désintéresser même et n’avoir en vue que le mouvement de quelques phrases ordinaires qui ne cessent de s’éloigner et de revenir, l’une par l’autre, l’une pour l’autre, dans l’autre, vers l’autre, relancées par une virgule, ou son absence, relayées par un qui ou un que, une imprécision, un silence, une tournure.
S’installe alors le besoin de serrer toujours plus étroitement le jeu des éléments qui concourent à ce quelque chose qui répand ses effets de part en part de ma respiration, sans méthode, rythme et musique sommaires, mélodie toujours davantage épurée tandis que la main se lève et dessine une ondulation spirituelle, ne laissant à la fin que la trace de son surgissement, mais qui aura eu pour effet de porter le trait assez loin et avec suffisamment de force pour qu’il pénètre l’air comme la charrue la terre, sans bruit, puissance du langage qui mène ou ramène les choses là où elles fleurissent et d’où j’étais parti.
Le langage ne se charge que de ce qu’il peut, se retire lorsqu’il en a fini, comme l’un de ces robustes et inusables remorqueurs, la mer est trop haute, il laisse dans son dos le bleu du ciel, une destination, la mémoire. Il est alors temps de mettre un point final et le nez dehors, là où s’élance le greffon que le langage porte-greffe a nourri.
Jean Prod’hom
L'essaim

Me demandais bien au retour du CHUV comment on allait cet après-midi récupérer l’essaim suspendu à une solide branche de l’un des cerisiers du verger de Marinette, un peu haut à mon goût. Il y avait bien les deux anciens qu’elle avait fait venir de Chavannes-sur-Moudon, mais il était exclu qu’ils montent sur l’échelle, ce n’est plus de leur âge. Je m’y collerai donc, ce n’était pas prévu, enfile la vareuse, les gants, le voile et un chapeau de cardinal.
André est apiculteur, il a perdu ses quinze ruches l’année dernière et marche avec une canne, il commente avec son compère, du pied du cerisier, mes faits et gestes. Je glisse une caissette sous l’essaim avant de secouer la branche. On espère que la reine sera du voyage, il se met à pleuvoir. Je remonte à deux reprises dans le cerisier, pour brosser le solde des ouvrières qui gainent la branche que je scie ensuite et qu’André place à côté de la ruchette, Il faut attendre, impossible de savoir si la reine aura suivi les ouvrières.
Marinette nous offre un café, il pleuvine, le plus petit de mes deux acolytes est un Duc, un paysan à la retraite d’un domaine dont son fils n’a pas voulu et qu’il a remis au fils du second. Le second c’est l’apiculteur, il s’appelle André, André Rossier de Villarzel, mais il n’y a jamais vécu. Serait-on toutefois cousins ? Mon grand-père et ma grand-mère maternels y sont nés en effet dans la dernière décennie du XIXème siècle.
On s’essaie à remonter le temps et à dessiner les branches d’un autre arbre, sans grand succès, personne pour tenir l’échelle. Son père, Louis, a épousé une Perret, mais pas de Perret, que je sache, du côté de ma famille. Pas de Bersier, Cachin, Coigny, Duc, Ducret, Gilléron, Joliquin, Mayor, Miéville, Morattel, Pichonnat, Pochon, Rubattel, Tenthorey, Trolliet ou Veyre du côté de la sienne.
Mais disons que l’apiculteur ne sait pas beaucoup de choses sur son village d’origine, ce qu’il sait c’est que son grand-père a épousé une Vingre et a quitté Villarzel autour des années 1870. Il a fait le charpentier à Cottens pendant plusieurs années avant qu’un accident ne le force à prendre un domaine en fermage du côté de Bremblens, que son fils Louis louera jusqu’à ce que les propriétaires décident, en 1964, de le récupérer. Louis Rossier fera alors l’acquisition d’un domaine sur la colline qui domine Moudon dont André s’occupera et que celui-ci remettra à son fils il y a quelques années.
Avant de quitter Marinette et les deux retraités, je jette un coup d’oeil à la ruchette, elle grésille comme une ligne à haute-tension sous la neige, on a peut-être réussi notre coup. A l’arrêt de bus personne, deux sacs d’école abandonnés sous la pluie. Mais Lili et Mylène sortent soudain du bois avec des secrets plein les yeux. A la maison Arthur malade dort. Quant à Louise, comme souvent lorsqu’elle a passé quelques heures au CHUV, elle fait trembler les murs de la maison.




Jean Prod’hom
CXXVI

Maracon : l’honneur revient à un élève débutant de la classe de Madame C. de conclure cette magnifique soirée en faisant entendre ses premiers pas au violon. Les visages se crispent, les dents grincent, tout le monde s’attache : le morceau s’intitule Mouvement perpétuel.
Jean Prod’hom
Il y a les sentiers didactiques

Il y a les sentiers didactiques
le mini-golf
le papier tue-mouches
il y a les chiens mouillés
les orphelins
les pains au chocolat
il y la canne et ses canetons
la mort aux rats
il y a le lundi matin
Jean Prod’hom
CXXV

S’ils n’en pensent pas moins, c’est d’abord parce qu’ils ne peuvent en penser plus.
- Impossible de retirer mon alliance, avec les années mon annulaire a boudiné.
- Pas de problème ! Mais enlevez-la, ce sera plus simple pour la scier.
Lili et Mylène sont sur le chemin de l’école.
- Elle y croit, elle, en Dieu et Jésus ?
- Non, juste un petit peu au Père Noël.
Jean Prod’hom
J'ai fumé comme jamais

Le printemps 1989 n’aura pas répondu à nos attentes, du gel au matin du 29 avril, la bise levée à l’aube qui n’aura pas faibli, pas plus de 5 degrés à 11 heures. Et pourtant, les premiers jeudi et vendredi de mai auront préparé le miroir du samedi, magnifique le dimanche, on y était enfin.
J’habitais alors Hermenches et nous avions, mon amie et moi, invité pour le café ma mère et mon père. On avait parlé de choses et d’autres, ils avaient raconté leur repas chez les Andrée avec les Gaston, leur escapade à Couvet où les attendaient mes deux soeurs et leur mari, les 3 heures de marche autour du Creux du Van, du souper enfin à Neuchâtel.
J’ai proposé alors à mon père de descendre à pied jusqu’à Moudon, belle trotte sur le dos des collines et au fond des bois. Nous sommes descendus jusqu’à la déchèterie, derrière la Moille Robert par Chauru, avant de rejoindre la lisière du Bois Bataillard qui surplombe la Mérine. Nous n’avions pas l’habitude de beaucoup parler lorsque nous marchions ensemble, et ce silence qui nous unissait nous séparait aussi. Il n’était pas rare que je me trouve à une dizaine de mètres en avant de lui, le laissant à ses pensées tandis que j’essayais de faire le ménage avec les miennes.
C’est en haut du premier raidillon que je me suis aperçu soudain que mon père ne suivait plus. Je me suis retourné et l’ai vu, tout en bas encore, penché au pied des arbres chétifs qui vivotent à l’ombre des hautes sentinelles des lisières. Il s’est relevé et baissé à plusieurs reprises, il n’observait visiblement aucune trace, je le devinais, ni les brins du muguet pour lequel il avait une préférence, il portait une veste bleue, légère. J’ai eu le pressentiment à je ne sais quel signe, imperceptible, mouvement de l’air ou nuage dans le ciel, qu’il se penchait sur ce quelque chose auquel il ne pouvait croire et que je devinais peut-être.
J’ai pris alors, sans être assuré de quoi que ce soit, l’engagement de renoncer à ce qui le rongeait s’il s’avérait que l’affaire dont je devinais les contours tournait mal. Nous avons continué par la Doreire sur Rossenges jusqu’à Beflori, traversé le bourg de Moudon et plongé sur la Broye.
En attendant le verdict, j’ai profité comme un condamné du délai que je m’étais octroyé et fumé comme jamais.
Jean Prod’hom
94

Ne pas perdre son temps à chercher le passage entre le trop tôt et le trop tard. N’y croît que le prévisible.
Le succès laisse supposer que le but est atteint alors qu’il en éloigne.
Brûler la vie par les deux bouts ? Un seul suffit, précise le fumeur de Havane.
Jean Prod’hom
On fumait la clématite

Riant-Mont 1968
J’ai tiré sur mon premier bois fumant dans le roncier surplombant les escaliers qui montaient au Petit-Parc, tout près de chez le gros Georges, avec Claude-Louis peut-être, ou son frère André, ou un autre copain du quartier. J’avais onze ou douze ans. Ce dont je suis sûr c’est que je n’étais pas seul, je n’aurais pas osé en effet glisser une boîte d’allumettes dans une de mes poches et marcher ainsi dans la rue.
Ma première cigarette, je l’ai fumée entre 14 et 15 ans, seul dans les toilettes de Riant-Mont, fenêtres grandes ouvertes. C’était une Brunette tirée du paquet de mon père. Ni lui ni ma mère ne m’ont fait une quelconque remarque à leur retour, je leur en sais gré. L’affaire était donc bien lancée, j’ai continué en augmentant ma ration jusqu'en 1989. J’ai fumé des Virginies sans filtre, des Gauloises bleues, jaunes, disque bleu, des Gitanes sans filtre, papier maïs, des américaines, roulées, sans ordre et sans faire preuve d’aucune fidélité. J’ai cessé de fumer des centaines de fois, à certaines périodes de ma vie c’était quotidien, ou ça durait un ou deux jours avant que je n’en allume une pour fêter ces premiers pas vers l’abstinence.
Je tiens tout bien pesé pour responsables de ce vice, au moins partiellement, mes parents, Claude-Louis, Michel, Garry Cooper, Cary Grant et la société tout entière. Mais je tiens mon père pour l’unique artisan de ma décision de cesser de fumer. J’ai énoncé les conditions d’un tel arrêt le dimanche 7 mai 1989, il m’a fallu attendre encore un mois et dix jours avant de passer à l’acte, c’était le samedi 17 juin dans l’après-midi. Je n’ai plus fumé depuis ce jour-là, rien pendant plus de vingt ans, c’était hier lorsque j’y pense. Et de ce point de vue, ce rien qui a occupé chacun des instants de cette seconde partie de ma vie l’aura réduite à presque rien.
Jean Prod’hom
La dernière Kent

Saint-Sulpice 1965
Lorsqu’il a été évident que la cigarette ne faisait aucun bien à la santé de quiconque, ma mère a renoncé à la Kent qu’elle se plaisait, parfois, à fumer en fin de semaine et s’est mise à mener la vie dure à mon père, condamné désormais à fumer à l’écart, comme un paria, à suçoter des pastilles pour donner le change, des Läkerol à la réglisse qui se mêlaient dans la petite poche intérieure de son veston à la monnaie que les sommelières lui remettaient à l’heure de l’apéro au café de la Couronne.
C’est tout cela que mon père transférait le dimanche matin, monnaie et bonbons, du veston de la semaine à celui d’un ensemble plus sombre qu’il enfilait pour aller au culte. C’est de cette nouvelle poche qu’il tirait les piécettes qu’il plaçait dans la bourse de velours circulant parmi les bancs de l’Assemblée des Trois-Rois. C’est de cette même poche qu’il sortait, peu après la collecte, un bonbon de réglisse, tiède, qu’il déposait comme un cadeau du ciel dans la paume de ma main, pour m’aider à faire avancer le temps, un temps que je suçotais mais qui ne passait pas, encalminé dans les professions de foi.
Jean Prod’hom
93

Quel soulagement lorsque l’écrivain apprit que ses rivaux engagés dans de prometteuses entreprises avaient fini par y renoncer et par accepter ses conseils avisés !
Que les choses essentielles dépendent de quelques-unes qui ne le sont pas, voici ce dont je ne me remets pas tout à fait.
Les réponses données à des questions qu’on ne s’est jamais posées sont aussi longues et complètes que les silences et les soupirs qui habitent celles qui ne nous ont jamais quitté.
Jean Prod’hom
Pourquoi je me suis mis à fumer ?

Et puis il y avait ce geste de prestidigitateur qu’effectuait mon père lorsqu’il tapotait l’extrémité de sa virginie sans filtre, sur son ongle ou à l’angle de la table, pour repousser à l’avant de la cigarette les miettes de tabac qui auraient entamé sérieusement le bonheur de la première bouffée en quoi devait se résumer, je le soupçonnais alors, le plaisir du fumeur, en l’obligeant à saisir ces grains parasites, sans la moindre élégance, du bout des doigts. Il y avait ensuite la pression de ses lèvres qui, avec l’aide du mouvement circulaire de l’index, du majeur et du pouce de sa main droite, bordaient l’ouverture d'une étroite marge de papier empêchant ainsi le retour intempestif des grains récalcitrants, avec le risque que cette protection gommée demeure collée à ses lèvres et fasse saigner celles-ci lors de son retrait. Il y avait enfin ce moment où il y boutait le feu à sa virginie, l’oeil fixé sur le lointain d’où venait certainement un second plaisir, moins physique mais infiniment plus romanesque auquel j’aurais voulu être initié.
Ces gestes que mon père réalisait à la perfection me renvoyaient à ceux qu’effectuaient les cow-boys entrevus à la télévision qui, après avoir fourbi leurs armes et embrassé leur belle, en fumaient une encore avant de s’engager dans des combats qui feraient d’eux des héros.
C’est dire que mon père a contribué sans le vouloir à mon désir de fumer, mais il aurait peut-être échoué si son oeuvre n’avait pas été complétée plus tard par mon ami Michel S, fumeur de la première heure, amateur de gauloises et de gitanes sans filtre, qui ajoutait au scénario suivi scrupuleusement par mon père, Cary Grant et Gary Cooper, le bruit des fers de protection en forme de lune fixés à l’avant et à l’arrière de ses mocassins qu’il faisait sonner sur le bitume, comme des sabots, faisant accroire à celui qui le voulait bien que le cheval qui manquait à mon père était désormais bien là.
Le bonheur était complet, le tableau achevé, il était temps que je me mette moi aussi à fumer.
Jean Prod’hom
92

La hauteur, du ciel à la terre, façonne aux beaux jours la pâte bleue dans laquelle l'homme se traîne et l'oiseau vole.
Jean Prod’hom
Il y a l’odeur de la térébenthine

Il y a l’odeur de la térébenthine
les myosotis
les éclaircies
les marlous
la brocante
il y a le livre à venir
les neocolors
il y a les lendemains de fête
il y a la petite restauration
Jean Prod’hom
Il pleut des cordes à la radio

Il pleut des cordes à la radio, bouchon sur l’A1 et personnel en surnombre, les eaux montent dans la vallée. Les journalistes en sourient et pépient, coups de coude, coups de gueule et comédie, à l’abri, à la cafète comme au théâtre, avec un thé et des petits fours. C’est là qu’ils conçoivent en secret l’objet de nos indignations et la destination de la prochaine croisade. Ici on remue le thé avec le petit doigt et on rabote ses arguments avec des poncifs. On tire des plans gros-grains sur la comète, on improvise des catastrophes, détermine par triangulations ce qui doit être et ce qui aurait pu être, c’est la guerre culturelle. Rires de crécelles et tessons de bouteilles entre les dents, rouge sur les lèvres mais choix du dentifrice, c’est fun, les reporters de salon se gargarisent et rient. Oh ! la vilaine énergie, l’humeur bon enfant, insistante jusqu'à la nausée, sotte, intenable de pied en cap : les plaintes de circonstance et les regrets télécommandés s’attaquent aujourd’hui aux nuages.
On a beau tendre l'oreille, rien, pas même le bruit de la course du meurtrier, pas le moindre carré de colza, le bruit de l'avoine dans la bouche de l’âne ou le dégoût d'en être arrivé là. Silence. Poussière empoisonnée éteignez-moi ce poste à galène, la bonne humeur est effrayante. Restez avec moi petite ondée !
Jean Prod’hom
Ascension, aire de dépose et acquittement

YVERDON-LES-BAINS L’école des Isles a été inondée ce jeudi en raison d’une avarie sur un réducteur de pression. Pas de souci pour les pieds des bambins, c’était jour d’Ascension.
VAUD Les élus du Mont-sur-Lausanne ont accordé sans discuter les 485’000 francs (suisses) demandés par la Municipalité pour la mise en place d’une aire de dépose au Rionzi, surpris pourtant lorsqu’ils ont appris qu’elle n’était pas destinée à des gros porteurs, mais aux enfants de leur commune en âge pré-scolaire.
SAINT-GALL La jeune mère qui avait donné en 2009 à son bébé un biberon contenant de la cocaïne et de l'héroïne a été acquittée. Les experts n'ont pas été capables de déterminer la cause exacte du décès.
Jean Prod’hom
Etat des lieux

- Et tes loisirs ?
- Je vais trois fois par semaine chez une répétitrice.
- D’autres occupations ?
- Je vais à l’école les autres jours !
- Comment ça ?
- Ouais, à l’école extra-scolaire !
Difficile de choisir mon sujet d’examen, j’ai beaucoup hésité entre la maltraitance des personnes âgées et la maltraitance des animaux. Disons que les personnes âgées ça ne me plaisait pas trop, alors j’ai pris les animaux.
Bien sûr que j’aimerais travailler, mais rien que d'y penser ça me démotive.
Jean Prod’hom
Jacques-Édouard Berger mort au Paris-Dakar

Fragment de stèle funéraire, calcaire, Nouvel Empire, XVIII-XIXe dynastie
Belle confusion je le concède ! d’autant que je l’entretiens depuis plusieurs décennies. C’est hier seulement que j’en ai réellement pris conscience, alors que je descendais au sous-sol du MUDAC, dans la cave sombre qui abrite quelques merveilles de la Collection Jacques-Édouard Berger dont ce musée a la charge et où je me rends parfois.
Jacques-Édouard ou François-Xavier ? Jacques-François ou Édouard-Xavier ? Jacques-Xavier ou Édouard-François ? Ma confusion trouve son origine là, dans ce couple de prénoms doubles un peu vieille France. N’ai connu ni l’un ni l’autre, mes informations à leur sujet ont toujours été partielles puis se sont brouillées. Qu’ont-ils chacun fait exactement ? Quelle fut leur vie ? Et leur mort ? Et d’ailleurs qui est qui ? Je n’y puis rien, impossible de tirer de ce méli-mélo deux corps, deux vies bien distinctes, deux destins. En cause donc leurs prénoms, mais d’autres éléments contribuent à mon désarroi. Je suis aujourd’hui incapable de suivre la piste de chacun, ils oeuvrent ensemble dans mon esprit ; je voudrais défaire l’écheveau, ne pas continuer à tourner dans ces eaux, les séparer, trouver un point d’appui.


Leurs prénoms ne font qu’un mais je dispose de deux visages, celui de Jacques-Édouard ou François-Xavier et celui de François-Xavier ou Jacques-Édouard, je ne peux m’empêcher de les imaginer chacun avec les traits de l’autre, blonds tous les deux. Ils ont eu une vie active jusqu’à leur mort prématurée, Jacques-Édouard ou François-Xavier alors qu’il avait 48 ans, François-Xavier ou Jacques-Édouard plus jeune encore, dans la fleur de l’âge.
Le premier était historien de l’art, comme son père René Berger. Le second était pilote d’hélicoptère, comme son père Bruno Bagnoud. C’est le fils qui était aux commandes de l’appareil lorsque celui-ci s’est écrasé au Mali en marge du Paris-Dakar, j’ignore ce que François-Xavier, ou Jacques-Édouard, faisait exactement dans le ciel bleu d’Afrique. Les circonstances malheureuses de cette mort, je ne puis m’empêcher de les reproduire dans l’image que je me fais de celle de l’historien de l’art, Jacques-Édouard ou François-Xavier, si bien que je l’imagine dans un hélicoptère au-dessus de la Vallée des rois, s’écrasant sur cette terre d’Egypte dont il était un spécialiste enthousiaste.
En souvenir de leur bref passage sur terre, et pour que leur mort serve à quelque chose, deux associations voient le jour, je m’en souviens maintenant, la Fondation Jacques-Édouard, ou François-Xavier Berger, et l’Association François-Xavier, ou Jacques-Édouard Bagnoud.
Cette confusion serait impardonnable si d’autres figures ne venaient pas continument nourrir mon désarroi. Principal responsable : Michel Berger, pianiste, auteur-compositeur-interprète, directeur artistique et arrangeur musical. Il n’est pas comme on pourrait le supposer un parent proche ou lointain des historiens de l’art, mais l’indéfectible ami de Daniel Balavoine, l’auteur-compositeur-interprète français mort à 34 ans dans l’hélicoptère que pilotait le fils Bagnoud. Comme si ce Berger ne suffisait pas pour semer la zizanie, un second pointe son nez, Yves, un Berger écrivain que je ne connais que de nom, mais un trait-d’union essentiel qui introduit dans la danse un autre Yves, pas un Berger mais un Simon, Yves Simon, chanteur de variétés et écrivain passionné de Salvadore Adamo, de Michel Berger et de Daniel Balavoine. J’aurais pu souhaiter que tout s’arrête là, mais c’était sans compter qu’un Simon peut en cacher un autre : Claude, Claude Simon qui de façon surprenante n’a guère eu à faire avec Michel, Daniel, Adamo, France et les Bagnoud, mais qui a croisé René Berger dans les Cahiers internationaux du symbolisme en 1981…
Cette enquête est sans fin, je croyais pouvoir dissiper ma confusion, mais rien n’y fait. Je me retrouve sur la place de la Cathédrale avec une série de questions dont je ne vois pas le bout. Qui donc s’est écrasé dans ce satané hélicoptère au-dessus du plateau de Gizeh ? Jacques-Édouard ou François-Xavier ? Accompagné de qui ? Yves, le fils de Claude ? Jacques-Édouard connaissait-il Yves ? Quel Yves ? Simon ou Berger ? Quel Simon ? Claude ou Yves ? Daniel ou Balavoine ? France ou Gall ? Berger ou Bagnoud ? Quant à René Berger et Claude Simon, que nous cachent-ils ?






Jean Prod’hom
Jug

« Pardonnez, Monseigneur, l'importance que je mets à ce fait. Il faut avoir éprouvé toutes les angoisses d'une instruction aussi pénible ; il faut avoir suivi et dirigé cet homme-plante dans ses laborieux développements, depuis le premier acte de l'attention jusqu'à cette première étincelle de l'imagination, pour se faire une idée de la joie que j'en ressentis et me trouver pardonnable de produire encore en ce moment avec une sorte d'ostentation, un fait aussi simple et aussi ordinaire. »
Jean Itard, Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron, 1806

Jug – carafe en verre soufflé à travers un os de vache gainé d’un cuir ourlé (MUDAC, Lausanne, de la série Craftica réalisée par Fendi, 2012)
« Au milieu de ces méprises, ou plutôt de ces oscillations d'une intelligence tendant sans cesse au repos, et sans cesse mue par des moyens artificiels, je crus voir se développer une de ces facultés caractéristiques de l'homme, et de l'homme pensant, la faculté d'inventer.
Je me rappelle que dînant un jour en ville et voulant recevoir une cuillerée de lentilles qu'on lui présentait, au moment où il n'y avait plus d'assiettes ni de plats sur la table, il s'avisa d'aller prendre sur la cheminée et d'avancer, ainsi qu'il l'eût fait d'une assiette, un petit dessin sous verre, de forme circulaire, entouré d'un cadre dont le rebord nu et saillant ne ressemblait pas mal à celui d'une assiette.
Mais très souvent ses expédients étaient plus heureux, mieux trouvés, et méritaient à plus juste titre, le nom d'invention. Je ne crains pas de donner ce nom à la manière dont il se pourvut un jour d'un porte-crayon. Une seule fois, dans mon cabinet, je lui avais fait faire usage de cet instrument pour fixer un petit morceau de craie qu'il ne pouvait tenir du bout de ses doigts. Peu de jours après, la même difficulté se présenta ; mais Victor était dans sa chambre, et il n'avait pas là de porte-crayon pour tenir sa craie. Je le donne à l'homme le plus industrieux ou le plus inventif, de dire ou plutôt de faire ce qu'il fit pour s'en procurer un. Il prit un ustensile de rôtisseur, employé dans les bonnes cuisines, autant que superflu dans celle d'un pauvre sauvage, et qui, pour cette raison, restait oublié et rongé de rouille au fond d'une petite armoire, une lardoire enfin. Tel fut l'instrument qu'il prit pour remplacer celui qui lui manquait et qu'il sut, par une seconde inspiration d'une imagination vraiment créatrice, convertir en un véritable porte-crayon en remplaçant les coulants par quelques tours de fil. »
Jean Itard, Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron, 1806

- Dites-moi Madame Guérin, c’est vous qui avez fait cet objet ?
- Ma foi non, Docteur!
- Et bien c’est Victor !
- Victor ? Mais c’est le vieux manche à gigot !
- C’est un porte-craie. Il l’a fabriqué lui-même.
- Comme c’est bien !
- Ah oui ! C’est très bien.
- Dis-moi, Victor, c’est toi qui as fait ça ? C’est toi Victor ? Oui ? C’est très bien Victor, c’est magnifique. Je te félicite, je suis très content.
François Truffaut, L’Enfant sauvage, 1969
Il y a la vie au camping

Il y a la vie au camping
le trot et la crinière
les yourtes
il y a les glaces à la pistache
les chemins de crête
il y a les petites perturbations
il y a les rêves la nuit
les rêves le jour
le partage des eaux
Jean Prod’hom
Chute, fermeture et concurrence

VALAIS Un Allemand de 33 ans à perdu la vie samedi en fin d'après-midi au Cervin après une chute de 200 mètres. Les spécialistes sont unanimes : dans le coin, 20 mètres auraient amplement suffi.
VAUD La fermeture des classes dans les villages est très souvent déplorée. D'autant que les habitants ont souvent déjà fait le deuil de leur office postal, de leur café et de leur commerce. Reste encore, pour les consoler, le cimetière.
VAUD La Garde aérienne suisse de sauvetage de la Rega et l’Alpine Air Ambulance du TCS sont en guerre. Plus personne pour les dépanner.
Jean Prod’hom
91
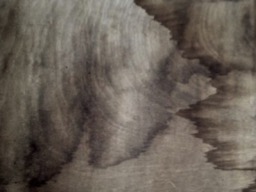
Combien sont-ils ceux qui vivent jour et nuit avec des essuie-glace ?
Lui sur le trottoir moi sur la route, je croise chaque matin cet ancien élève, dix ans que ça dure. La petite tristesse qui l’habitait sur les bancs d’école a pris depuis ses quartiers et s’épanouit chaque jour davantage. Je regrette parfois de ne pas l’avoir suffisamment encouragé à la faire fleurir dehors – il écrivait bien le bougre. Je suis triste, triste de savoir qu’il y a des choses qui ne se peuvent pas, triste aussi que lui aussi n’y croie guère. A moins que,… plus tard.
Le petit vieux appuyé au montant de la barrière qui longe l’avenue des marronniers et qui peine à retrouver son souffle sourit. Il me rappelle ma mère au mois de juillet 2003. Elle avait alors juste assez de force pour en perdre un peu encore, mais pas assez pour en redemander.
Jean Prod’hom
L’étreinte lorsqu’elle se desserre

Assailli de toutes parts, condamné pour desserrer l’étreinte à un détour par le maigre, on le voit parfois dans le ciel, les yeux fermés, tourner par larges cercles concentriques, toujours plus larges, jusqu’à disparaître et laisser place à l’incompréhensible.
C’est l’étreinte lorsqu’elle se desserre qu’écrit cet homme-là, avec dans la main quelques mots transparents et la plume légère d’une oie sauvage qui le ramène parmi nous en faisant tourbillonner un poème au-dessus du lieu qui l’avait vu se raidir.
Jean Prod’hom
Effacer un mot et retrouver l'énigme intacte

Chemins, taches rousses des sédums, lianes des clématites sauvages, chaleur du soleil couchant.
(Noté d'abord cela, pour ne pas oublier l'intensité singulière de ces instants.)
Aussitôt après :
Ces taches rousses sur les rochers - comme on parle de la lune rousse –, comme des morceaux de toison, de la toison du soleil couchant ; et puis ce lien entre chemins et chaleur, une chaleur émanée du sol…
En dépit de ma bonne volonté, je ne parviens pas à donner le moindre crédit à ce mot placé là, émanée, dont la voyelle finale, lourde et émoussée, me détourne de ce chemin d’où monte, comme une invisible vapeur, une chaleur couleur de terre. Tout s'y refuse.
Surgit pourtant dans le même temps, comme pour remplacer ce mot qui m’est refusé, une image venue de très loin, un pâturage au fond d'un vallon traversé par le Triège, atteignable par un chemin caillouteux à double ornière depuis le Trétien, ou par un sentier depuis le col de Fenestral au-dessus de Finhaut, mais qu'on rejoignait en famille de la Creuse en suivant un sentier au pied du Luisin. Vallon profond qui s’étend dans une herbe maigre, épais tapis de tourbe avec des linaigrettes et des carex, moquette mitée par le ruissellement d’innombrables petits cours d’eau qui se rejoignent et se séparent comme des coraux. Ravivée l'été passé par quelques balades, l’image de cet alpage s’impose, écarte le vilain mot, malvenu, couvert d’une épaisse couche d’étain, avant que je ne reprenne, à la sortie de ce vallon dont j’aurai parcouru les beautés, en aval, intacte, la lecture des pages de Philippe Jaccottet.
et le chemin, une sente plutôt qu'un chemin, "la sente étroite du Bout du Monde" mais justement pas du Bout du Monde : d'ici, de tout près, sous les pas. (Non dans un livre.) Tendre trace silencieuse laissée par tous ceux qui ont marché là, depuis très longtemps, traces de vies et des pensées qui sont passées là, nombreuses, diverses, traces de bergers et de chasseurs d'abord – et il n'y a pas si longtemps encore –, puis de simples promeneurs, d'enfants, de rêveurs, de botanistes, d'amoureux peut-être...
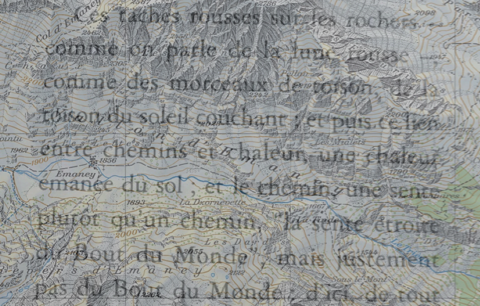
On se rendait à pied au fond de ce vallon dès l'aube pour être de retour à midi, avec le beurre et la crème que nous achetions au berger, avec les petits fruits aussi que nous cueillions en chemin, myrtilles surtout pour lesquelles notre mère vouait une véritable passion. Le sentier qui longe le Triège s’en éloignait lorsqu’on reprenait en début d’après-midi celui qui nous conduisait à la Creuse, laissant derrière nous le pâturage d’Emaney qui avait illuminé cette journée sans que personne ne le sache encore, le vallon d’Emaney vers lequel on lèverait la tête, plus tard, comme en direction d’une énigme. On croisait d'autres habitués, silencieux, qui marchaient comme nous avec mille précautions, parce qu’on se croisait à peine sur ce sentier qui se faufilait entre mélèzes et arolles, aulnes et bouleaux nains, genièvre, sariette et rhododendrons, et de lourds blocs de granit brûlant qui l’obligeaient à se contorsionner.
Si l’image de cet alpage, de ce vallon et de tout ce qui les entoure s’impose à moi aujourd’hui, c'est en raison d’un nom que je n’ai pas cessé de répéter à la place du mot que j’ai répudié, Emaney, avec à la fin, tout au fond du vallon, cette voyelle qui ouvre ses bras et son assiette, inscrivant au coeur d’un texte les lignes souples d'un autre temps, à la fois morceau du monde, ici, tout près, dans un pli de la mémoire, trace d'enfant qui n'a rien perdu de son intensité, quelque chose du dehors qui s'installe sans crier gare dedans, une poche sans fond mais aussi, comme le dit Philippe Jaccottet dans Couleur de terre, la stupeur d'avoir été simplement là, sans savoir ni comment ni pourquoi, à Emaney, avec non pas la chaleur qui montait des chemins, une chaleur émanée du sol, mais la force invisible d’un vallon, l’imperceptible émané d’un nom.
Jean Prod’hom
Aproz : la qualité d'une reine c'est sa faculté d'oubli

C’était dimanche en Valais à l’occasion de la Finale nationale des combats de reines d’Aproz. Demi-finales, Bombe H ne fait pas le poids face à Pandore, ni Papillon face à Cobra – mais ça c’était plus attendu. En finale Cobra culbute Pandore.

La reine 2013 de la race d’Hérens, Cobra avec son roi, Viktor Gsponer de Niedergampel

Si on n’est pas là, à la seconde qui suit elle plante dans le cul, pis c’est dommage pour l’autre propriétaire (Jean-Pierre Formaz, chef rabatteur de reines à Aproz)
Deux mots encore sur Cobra la reine des reines. Elle s'était très mal classée en début d’année lors du concours du Haut-Valais. C'est dire qu’elle ne figurait pas parmi les favorites, d'autant plus que plusieurs bêtes qui l’avaient battues lors des qualifications étaient en finale.
Mais Cobra est dotée d’une des plus hautes qualités que puisse posséder une reine, explique un de ces propriétaires de nouvelle génération, Cobra a la faculté d’oubli, elle ne se souvient pas d’avoir été renversée. Et il cite Nietzsche : « Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourraient exister sans faculté d'oubli. »
Jean Prod’hom
Zéro, un et deux : clarifications

C'est un luxe que de différencier – un mirage – le zéro de l’un. A dire vrai et hors la mathématique, c’est-à-dire bien en-deçà de sa naissance en Grèce, ou ailleurs peu importe, bien avant qu’elle ne tende sa toile collante, bien en amont de ses séductions, aucune caractéristique ne les distinguait aux abords de l’origine : zéro et un étaient confondus et personne ne s’en offusquait, personne ne réclamait, tout ou rien, qu’importe, ni l’un ni l’autre aussi bien. Zéro et un n’ont jamais été premiers, entendez-vous ?
Pour donner raison à ce distinguo, si faible qu’il soit, ou qu’elle soit, il aura fallu l’apparition du deux, le véritable événement dans l’histoire de notre espèce, un deux que l’homme rencontrera un peu par hasard, sans raison, pas si facile que cela de l’imaginer, un don de Dieu dans une flaque d’eau, l’oeil d’une femme, la révolte de son ombre ou la vitrine d’une boutique, voici deux le nouveau-né.
C’est par lui, le deux, que l’homme s’éprend miraculeusement de l’idée qu’il existe hors de lui quelque chose plutôt que rien, quelque chose qu’on peut voir, sentir, caresser, entendre, c’est-à-dire toi ou autre chose, c’est-à-dire le même, l’un, et imaginer alors, pendant ses loisirs nés avec, pour rire, du zéro, trop tôt ou trop tard, mais cet événement étendu sur une durée qu’on peine à imaginer.
Disons-le tout net, on n’aura eu besoin – mais en est-ce un ? Ne le regrette-t-on pas aujourd’hui ? – du un et du zéro que rétrospectivement pour offrir un passé à un piège d’une autre nature que celui de l’immédiat .
En disant zéro on dit deux, en disant un, trois aussi, c’est deux. Hegel a voulu par une ruse qui est celle de la raison sortir de l’ornière, nous en avons parlé, il ne regrette rien mais concède. Quant aux mathématiciens, petits maîtres, ils prétendent que je radote, pas tous. Qui sont-ils ces hommes assis dans le compartiment d’un train aveugle filant sur une voie ferrée, tranchant un espace dont ils ne soupçonnent pas même la divine étendue et l’étrange épaisseur ? Ivres, perdus dans le livre de comptes du grand apothicaire.
Jean Prod’hom
Ecrire à deux mains

Hiver 1931-1932, Ramuz n’a plus de cigarettes, un hiver gris, joli et pâle, bandes de gris bandes de blanc, fumées bleues dans le ciel de Pully, déjà vu ça. Un peu tête en l’air l’écrivain, il ne pense pas au verglas, l’aurait dû, il a gelé pendant la nuit.
A traversé la placette un chapeau sur la tête, est entré dans la boutique à cent mètres de chez lui, en est sorti un paquet dans la poche. L’homme n’est pas descendu du ciel, pas encore, la tête dans un livre d’astronomie, dans les étoiles donc, celles qu’on voit, celles qu’on ne voit pas, celles qui ne sont plus, distrait du monde, ça glisse terriblement, il n’a rien vu venir, le voilà sur le dos, le dos sur la chaussée recouverte de neige, impossible de se relever, sa main gauche ne répond pas. L’homme voudrait appeler de l'aide, cherche le ton juste mais ne le trouve pas, l’homme a horreur du ton faux alors il se tait, bien décidé à s’en tirer seul. Il s’arrange pour ramener cette main, ce bras et cette épaule qui ne répondent plus mais qui lui appartiennent, il ne les lâche pas, serre sa main contre lui et rentre, au diable les cigarettes.
C’est l’humérus, cassé en biseau avec chevauchement, son bras garni de ouate et de de bandelettes est immobilisé d'abord dans une armature triangulaire et deux planchettes, dans un appareil en aluminium ensuite, extensible, cordelettes, écrous et poulies, un autre siècle de la médecine.
Cette aventure est l'occasion pour Ramuz de confronter l'être volontaire qu'il est resté avec le nourrisson impotent qu'il est devenu et d'en tirer quelques enseignements. Méditation sur la symétrie et l'asymétrie de la machine humaine, pas si simple de trancher. Un corps en partie symétrique mais aucunement de part en part. On voit, on entend et on respire symétriquement, mais on pense, continue Ramuz, on digère, on aime asymétriquement. Deux jambes, deux pieds, deux bras, deux mains réparties de chaque côté d'un axe de symétrie, mais un fonctionnement asymétrique, non rien n'est simple, ils ne font rien l'un sans l'autre mais ils ne font pas la même chose. C’est en boitant qu'on écrit, non pas d’une seule main mais des deux, malgré les apparences, dans le déséquilibre, comme on aime, comme on digère, comme on pense.
Ecrire. On distingue tout à coup, et pour la première fois de sa vie, qu’on écrit avec les deux mains. Au travail évident, et le seul auquel on prenne garde, de la main droite, la gauche vient sans cesse apporter une collaboration si discrète qu'on ne la remarquait pas.
La voilà qui se venge. Brusquement, elle se refuse à ce rôle ingrat; elle vous dit : « Tâche de te passer de moi, tu verras. » On voit. On voit que, pendant que la main droite formait les lettres, elle, elle était là tout le temps qui l’aidait à les former. C’est elle qui tenait le papier. C’est elle qui tenait la pipe et et la cigarette. C’est à elle qu’étaient dévolu un tas de petits gestes accessoires, mais non moins utiles et mêmes indispensables, qu’elle exécutait fidèlement, sans même qu’on s’en doutât.
C. F. Ramuz La Main, Rencontre, Lausanne, 1952 (Première édition :1933)
C’est à l’autre, voudrais-je ajouter, que revient le soin de mettre un peu de hauteur au travail de la main qui écrit, de la ralentir, de lui rappeler l'étendue et le volume dont elle s’est dégagée pour exister, de l’obliger à leur offrir la place qui leur revient, de lui passer de main à main ce qu'elle a de son côté appris dans son commerce avec les choses. Les claviers de nos ordinateurs ne doivent pas nous le faire oublier, nous écrivons à deux mains, tandis que l’une trace, l’autre respire, sent, observe. C’est par l’autre que ce que manque la main qui écrit revient par l’ouverture ménagée dans ce qui n’en a pas. Tâtonnement, écart sans lesquels il n’y eût ni profondeur, ni souvenir, ni écho, ni feu, ni même vérité. Celui de la Main coupée en sait quelque chose.
Jean Prod’hom
Avec François Bon

Très heureux d’accueillir François Bon, mais inquiet à l’idée que ces pages – faut-il les appeler encore ainsi ? - se révèlent bien étroites pour le texte de cet homme aux mille bras. J’ai pensé un instant profiter de sa venue pour entreprendre de gros travaux, élargir le corps principal du site et réduire ses marges, l’excaver même, surélever la charpente pourquoi pas et y aménager des combles. Mais c’eût été trahir l’esprit des vases communicants dont il est l’un des initiateurs – le premier vendredi du mois chacun écrit sur le blog d’un autre. Circulation horizontale pour produire des liens autrement. Ne pas écrire pour mais écrire chez l’autre.
Allez donc jeter un coup d’oeil à sa résidence si vous ne la connaissez déjà, Tiers Livre, le bonhomme y vit, en déborde, il étonne, invente, tonne, vous le croyez à New York il est à Manosque, à Marseille il est à Ferney, hier à Marrakech aujourd’hui à Rabat d’où il raconte la ville, les morts et la mer, la huitième de ses fictions dans un paysage, la neuvième si l’on compte L’Enterrement, ce grand texte que publiaient les éditions de Minuit en 1991, repris désormais par publie.net, un texte que j’ai traversé ébahi avant de me risquer moi aussi du côté des morts, pour y suivre, chez lui, cette route au-delà de laquelle il n’y a rien.
JP
fictions dans un paysage, 8
la ville, les morts, la mer

Ici la ville semait ses morts entre elle et la mer.
La mer, nous l’avions longée longtemps : elle est brutale et sauvage, une houle bien plus raide que chez nous, et qui tombe droit sur la côte droite, éclate dans les basaltes noirs.
La ville, ici, s’arrête. Elle a planté les murs de ses casbahs, elle a maintenu la rectitude de ses infinis remparts. Les routes de la ville sont routes caravanières, et les vieilles routes des livres aussi, ou la route d’Ibn Battuta le voyageur, elles sont routes qui vont vers l’Asie et le coeur noir de l’Afrique, la ville ici ne connaît pas la mer, ne la met pas en travail, et le fleuve est trop étroit pour accueillir autre chose qu’un peu de pêche.
Mais les morts, ne doivent-ils pas accompagner aussi les routes, qui s’arrachent aux lointains pour irriguer la ville ? Et les morts, ne doivent-ils pas être sous la ville comme sous un abri, et que les remparts les protègent et les sauvent, dans leur infinie attente ? Mais les morts ne doivent-ils pas eux aussi savoir ce qui se passe après eux dans les rues serrées et les maisons secrètes ?
Pourtant ici la ville tournait le dos à la mer, la ville ignorait la mer. Où elle avait construit un récent attouchement de béton, parce que c’était le lot des villes modernes, des pays du loisir et des images de télévision, elle avait jeté sur le basalte une esplanade et un phare. Des amoureux s’y cachaient, dans les anfractuosités soumises au vacarme des vagues. Ce n’était pas temps de voir l’un chez l’autre, alors la mer servait à cela.
Une mer de vent, de roche et de houle. Et la ville avec ses avenues secrètes, ses arcades, ses labyrinthes et ses écoles. Une ville si ancienne qu’on n’y mesurait même pas le temps, et sans doute les allées-venues des cigognes sur les mausolées duraient depuis aussi longtemps qu’elle.
Nous marchions en ce bord, avec la route à quatre voies, le surplomb de la houle raide, et la ville au dos tourné. Et dans cette frange où nous marchions, voilà que nous enjambions les morts. Ou bien voilà que les morts, de chaque côté de nos pas, nous entouraient et nous aspiraient.
Ici, à droite, ils étaient dispersés dans l’herbe, et regardaient la mer. Mausolée ou pierre, et des hiérarchies ou regroupements nous n’avions pas la grammaire. De l’autre côté, à gauche, où la pente grimpait vers l’arrière étanche de la ville, ils se serraient à bien plus, les morts du temps présent.
Et c’était une longue bande en surplomb de la mer, la mer donnée à la réflexion des morts, la mer offerte à la solitude des morts, et son horizon pour penser à ce que la mort aussi contient de sans limite.
Nous marchions : était-ce encore aller vers la mer, si pour cela il fallait ainsi radicalement quitter la ville, l’ignorer, et son vacarme et ses chants, et la géographie infiniment compliquée de son histoire en ses murs ? Nous ne marchions plus que parmi les morts qui sont hors de la ville, les morts que la ville avait éloignés d’elle, tout en leur offrant sa mer inutile.
La quatre voies de ciment et de bitume, c’est donc aussi sur le tapis des morts qu’on l’avait posée ?
Nous marchions. Nous étions devant la mer, et sa houle raide et violente, sur les dais de basalte, sous le phare, avec dans les anfractuosités les amoureux qui eux aussi n’étaient que des dos, dos enserrés, dos immobiles, face à la mer et qui probablement cherchaient plutôt en eux-mêmes le nouvel horizon.
La ville ne donnait pas de réponse, ni quant à la mer, ni quant à ses morts. Les morts la connaissaient, eux, probablement, la réponse. Mais elle était dans l’horizon même, et leur immobilité et leur silence de tous, devant la houle infiniment refaite, et ils ne la donnaient pas – du moins à qui passait, passait seulement.


François Bon
Et d’autres vases communicants ce mois, merci Brigitte Célérier :![]() Eve de Laudec et Michel Brosseau
Eve de Laudec et Michel Brosseau![]() Poivert et Pierre Ménard
Poivert et Pierre Ménard![]() Corinne Le Lepvrier et Lou Raoul
Corinne Le Lepvrier et Lou Raoul![]() Anne Charlotte Chéron et Amélie Charcosset
Anne Charlotte Chéron et Amélie Charcosset![]() Danielle Masson et Wana Toctouillou
Danielle Masson et Wana Toctouillou![]() Éric Dubois et Chris Simon
Éric Dubois et Chris Simon![]() Chez Jeanne et Franck Queyraud
Chez Jeanne et Franck Queyraud![]() Dominique Hasselmann et François Bonneau
Dominique Hasselmann et François Bonneau![]() Zéo Zigzags et Visant dessinateur
Zéo Zigzags et Visant dessinateur![]() Louise Imagine et Ana NB
Louise Imagine et Ana NB![]() Anne Savelli et Sabine Huynh
Anne Savelli et Sabine Huynh![]() Mathilde Roux et Virginie Gautier
Mathilde Roux et Virginie Gautier![]() Christophe Grossi et Daniel Bourrion
Christophe Grossi et Daniel Bourrion![]() Camille Philibert-Rossignol et Christopher Sélac
Camille Philibert-Rossignol et Christopher Sélac![]() Anna Jouy et Giovanni Merloni
Anna Jouy et Giovanni Merloni![]() Danielle Carlès et Brigitte Célérier
Danielle Carlès et Brigitte Célérier![]() Hélène Verdier et Dominique Boudou
Hélène Verdier et Dominique Boudou![]() Claude Favre et Jean-Marc Undriener
Claude Favre et Jean-Marc Undriener![]() François Bon et Jean Prod'hom
François Bon et Jean Prod'hom
Il y a le vacarme des vagues

Il y a le vacarme des vagues
les chapeaux de feutre
les librairies de province
il y a les postes de police
l’ami loyal
l’abonnement général qui échoit
il y a l’étendue de ce que tu aimes
le territoire des bêtes
le vent lorsqu’il te prend par le bras
Jean Prod’hom
Tempête sociale

Sale printemps! De la pluie et du froid! Temps pourri!
Je te le confirme doux rêveur, il n’y aura ni printemps ni été, les mois de juillet, août et septembre auront la couleur de l'automne, les suivants auront celles de l'hiver. Et il en ira ainsi dans les années qui viennent, je le sais de source sûre. Car disons-le tout net, les prévisions des météorologues sont aujourd'hui des certitudes, les modèles utilisés pour prévoir le temps sont tout à fait fiables. Mais ce secret est le secret le mieux gardé au monde, rien ne filtre, les politiques invoquent la raison d’Etat, ils craignent les tempêtes sociales qu’engendrerait immanquablement une telle information auprès des masses, le peuple est plus imprévisible que le temps autrefois, trop imprévisible pour qu’on lui dise la vérité, rien n’a changé, l’ordre social avant tout!
Jean Prod’hom
Jean Villard Gilles et la question des origines

Nos ancêtres les Waldstätten
Nos pères qui j’imagine
encore au temps des Bernois
recherchant leur origine
dans le saladier vaudois
vous mélangeaient Burgondes
Latins Celtes et Savoyards
et ça fait beaucoup de monde
pouvaient se croire des bâtards
Nous les fils on est tranquilles
car depuis 150 ans
pas besoin de s’faire de bile
nous savons exactement
la chose est tout à fait claire
nous savons qui sont nos pères
Mais pour les chanter
il faut adopter leur manière en vérité
Ainsi que certains Noirs d’Afrique
pouvaient avec (?) un président-roi
de la cinquième république
dire (?) nos ancêtres les Gaulois
nous Vaudois de langue française
plutôt mous par tempérament
nous n’éprouvons aucun malaise
et le 1er août notamment
à célébrer d’un coeur sincère
avec ceux d’Schwytz et ceux d’Olten
Nicht wahr! Bolomey mon vieux frère
nos ancêtres les Waldstätten
Comme nous les Ticinese
nonchalants et langoureux
sont devenus par antithèse
de vrais Suisses aux bras noueux
et l’on se sent l’âme fière
en pensant que Guillaume Tell
et quelques rudes compères
sans le moindre colonel
avec en fait de mitraille
des troncs d’arbre et des rochers
ont réduit en cochonnaille
leurs baillis empanachés
On aurait voulu en être
de cette fête champêtre
et pour ça chanter
il faut adopter leur manière en vérité
ach Gott !
ach! c’est la manière forte
mais nous on peut pas se forcer
eux ils allaient pas de main morte
nous faudrait plutôt nous pousser
on n’aime pas tant les histoires
l’ordre établi même Bernois
même si c’est la mer à boire
on y tient par amour des lois
C’est pas nous faut le reconnaître
qui aurions fait à Morgarten
ce qu’ils ont fait contre leur maître
nos ancêtres les Waldstätten
Aujourd’hui la chose acquise
nous chantons la liberté
mais cependant quoi qu’on dise
quand un peuple révolté
par les abus prend les armes
nous sommes dans tous nos états
et prêts à verser des larmes
sur le sort de Batista.
et pourtant Castro Fidel
et nos rudes montagnards
c’était les mêmes rebelles
et les mêmes maquisards
ils ont dit « Nous serons libres. »
ils avaient ça dans la fibre
Mais pour les chanter
il faut emprunter
son air à la liberté
un air parfait pour nos chorales
et nos orateurs pleins d’onction
on chante avec un accent mâle
au milieu des interdictions
des défenses des formulaires
des contrôles des règlements
de la censure et des barrières
que diraient-ils en nous voyant
si soumis si repus si riches
ceux qui un jour à Morgarten
on dit merde à l’empereur l’Autriche
nos ancêtres les Waldstätten
Jean Villard
CXXIII

Ne rien attendre des eaux dormantes, certaines ne se réveillent pas.
Tout se verrouille parfois, même ce à quoi nous n'avons pas songé.
Il avait le cerveau d’un caterpillar, avec une fleur à la boutonnière pour donner le change.
Jean Prod’hom
Ombilics

La naissance est aussi inconcevable que la mort. C’est par l’ombilic que les mères nourrissent leurs enfants, c’est par la route du cimetière que la communauté nourrit ses ancêtres. La route du cimetière est un ombilic inversé. Je ne me souviens pas de quand je suis né, et toi t’en souviens-tu ? On naît comme on meurt, il faut du temps et personne ne s’en souvient. Pour naître il faut un cordon, pour mourir aussi. A gauche et à droite de nos vies l’inconcevable dont les vivants et les morts nous protègent.
Jean Prod’hom
L'Europe demain

Tandis que Lili suit son cours de piano, la librairie du Midi accueille Fabrice Colin et Ta mort sera la mienne, les cyclistes du Tour de Romandie longent la Broye, deux collégiens boivent bière sur bière dans le parc de l’église, un homme ivre invective les clientes d’un tea-room, deux policiers patrouillent. Je reconnais alors très distinctement dans le fond du bassin vide de la Place de Foire à Oron une image de l’Europe vue du ciel : on distingue les terres, les mers, les vignes et la glace, l’Esèagne, des ombres, de la lumière, des îles et des détroits, la Mer Noire, Gibraltar, la Sardaigne et le Danemark. Mais quelque chose a rongé l’enduit qui avait fait tenir jusque-là les choses ensemble. Personne.
Jean Prod’hom
Un peu de jeu à leurs jours

Les taupes s'activent près du compost, petits monticules de terre dans l'herbe grasse, quelques primevères, des jonquilles, un forsythia. On a rétabli l'eau, deux arrosoirs jaunes dressent leur nez dans l'angle d'un bassin, on en oublierait les morts. Mais pas d'au-delà au cimetière, des sentinelles veillent, pierres dressées indiquant un improbable accès : corps invisibles, corps morts dans la terre.
On entend des cris, corps éclatés et vivants sous les paupières des yeux des enfants, parties subtiles qui ne cessent de se répandre aux alentours du village, redonnant un peu de jeu à leurs jours et à leurs nuits.
Jean Prod’hom
Longue liste des merveilles

Me voici la tête dans le pare-brise, passant à côté de ces premiers jours de printemps qui n'attendront pas, je cours sur la route de Berne en file indienne.

Au Riau les beaux jours ont installé leurs quartiers dans les vergers, les brins des prés gonflés d'eau battent l'aile. Je regarde par la fenêtre de la salle des maîtres, les bouleaux jettent par poignées des pièces d'argent dans le ciel, les filles et les prunelliers découvrent leurs bras blancs, les bois des cerisiers rosissent. Une bergeronnette fait ses ablutions dans une gouille, un rouge-queue des génuflexions. Me revient un air de Tarente sur le chantier d'à côté, un pic sur une boîte à rythme, deux pies au balcon, et tout autour la longue liste des merveilles.
Faudrait-il être poupon, idiot ou des bois pour goûter sans laisse à ces parfums ? Ou doit-on remercier Dieu de pouvoir les nommer ?
Il est 18 heures, je laisse les filles à leur maison établie tout près du ciel, ce qu'il me plaisait d'imaginer ce matin est là, le bois Vuacoz m'offre un peu de ce quelque chose à côté de quoi j'ai bien failli passer.

Jean Prod’hom
90

Le doute avance comme un mille pattes, les certitudes au pas d’amble.
Inquiet lorsque son ombre s’attache à ses basques, criminel lorsqu’il l’autorise à prendre les devants.
Aller au hasard la chance pour donner une chance à ce qui déborde la raison.
Jean Prod’hom
Seul dans l’ignorance de ce qu'il en retourne

De retour ce matin dans les bois, avec dans la tête quelques éléments d’un texte que François Bon devrait accueillir la semaine prochaine dans le cadre des vases communicants. Me rends compte que la difficulté éprouvée à me lancer dans cette aventure – les morts, leurs places – est liée tout autant à l’expression qu’elle suscite qu’à l’apaisement auquel je voudrais être conduit. Et je balance, incapable de donner à la fois une voix à ce tourment et le faire taire. Comme s’il fallait choisir l'une où l'autre
On ne mène pas cette double opération simultanément. Pourtant, c'est lorsque l'expression s’ouvre à ce qui l’entrave, sans vouloir maîtriser les allées et venues de cette chicane, sans vouloir même la nommer autrement que dans le blanc d’une invisible fosse, que l'apaisement survient un bref instant. Impossible cependant de réouvrir l'huître, il faut recommencer ailleurs, en partant parfois de très loin et renoncer à tirer par un bout le fil d’une pelote qui n’existe pas hors de nos rêves.
Je devine l’issue, un ensemble de fragments charriant le même tourment muet que n'apaisera à la fin que l’inachèvement de son expression.
Décider l’ordre des fragments en obéissant à la chronologie de leur rédaction ou a une supposée logique du contenu, laisser la nuit les ensevelir ou forcer le secret d’une cohésion appelée de mes voeux, creuser des blancs, c’est ce que j’aurai à décider.
C’est au bois Vuacoz que je pense à tout cela, dans un lit d’épines humides. Repousse le moment de rentrer, je crains que tout cela n'intéresse au fond personne, j’ai si souvent l’impression qu’on m’a laissé seul dans l’ignorance de ce qu'il en retourne de nos vies et de nos morts, ou tout au moins de ce qu’il faut en penser.
Le soleil est là, me débarrasse des épines, me souviens alors d'avoir avoué à une paire de philosophes qui débattaient de l’être en tant qu’être comme d’une affaire entendue que j’étais bien loin de saisir le sens de cet énoncé et l’importance qu’on lui prêtait. Les deux sages m’avaient souri en me disant à demi-mots qu'il était parfois plus honorable de se taire et de ne pas revenir sur ce qui était entendu. Je me souviens, c’était l’été 1981, en face de la Nouvelle-Académie, un soir des Fêtes à Lausanne. L’un est mort, dit-on, en croquant de la ciguë, l’autre, spinoziste, a disparu.
Jean Prod’hom
Il y a les chemises blanches à courtes manches

Il y a les chemises blanches à courtes manches
les pages de Drillon sur la virgule
la double-crème
il y a les jardins ouvriers
les poules d’eau
les nobles artifices
il y les filets de sole
l’odeur du formol
il y a ce week-end à Charleroi
Jean Prod’hom
89

Bouchon à la sortie d’Epalinges, je rumine de n’être pas resté sur la file de gauche, m’agite, jure et sacre jusqu’au moment où je prends conscience que les voitures qui me précèdent sont en zone bleue.
- Dis papa ! Quels sont les animaux les plus propres ?
- Les poissons évidemment !
- Tas déjà vu des poissons qui se lèchent ?
Il convient parfois de laisser reposer son âme sur la grille d’un barbecue, en compagnie d’un cervelas.
Jean Prod’hom
Avanie et framboise
![]()
N’en fait qu’à sa tête et s’entête.
Décide de prendre les choses en main![]()




![]()

![]()




![]()

![]()


![]()

![]()

![]()

Jean Prod’hom
Les morts hors des villages

Dans son Arrêté du 16 janvier 1812, le Petit Conseil du Canton de Vaud met à exécution les dispositions de la Loi sur la police de santé des hommes décrétée le 1 juin 1810 par le Grand Conseil. Cette loi de 1810 et l’arrêté de 1812 sont à l’origine du remodelage du paysage des communes vaudoises.
1. Aucun cimetière ne peut être établi dans l’enceinte d’une Ville ou d’un Village.

Poliez-le-Grand
La Loi avertit les communes qui contreviendrait à cet article que Le Petit Conseil est autorisé faire canceler les cimetières qui seraient trop rapprochés des habitations.
Dès 1812, les communes vont donc entreprendre de gros travaux pour déplacer l’espace consacré à l’inhumation de leurs morts et ménager des chemins d’accès s’il n’en existait pas. Dans l’article 6, le Petit Conseil oblige chaque commune, dès le mois de juin, de se conformer à une disposition qui dessinera l’allure de ces espaces destinés à leurs morts.
6. Les Cimetières seront tenus clos et fermés.
L’intention est claire, il convient de ne plus mêler les vivants et les morts comme on le faisait jusque-là, de bien distinguer les différentes fonctions des espaces. A chacun d’eux un usage.
Parce que les autorités ont conscience qu’il ne suffit pas de décréter le déplacement des cimetières hors des village – la tâche ne saurait se faire en un clin d’oeil – l’article 9 stipule qu’on cessera au moins d’utiliser l’espace autour des églises pour des activités qui étaient, semble-t-il, habituelles.
9. Les Municipalités veilleront à ce qu’on ne fasse pas pâturer du bétail sur les Cimetières, qu’on n’y établisse pas des étendages, des chantiers, des entrepôts, en un mot, à ce qu’ils ne servent pas à d’autres usages qu’à enterrer les Morts ; toutefois il sera permis d’en faucher l’herbe.
Dès 1812, la campagne vaudoise va prendre l'allure qu'elle a aujourd'hui. Certains cimetières vont cependant être avalés au XXème siècle par la réaffectation des zones agricoles en zones constructibles, sans que les autorité mettent leur menace à exécution et fassent canceler les cimetières.

Thierrens
Qu’en sera-t-il dans les années qui viennent ? Nul ne le sait. Je sais que le cimetière de Rossenges, situé loin de l’enceinte du village en 2009, a disparu du paysage. Le terrain a été désaffecté et rendu aux agriculteurs. C’est en voiture que les vivants de Rossenges vont à Moudon y enterrer leurs morts ou déposer les urnes contenant leurs cendres.
Jean Prod’hom
Rematérialisation des textes et des morts

Urne funéraire
Urne livre-noyer-decor-floral
295 x 200 x 85
299 euros
J’ai commencé par les livres. je finirai par eux. Pensons au problème que pose actuellement la numérisation électronique des livres dans les bibliothèques. Cette opération technique ne fait rien moins que dématérialiser les livres, convertissant leurs feuilles et leurs textes en une réalité, certes lumineuse (puisqu’elle s’affiche sur des tubes cathodiques), mais fragile et impalpable. Le livre, dont le texte a été numérisé, réduit et transportable comme le mort crématisé et informatisé, est un livre qui a perdu son « corps » : sa forme et sa matière. Dès lors, télématiquement transmissible, il devient une archive vagabonde, partout et nulle part à la fois, disséminée, partageable et sans lieu propre – une abstraction, comme les cendres nomades du défunt incinéré.
Il est fort intéressant de constater qu’un éminent collaborateur de la Très Grande Bibliothèque, Roger Chartier, a exprimé l’opinion suivante, à savoir que s’il faut admettre comme nécessaire la dématérialisation électronique des textes, il n’en faut pas moins envisager, à l’aide de substituts qui restent à inventer, de compenser les effets de cette opération par des procédures de rematérialisation afin, précisa-t-il, de préserver chez le lecteur la sensation du contact, la mémoire de la forme et la perception d’une présence, celle du livre en l’occurrence.
De même à propos de l’incinération, d’une archive à l’autre, si l’on doit bien admettre la dimension dématérialisante de ce « procédé de l’avenir par excellence », son utilité et même sa nécessité en contexte urbanisé, à très forte densité de population, ne faut-il pas cependant, dans une optique analogue, promouvoir également des procédures symétriques de rematérialisation pour les morts crématisés ? Question de trace. Question de place et de signe ultime à dresser entre le néant et l’illusion, pour la présence sociale des morts et contre l’absence nue, contre l’obsédante immatérialité du fantôme ou la béance sans nom ni lieu qu’une urne vide sur un piano, il faut bien en convenir maintenant, n’est pas à même de combler.
Aussi le Petit Poucet, s’aventurant dans la forêt pour retrouver sa route, se mit-il à semer des petits cailloux tout au long du chemin – afin de se souvenir…
Jean-Didier Urbain
L’Archipel des morts, Cimetières et mémoire en Occident,
Petite Bibliothèque Payot, 2005 (1ère édition - 1989)
Postface 335-336

Le Riau de Corcelles

Le Riau de Corcelles, retenu ici par un affleurement de molasse, là par les restes d'un bloc erratique ou d’un amas de bois morts, culbute et tourbillonne au détour des gorges liliputes qu’il s’est ménagées dans la tourbe.
On peut, si l'on s’étend sur l’une de ses rives au printemps et qu’on ferme les yeux, écouter simultanément trois ou quatre de ces délicats incidents sonores qui ponctuent le cours des ruisseaux à leur naissance, ronds et souples comme des pelotes de laine, mais de profil si différent qu’on se met immanquablement à identifier les secrets d’un autre monde : le petit lait tout à côté contre lequel vient buter en amont le roulement d'argent de billes bien graissées. En aval des bouches de tuba qui dégringolent, plus loin une caverne qui se gargarise.

C’est d'être deux dans son lit et hors de lui que le Riau de Corcelles est un, ce sont ces motifs sonores bien distincts les uns des autres qui attestent d’un second ruisseau par-dessus le premier.
L’un est sombre, obstiné, bitumeux, c’est lui qui porte sur sur son dos le second qui s’agite, jette des éclats, rit, babille sans qu’on puisse, si l’on cède à l’appel et entrouvre un oeil, localiser précisément le lieu de ses vocalises. C’est dans ces chutes infimes que le ruisseau du dessus cascade et s’allège battu comme un blanc d’oeuf.
Jeune encore, il n’hésite pas à se mouiller les mains, puis il reprend son souffle une dernière fois, se gargarise d’aise avant de plonger la tête la première, de mêler ses eaux à celui du dessous, ne faire à deux plus qu’un à l’entrée de la plaine limée par la Broye qui file les mains moites jusqu'à la mer.
Tandis que tu tends l'oreille pour en savoir plus, les hôtes que tu avais oubliés reviennent occuper leur place, le merle et son chant, le bruit des feuilles qu’il remue, les cris du geai et de la corneille, le bourdon de l’avion et l’abeille, les bruits liquides, la litanie des « l » et des « r ».
Si tu t’éloignes de quelques pas sans les mêler aux feuilles mortes, tu te rends compte soudain que le Riau de Corcelles fait entendre tous les chants du monde, il suffit de se déplacer d’un pas pour que le petit lait se fasse crème. Le roulement à billes se fait pâte pétrie et les bouches de tuba toux grasse.
Le ruisseau aurait pu se vanter de son répertoire infini mais le diable est discret. Si tu lui dis qu'il partage le monde en deux comme le Rhône et le Rhin, il te rit au nez, il a d’autres choses à faire.
Jean Prod’hom
La pince se desserre

Les enfants sont à l’école, Sandra au Mont, c’est mardi et il fait soleil au Riau. Je laisse en arrière tout ce qui est susceptible de se transformer en remords et envoie à trois jets de pierre les urgences. Je fais un pas, puis deux, trois, ça suffit pour que la pince se desserre.

Vingt-deux degrés, je me réjouissais de cet instant, retrouver le bois Vuacoz où j’ai vécu tant de belles heures l’année passée, choisir une souche et m’y adosser, avec le chien qui vaque à ses affaires et ce bonheur enfantin d’être dehors et d’y rester.
Eux aussi sont au rendez-vous, mais ils sont à l’air libre depuis samedi à l’aube. Je n’ai besoin de rien sinon de mes mains nues pour disposer d’un peu de place au milieu de leurs chants. Je ne les vois pas mais leurs sifflements montent à la verticale avant de retomber comme des feux d’artifice, ils semblent se comprendre, je ne comprends pas, c’est réconfortant.
Un peu de lecture, de la bruyère, un tapis de mousse et des bouquets de prêles avant que mon corps se défasse, se fragmente, menus atomes qui se dispersent comme des grains de poussière dans un rais de lumière, mon visage tient tout seul près du feu de la forge. Tout se juxtapose mais les choses ont les coudées franches, celles qui portent un nom et celles qui restent muettes, si bien que le verbe se lève : il ôte ses gants et se fait brise.
Jean Prod’hom
CXXII

Parce qu’il n’avait rien compris à l’idée de vacuité, Jean-Rémy rentra du séminaire les mains vides mais illuminé, avec le sentiment d’être en accord avec lui-même.
- ... ne saurait donc exister dans le monde de cause sans effet, ni d’effet sans cause.
Et le sage se tut. J’étais à deux pas de penser que la cause et l'effet étaient une seule et même chose. Heureusement je m’arrêtai à temps.
- Existe-il une réponse définitive à une question qui ne se pose pas ?
- Oui !
- Laquelle ?
- Non !
Jean Prod’hom
Une petite Triumph décapotable

Le printemps est entré ce matin par la fenêtre du fond d’un couloir sombre d’un tea-room de la Gruyère.
J’ai essayé de rattraper sur l’autoroute, pour mieux la voir, une petite Triumph décapotable, mais j’ai dû renoncer par manque d’essence. J’ai écouté la voix de Monsieur Jardinier en faisant le plein, il parlait de primevères et de pensées, de tomates et de pois. Même l'aire du Muguet souriait.
Le Daïla-Lama a abordé ce matin trois questions : Qui suis-je ? Ai-je un début ? Ai-je une fin ? La réponse à la première question entame fortement la notion d'un sujet substantiel, indépendant, patron de la conscience. Les réponses aux deuxième et troisième dépendent de la réponse à la première, elles m'ont rappelé celles que donnaient Epicure et Lucrèce.
Tout au long de la journée, les gens marchaient comme des vieux, voûtés, aussi bien sur la scène où étaient installés le Daïla-Lama, ses disciples et ses assistants que les anonymes qui allaient et venaient dans les travées. J'ai compris que tous ces gens ne se faisaient pas petits exactement pour les mêmes raisons, quoique... Les anonymes pour ne pas déranger les spectateurs qui regardaient les écrans géants, les seconds par égard pour le maître.
J’ai cru soudain que le Daïla-Lama salivait, j’ai eu mal pour lui. Mais ce n'était que le micro-miniature qui pendait à la commissure gauche de ses lèvres. J’ai eu mal pour moi.
À la question d'un jeune homme qui ressemblait à Tom Cruise et qui lui demandait ce qu’il pensait des mouvements New Age, le Daïla-Lama a répondu qu'il n'aimait pas trop ces pensées qui picoraient à tous les stands.
Le Daïla-Lama était installé au sommet d'un échafaudage molletonné aux couleurs de fête foraine, il m'a donné l’impression d'un homme qui se prépare à jouer avec sérieux une partie qu'il aurait à arbitrer, mais qui doit préciser au préalable les règles, indéfiniment. Et soudain la partie est terminée et t’as rien vu passer !
Le maître et son interprète, Martin Ricard, ont joué une autre partie, une belle partie au cours de laquelle à la fois ils serraient et desserraient les choses. J’ai reçu la réponse aujourd’hui à une question qui ne m’a pas quitté hier. Martin Ricard prend des notes dans la langue du maître, qu'il interprète dans sa propre langue lorsqu’il en reçoit l’ordre.
Tandis que Sa Sainteté rejoignait la communauté tibétaine de Suisse, je suis allé me balader au milieu des stands de ce petit Disneyland, puis je suis remonté près de la patinoire où j’avais parqué ma voiture. C'est le triomphe du printemps sur l’autoroute et au Riau. Je croise la décapotable bleue aperçue ce matin, au Riau Sandra a installé le parasol.
Jean Prod’hom
Avec le Daïla-Lama

Rendez-vous ce matin à Granges-Paccot avec le Daïla-Lama, au nord de Fribourg, à deux pas de la patinoire, à trois du terrain de foot, à quatre du cimetière. Les commerces avaient annoncé la couleur et donné le ton : le Maxi Bazar, La Grande Récré, Keria Luminaires-Monde de Lumière, Orchestra,…
Ça s’appelle le Forum, une salle immense dans laquelle sont organisées toutes sortes de manifestations. Tenez, le forum accueillera bientôt Le Salon romand de l’habitation durable et de l’efficacité énergétique, puis la Foire de Fribourg. Les Témoins de Jéhova sont de bons clients, ils viendront à quatre reprises à Granges-Paccot d’ici 2014.
Nous étions plusieurs milliers aujourd’hui, j’y ai rencontré une étudiante en droit venue de Belgique, un herboriste neuchâtelois, un boulanger qui habite Matran, un chauffeur de bus, une coiffeuse de Bulle. J’ai même discuté avec un le propriétaire d'une villa cossue de Cousset. Il y a évidemment aussi des bouddhistes, des vrais, on les reconnaît à leur habillement moutarde et bordeaux, il ressemble étrangement, lorsqu’on y songe, au costume du groupe folklorique de "La Villanelle" Montagny-Cousset, mais eux n’ont pas le crâne rasé.
Je crois qu’on l’aime bien le Daïla-Lama dans notre région, l’étudiante belge le trouve gentil, l’herboriste me confie que cet homme lui apporte un sentiment d'universalité, il ne fait pas de chichi, m’a dit la coiffeuse de Bulle, et puis il ne crache sur personne, a jouté le boulanger pour plaisanter.
Bon, le premier contact avec l’équipe de Sa Sainteté n’a pas été comme je l’espérais. J’ai dû déposer mon appareil-photo à la consigne, j’ai lu sur une pancarte qu’il était interdit d’emmener dans la salle ni casque, ni bouteille, pas de parapluie, pas de sac à dos, pas de valise, pas de couteau pas de pousse-pousse ; par chance je n’avais emporté aucun de ces objets. J’ai eu droit à une fouille superficielle, mais une fouille quand même, je n’aime pas ça.
Puis il est apparu, tout le monde s’est levé et a applaudi, il est comme à la télé. Le Daïla-Lama on le reconnaît facilement, c’est le seul à avoir sur la tête une casquette dont il a découpé le sommet, c’est lui aussi qui décide de tout, qui décide quand le traducteur doit traduire et quand il doit se taire. Le Daïla-Lama n’est pas si commode que ça, il a pourtant de prime abord l’allure d’un de ces idiots qui ne se rendent pas tout à fait compte d’où ils se trouvent, qui semblent ignorer qu’il y a du monde autour d’eux, qui rient même lorsque leurs interlocuteurs ne comprennent pas pourquoi ils rient. C’est ça je crois qu’on apprécie chez le bonhomme : lorsque le traducteur traduit ce qu’il vient de dire, il ne l’écoute pas, il fait le clown, semble ne pas s’en préoccuper, il regarde les gens des premiers rangs, leur fait des sourires, des grimaces, des clins-d’oeil. Une belle autorité. J’ai vu tout ça sur l’écran géant mis à la disposition des spectateurs un peu éloignés de la scène. Pour le reste je ne sais pas, je connais pas.

À midi j’ai mangé à la COOP, c’était une toute autre ambiance, j’y ai retrouvé des gens qui étaient dans mon secteur, le C1. Ils ont fait mine de ne pas me reconnaître, j’ai fait la même chose.
Suis sorti finalement à 16 heures 30 du Forum, lorsque le Daïla-lama a remis et lacé ses chaussures pour nous signaler que c’était terminé.
Me suis arrêté en rentrant dans l’abbaye cistercienne d’Hauterive, obéissant ainsi à une invitation de Sa Sainteté.
- Allez voir d’où vous venez et faites un peu de lumière sur le christianisme. Laissez au peuple tibétain le bouddhisme.
On faisait sonner les cloches pour les vêpres, je suis arrivé avec le soleil, trois bons quarts d'heure de chants et de louanges, en latin et en français, deux langues en définitive aussi difficiles que le tibétain et le sanscrit.
Jean Prod’hom
Glaise

Glaise
terre-glaire lise
dépouilles et détrempe
les chemins ont tourné au gris-abandon
patte molle qui fait cuirasse de fonte
insaisissable par ce temps de poisson
rien dans ce ramassis de feuilles rances
rien à débarder pas d’écailles
terre noire
menteuse et visqueuse
sort de son lit
encombre les flaques
se mêle au sable
colle
et puis gobe le ciel
Jean Prod’hom
88

Tout autour de la ville des propriétés privées, à perte de vue, des propriétés privées de tout.
Il n’est pas raisonnable de vouloir conduire l’enfant du je dois au je veux dans une école obligatoire.
- Dis maman ! tu trouves pas que le riz tout seul c’est meilleur avec quelque chose ?
Jean Prod’hom
Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo

Je dédie ces mots à la vierge Marie mon coeur je m’envole et m’approche amoureux comme un enfant je rêve à tes bras offre-moi quelque chose fais-moi oublier la méchanceté la malveillance la guerre donne-moi un peu de paix un peu d’amour je n’en puis plus éclaire cette confusion et le monde désert je te le demande entoure mon coeur mon âme mon souffle mon amour protège-moi comme une mère protège son enfant je t’en prie laisse-moi dormir.
Salvatore Prudele (Saint-Valentin | 14 février 2012)

Il s’appelle Marco Prudele et habite le rez du Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo. J’ai passé devant chez lui samedi passé, la nuit était tombée, la porte de sa loggia était grand ouverte, un poste de télévision distillait une émission de variétés de l’autre côté de la ruelle déserte.
Je guigne, Marco m’invite à entrer dans l’antre de son frère. Son frère c’est Salvatore, il dort, fatigué, très fatigué. Il a subi une opération du coeur en 2012. Un brave gamin qui se trouvait sur l’Achille Lauro lorsque celui-ci a été détourné en 1985. Il a fait un peu le maçon en Autriche, en Allemagne, au nord de l’Italie. Mais il n’a rien redémarré de sérieux, c’est aujourd’hui un pensoniato, alors sans rien dire à personne il a transformé sa maison en vaisseau fantôme, lumineux, il a collé sur les murs de sa chambre et de son plafond ce qu’il a trouvé dans la ville, les textes qu’il a rédigés. Salvatore a neuf frères et soeurs, mais c’est lui, Marco, qui s’occupe du cadet et de cette mère qu’ils aiment tant.
Autrefois c’était l’héroïne et la camorra, plusieurs morts chaque jour. Aujourd’hui c’est les incivilités des enfants. On était des scugnizzi, les choses ont bien changé. Pas Salvatore, il est resté le même, il aime toujours autant sa mère et illumine sa chambre de bouts de chandelles et de tickets de métro, de saintes et de publicités, de cartes de loto et de colliers. Salvatore n’a pas changé depuis le temps, il laisse sa porte ouverte du printemps à la fin de l’automne.
Tu sais, me dit Marco, ici on n’est rien, on est grec et espagnol, c’est nous qui avons fait Naples, je la connais, je te la ferai voir demain. On montera au Vomero.
Marco a les yeux brillants des possédés, il piaffe, respire et pleure. On s’est donné rendez-vous l’année prochaine. Marco me montre encore de l’autre côté de la rue les portraits de ses parents, de cette mère que lui et son frère aiment tant, elle est à l’image d’une sainte, d’une ville. Je ne verrai pas ce soir Salvatore, il n’a pas bronché sous son édredon, il fait le mort. 


Jean Prod’hom
Assomption

Parmi tant d’autres choses je ramène de Naples un peu de son soleil, le souvenir d’une vitalité sans borne, le goût d’une ferveur, la gentilezza.
Et puis une définition du miracle qui serait, selon ce père jésuite bien peu orthodoxe rencontré via Sapienza, le produit de l’ordinaire et de la bricole, dont nous pouvons, me dit-il, reconnaître les traces miraculeuses à chacun de nos pas. Je comprends mieux les mots du saint homme lorsque j’aperçois Piazza Gaetano, peu après que nous nous soyons quittés, une Assomption qui m’était évidemment destinée.
Jean Prod’hom
Lundi à Naples

Le solde des âmes pezzentelle – abritées dans de tendres petites têtes d’os (capuzelle) – dont un décret a interdit le culte en 1969 ont été déplacées de l’église inférieure de Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco dans le cimetière de la Fontanelle. Je paie 4 euros pour en obtenir une confirmation. On n’en devine en effet plus que quelques-unes dans de rares niches, abandonnées là pour les curieux et quelques fidèles. La gardienne culturelle du temple me confirme qu’elles sont devenues rares les âmes charitables qui descendent dans l'hypogée austère pour abréger le temps de purgatoire de celles et ceux qui pourraient intercéder en leur faveur sitôt arrivés au ciel. J’apprends que, pour ne pas avoir à payer 4 euros à chacune de leur descente au purgatoire, les dernières adeptes de ce culte des âmes pezzentelle reçoivent une carte qui atteste de leur fidélité.

Passe à nouveau dans l'atelier de restauration de l’impasse débouchant sur la Via San Gregorio Armeno. Ils sont trois ce matin, les deux frères – Rosario et Antonio Ebreo – et un collaborateur.
Le San Stefano de Salerne a bien avancé, quant au collaborateur, il replâtre la Santa Marguerita d’une petite église du Lazio, ils se sont mis à l’ouvrage avec le jour. C’est ainsi depuis trois générations, ils m’informent que c’est dans cet atelier que l’autel de la Certosa di San Martino a été restauré. Ils sont confiants malgré leur santé précaire, ils travaillent tous les jours et leurs enfants reprendront l'affaire.





On mange tout près de la place San Gaetano, mal très mal. On boit un café avec du soleil sur la place San Lorenzo, c’est mieux bien mieux, on aimerait même que les choses durent ainsi.
Sandra et les enfants repartent faire un dernier tour dans les boutiques pendant que je fais un saut à la chapelle Sansevero, on est nombreux à nous demander ce qu'il y a sous le linceul de marbre du gisant que Giuseppe Sammartino a sculpté au milieu du XVIIIème siècle. Difficile de croire à de la pierre. Un corps vivant ? mort ? Ne rien toucher, pierre molle pierre liquide, le vivant serait-il mortel pour la pierre ? Une pancarte m’en avertit, le monde va décidément à l’envers, je suis tout retourné :
Si prega non toccate. Gli umori corrodono il marmo.
Jean Prod’hom
Dimanche à Naples

Le Musée archéologique national de Naples est un palais immense, tout y est grand, plus grand qu’à l’ordinaire : le bâtiment, les salles, les plafonds, la lumière, les sculptures,… Les fenêtres sont encore fermées, les gardiens sommeillent ou font des mots fléchés, ils valent autant que les sculptures de la collection Farnese ou celles qui on été extraites d’Herculanum. Alignées dans de longues salles, elles ont, comme eux, la mandorle à l’intérieur du crâne, chacune livrée à sa solitude.





Les fresques du premier siècle au second étage donnent le vertige. M'arrête devant ce qui devrait ne pas avoir changé depuis 79 : un ibis et un martin-pêcheur. Mais tout s’en va, se dérobe. Je me sens aussi éloigné des Romains que des Japonais.





Le funiculaire du centre nous emmène au Vomero, celui de la Chiaia nous ramène en bord de mer sur la via Fancesco Caracciolo. Des grappes de Napolitains et de Napolitaines se promènent, ils ont mis leurs habits du dimanche, leurs enfants sont couverts de jouets à quatre sous, c’est l’or de Naples, autrefois en noir et blanc, aujourd'hui en couleurs.
Une procession conduite par des gamins remonte la via Pizzofalcone avec la Madonna d’Arco dans leurs bras, une vieille pleure, rien n'a vraiment changé. La nuit tombe bientôt sur la baie de Naples, le Vésuve a disparu dans une des innombrables niches dont est parsemée la nuit, le Vésuve a la tête retournée, allongée contre le flanc, il est comme une grosse bête rassasiée. Ça bouronne au fond de la ville, de la périphérie au centre et le feu remonte dans toute la ville, seule la fente noire de Spaccanapoli reste dans la nuit.
Jean Prod’hom
Samedi à Naples

Deux ou trois heures en famille dans le Circumvesuviana au travers de zones sinistrées, de la gare centrale jusqu’à Pompéi, de Pompéi jusqu’à Méta di Sorrente et de Méta di Sorrente jusqu’à la gare centrale. Plus le temps continuera et moins Pompeï ne bougera pas, je sais pas mieux dire.

Seule chose d’époque à Pompéi, les chiens.
Sors de chez Ménandre, hésite à faire un saut au lupanar, remonte la via stabiana jusqu’aux thermes à la façon d'un vieux sénateur romain. A ma grande stupéfaction personne ne se retourne sur mon passage. C’est évident, dans de tels lieux on préfère les morts aux vivants.
Arthur a une vision pessimiste de l’histoire, il s’étonne en effet qu’il y eut déjà des bordels en 79 après Jésus-Christ, il conjecturait que les hommes étaient autrefois moins frustrés qu’aujourd’hui. Je pensais exactement l’inverse à son âge. O tempora o mores.
- Dis papa, quand le Vésuve a recouvert la ville, tu étais né?
Louise considère avec circonspection le plan des ruines de Pompéi, elle craint que la buvette ne soit elle aussi d'époque.

Sable de cendre, les mères ont lâché leurs petits, les glycines sont en fleurs, je joue avec une quinzaine de tessons ramassés près du port.





Jean Prod’hom
Vendredi à Naples

Ce matin encore entre Piazza Dante et Montesanto, les fripiers et les vendeurs de mozzarella côtoient les maraîchers et les tripiers, dans le même ordre que la veille, c’est à nouveau la vie avec tout son bric-à-brac, un jour encore dans les ruelles, vico, vicolo et vicoli, la nuit n’y peut rien. Arthur, Louise et Lili font des photos de tout et de rien, on traîne, on s’égare et c’est bon.
Mais c’est le métro qu’il nous faut prendre pour rejoindre la Solfatare, je demande un peu d’aide à un Napolitain qui nous accompagne jusqu’à la station la plus proche, avec le sourire, je lui souris, il ne me demande rien.
On se fait tout petits dans l’une des cages de fer de la ligne 2 dont les bruits et les tremblements nous font croire à un décollage imminent, ou à une explosion, rien de cela, on traverse les Campi Flegrei occupés par des locatifs comme on en voit dans les banlieues des grandes villes italiennes, châteaux de cartes décrépits qui ont poussé comme de gros chardons dans des pâturages gagnés par la mauvaise herbe. A quoi bon ? Ici la terre menace, tout le monde se souvient de 1980 et ne pense pas trop à l’avenir. On descend de l’avion à Pozzuoli, à un ou deux kilomètres du volcan de la Solfatare, une navette nous y conduit, j'avais imaginé le cratère plus près du niveau de la mer.
La Solfatare ressemble moins aux enfers que du temps du Voyage en Italie, il faut dire qu’aujourd’hui le ciel est bleu et des barrières interdisent d’aller où on veut. Le guide qui emmenait le personnage d’Ingrid Bergman dans le film de Rossellini est toujours là, dans ses habits gris et sales. Il fait voir à un petit groupe de touristes les secrets de la terre, un reste de mégot pend à sa lèvre inférieure, il roule les r avec un petit rire de diable édenté, gloussements de castrat qui se mêlent à la vapeur brûlante, le souffre prend les poumons. Je crois apercevoir Ingrid Bergman s’éloigner, elle porte un long manteau, un de ces manteaux couleur sépia du temps du cinéma en noir et blanc. Louise et Lili n’ont rien vu, elles ramassent quelques pierres aux teintes blafardes en rêvant de cristaux et de colliers de perles.
On descend jusqu’au port de Pozzuoli avec devant nous un bout du Cap Misène, impossible d'aller jusqu'à Procida et d'en revenir avant le soir, on se rabat sur le front de mer qui ressemble à celui de Mani sulla città, mosaïque de sacs-poubelles, baignades interdites, horizon glauque, odeurs douteuses, plages jonchées des restes de la cuisine du monde, maisons abandonnées, immense catastrophe à laquelle les habitants de Campanie semblent se faire. Il est difficile d’imaginer à quoi ressembleront Pozzuoli, Portici et la baie de Naples dans une vingtaine d’années. Une mariée pose avec son mari sur une bite d'amarrage avec pour décor la coque d'un bateau pisseux, je ne comprends pas bien leur décision.
On emprunte pour le retour la Linea Cumana jusqu’à Montesanto, puis le funiculaire qui nous dépose au pied du château sant'Elmo. On jette un coup d'oeil sur une autre mosaïque, celle des toits plats et des terrasses en nous promettant qu'on reviendra. De larges escaliers de lave nous ramènent en six ou sept larges virages jusqu'à la station intermédiaire du funiculare centrale, deux femmes s'invectivent de maison à maison.
On parvient épuisés au pied de l'imposante cage d'escaliers de notre palais où logea autrefois Gioachino Rossini, de l'ascenseur aussi qui nous emmène au sixième étage pour dix centimes d'euro.
Jean Prod’hom







Jeudi à Naples

Six étages plus bas, au pied du Palazzo di Domenico Barbaja coiffé d’innombrables petites terrasses qu'on rejoint par d’étranges labyrinthes, on aperçoit la via Toledo et la station du funiculaire centrale qui dépose ses usagers à deux pas de la place Vanvitelli. La Certosa de San Martino se dresse tout en-haut parmi les antennes de télévision et les citronniers, le ciel est bleu.
On a traversé ce matin la verrière de la Galleria Umberto, j’ai bu un café au Gambrinus, longue marche ensuite sur le damier de lave noire des quartieri spagnoli dans lesquels dominent le bruit et la ferveur. C’est le grand tambour, on distingue un peu de stupeur dans les yeux des enfants qui sortent leur appareil de photos, tout mérite qu’on s’y attarde, on s’arrête, on repart, les scooters, les têtes qui dépassent des box au rez des vicoli, les autels nichés dans le tuf, les activités secrètes, les tags, les petits commerces, bouchers, tripiers, mais aussi les conciliabules, les cris, les enfants, les vieux. Le regard flotte et rejoint de lessive en lessive les rampes d’escaliers qui montent au flanc du Vomero.
On se balade en bras de chemise, le soleil a fait halte pour la premier fois cette années, nous dit-on, on prend du bon temps dans une trattoria du vico Teatro Nuovo.
Fin d’après-midi sur l’autre rive de la via Toledo, babioles, pâtes et débrouille, autant d'églises que de locatifs, vivantes, fermées ou recyclées en galerie d'art ou en salle de théâtre. Boutique obscure au fond d'une impasse, un vieil artisan passe en rouge la robe de san Stefano, ils sont deux, même blouse, même air de famille, le second assis regarde le premier qui travaille.
On trouve un banc public libre sur la Piazza San Gaetano, à l'angle de la Via dei Tribunali et de la Via San Gregorio Armeno. Le spectacle est partout, la vie plutôt, les gamins du quartier jouent au foot au pied de l’église de San Paolo Maggiore qui s’appuie sur deux anciennes colonnes du temple des Dioscures, à Naples c’est le mélange qui fait tenir les choses ensemble, la pauvreté proverbiale de la ville emprunte pourtant les habits de l'opulence, les gamins sont dodus. Ils se déplacent comme des pigeons autour des présentoirs dressés à la va-vite par les nouveaux arrivants. Les enfants sont des rois, quant aux miséreux ils inventent des solutions, finalement une paire de cannes suffit pour deux boîteux.
Il est 8 heures, la ville clignote, les bruits s’éloignent, les trattoria ouvrent leur porte, de temps en temps une sirène. Je descends à pied les six étages du Palazzo di Domenico Barbaja que je remonte bientôt avec deux pizzas de chez Mimi.
Jean Prod’hom




Pas de mur mitoyen entre la vie et la mort

Aclens | Google Earth, 2008 | élévation : 300 mètres
Pas de porte entre la vie et la mort, pas d'après, de seuil, pas de pas, pas de Styx, de mot, pas de mur mitoyen, rien pour dire cette relation, ou cette absence de relation, la vie n'étant peut-être que cet effort à repousser la mort qui survient et dont on ne sait rien, une incompatibilité qui conduit à un curieux montage. Ce montage la mort nous y oblige, écrit Patrick Baudry dans La Place des morts (1999), la mort n’envahira pas la terre promise aux vivants à la condition qu’ils lui ménagent une place dedans. Il s'agit de régler ce passage, ce détour par lequel la mort est reconnue et les morts repoussés à l’intérieur d’un fort dont ils ne sortiront pas, déterminant en contrepartie l'espace des vivants dont on peut voir d'en-haut très clairement les contours.
Jean Prod’hom
Une barbarie de seconde main

On peut l’espérer, nous aurons sous peu, presque complets sous nos yeux, le monde et ses parties. Restera à conclure cette immense entreprise ouverte par la raison, ne me souviens plus quand, ne me souviens plus où, dans un campement du Croissant fertile je crois. Régler les derniers détails, lisser le rugueux, poser une couche de syntilor. Domestiquer ce qui pourrait l'être encore, soigner nos dernières blessures, apaiser ceux qui s'agitent, liquider nos dettes, enterrer les médiateurs, faire taire les dernières colères : plus de cartes à jouer, plus d'air à respirer.
Je crains aujourd'hui que nous soyons revenus de médiation en médiation à l'immédiateté des bêtes et des fossiles dans un monde dédoublé et décalé. La corde sur laquelle on a tiré aveuglément nous étrangle et nous ramène pas à pas vers ce qu'on avait quitté, la barbarie, une barbarie nouvelle, lisse, une barbarie de seconde main.
Jean Prod’hom
Prés-de-Vidy

D'en haut, disons de 300, 400 ou 500 mètres, nos cimetières se laissent aisément reconnaitre : en périphérie des villes et des villages depuis le début du XIXème siècle si ceux-ci ne les ont pas engloutis, espaces clos, plan orthogonal, partitions multiples, désaffectations partielles, bosquets et chemins, hauts arbres à proximité, avec le ciel à portée de main. De plus près on aperçoit quelques couleurs, buissons ardents, roses artificielles, pensées, arrosoirs, tuyaux d'arrosage, un bassin et dans un coin un compost.
D’en-haut il arrive pourtant que même l’observateur le plus averti se méprenne et confonde les cimetières avec d’autres espaces aménagés par l’homme. Certains d’entre eux tout particulièrement peuvent nous égarer, ce sont les jardins ouvriers installés comme les cimetières en bordure de ville, orthogonalité, labourage, arrosage, compostage. Chacun est chez soi dans ce qui pourtant n’est pas à lui, écrit Jean-Christophe Bailly. Il y a dans l’organisation et la gestion de l’espace des cimetières quelque chose qu’on retrouve dans celles des jardins ouvriers, c’est le tissu de toutes les parcelles qui forment le jardin.
Les jardins familiaux des Prés-de-Vidy et le cimetière du Bois-de-Vaux ont fait bon ménage des années durant dans l’ouest lausannois, séparés par la route cantonale, mais la rupture est consommée. La Ville a décidé en effet en 2006 de déplacer ces jardins sur un terrain voisin pour réaliser l’un des pans de son vaste programme urbanistique intitulé Métamorphose. Les archéologues se sont frotté les mains, les jardins familiaux occupaient en effet un terrain en bordure de la ville gallo-romaine de Lousonna. Si donc la Loi autorise de modifier l’affectation de cet espace, elle doit laisser le temps aux archéologues de fouiller et d’étudier le sous-sol avant que les pelles mécaniques et les caterpillar ne mettent le tout en bouillie.
Les sondages sous les jardins familiaux ont permis de localiser une nécropole de dimension importante, près d’un hectare, entre 5000 et 8000 sépultures. Il faudra donc attendre deux à trois ans avant que les travaux ne démarrent.
En attendant 2015 ou 2016, de hauts grillages ont isolé les Prés-de-Vidy du reste du monde, les jardins sont à l’abandon, herbes hautes du dernier automne, gouilles du printemps, traces de véhicules et quelques roulottes. Sitôt les cabanons transférés en 2010, des gens du voyage ont utilisé ce que leur ont laissé leurs prédécesseurs, ils y ont passé l’hiver, et puis un printemps. Ils sont partis depuis, ne restent qu’une petite dizaine de sans-abri, j’en aperçois un qui pelle au milieu de cette jachère jonchée de déchets, je l'imagine tirer de ce bourbier une poignée de tessons et un buste impérial en or.
Jean Prod’hom

Aigle, 300 mètres, 2012

Jardins Volpette, Saint-Etienne, 500 mètres, 2012

Jardins familiaux / Cimetière du Bois-de-Vaux, 1000 mètres, 2009

2009-2013
Jardins familiaux, Près-de-Vidy, octobre 2009


Jardins familiaux, Près-de-Vidy, avril 2011


Jardins familiaux, Près-de-Vidy, août 2012


Prés-de-Vidy, dimanche 31 mars 2013



CXX

Maman a bataillé ferme 15 ans durant auprès des autorités communales pour nous éviter, à moi et à mes soeurs, le spectacle douloureux proposé quotidiennement par l’abattoir du village situé en face du collège. J’ai fait des pieds et des mains pour mettre fin aux activités douteuses du salon de massage qui a remplacé ce vénérable coupe-gorge. Ma fille voudrait aujourd’hui que ses enfants aient sous les yeux, lorsqu’elles sortent de l’école, autre chose que le désert.
Le printemps peinait à s’établir, il neigeait. On n’y pouvait rien mais on usait de tous les moyens mis à notre disposition pour nous donner un peu de courage. Sitôt installés dans nos véhicules on mettait le chauffage à coin, on réglait le tableau de bord en langue italienne, on basculait l’indicateur de température sur les fahrenheit, on chantait O sole moi avec sous les yeux un 36 ou 37 degrés.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, bégayait Mathieu ivre mort sur le seuil de la Dolce Vita. Il était minuit passé d’une grosse heure. Une heure treize, nota un quidam pour la postérité.
Jean Prod’hom
CXIX

Les jeunes gens qui ont déversé l’année dernière plus de dix mille doses de LSD dans les réservoirs d’eau potable de la ville ont réalisé hier une nouvelle opération d’envergure.
Par petites unités mobiles, ces désoeuvrés ont arraché prenant la nuit tous les indicateurs routiers de la région, les indications aux devantures des commerces, les prénoms et les noms sur les boîtes à lettres. On a frisé la catastrophe.
Les instigateurs de cette entreprise qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses ont été arrêtés, avec leur matériel, dans une grange de Prévonloup où était établi leur QG.
Jean Prod’hom
Balade en Gruyère

Née en 1877 en Gruyère, Marie Thomet travaille une grande partie de sa vie à Broc chez Monsieur Cailler. Elle confectionne des confiseries à base de chocolat, gagne 8 centimes de l’heure et travaille 14 heures et demie par jour. La dame aime bien son patron. Au journaliste qui lui demande en 1964 ce qu’elle pense de Monsieur Cailler et de son entreprise, elle répond :
- On ne savait pas, à ce moment-là, que ça deviendrait une grosse boîte. Eux si ! mais ils ne se confessaient pas à nous. Si vous êtes fidèle, vous aurez une pension, qu’ils nous disaient, il était bien Monsieur Cailler, un très gentil patron, il nous avait même promis un réfectoire.

Les deux gardiennes du Musée gruyérien de Bulle ont la vie dure. Les visiteurs sont venus nombreux et de loin, d’Estavannens, de Grandvillard et de Lessoc. Descendus des quatre coins de la Gruyère, ils viennent voir une dernière fois un monde qui fout le camp, le leur. Ils font sonner les toupins qu’ils ont généreusement offerts aux gestionnaires de leur patrimoine, vérifient qu’ils ont encore la main et tranchent des tavillons, chantent le ranz des vaches, jouent, tressent, corrigent les erreurs des conservateurs du musée.
Halte ! disent les deux gardiennes du musée, pas touche ! c’est un musée. Les armaillis qui ont mis leurs habits du dimanche baissent les yeux, se découvrent comme des enfants pris en faute, c’est pourtant leur musée, mais non, ils s’en rendent soudain compte, trop tard, et rentrent dans le rang, on les a volés. Ils quittent le musée et s’en vont dans la ville déserte, il neige, c’est vendredi saint, le temps est bouché. S’ils veulent voir le Moléson ou la Dent de Brenleire, ou la Dent de Broc c’est dedans, aux cimaises du musée gruyérien.

Brève histoire de la Chapelle Notre-Dame de Compassion de Bulle
1350
Sollicité par les nobles et les bourgeois, François de Montfaucon, prince-évêque de Lausanne, fait construire une chapelle en l'honneur de la Vierge au bas de l'hôpital de la ville frappée durement par la peste.
1447
Un incendie ravage Bulle, la chapelle partiellement détruite est reconstruite, le pèlerinage survit.
1647
Dom Claude Mossu, supérieur de la maison de l’Oratoire, remet de l'ordre dans une affaire qui a de la peine à redémarrer.
1679
A la mort de Mossu, les capucins assurent la desservance de la chapelle, ils sont même établis à perpétuité.
1805
La chapelle échappe miraculeusement à un incendie qui ravage Bulle.
2005
Les capucins quittent le navire et une association des amis de la chapelle de Notre-Dame de Compassion se met en place.
2013
La chapelle est munie d’une porte automatique, l’horaire est affiché à l’entrée : Ouverture 6 heures 30 | Fermeture 20 heures.
Jean Prod’hom
87

La vieille de Pra Massin à qui j’avais fait entendre que j’en avais fini avec les choses qui encombraient ma vie me répondit d’un air bourru qu’il était temps de songer à me débarrasser du reste.
Il y a ceux qui se présentent avec un dièse, ceux qui se présentent avec un bémol et personne, personne qui répond au nom de personne, se tait et grogne, silence, c’est une autre musique.
Entendu au zinc de l’auberge communale ces mots : « René, arrête ton char ! » Ai renoncé à faire mon Quichotte.
Jean Prod’hom
Deux c'est trop

C’est assez
fin mars
avec nos bas de laine
les glaçons pendent
aux chenaux
comme
des fanons de baleine
Jean Prod’hom
86

De l’espoir ne naît pas autre chose que d’autres espoirs.
Je n’ai rien à ajouter, dit le vieil homme qui avait déposé les clefs de ses poèmes au Mont-de-Piété.
J'ai longtemps confondu Jerry Lewis et Jacques Lacan.
Jean Prod’hom
85
Les formules heureuses n’infléchissent pas le cours des choses mais les réchauffent un bref instant du soleil du dedans.
C'est la nuit, il fait gris, il fait froid; avec le temps qui passe, le temps qu'il fait pèse toujours plus lourdement sur le contenu et l'allure de ce qui lui vient à l’esprit. Il s’en réjouit lorsqu'il fait beau et chaud.
Lili joue du piano, cela suffit pour me remettre au diapason.
Jean Prod’hom
84

L’homme ne cesse de marcher sur les pieds de son ombre.
Combien sont-ils à se faire la courte échelle pour se retrouver dans la boue ?
L’homme était si brillant que je me mis à rêver d’un peu de fraîcheur.
Jean Prod’hom
Hagiographies d'Albert Einstein

Une découverte récente dans la vie d’Albert Einstein a conduit ses hagiographes à revoir leur copie. Jusque-là, ils avaient fait apparaître au coeur du bonhomme un cancre bon-enfant s’ennuyant sur les bancs de la maternelle, incompris, collectionnant les 1, mais habité par des forces vives prêtes à éclore. On s’avise aujourd’hui que l’échelle de notation était inversée dans son école et que les 1 qui avaient parsemé ses agendas scolaires étaient, comme nos 6, les signes de l’excellence. Les hagiographes ont retroussé leurs manches mais n’ont guère eu de peine à démontrer que le génie était compatible avec le chemin de croix que la société place sur le curriculum de ses ouailles.
La nullité ou la perfection ça joue, mais la médiocrité n’a jamais ouvert à personne les portes de la Légende dorée si bien que je me réjouis de voir comment l’hagiographie s’y prendra pour sauver son entreprise lorsqu’on rendra public ce que la succession d’Einstein a toujours voulu escamoter, la présence d’un 3,5 et d’un 4,5 dans le curriculum d’Albert, alors qu’il était élève au Luitpold gymnasium de Munich en 1889.
Jean Prod’hom
83

Ne rien écrire sous surveillance, c’est-à-dire par-dessus sa propre épaule.
Ce n’étaient en définitive que des phrases mystérieuses qu’il avait cru entendre en réponse à ce qu’il aurait voulu dire s’il en avait été capable, et qu’il avait, en toute liberté, transcrits fidèlement.
Faire parler les morts et flotter les enclumes, recueillir sur la page ce qui ne tient pas dans le creux de nos mains, faire de l’ondulatoire avec du corpusculaire. Bref, transsubstantier.
Jean Prod’hom
82

L'accès à l'étang est devenu impossible, les herbes et les ronces barrent le passage, je remonte par le chemin des copeaux avant de m'asseoir une demi-heure au pied d'un épicéa. Oscar fouine dans tous les coins, je ne fais rien et m'en satisfais. Cela fait quelques mois que je parviens – quelquefois – à ne rien désirer de plus que de rester là où je suis, sans lire, sans regarder vraiment, sans penser même, mais dans une espèce de stupéfaction molle. Ces endroits sont quelconques, ni bords ni centre susceptibles de les identifier clairement, des lieux sans nom où personne ne s'agite et dont le rien est le seul hôte fidèle. C'est ici ou ailleurs, et chaque fois un petit regret me pince de devoir me lever et rentrer.

Je continue l'éducation d'Oscar sur le chemin du retour, lui demande de rester assis tandis que je m'éloigne, de ne me rattraper que lorsque je lui en intime l'ordre et d'accepter sa récompense. Ça marche.
Sandra fait du ménage, passe l'aspirateur dans toute la maison, Arthur ramasse les dépouilles de la haie que j'ai taillée hier. J'en fais un grand feu dans lequel je jette les branches sèches des chênes qui se dressent devant le poulailler, charge dans la Yaris des morceaux d'érable que j'entrepose dans l'aire de pique-nique de la Moille-au-Blanc, ça pourrait servir. Tonds le haut du jardin, vide l'aile droite du hangar et brûle le bois qui y traînait. Je termine ces travaux au milieu de l'après-midi avec mon coude qui grince, Arthur fait du yoyo devant la véranda – un yoyo de nouvelle génération – et Sandra rédige à son bureau l'article qu'on lui a demandé sur les Jeux internationaux de Poitiers.
On part pour Curtilles en fin d'après-midi, Louise et Lili sont satisfaites de leur camp, heureuses de nous voir, elles se sont ennuyées chaque jour, un peu. Elles ont monté leur poney préféré dans le lit de la Broye, ont fait de la voltige.
En ouvrant le sac de Lili, Sandra découvre les trois livres qu'elle y a glissés avant de partir : Clara et les poneys, Le Fils de l'étalon noir et Lili a la passion du cheval. Voilà une fille qui a de la suite dans les idées. Elle nous dira aussi plus tard qu'elle n'a presque rien lu, il y avait tant de choses à faire. Voilà une fille qui a des priorités.
Un hérisson qui vit dans les hortensias à côté de l'entrée montre ce soir le bout de son nez.
Jean Prod’hom




Petite visite à eux-mêmes

Un village ce n’est plus le destin commun de familles réunies, aujourd’hui on s’en va vivre sa vie où on peut mais le cœur sur la main, pleureuses, elles étaient venues et avaient coiffé le masque fixe du deuil, nulle n’aurait manqué ce matin et la mère rendrait la pareille quand il le faudrait : le deuil des autres c’est le meilleur moyen qu’on a de revenir un peu dans les siens et la seule façon qu’on vous laisse parler de vos morts au moins le temps pour l’autre de préparer sa réponse C’est comme moi je. Et puis le cimetière on y a sa propriété chacun, on n’irait sinon que pour la Toussaint et aujourd’hui les condoléances terminées on y ferait un petit tour en passant, le vent souvent renverse un pot de fleurs et toujours il y a les mauvaises herbes à gratter dans le carré de famille, il y a toujours à faire et c’est le canif à la main pour nettoyer qu’on se recueille le mieux. Les vieux se faisaient préparer leur coin de caveau longtemps avant d’en profiter pour de bon (comme perdurait disait-on cette manie d’emmurer chat tué ou louis d’or dans le parpaing d’une maison qu’on bâtit), sur le granit gris poli d’avance gravé : nom prénom date de naissance trait d’union, à chaque cérémonie se rendant ainsi petite visite à eux-mêmes. De toute façon, pleureuses, n’importe quoi qu’on ait fait de sa vie, l’enterrement la rattrape, tout le monde y a droit d’autant plus que celui-là a manqué ce qu’il vous semble avoir réussi, et en déployer dès la voiture et votre robe la marque et les signes, dignité de menton : faire à quelqu’un le dernier bout de conduite garantit qu’on ne partira pas tout seul non plus. « Ce qu’on fait de bon cœur ne pèse pas », de tout cela il n’y a pas à parler : il en est ainsi depuis si longtemps. On n’imaginerait pas ici de funérailles deux le même jour...
François Bon, L’Enterrement, Publie.net, Temps réel, 2012
Un autre arrière-pays

La caractéristique d’un chef-d’œuvre est qu’il s’arrête à sa propre affirmation ; comme on dit communément, il est une impasse. Rembrandt, Racine ou Wagner tuent à l’avance quiconque les prend pour modèles ; il n’y a qu’une manière de les continuer, c’est de les oublier, au moins en apparence, d’être Watteau, Marivaux, ou Debussy.
C’est lorsque la route s’interrompt mais qu’il n’a aucune raison de s’en remettre à la panique parce que la situation n’engage pas sa vie, c’est lorsque les ronciers lui interdisent d’aller plus loin, lorsqu’un mur ou un ravin l'oblige à rebrousser chemin qu’une terre inespérée surgit à deux pas, au-delà de cet obstacle qu'il ne peut franchir, et s’étend immense, image de la terre, muette, à laquelle les circonstances ont choisi de lui barrer l’accès en la lui offrant tout entière, non pas tant une terre à laquelle il aurait pu, s'il en avait décidé autrement, accéder au terme d’un long détour, par ruse ou par calcul, de cela il ne saurait en être question, mais une terre à laquelle il n’accédera jamais et qui demeurera intacte, sans lui, une terre dont on ne peut ni ajouter ni retrancher quoi que ce soit, qui s’arrête à sa propre affirmation, une terre oubliée, une terre à l'écart, peuplée de gens silencieux qui vont et viennent en obéissant à des impératifs qui échappent au calcul, paisibles et secrets, donnant l’avant-gout d’une vie à laquelle il n’a pas ou plus droit.
Il regarde cette terre et ses habitants comme un tableau, sans faire de bruit. Mais combien sont-ils ? Peu à l'évidence, ils n’ont jamais forcé aucun passage, séparent le grain de l’ivraie et l'ivraie du grain, un autre règne, une autre manière d’habiter, un passé plus ample que le sien les précède et les porte, ils vont à l’allure de la mule et de l’âne qu’ils conduisaient autrefois.
N’ayant d’autre chose à faire que de rebrousser chemin, je songe à ces terres d’après le désastre, à ces lieux oubliés, délaissés dans lesquels les gens du voyage attendent la nuit, sans hâte, assis devant leurs roulottes.
Il est temps de m’éloigner de ces terres interdites, avec la certitude que je les retrouverai après de longs détours, que je les considérerai de l'autre côté du ravin, de ce lieu que j’aurai fait mien sans le savoir, avec derrière la haie vive le lieu miraculeux où je suis aujourd'hui.
Jean Prod’hom
Te le répète

Te le répète
reprends ton rimmel
ton dentifrice et ton fond de teint
plie ton linge de bain
et file !
on saura faire sans toi
Jean Prod’hom
81

Vivre aussi souvent que possible à la distance d'un jet de pierre, là où se montrent les anges, seul, à respectable distance de ceux qui se sont endormis, de ceux qui veillent et des oliviers, bien visibles parce que cachés, comme nous l’enseignent les bêtes entre chien et loup.
Jean Prod’hom
Oscar

Oscar passe une partie de la matinée dans le jardin tandis que je brûle les dépouilles du tilleul que Daniel a fait tomber vendredi. Il s'affaire sur un morceau de bois, le ronge, court après son ombre et les bruits, lève la tête, se roule dans les copeaux, aboie, disparaît, revient. Lorsqu'il m'aperçoit avec un bout de tilleul à sa taille, il s’approche, me regarde, attend. Mais je n'ai pas le temps ou ne le prends pas, ou ne le lui donne pas. Il penche la tête à gauche, à droite, je fais de même, à droite, à gauche, je joue, il reprend, je ris, lui pas, il ne joue pas, c’est autre chose.
Son insistance muette – elle me fait penser à celle des innocents, des enfants, des oubliés, ou à celle des pauvres – fait tomber mes dernières résistances, je jette en direction du hangar un os de bois avant de retourner à ma tâche.
On se sera donc croisés quelques secondes avant de rejoindre chacun de notre côté notre ventre et le gros de notre vie, dans un jardin où coexistent d’innombrables mondes, il rejoint le sien, je rejoins le mien. Je l’observe pourtant à la dérobée et, alors qu’il reprend place au centre de son domaine et se livre aux circonstances en cueillant quelques fruits du hasard, je m’interroge, cherchant la clé de ses actions. Je radote, il se tait, c’est évident, il me montre la voie, il fait rayonner en effet une autre vie à quelques lieues des boulevards du langage et de la raison.
Son esprit n’est décidément pas soumis au déroulement linéaire qui nous éloigne de la coexistence et de la diversité des mondes. Les décisions qu’il prend sont justes, ne le conduisent pas au désastre, mais elles n’obéissent pas aux règles qui président aux miennes. Les étoiles tombent de partout autour de lui, monde ouvert qui ne change pas et qui semble clignoter continûment tandis que j’avance entre deux haies de raisons, au coup par coup, comme dans un récit taillé à la machette et dont l’imprévu a été exclu.
En affinant ses rapports au monde par le langage, l’homme s’est coupé d’autres manières de l’habiter, l’oubli du temps d’avant l’enfance en témoigne. Comment Oscar fait-il pour s’y retrouver, ne pas devenir fou, aimer ? Oscar est un philosophe qui s’ignore, me voilà moins seul dans le monde du langage, ensemble dans le jardin. Je le sais seul loin de moi dans le sien, ne veux ni le rejoindre ni le rapatrier dans le mien.
Jean Prod’hom
Fermeture de blog

Elle avait publié sur son blog un petit texte bien senti qui avait déclenché de nombreux commentaires, une avalanche de mots gentils : des remerciements, différents témoignages, des confessions même. Les lecteurs avaient été visiblement touchés, profondément même. Beau moment de partage qui aurait dû la réjouir mais qui la rendit soudain honteuse, traversée par un sentiment analogue à celui qu’elle avait éprouvé autrefois, lorsqu’au nez et à la barbe des habitants du cru elle avait gagné une tarte aux pommes à l’occasion d’un loto organisé par le syndicat d’initiatives d’une petite commune de Lozère dans laquelle elle avait vécu tout un été avec deux amies, elle n’avait d’abord pas osé crier « Carton! ».
Ses lecteurs, ses si sensibles lecteurs avaient relevé les perles de son beau texte, ses bons mots, jolies tournures, clins d’oeil, caresses discrètes. Personne n’avait passé à côté des traits de son esprit torturé et de sa modestie, séduit par les éclairs de son intelligence vive, interpellé par les références qu’elle avait savamment distribuées de droite et de gauche. C’était décidément un texte bien senti par la grâce duquel elle était parvenue à draguer dans le fond de l’âme de chacun de ses lecteurs un assentiment enthousiaste qui dépassait toutes ses espérances.
L’obtenir soudain lui fit voir ses traîtrises, ses compromissions, petites révoltes, petits scandales, petites extases, susceptibilités, abandons, évanouissements, bon sentiments. Elle commença à suffoquer dans ces lieux irrespirables où suintait une douceur qui collait à la peau comme du salpêtre.
Le lendemain c’était dimanche, elle laissa tomber son blog et se rendit à la messe, seule.
.Jean Prod’hom
Habemus papam

Dans chacune de nos maison un foyer où couvent des secrets, une cheminée d’où s’échappent des légendes.
La bise s’est levée et secoue des deux bras les contrevents : des giboulées dansent aux fenêtres et la grande noiseuse trace des messages sans queue ni tête. Le soleil est vite refroidi, le foyard crépite, arabesques au-dessus des cheminées, on n’est pas tous logés à la même enseigne : bois jeune noyé de paille, fumée noire, on bataille ; vieux bois mort d’âge, dix ans au sec, fumée blanche, réjouissances.
Jean Prod’hom



CXVI

Dans les 1227 billets publiés sur lesmarges.net, le mot réjouir et et ses dérivés apparaissent à 70 reprises, le mot regret et les siens à 77. C’est le moment de m’en réjouir si je veux inverser cette tendance.
Jean Prod’hom
80

L’homme passe son temps à prendre de l’avance ou du retard dans la réalisation de tâches fastidieuses, mais incontournables s’il souhaite disposer à la fin d’un peu de ce temps et de cette liberté sans lesquels l’essentiel ne se montre pas.
Il a préféré pourtant différer aux calendes grecques la jouissance de ce bien. Il profite en attendant de prendre un peu d’avance ou de retard, quoi qu’il fasse et où qu’il soit. L’homme est à l’image de l’usurier, à l’image de la victime du petit crédit, un handicapé du temps.
Jean Prod’hom
79

L’indifférence avec laquelle la pluie la neige, le froid et le chaud traitent tout ce qui tombe sous leurs mains, fleurs, bêtes, hommes ou femmes doit nous amener à reconsidérer les égards que nous témoignent ceux qui nous veulent du bien.
Jean Prod’hom
CXV

Il s’endormait aussi bien en marche avant qu’en marche arrière. Pour se réveiller c’était une autre paire de manches.
Jean Prod’hom
Deuxième poussée du printemps

On attendait une réplique à la poussée noire de la semaine passée, c’est fait, les arbres nus n’offrent plus aucun abri, le roquet aboie, trois chevreuils fuient. La glace cède, l’eau remonte jusqu’aux chevilles, le carton est détrempé. Dans l’ombre des dépouilles de l’hiver, un cortège de signes qu’on ne sait par quel bout prendre s’allonge sur le chemin : animaux de basse-cour qui dansent, animaux des bois qui fuient, mais aucun chiffre, aucune clé, une succession d’approximations passagères. Bouffées d’air chaud dans le ciel blanc au-dessus de la Mussilly, coup de fatigue, tout ira vite désormais, tout est beaucoup plus clair, un merle siffle le rassemblement.
Jean Prod’hom
Fers de lance

Les fers de lance sont épaulés par des hommes qui ont baigné dans le secret des dieux. Ce ne sont pas des mercenaires, bien au contraire, mais des hommes épris de justice qui font caisse et cause communes, espérant qu'un peu de lumière rejaillira sur eux.
Ceux que l’infidèle a adoubés lui ont juré fidélité.
Ce sont les porteurs d'eau, les infatigables courtisans qui assurent de courbette en courbette l'extension du territoire. Quelques flatteries sur leurs flancs rassasiés suffisent à ce qu'ils ne quittent pas les lieux.
Aux infidèles qui n'ont pas installé derrière eux un vide sanitaire, tôt ou tard les compromissions.
C’est de l’arrière que la trahison remonte jusqu’à l'infidèle, il aperçoit alors la foule et les armes dans son dos.
On devrait pouvoir choisir ses fidèles, dit l’infidèle, et d’un coup sec il détache l'essaim des courtisans accrochés à ses basques.
- Sois fidèle à rien mais infidèle à quoi.
Un flocon, un poème, délicieux, transparent, nu comme un ver.
Jean Prod’hom
Reprends tes billes

Reprends tes billes
tes cliques et tes claques
roule ton sac
et zou !
fous le camp
Jean Prod’hom
Pavé romantique et chantier romanesque

Gilles Caron s’est trouvé en juin 1967 sur les rives du canal de Suez, en novembre de la même année au Vietnam sur la colline 875, en 1968 à Paris. Il s’est rendu, également en 1968 à Mexico, juste avant les Jeux Olympiques, et trois fois au Biafra ; à Londonderry, Belfast et Prague en 1969 ; est parti pour le Tchad au début de l’année 1970, au Cambodge en avril. Trois ans au total pour ramener des images de quatre années folles : Gilles Caron disparaît le 5 avril sur la route n°1 qui relie le Cambodge au Vietnam. Le musée de l’Elysée présente à Lausanne 250 photographies de cette tête brûlée, du 30 janvier au 12 mai 2013, j’ai vu ces photographies dimanche passé.
Le hasard a voulu que je longe aujourd’hui un chantier isolé du monde par de solides grillages, deux hommes y posaient accroupis des pavés du Portugal, un troisième – le patron – râtelait un peu plus loin un lit de gravier, je me suis arrêté. C’est un travail modeste et besogneux, un ouvrier en pose entre 10 mètres et 10 mètres carrés par jour. Le patron m’a confié que le travail ne manquait pas dans la région, mais lui et sa petite équipe devaient faire face actuellement à une concurrence déloyale, des entreprises qui ne sont pas de la branche soumissionnent à des prix réduits des travaux qu’ils obtiennent sans peine et qu’ils réalisent en embauchant des temporaires à bas prix. L’homme n’est pas content, je le comprends.
On a parlé de choses et d’autres, le patron est d’ici ; celui qui parle français est l’un de ses amis, charpentier de formation qui s’est formé sur le tas ; le troisième se tait, il est espagnol et ne parle pas français. Le chantier va durer encore quelques jours avant qu’ils ne déposent le dernier pavé. Le dernier pavé, c’est le plus difficile, il doit avoir les dimensions qu’il faut, c’est lui qui fait tenir le tout, c’est la pierre d’angle. Il faut préciser que le pavement qu’ils réalisent n’est pas un pavement définitif, c’est-à-dire qu’il n’est pas posé sur du mortier, il ne sera pas jointoyé avec une chappe, il est simplement posé sur un lit de gravier, les joints seront faits de sable mêlé à du gravier. Je lui demande alors en souriant s’il met ainsi de côté et en lieu sûr les armes dont auront besoin ceux qui manifesteront demain contre l’ordre établi. Il sourit et me dit fièrement que même si le pavement n’est pas définitif, il sera très difficile de retirer la première pierre. On s’est quittés.

En montant au Riau m’est revenue à l’esprit une image aperçue dimanche au Musée de l’Elysée qui m’avait laissé un sentiment d’inquiétante étrangeté, la célèbre photographie que Gilles Caron a réalisée dans les rues de Paris le 6 mai 1968, un lanceur de pavés dont les CRS mesurent la performance à l’autre bout du stade de la rue Saint-Jacques. D’où vient le pavé que projette dans le ciel ce discobole moderne ? Pas trace de chantier ou d’excavation, le pavé qui disparaît paraboliquement dans le ciel ne vient de nulle part, il est fourni par l’histoire. Je voudrais trouver la photographie des manifestants qui s’échinent sur le premier pavé, une photographie qui donnerait à voir la vérité romanesque du chantier.
Jean Prod’hom
Première poussée du printemps

C’est venu de dessous, une poussée noire qui a desserré les pinces du gel, ça se préparait depuis quelques jours, elle est là, vague et débâcle, boue noire dans laquelle le premier printemps essaie de se tenir debout, mais il s’enfonce parce que ses appuis se dérobent comme les pieds d’une échelle auxquels on aurait oublié d’enfiler des bottes.
Le foehn a ouvert d’immenses chantiers, l’eau noire des rivières s’est attaquée aux talus. Dans les champs et les jardins détrempés, le bric-à-brac laissé à l’automne réapparaît, on croyait les canettes enterrées, les guirlandes des nuits de Noël au grenier : la campagne ressemble à la baie des Trépassés.
Ce matin les moineaux et cinq petites boules jaunes dans la plate-bande ont pris les devants, on est plusieurs à avoir desserré les dents. On attend confiants les répliques de cette première poussée pour fêter le nouvel an.
Jean Prod’hom




A la Muette

Je sais qu'à un certain moment on n'écrit pas autrement que sous dictée.
Une voix dont personne ne savait rien et que personne n'avait entendue avant lui a obligé le bonhomme à retrousser les manches en engageant des travaux imprévus, au burin et à la pointe sèche, pour mettre dans la langue de quoi entendre le monde et ses parties, tels que personne ne les avait entendus jusque-là ; reprendre chaque chose dans ses rapports aux autres, le monde, les êtres qui en sont locataires, les événements qui s'y déroulent ; refonder la langue qui est seule susceptible de les dire, la libérer des formes convenues de subordination, plier la ponctuation à cette entreprise, réhabiliter ce que les certitudes académiques ont mis au pilori ; remettre chaque chose avec du jeu dans le jeu, puzzle ou peinture, rythme et coupures.
À côté du monde dans lequel on croit vivre et que l'on croit voir, il y a des mondes que des voyants soudain nous font voir et qui nous donnent la force de ne pas nous livrer à la tyrannie du réel.
L'entreprise a été interrompue au moment même où l'homme est mort en 1947, il ne nous en dira pas plus.

Mais la voix n'a pas cessé de se faire entendre, car l'écriture a elle aussi ses cordes vocales. Inutile pourtant de frapper, les ponts sont coupés, les volets sont fermés, personne n’est assis sur les marches d’escalier.
En tendant l'oreille sur le parvis de l'église qui surplombe la Muette, on entend pourtant quelque chose qui défie tous les secrets, c’est dimanche, le bourg est désert, on perçoit une rumeur, un bourdonnement, du bas du lac au haut des vignes, une empreinte qui n’est pas si différente de celles que laissent dans le paysage les choses d’autrefois auprès desquelles on a été enfant et vers lesquelles on retourne un jour, le silence de la ruelle, le silence des galets, des roses contre le mur, du crépi des murets juxtaposés comme dans les livres de Ramuz.
On se surprend alors à rebrasser les cartes, et on regarde les choses sans arrière-pensée, comme elles le sont avant d'être dites, et on recommence une partie avec des yeux neufs.
Jean Prod’hom
78

Avoir une ligne sans être pointilleux.
Vivre le présent d’accord, mais demain. Souvenez-vous d’hier.
Jean Prod’hom
Une sainte Barbe à l'entrée de la nuit

Des inconnus – personne ne sait combien – ont tiré leur capuche et processionnent dans la nuit au-dessus des Paccots, lampes Led sur le front. Ces mineurs de plein air n’ont pas fait voeu de silence mais on ne les entend guère, le frottement des clous des raquettes et des peaux rêches sur la neige durcie couvrent le bruit de leur respiration.
Ce soir sainte Barbe, la patronne des mineurs, des pompiers et des égoutiers les accompagnent ; j’en fais le pari, elle deviendra sous peu la protectrice des randonneurs nocturnes, on creusera alors dans la pierre de petits autels surmontés de panneaux solaires abritant au pied des indicateurs piétonniers le corps de la martyre et une ampoule sainte, Led perpétuelle, pour donner du courage aux plus faibles et éclairer la vie de ceux qui ont broyé du noir tout au long de la semaine.
Les étoiles se sont retirées du ciel pour laisser la place ici ou ailleurs à une danse, Corbettaz-Rosalys à raz-terre et retour, les pèlerins ont creusé dans la nuit un tunnel qui les protège de ses coups de grisou.
Jean Prod’hom





Il y a les chants de l'absence

Il y a les chants de l'absence
les corps forteresses
les marmottes
il a la fièvre lorsqu'elle baisse
les sépultures
le métro de Londres
Tintin en Amérique
il y a l'air neuf
Pif Paf magazine
il y a les champs après le passage de la herse
Jean Prod’hom
Aux voyants la jachère

Eradiquer le bruit, exclure le faux, baisser les yeux, fermer les fenêtres virgule, isoler, encadrer, trancher virgule, distinguer le haut du bas, élever le ton, sonner les cloches virgule, brûler l’incorrect, chasser l’étrange, écrire au lance-flammes, faire rédiger des poèmes point. On s’étonnera demain de l’improductivité de nos sols virgule, passez donc virgule, il n’y a plus rien à voir point à la ligne.
Les mauvaises graines poussaient aux flancs des talus, le bleuet et le coquelicot autour des crapules, l’école buissonnière derrière l’horizon. Aux voyants la jachère et les chemins de halage, la chienlit et le carillon, les refuges et les portes cochères, la forêt, l’eau trouble et la mauvaise herbe.
Jean Prod’hom
Insurrection

On allait vers le printemps, l'aube se faisait chaque jour plus matinale, les merles avaient épuisé leurs réserves et croquaient les derniers fruits des aubépines et des sorbiers, les bergeronnettes marchaient à petits pas pressés sur la molasse de la rivière en hochant la tête et la queue, la glace de la fontaine avait molli, le givre ne résistait pas au premier coup d’essuie-glace, pas de bouchons sur l’A1.
Mais tout semblait pourtant revenir en boucle dans la ronde des saisons. Nous roulions en bon ordre sur le plateau de Sainte-Catherine, incognito, pas un mot pas un signe lorsqu’on se croisait. Il y a avait dans l’allure de chacun, dans le sérieux qui animait nos visages, l’odeur de discipline que chaque conducteur répandait tout autour de lui ce quelque chose qui garantit, pour notre malheur, la pérennité des langues de bois et des poignes de fer.
Je ne pouvais imaginer qu’au-dedans de nous les choses se passent ainsi et que nous ne nous arrachions pas de la mainmise de cette misère par quelque battement de coeur. Je devinais forclos en chacun de nous un chaos équipotent à l’ordre que nous suivions servilement.
J’ai soudain entendu un chant, et j’ai aperçu sortir du cortège un magicien qui s’est mis à danser, il occupait la seconde face d’une bande de Möbius sur laquelle il esquissait un décor dans lequel il égrenait le chaos, brassant les pièces d’un puzzle géant à grands coups de pinceaux.
Ce chant était une berceuse et une ribambelle d’enfants marchaient sur les bas-côtés de la route que le magicien avait crayonnée et sur laquelle nous roulions tête en bas, les enfants allaient à contre-sens, il étaient en pyjamas disgracieux.
J’ai très vite compris, ceux qu’on avait arrachés tout l’hiver au sommeil et à la nuit pour les mettre en rangs, comme aucune bête ne l’avait fait jusque-là, rentraient chez eux pour se glisser sans bruit dans leur lit. On entendait dans le lointain les parents qui applaudissaient la résolution de leurs petits. Lorsque plus tard les enfants se sont réveillés. le soleil avait réchauffé la terre, l’eau coulait dans la fontaine, l’aubépine bourgeonnait, les merles barbeyaient les haies. Les enfants ont cueilli les premières perce-neige, les premières primevères, c’était le printemps. Le mastodonte avait bel et bien été déplacé, les gamins l’avait décalé de deux heures en direction de l’avenir. Une lueur est alors apparue au-dessus de Mauvernay.
Jean Prod’hom
Le dernier mot

La cérémonie d’adieu organisée en souvenir de l’adolescent emporté par une avalanche au Bec des Etagnes le mercredi 13 février a eu lieu ce lundi à 14 heures au Bremgartenfriedhof de Berne.
Le prénom du garçon, avec l’heure de la cérémonie, était inscrit en caractères mobiles sur la façade de la chapelle qui jouxte le cimetière. On distinguait bien entre chacune des lettres le vide qui leur donnait sens et la force qui travaillait à les éloigner les unes des autres, comme il en va pour toutes choses, car les mêmes éléments qui forment la terre, le ciel, la mer, les fleuves et le soleil, engendrent aussi les arbres, les moissons et les animaux; mais ils sont mêlés à d'autres, et leur arrangement diffère.
Le garçon n’est pas entré dans la chapelle, il est resté en arrière et nous a laissé le dernier mot, celui qui aurait pu le ramener parmi nous. Le gamin était tout près, à deux pas à peine sans qu’on puisse toutefois combler cette distance. Alors on a fait quelques pas vers l’avant, et puis on s’est arrêtés en prêtant l’oreille aux mots qu’on aurait voulu entendre dans notre dos, mais il se taisait. Nous avons fait quelque pas encore mais nous foulions déjà sans le savoir la terre à laquelle il était désormais mêlé.
Notre désir d’être auprès de lui s’est détendu et nous nous sommes mis à aller et venir, là-bas tout près de lui, ici à l’autre bout du monde, il faut bien vivre, il ne fait pas bon rester dans les parages de la mort.
On a dû s’y faire, le gamin se taisait et ne nous écoutait pas, lui seul aurait pu regretter ce qui s’était passé s’il l’avait su, mais il s’était détourné de tout, de nous, s’était retourné du côté de sa propre vie. Et pendant que nous parcourions les images qu’on plaçait entre lui et nous pour garder la possibilité d’un accès à cet autre monde, nous vieillissions à la vitesse de l’éclair.
Il fallait bien sûr mettre en place pendant qu’il était encore temps les signes d’une carte nouvelle, mais trop proches pour s’en satisfaire, nous nous imaginions en sa compagnie, je l’ai vu distinctement à Ropraz, sa blessure au coude, j’ai entendu sa voix, ai répondu à son sourire, on s’était dit au revoir et les choses auraient dû continuer ainsi de ce côté-ci. En mourant le gamin a coupé les ponts et nous a laissé le dernier mot, pas tout à fait un mot, un prénom en caractères mobiles auquel s’accroche un faisceau d’étoiles.
Jean Prod’hom

Berne | Google Earth, 12 mars 2012 | élévation : 1807 mètres 
Berne | Google Earth, 12 mars 2012 | détail
Lemmes (10)

Dire aux élèves à journée faite que le temps manque, qu’il y a le programme, que d’autres tâches l’attendent, c’est les endoctriner en les faisant participer sans nécessité autre que celle du dressage à la chaîne industrielle de l’éducation.
Qui dit à ses élèves qu’il y a du pain sur la planche et qu’ils ne peuvent se permettre de lambiner fait de la propagande politique et commet une faute grave, il demande à ceux dont il a la charge d’annexer l’avenir en étendant les modes de production du présent au futur.
Il convient de faire exactement l’inverse : se taire et creuser au vilebrequin un peu de vide dans le plein, comme au jeu du taquin, ne pas rétrécir les marges, ne pas couper les haies, ne pas étouffer le silence et et voir venir.
Que le maître dise comme on le disait autrefois : il y a encore assez de pain sur la planche, l’école a suffisamment de ressources pour l'avenir, soyez assurés que nous ne manquerons de rien : un morceau de bois et un fil de fer, un peu d’espace et un peu de temps suffisent à lever le voile sur un coin du monde et de la connaissance.
Jean Prod’hom
Si cela se pouvait

Si cela se pouvait, je soutiendrais à bout de bras ceux pour qui cela ne se peut pas, ceux que les circonstances ont lâchés d’un seul coup, désemparés – je pense aux plaines immergées du Pô ou du Gange –, assourdis par les vrombissements d’un silence qui monte jusqu’au plus haut et inonde, avec l’aide de la raison, les moindres recoins de ce qui les entoure, qui ont pour seul rêve l’inconcevable, que tout recommence et que cet homme asphyxié se réveille autre et ailleurs.
Cela ne se peut pas, dit le fils au père, à moins que l’homme ne vive où qu’il soit que parce que c’est l’unique moyen qui lui reste, dit le père au fils, de ne pas être tout à fait seul lorsqu’il meurt.
Jean Prod’hom
77

Peine à croire que le petit estagnon de sang couleur bordeaux que m’a retiré l’infirmière la semaine dernière à Mézières ait un quelconque rapport avec mes jours et mes nuits, si n’avait été cette brûlure aiguë à la pointe de l’avant-bras droit.
Jean Prod’hom
Le linge sale n’a pas pris le virage du numérique

La matinée pour remettre en ordre les Genets et charger les voitures. Il neige, trois enfants sont allés skier, il fait froid. Pique-nique dans un garage à dameuses de pistes.
Lili et Arthur sur leur iTouch, Louise sur son mini-iPad, Sandra et moi sur nos portables, on répond au courrier. Oui, mais quand donc le linge sale prendra-t-il le virage du numérique ?
Il est passé 23 heures lorsque j’ai mis à jour les billets de cette semaine. J’éteins la lumière chez Arthur qui dort les poings fermés, débranche son poste de radio, passe chez les filles, respire avec elles.
C’est décidé, on ira Sandra, Louise, Arthur et moi à Berne lundi après-midi. Lili chez Mylène. Je monte dans les combles rejoindre la bise et ma belle.
Jean Prod’hom
Un petit air de boîte à musique

Passe la matinée avec Oscar aux Genets qui sont, nous a expliqué le responsable de la location, une ancienne dépendance du Grand Hôtel des Rasses dont la Neuveville a fait l’acquisition en 1898 : peu probable. Fais la vaisselle du petit déjeuner pendant que Sandra et les autres s’initient au ski de fond, la maison est déserte, j’écoute la radio, une dame présente les modestes buts de l’association d’écrivains vaudois qu’elle dirige. Mets à jour pendant ce temps les billets du début de la semaine avant de chausser mes raquettes. Je grimpe avec Oscar dans les bois jusqu’à la Casba. Il ne fait pas très beau, 2 ou 3 clients seulement.
Elle s'appelle Maguy, elle est originaire de la Roche au pied de la Berra. Ses parents reprennent un alpage et une buvette sur les hauts de Baulmes alors qu’elle est encore enfant, elle y donne un coup de main avant d’être engagée par les Piaget à la Côte-aux-Fées. Elle travaille d’abord au premier étage, à l’ébauche, avant de gravir les étages et d’être engagée pour monter les mouvements. Son mari meurt en 1997. Elle revient alors comme elle le dit aux sources. En 2001 elle reprend la Casba, y travaille dur pendant 12 ans, si on bossait plus de 8 heures chez Piaget, on en bosse près de 18 ici, elle aimerait la remettre en fin d’année, elle et son aide n’ont pas chômé, elles ont bien mérité un peu de repos.
Je grimpe au sommet du Cochet avant de redescendre sur Sainte-Croix par les Praises. Cherche à entrer dans l’église, fermée comme il se doit et si haut perchée qu’il ne faut pas s’étonner que les fidèles d’en-bas n’y montent pas. Remonte aux Rasses par les Replans. Photographie une étrange scène que j’aperçois à l’étage d’une maison de l’autre côté de la route, derrière une grande baie vitrée. Un passant m’apprend qu’il s’agit de la maison de l’automatier François Junod. Lui c’est un ouvrier de chez Reuge, il a 62 ans, est arrivé des Pouilles alors qu’il avait 16 ans. Il a épousé une femme du coin, ses enfants travaillent dans la plaine. Il y a dans son histoire un peu triste un petit air de boîte à musique que j’ai souvent entendu depuis quelques jours.
Jean Prod’hom
Croise un chamois pas inquiet pour un sou

Nuit hachée, un rêve qui tourne au cauchemar, une panthère – ou un jaguar – qui fait ami-ami avec Arthur. L’animal ne desserre pas les dents et lui fait les yeux doux. J’ai beau avertir le mousse que le gros grain ne signale sa présence à la coquille de noix que lorsqu’il est trop tard, le pelage soyeux du félin n’exclut pas sa voracité, en témoignent ses canines, la bête peut soudain virer d’humeur et faire sa fête au meilleur de ses amis. Le gamin n’y croit pas, ne veut rien entendre, en appelle à l’humeur stationnaire de son gros chat. Je me dois de l’avertir avant qu’il ne soit trop tard, le temps presse, me désole et songe à l’avalanche qui a emporté son ami au Bec des Etagnes la semaine passée. Ne lui dis rien mais lui fais voir ma nullité, éducation ratée. Cela aura suffi, Arthur éloigne sa peluche qui ouvre sa gueule et découvre ses canines derrière les barreaux d’une cage.
Ne vois et n’entends ce matin que des égocentriques doctrinaires à l’égo terne, liberté de choix et convictions d’apparat, surdité et lâcheté. Je ne suis pas dupe, c’est moi, pas mécontent dès lors de filer et de ne pas les charger des dépôts de mon humeur noire, je pars avec Oscar récupérer la voiture que nous avons laissée la veille aux Cluds. Poursuis jusqu’à Mauborget, reviens par Bullet, vais jusqu’à l’Auberson : de la grisaille et des visages défaits, village-rue désert. Fais quelques photos des cimetières, le chemin qui mène à celui de Bullet n’est pas ouvert, on attendra le printemps. Croise un chamois pas inquiet pour un sou sur le talus de la route des Verrières, en contrebas coule un ruisseau d’encre et l’acide ronge les ourlets blancs de son lit.
Jean Prod’hom
Mort blanche

Mercredi dernier une avalanche a emporté un enfant alors qu'il montait au Bec des Etagnes, c’était un ami de notre fils, ils faisaient du vélo ensemble, ils s’aimaient beaucoup je crois. De la poisse, il n’avait pas neigé, le danger d’avalanche était bas, niveau 2, formée par le vent une plaque qui se détache à mi-pente, un accident. Le copain d’Arthur a dû la voir venir mais elle a eu le dernier mot. L’innocent a été entre la vie et la mort le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, finalement la mort a gagné la partie. Malgré tous les soins prodigués, l’ami d’Arthur nous a quittés lundi en fin d'après-midi.
Son père qui l’accompagnait avec quatre amis nous a écrit un mot, on l’a reçu au moment du repas. Trois phrases sobres, nettes, lues et relues, tranchantes, avec trois fois le prénom de son fils. La seconde précise que l’enfant a été le dernier des quatre skieurs à être dégagé et réanimé. Il aurait donc pu en aller autrement, c’est écrit et on le sait, mais le ciel s’est bel et bien effondré sur la tête de ce père, de cette mère, de sa soeur, de ses amis. Il leur en faudra du courage, bien plus que je ne peux l’imaginer, pour faire face aux coulées qui vont succéder à l’avalanche qui a dévasté leur vie. Je vais dès aujourd’hui mette de côté un peu de ce courage qui va leur manquer, au cas où ils m’en demanderaient.
Sandra a annoncé cette tragédie à Arthur, je l’ai annoncée aux filles et à nos convives. Personne n’a été satisfait de la mort du gamin, ils voulaient comme de normal en savoir plus, recevoir les premières explications et les causes immédiates, petits immortels que nous sommes. Chacun en a profité pour raconter ses expériences, donner un ou deux conseils utiles en pareil cas, esquisser un pas de morale.
On n’a rien vu venir, ni Arthur qui nous avait confié il y a quelques semaines qu’il enviait parfois cet ami et son père qui allaient étreindre les neiges éternelles, ni Louise qui s’est effondrée, ni Lili ni Sandra, ni moi. Sandra a réuni son petit monde dans la chambre qu’on occupe aux Genets, je les ai rejoints. On a eu une bien vilaine soirée.
Quelque chose s’est déchiré entachant mes heures, celles du mercredi au lundi vécues à l’abri de cette tragédie, pâlissant à mesure que le malheur creusait son chemin au Bec des Etagnes, à Sion, à Berne. Qu’on le veuille ou non, l’ignorance de l’homme n’est pas celle des arbres et des montagnes. Tout s’est effondré d’un coup avec un roulement sombre. nos vies qui se frôlaient se sont déchirées avec le bout qu’on pensait naïvement faire ensemble.
J’avais skié au début de l’après-midi avec les filles, un petit groupe était monté plus tard jusqu’au sommet du Chasseron depuis les Cluds par la Bullatonne, avec le soleil à notre gauche et puis le soleil devant nous, je me rappelle maintenant, on était sur le dos de la bête, les sapins étaient salement recouverts de blancs d’oeuf meringués, des lambeaux de neige pendaient aux branches comme des nids de fourmis processionnaires, les épicéas avaient mis leur cime en berne et marchaient vers l’ouest encagoulés comme les dignitaires d’une tragédie cosmique.
Au Grand Hôtel des Rasses il y a foule ce soir, des couples de voyants et de malvoyants organisent un bal. L’un d’eux fait bande à part et caresse du bout des doigts le crépi du mur, c’est ainsi qu’il prend connaissance des lieux, son accompagnant tourne les pages du journal. Je crains qu’ils se mettent à parler de l’avalanche du Bec des Etagnes, qu’ils mettent de l’huile sur le feu et invectivent des innocents. Mais un autre sujet domine l’actualité, la viande de cheval dans les plats précuisinés.
Jean Prod’hom
Les Rasses

Les parasols du Grand Hôtel des Rasses sont baissés, personne à la réception, cheminée close, la clientèle est bruyante, dehors la neige a les dents jaunes. La publicité ne le dit pas mais le balcon du Jura fait voir depuis quelque temps déjà les pointes tordues de sa ferraille rongée par le froid et la rouille, le béton pourrit en beaucoup d’endroits, les enduits sont à refaire, maisons fermées, va-et-vient des pendulaires, châssis de guingois.
Malgré le soleil, la bande large d’une centaine de mètres entre pâturages d’en-haut et bois d’en-bas n’est pas belle à voir. Il vaut mieux l’habiter que de l’avoir sous les yeux. Les architectes et leurs commanditaires y ont mis du leur, l’argent qui manquait, la hâte, les sociétés de développement n’ont pas levé le petit doigt, ils ont tous ensemble défait la fragile avant-scène de cet arrière-pays.
Il y a eu dans la gestion de ces paysages idylliques entre ciel et terre un flottement sensible dans les dernières décennies du XIXème siècle qui a conduit leurs habitants à remettre aux Anglais la clé de certaines de leurs terres. Ils y ont élevé de grandes demeures, lourdes mais bien calibrées, ici dans le Jura, mais aussi dans tous les territoires alpins situés entre 1000 et 1500 mètres. Les autochtones flairant l’aubaine ont suivi les Britanniques en vendant lopin par lopin l’ensemble de la couronne du plateau, à la lisière des bois et des pâturages. On est passé de l’hôtellerie de luxe aux résidences pavillonnaires, du lourd collectif au léger privatif.
Les tôles se tordent, il pleut dans les granges, les balles sont trouées et parfume l’air d’herbe rance, les lambeaux de tavillons pendent dans les assiettes, on a peint quelques maisons, jaunes, vertes ou roses, ketchup suédois ou moutarde finlandaise. Pas la peine de refaire les façades et les descentes de chenaux, il y a si peu d’argent.
Je suis allé voir plus loin, mais il n’y a rien au-delà de Sainte-Croix, au-delà du col des Etroits, après l’Auberson et les Verrières, à l’arrière de l’arrière pays du pays du Haut-Doubs qui s’épuise de vallonnement en vallonnement. Quelques engins militaires vont se perdre dans leur tenue de camouflage au fond des vallons. Depuis les derniers essartages médiévaux, il ne s’est pas passé grand chose dans le coin, mis à part l’accueil de l’armée de Bourbaki
Antonietta pelle depuis son balcon la neige qui s’est amassée sur l’une des ailes de sa grande maison, elle a enveloppé sa mise en plis d’un filet rose, ses bigoudis s’agitent comme des chenilles. Elle me raconte les beaux-jours, son mari travaillait aux CFF, ils ont acheté cette maison à un notaire de Fleurier qui montait jusqu’à Sainte-Croix à pied avec sa famille, week-ends et vacances. Le mari d’Antonietta est mort en 1964, elle est restée là, jamais eu le courage de retourner à Bergame d’où elle est originaire, elle a deux filles qui travaillent en plaine, elles viennent la voir régulièrement. Et puis, me dit-elle, il y a ces écureuils qui viennent la voir chaque matin et qui la réjouissent.
Jean Prod’hom
Lemmes (9)
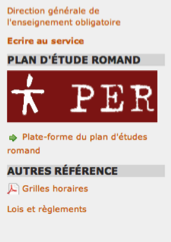

Sur la plate-forme en ligne du nouveau Plan d’études romand qui doit permettre aux enseignants de la région d’organiser leur travail dans les années à venir, on peut lire sur la même page les deux transcriptions suivantes : Plan d’étude et Plan d’études. Il semblerait donc bien qu’on ait hésité sur la nature de l’étude jusqu’au sommet et que les autorités ont souhaité garder une trace de cette hésitation en page de garde, comme elles l’avaient d’ailleurs déjà fait à propos du Plan d’études vaudois.
Pour le reste elles ont tranché en choisissant dans le gras de l’ouvrage la seconde transcription : Plan d’études. On peut raisonnablement apporter notre soutien à une telle décision, comme à celle qui a conduit jadis à parler de Mathématiques (et non de Mathématique), de Sciences (et non pas de Science). Faudrait-il encore que nos décideurs s’en expliquent. Pourquoi Histoire et non pas Histoires ?
J’aurais penché de mon côté pour l’autre transcription, Plan d’étude, arguant du fait que les enfants d’aujourd’hui, comme ceux d’hier et d’ailleurs, ont plus que jamais besoin d’apprendre à penser en intension plutôt qu’en extension. Tout n’est en effet pas comptable, ni le sel de l’existence ni le silence. Et pour l’étude, pas besoin de châteaux ou de palais, un simple plan de travail et un abri auraient suffi.
Jean Prod’hom
Lemmes (8)

Les manuels scolaires, les plans d’études, les lois et les règlements constituent les différentes parties de l'ancre qui interdit au vaisseau-école d’appareiller et de changer d’horizon. Trop gros désormais, trop lourd pour le stopper si on le mettait en route. On le maintient donc à une certaine distance de l’administration qui le surveille à quai, houle et clapotis. Des spécialistes s’assurent que les maillons de la chaîne tiennent, densifient les corps-morts, tiennent à jour des cartes maritimes devenues inutiles, font repeindre la coque du bâtiment, jettent du pain aux goélands qui crient. Il sera toujours temps de mettre ce Titanic en cale sèche si le vent forcit.
J’appellerais volontiers cette entreprise, si l’expression n’était pas trop forte et utilisée à mauvais escient, une kremlinisation de l’école.
Mais regardez bien tout autour de l’auguste embarcation, regardez la multiplication des petits rafiots qui fendent l’eau, récupèrent ce que le grand ne digère pas, regardez les barques et les pédalos, solitaires, radeaux, périssoires, mystics de luxe ou gondoles, regardez les remorqueurs, barquettes et youyous, bachots et optimists que barrent des bénévoles ou des requins, des coachs de toutes obédiences, des répétiteurs et des répétitrices, des grands-parents, des amis, des psychologues et des gourous. Cette population qui grouille tout autour du mastodonte, ce n’est pas très bon signe.
Oui, quelque chose flotte et le gros temps guette.
Jean Prod’hom
Lemmes (7)

Curieux d’imaginer les complets et les vestons, le bruit feutré des pas sur la moquette des longs couloirs et des bureaux cossus du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, les chuchotements, les briefings et les débriefings, les petites rivalités, les postes à repourvoir, les départs à la retraite, les papiers qui s'échangent, les agendas qui débordent tandis qu’à l’autre bout du monde, à Combremont-le-Grand ou à Combremont-le-Petit, un enfant pleure à la sortie de l'école pour une mauvaise note qu’il n’ose pas ramener à la maison. Et, tandis qu’il le regarde par la fenêtre s’éloigner avec le sentiment d’être un moins que rien, le maître regrette une fois encore d'avoir suivi des directives assassines.
Jean Prod’hom
Lemmes (6)

Si le ton supérieur hiérarchique te répète avec force que tu es un professionnel, il t'avertit simplement qu'il n'entrera pas en matière sur la question qui te préoccupe, qu'il va falloir te débrouiller seul et qu'il ne te soutiendra pas s'il y a du grabuge.
Combien sont-ils ceux que la hiérarchie n'a pas reconnus dans ce qu'ils faisaient, qui hébergent au-dedans d’eux un silence plein de rancœur et qui caquètent au tea-room ?
L’institution a pour tâche essentielle de soutenir ceux des siens qui proposent un avenir meilleur à ceux pour lesquels elle a été conçue. C'est au suicide que l’institution se prépare en se donnant pour seule fin celle de sauver les apparences, de se reconnaitre dans ce qu'elle était par la neutralisation de tout ce qui dépasse, par l'aménagement de fausses avenues et l’interprétation triviale du principe d'identité.
Jean Prod’hom
Lemmes (5)

En guise d’avertissement pour une absence dont il avait pris soin d’exposer spirituellement les raisons et qui ne semblait pas porter préjudice à la bonne marche de l'institution qu’il animait par ailleurs sans compter, un enseignant de mes amis reçut de son employeur le pataquès suivant : « J’aimerais vous rappelez la règle !» L’employeur exposait ensuite, dans la langue du caporal, les habitudes en la matière et esquissait une morale de Père Noël.
Par manque de courage peut-être, ou parce que le bon sens ne l’a jamais quitté, mon ami du bout du lac n’a pas osé, par retour du courrier, renvoyer le bonhomme à une règle orthographique qui ne souffre aucune exception.
Il ne faut pas réveiller le Léviathan qui dort.
Jean Prod’hom
Lemmes (4)

L’apprentissage est un jeu solitaire qui se joue à plusieurs.
Le maître est celui qui s’honore – et se satisfait – d’assurer l’existence de la case vide dans un jeu de taquin aux dimensions du monde. Un vide essentiel sans lequel les choses, la respiration, le mouvement et la rencontre des êtres ne sauraient se concevoir.
Le silence du maître, les haies dans le paysage, la case vide au jeu du taquin, c’est tout un.
L’école conçue comme chaîne industrielle (Bernard Collot) craint comme la peste les trous, les vides, le ciel, si bien que la machine scolaire ne dispose plus de jeu, les esprits s’échauffent, l’air devient chaque jour plus irrespirable.
- Les élèves voudraient combler au plus vite le vide que leur impose leur maître.
- Pourquoi ?
- Pour passer à autre chose.
- Mais à quoi ?
- A quelque chose qui n’aurait pas de jeu.
Jean Prod’hom
Lemmes (3)

Les élèves ignorent où se trouve leur maître, non pas qu’ils soient ainsi sous une menace continue, mais parce que le maître est nulle part. Que ceux qui le cherchent ouvrent les yeux, le trouvent au dedans et l’en chassent pour accéder à eux-mêmes.
Le maître se doit d’accompagner ses élèves au plus vite là où il n’est jamais allé, c’est-à-dire n’importe où.
Le maître dit à ses élèves : vous accéderez au monde lorsque vous vous intéresserez passionnément à ce qui ne vous intéresse pas, à ce qui ne m’intéresse pas, c’est-à-dire à ce qui n’intéresse personne. Sinon vous désormais.
Jean Prod’hom
Lemmes (2)

Le maître souhaite que ses élèves puissent faire leur vie sans lui. Mais s’il le veut c’est tout autant pour lui que pour eux. Car en se débarrassant d’eux le maître se débarrasse aussi du maître qui s’accroche en lui et qui alourdit ses pas.
Se débarrasser de ses élèves n’est pas tâche aisée car le maître n’a pas d’autre point d’appui pour y parvenir que les élèves eux-mêmes.
Tout ce que dit, fait ou montre le maître n’est qu’un leurre pour détourner son élève de ce face-à-face dont celui-ci attend tout, et lui désigner ce qu’il ne voit pas. C’est seulement lorsque l’élève se satisfait de la crête des vagues, des verbes être et avoir que le maître invite l’élève qui sommeille en lui à reprendre les choses à l’endroit où il les a laissées, sur la terre, dans le ciel et dans la mer.
Jean Prod’hom
Lemmes (1)

La vie du maître apparentée à celle du larron est faite d'occasions, le cahier de préparations est l’une des sept plaies de sa profession.
Sa tâche principale – essentielle – consiste à jouer petit, très petit, plus petit encore, pour que ceux dont il a la charge soient amenés naturellement à prendre la main. Même les plus récalcitrants. Comme au bridge. Pour autant que les uns et les autres jouent le jeu.
Quoi qu’on en dise le maître joue ses cartes à l’estime. Mais il se doit d’inviter ceux qu’il accompagne bien loin de l’école à faire une halte après chaque coup. C’est de son devoir de les obliger à se retourner pour tracer le chemin parcouru sur la carte de leurs pérégrinations, à regarder où pourrait les mener le pas suivant, de s’y rendre ensuite.
Jean Prod’hom
Il y a Donneloye

Il y a Donneloye
l’étang de Berre
la mer de Marmara
il y a Thulé
le Grimsel
et Joe Dassin
il y a Las Vegas
le Klondike
Tegucigalpa
Jean Prod’hom
La comparaison est comme une parabole

Il arrive un instant où celui qui s’aventure à comparer une chose avec une autre s’essaie non plus tellement à faire entendre ou faire voir un aspect tenu secret de la première par le truchement de la seconde – qui, nous fait croire la rhétorique, le serait resté sans ce recours à l'évidence –, mais à faire sauter tout au contraire le verrou de ce qu’il croyait savoir des secondes en recourant à quelque chose dont personne n'attendait la métamorphose et qui se trouve soudain précipité dans un espace inconnu, débordant sur le noir qui enveloppe les deux parties et dans lequel l’énigme étend son empire.
Comparer c'est remettre pacifiquement les choses – et nos vies – à ce mystère dont elles proviennent et sur lequel elles prennent appui quel que soit notre usage du monde, c’est les plonger les unes et les autres en-deçà ou au delà d'elles-mêmes, c'est-à-dire à côté.
Il est un moment où le rapprochement de deux choses – de deux mondes –, devient au yeux de celui qui en est l’artisan comme la parabole de son ambition, celle de faire un détour par les sources pour donner son assentiment à l'inachèvement de chaque chose, car aucune ne s'appartient, chacune est tout autre. Revient à celui dont les pieds se dérobent la tâche de recoudre les morceaux d'un patchwork qui ressemble toujours davantage à un monde décousu, libre, affranchi des convenances.
Jean Prod’hom
Cimetière de pierres tombales

Le saxophone avait creusé l’espace du grand salon et de la salle à manger des Cerisiers, tapissé ses murs de blancs et d'ors et le plafond s’était exhaussé. Pas de croissants ce matin-là mais une cuchaule, on avait bu un café en parlant de choses et d’autres, de nos enfants, du travail, des dimanches si bons à tout faire, on ne s’était pas revus depuis un mois.
Dehors il faisait cru, on a emprunté un sentier dérobé qui serpente entre locatifs et villas jusqu’au cimetière de Pully. On est allé saluer Charlotte, le soleil est revenu. Au nord, la série des tombes en ligne de la classe 1992 dont les autorités compétentes avaient annoncé la désaffectation au début de l’année avait disparu, les jardiniers du service des parcs et promenades avaient liquidé les pierres et les entourages, gazonné ce qui n’était plus qu’un tertre, regroupé les croix de bois avec les déchets encombrants au bas du cimetière.


Mais où passent donc les pierres et les bordures qui recouvrent ceux qui sont morts ? Où est par exemple la pierre tombale de ma grand-mère Hortense Rossier, morte en 1966, avec son nom dessus, que je n’ai pas retrouvée l’autre jour dans l’ancien cimetière d’Epalinges ? Et toutes les autres pierres ? Et tous les autres noms ?
Impossible d’obtenir des renseignements à Pully, je téléphone donc au responsable du Service des travaux d’Epalinges qui n’en sait rien, mais qui me donne les coordonnées du chef de service du Bureau de la Sécurité publique et Police administrative. Ma demande le surprend, il se souvient pourtant bien de cette opération de désaffectation, plus de soixante tombes, cinéraires ou de corps, son service avait averti comme il se doit les familles par la publication d’un billet dans la Feuille des Avis Officiels, elles pouvaient venir récupérer les os et les pierres, le service avait en outre fait placarder des avertissements dans la partie du cimetière concernée plusieurs mois avant le début des travaux.
- Ça fait déjà deux ans cher monsieur ! Quant aux pierres, j’ignore ce qu’on en a fait, je vois demain le responsable de l’entreprise qui s’est occupée des travaux, donnez-moi votre adresse, je vous enverrai un mot. Et rassurez-vous, il n’existe pas de marché parallèle, les pierres ne sont pas utilisées une seconde ou une troisième fois.
J’apprends toutefois, par Internet, qu’en 2006 des monuments funéraires d'occasion provenant de concessions échues ont été mis en vente à Quimper et qu’en 2009, dans une petite ville de Vendée, on a proposé aux internautes d'acheter aux enchères des pierres tombales d'occasion de son cimetière.

Grégoire Favre, Cimetière de pierres tombales, 2012

Grégoire Favre, Cimetière de pierres tombales, 2012

Grégoire Favre, Cimetière de pierres tombales, 2012
Je tombe finalement sur trois belles photos que Grégoire Favre a prises le 27 octobre 2012 dans la région de Sierre et qu’il a intitulées Cimetière de pierres tombales. Internet a vraiment simplifié nos vies, il me suffit de quelques clics de souris pour savoir à qui appartient cette inquiétante décharge. Il s’agit d’une entreprise – catégorie : commerce de gros de matériaux de construction – dont le but est le commerce de pierres naturelles, de produits manufacturés à base de pierres naturelles, d'articles funéraires, marbrerie et sculpture ainsi que toutes activités analogues. Cette entreprise affiche ses compétences dans l’art funéraire – pierres tombales, bordures, sculpture –, mais aussi dans la conception de cheminées, de fourneaux et de poêles. Je décide de lancer un coup de fil au patron pour en savoir un peu plus.

Google Earth, 1 novembre 2009 | élévation : 807 mètres
Il m’explique gentiment que cet amoncellement de pierres tombales n’est pas une décharge mais un dépôt. En effet, me dit-il, ces pierres vont retourner sous peu au cimetière. Elles ont été placées chez lui en attendant, parce que certaines tombes ont été réouvertes pour y placer un époux, une épouse, un frère ou une soeur. Dans une année ou deux, les familles viendront reprendre la pierre sur laquelle ils feront ajouter le nom du ou des nouveaux locataires avant de la replacer là où elle était.
A l’allure de cet amoncellement, je m’inquiète de l’état dans lequel les familles vont retrouver leur monument. Il m’explique alors qu’il y a un certain nombre de pierres qui proviennent en effet de tombes désaffectées et que les familles n’ont pas réclamées.
- On puise dans ce stock lorsqu’il faut faire des petites réparations ou des petites combines. Faut que vous sachiez que lorsque ces pierres sont retaillées, elles sont comme neuves.
Vais aller faire un tour du côté de Sierre, voir si je ne trouve pas dans cette montagne de pierres à l’abandon celle de ma grand-mère, en cupesse, avec Hortense Rossier écrit dessus. Il y a anguille sous roche, la tombe d’une protestante en pays catholique, ça va chercher loin.
Jean Prod’hom
Fenêtre de Balthus à Rohan
Personne dans ton dos, personne dans le couloir, personne dedans la pièce sur laquelle la fenêtre s’ouvre, c’est le moment. Tu te penches, passes délicatement la main sur la gorge du battant du vantail droit et sur le battant mouton du vantail gauche, effleure le fer de la gâche inférieure à l’intérieur de laquelle s’engagera, lorsque tout sera terminé, la tringle de la crémone. Tu poses tes yeux sur l’appui fenêtre et les ombres du dormant.
Puis tu mets la tête dehors, sans toucher ni au couteau ni au pichet, regardes en-dessous ce que le peintre n’a pas daigné montrer pour tordre le coup aux idées, tu aperçois alors l’ambition démesurée de ce faussaire obstiné qui témoigne, mieux que les penseurs, de ce dont le monde est fait. Le peintre est en-bas, au pied du mur, il a repris une fois encore le tout depuis le début, la lumière et l’ombre, le dedans et le dehors, le temps qui passe et les rideaux que le vent fait onduler : c’est sans fin que le le vernis s’écaille.

Balthus, La fenêtre, cour de Rohan, 1951, Troyes
Fenêtres,
de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte...
DU 25 JANVIER AU 20 MAI 2013


Jean Prod’hom
CXIV

C’est pure folie d’enseigner aux adolescents passés maîtres dans l’élaboration de stratégies d’évitement l’étude des probabilités.
Jean Prod’hom
Désaffectation

La fraicheur du tombeau pour une minorité, sans doute. Et qui se souviendra d’eux, d’ailleurs est-ce qu’on se souvient ? Le souvenir, la conservation et la sauvegarde, écrivait Pierre Bertaux il y a déjà trente ans, à propos de la mutation de l’humanité, n’étaient indispensables qu’à une époque où la densité des habitations était faible, rares les objets fabriqués par nous, et où l’espace était abondant. A cette époque, tous étaient indispensables, même ceux qui étaient morts. En revanche, dans les conurbations de la fin du XXe siècle, où chacun est remplaçable dans l’instant, et en fait superflu dès sa naissance, il importe de jeter sans cesse du lest par-dessus bord, d’oublier sans réserve tout ce dont on pourrait se souvenir, la jeunesse, l’enfance, l’origine, les aïeux et les ancêtres. Pendant un certain temps il y aura encore ce « Memorial Grove » qui vient d’être instauré récemment sur Internet, où l’on pourra ensevelir et visiter électriquement ceux qui vous étaient particulièrement proches. Mais ensuite ce virtual cemetery lui aussi se dissoudra dans l’éther, et tout le passé se diluera en une masse informe, non identifiable et muette. Et issus d’un présent sans mémoire, confrontés à un présent que la raison d’un seul individu ne peut plus saisir, nous finirons par quitter nous-mêmes la vie sans éprouver le besoin de rester encore ne serait-ce qu’un instant, ou de revenir à l’occasion.
La femme d’un ami s’est noyée l’été passé, coup de tonnerre, on s’était promis alors de se revoir plus régulièrement, maigre consolation. L’été a passé, l’automne aussi et puis un bout de l’hiver. On s’est revus finalement il y a quelques semaines, c’était un samedi matin, deux de ses trois filles étaient là, ils vivaient aussi bien qu’ils le pouvaient, ils avaient eu des moments difficiles, on a parlé de choses et d’autres. On a convenu de se rencontrer régulièrement le premier dimanche de chaque mois, le matin seulement car il n’a pas beaucoup de temps, il doit s’occuper de ses trois filles et il travaille dur. Il m’a raconté également qu’il se rendait souvent au cimetière pour entretenir le petit coin de terre où sa femme repose désormais, aménageant et conjurant par des minuscules attentions ce qui ne se peut pas. Nous sommes allés au cimetière ensemble, il faisait beau, on a visité : allées et contre-allées, bosquets, l’eau ne coulait pas dans le bassin. Il y avait du remue-ménage au nord, des pancartes glissées dans des dossiers transparents annonçaient que des travaux de désaffectation commenceraient le premier janvier dans la section du cimetière contenant des tombes de la classe 1992, tombes de corps et tombes cinéraires, mais aussi urnes et ossements qui y avaient été placés ultérieurement. Nous étions le 5 janvier.


Vingt ans donc pour oublier ceux dont on voulait se souvenir et qu’on a dû, faute de moyens peut-être, enterrer en ligne. Mais les panneaux avertissaient les familles qu’il leur était possible encore de retirer les monuments funéraires et les urnes s’ils en faisaient la demande par écrit avant le 31 décembre. Passé ce délai, les monuments et entourages seraient détruits. Nous avons été soudain scandalisés de la manière dont notre société traite ses morts. Vingt ans c’est bien peu, il y a des désaffectations qui ressemblent étrangement à des profanations.
Le lendemain de notre balade au cimetière de Pully, j’ai lu un billet dans lequel François Bon, entre granit rose au carré et empilement de cendres en boîte, désespérait de voir comment notre société sans rite tente d’accommoder ses morts. Nous ne sommes donc pas seuls.
Je retrouve mon ami demain matin, je lui ai promis de lui apporter Campo Santo, le texte que Sebald a consacré au cimetière de Piana en Corse, j’en ai fait une copie l’autre jour, j’amènerai aussi des croissants. On ira faire ensuite un tour du côté du cimetière pour dire bonjour à Charlotte et voir où en sont les travaux de désaffectation réalisés par le service des parcs, des promenades et des cimetières de la ville de Pully.

Pully | Google Earth, 1 août 2012 | élévation : 807 mètres

Pully | Google Earth, 1 août 2012 | détail

Jean Prod’hom
Il y a la soupe

Il y a la soupe
les parenthèses heureuses
les plans de départs volontaires
il y a les mocassins
les Flandres
les volets ajourés
il y a l'âge de raison
les dessertes locales
il y a les lumières de la ville sur lesquelles la nuit souffle
Jean Prod’hom
Belle et noble contrée

J’écluse à petites gorgées un verre de Païen de chez Claude Clavien de Miège dans le salon du rez-de-chaussée de l’Hôtel du Parc, les fauteuils sont vides. Tandis que le jour s’enfonce dans la nuit en arrière du val Ferret, un pianiste enchaîne des standards dos au mur, je fais les comptes.

L’hôtel a certainement changé, les parquets flottants couinent à peine, les baies vitrées ont remplacé les portes-fenêtres, le béton le bois. Mais quelque chose, je le sais sans savoir exactement quoi, n'a pas quitté la butte de Montana, quelques mélèzes s’en souviennent : Louis Antille, c’est sûr, Placide et Alcide, Géo et Algé, Otto et Jacinthe, les mulets chargés. Depuis 1892 les Alpes n’ont pas bougé, le Rhône qu'on devine en bas à peine, mais ce qui s’est perdu dans l’aventure, ça je le sais aussi, c'est la déshérence, l’éclat des lacs et l’herbe des pâturages. Personne n'a rien vu venir ici, le père de Gaby a vendu un peu de terrain, acheté des appartements, des gars véreux ont promis le paradis sans donner d’adresse, les Russes viendront demain pour remettre des millions dans l’alambic et sauver ce qui ne ne l’est plus, personne n’a jamais arrêté ce qui ne s’arrête pas. Tout a passé de main en main sans que rien ne soit à personne. Et mon copain Jeff, le gros loup de Chermignon ne voit guère comment il eût pu en être autrement.
La nuit tombe sur la belle et noble contrée, de l’autre côté le vent souffle sur les braises d’Hérémence, quelques arbres me cachent le reste.
Jean Prod’hom


Architecture sanatoriale

La conception des bâtiments locatifs des grandes cités européennes de la seconde moitié du XXème siècle vient tout droit de l'architecture sanatoriale alpine de la fin du XIXème siècle et de la première moitié de celui qui suit. Longs vaisseaux symétriques, orientation sud-ouest-nord-est, parallélépipèdes sans poupe ni proue aux larges flancs et à angles droits, façades malvoyantes au nord mais ouvertes au sud sur de larges baies, balcons supportés par des colonnes qui rappellent, en plus rustique et armé, l'art de construire des renaissants florentins.

Ces bâtiments néoclassiques de Montana commandités par les cantons de Lucerne, Genève, Berne et du Valais témoignent d'un vieux rêve que les hommes ont raisonnablement fait naître, rêve de ceux qui ont sué en contribuant, souffrant, à l’augmentation des richesses de ceux qui soignent leurs dépenses, ces industriels qui ont transformé comme en écho, au même lieu, des raccards et des mayens en les recouvrant de lauzes doublées d’hermine, chalets ou palaces. Ce rêve, ils n’ont eu le temps que de le faire passer plus loin, trop de travail, des heures supplémentaires jamais payées, leur vie en gage ou en nantissement. Comment dire ça ?
Parce que la vie des tuberculeux de la fin du XIXème siècle, chaque fois que cette vie est restée à bonne distance de la mort, s’est approchée d’un rêve, vie douce loin de l’éternité, la seule qu'on peut espérer. Les malades de ce temps, patients comme nous tous, nous rappellent aujourd’hui encore notre condition de mortel, un jour encore si Dieu le veut, l’éphémère se prolonge : une nourriture satisfaisante, le repos, allongés dans les transats de l’un de ces vaisseaux pris dans la glèbe, à la cape, soleil, grand air, Dent Blanche, Mont Blanc, Tête Blanche, une pensée pour ces proches qu'on a dû quitter.
La vie au sanatorium apparaît aujourd’hui comme un rêve réalisé, celui que les Lumières avaient fait naître un peu plus d'un siècle avant la naissance de l’Hôtel du Parc de Montana, paix perpétuelle, acceptation de nos finitudes, le temps de vivre. Mais on se penchera encore sur le miracle du temps qui passe juste à nos pieds, le sud au sud, et du balcon droit devant la montagne magique.
Jean Prod’hom
CXIII

Il aura suffi de deux jours à Crans-Montana pour que je me mette à parler de dollars et d’euros, de yorkshires et de zones à bâtir, de faillites, des fils Hariri, de David Halliday ou de Roger Moore. Et voilà que cet après-midi déjà je me retourne sur les ronflements des limousines devant la boutique de chez Carmelo, je veux en avoir le coeur net, mais pas de prix sur les pare-brise.
Au Senso, le soleil ne s’est pas levé. Des hommes d’affaire ont rejoint des retraités aisés, ils boivent dans de grands verres évasés des vins sucrés, assis dans d’épais fauteuils de cuir noir à l'abri des intempéries et de l'esprit, sous les jupes d'un luxe épuisé. Ce soir je lirai Gala.
Jean Prod’hom
Rien d’autre que le noir et blanc



Ciel boueux, temps sale, une poignée de moutons lèvent la tête au large de Bex, maigres dans l’herbe rase. Du rimmel dégouline de Morcles, ça ne rigole pas, impossible d'essorer à mesure. Des fuites de gasoil ravinent les allées des jardins ouvriers, arbres décharnés, écorce de bouleau, Rhône gris, pylônes, fantômes et squelettes dans la détrempe, cendre noire au pied des allées de peupliers. L’autoroute plonge sous des ruines, le vent tiède s'engouffre dans les tunnels des maraîchers ouverts sur des perspectives vides, ils abritent des balles de foin éventrées et des fils de fer orphelins. On a enroulé sitôt les récoltes terminées les filets noirs des vergers, les sarments grincent des dents, deux corneilles grimacent sur le rebord d’un tonneau de vidange, à côté de lourds containers dans un cimetière agricole. Rien d’autre ce matin que le noir et blanc, un peu de mauve, un cortège de véhicules processionnaires et de la tristesse.
Jean Prod’hom
Pas de trace

Je suis parfaitement conscient du sort que le terme clé de « réel » a subi depuis Wittgenstein, écrit Erving Goffman dans ses Cadres de l’expérience. Moi aussi, mais ce sort est en définitive celui de n’importe quel concept, clé ou secondaire, passé par les aménagements de l’esprit, que ce soit celui de Wittgenstein ou celui du premier venu. L’inouï c’est que ces termes passés au feu, à l’enclume, recyclés, laminés, affinés n’ont laissé à la fin aucune trace de leurs vicissitudes. Et la mer, la neige et les nuages reviennent dans le ciel comme aux premiers jours.
Jean Prod’hom
La Roche-La Berra

On est une vingtaine sur le flanc oriental du bassin de la Serbache, une fin d’après-midi qui est déjà la nuit, on monte raquettes aux pieds dans le bois de La Joux en direction du Gîte d’Allières.
C’est la pleine lune ou presque, les épicéas font écran, mais ses feux pâles parviennent à se glisser jusqu’aux deux rives du ruisseau de Stoutz dont ils éclairent le tracé capricieux. On se suit à la queue leu leu sur un chemin bougrement intelligent qui se joue des ravines et des combes, un chemin qui s’éloigne parfois de la meilleure pente qu’a choisie le ruisseau, c’est une nécessité, il fait alors de longs méandres avant de se lancer dans la pente raide et rejoindre les rives de son compère, ils ne se perdent jamais de vue très longtemps, font parfois un bout ensemble, il sont comme deux attributs de la même substance, deux traductions d’une même réalité, deux caprices. Je me plais à les imaginer tous les deux dans la nuit déserte, libérés du soin de conduire et de nourrir les passants, le ruisseau qui chante et le chemin qui danse.
On fait une petite fête au Gîte d’Allières assis sur des bancs : vin rouge, thé chaud dans un long couloir que parcourt un vent froid, pain et fromage, vin blanc, un air d’accordéon à l’étage.
Il est 23 heures, brève halte sur la tête d’Allières avant de redescendre dans la plaine. On devine à nos pieds le Javro, la Valsainte et la route qui mène au Lac Noir. En face les Dents Vertes et la vallée de la Jogne, plus au sud Brenleire et Folliéran. On choisit d’emprunter les larges avenues des pistes, plus de chemin, les frontales des skieurs ont disparu dans la nuit, on est les derniers. Je prends quelques photos avec l’appareil que Sandra m’a apporté vendredi, m’attarde, suis le dernier des derniers, la lune fait le reste. J’aurais voulu au fond qu’on m’oublie, mon dos ne me fait plus mal, demeurer un instant encore dans ce pays d’une autre substance, tourner les pages de cet album de cartes postales colorisées, le froid tenu à bonne distance, à peine des couleurs.
Jean Prod’hom












Il y a les courts métrages

Il y a les courts métrages
le creux des vagues
le creux des barques
les longs silences sur Twitter
la migration du gibier
il y a la rumeur des foires lointaines
les conditions initiales
il y a le travail honnête de la caméra
le travail moins honnête du cinéaste
Jean Prod’hom
-oir

Déclinoir : plan social
Roupissoir : local sans porte ni fenêtre ouvert l’hiver aux sans-abris
Désiroir : benne dans laquelle sont jetés les jouets en fin de vie
Douloir : recueil de complaintes
Editoir : pièce à température constante dans laquelle s’affairent des robots
Bouchoir : mouchoir de qualité supérieure
Cernoir : quartier malfamé des enfers
Décrochoir : école obligatoire
Pleuroir : A côté du boudoir
Plaignoir : morceau de lin qu'on plaçait sur le visage pour cacher sa tristesse
Rimoir : gueuloir de salon
Cheminoir : chemin de croix
Déridoir : rouleau pour aplanir les allées des grandes propriétés
Concessoir : chemin du pire
Hérissoir : atelier du ramoneur
Démentoir : conférence de presse
Jean Prod’hom
Demandes de grâce

Extraits du livre de prières placé sur un lutrin dans une absidiole de l’église de S.
Seigneur, protège A. malgré son acte irréparable, donne-lui la force de se pardonner un jour.
Mon dieux faite que mais veux soit realiser demin pour mais examins. Améne
Mon Dieu, aide-moi à garder la ligne quoi qu’il m’en coûte. J.-C.
Hier, il n’y avait plus d’allumettes pour allumer des bougies, c’était urgent. Je suis revenue aujourd’hui avec une boîte, mais il n’y a plus de bougies. Renonce, trouverai une autre solution.
Jean Prod’hom
Un matelas de crin dans la main

Du côté de mon père ça a été une autre paire de manches, parce que mon père a été lié simultanément au monde du travail et au tabac brun, comme toute cette génération de gardes-frontière helvètes mobilisés pendant la Seconde Guerre qui les a initiés, alors qu’ils avaient à peine vingt ans, non seulement au désoeuvrement mais à l’utilisation sans frein de l’herbe à Nicot.
Il fumait son paquet de Virginie sans filtre chaque jour, à l’usine, à neuf heures au café de la Couronne d’Or, à l’apéro et sur le trajet qu’il empruntait pour se rendre Rue des Deux-Marchés derrière le Tunnel. Jamais à la maison pour autant que je m’en souvienne. Il m’envoyait parfois au tabac du bas du Valentin lui acheter un paquet. Les jours de fermeture je faisais glisser dans l’automate une pièce d’un franc dont ressortait un paquet niché dans un tiroir, avec glissée sous le timbre qui en assurait la fermeture une pièce de quatre sous. Je remontais à Riant-Mont en palpant comme un aveugle cet objet plein du monde qui m’attendait, et emballé comme un cadeau.
Le plaisir d’avoir sur le chemin de retour tenu ce petit paquet à la dimension de ma main m’en annonçait d’autres, sa molleté ferme me procurait une sensation comparable à celle que le corps éprouve au contact d’un tapis de bottes de foin ou d’un matelas de crin, mais avec le curieux sentiment de le tenir dans la main, d’en faire le tour comme lorsqu’on tient une rampe d’escalier polie par les ans.
Jean Prod’hom
Une cigarette du bout des lèvres

Une ou deux fois par année j’ai vu ma mère fumer une Kent. Elle prenait alors les traits de cette jeune femme émancipée aux cheveux noirs et courts qui apparaissait sur les paquets de MaryLong : rouge à lèvre, double rangée de perles au poignet, foulard bleu au vent, je l’imaginais sous le soleil et sans nous au volant d’une décapotable.
La plupart du temps on roulait en famille, dans une 4 L d’abord, dans une Simca 1100 break ensuite. Plus tard ma mère a revendiqué le droit de ne pas avoir de permis de conduire, c’était une manière à elle d’y renoncer la tête haute.
Jean Prod’hom
Diligences

A l’endroit où le Trient déboule dans la plaine les églises ressemblent à des centrales hydrauliques, les postes électriques à des cimetières. Les langues sont en très grand nombre le dimanche dans les cafés de Vernayaz, chacun se tait. Et le Rhône bleu de sable pousse ses laves dans un lit creusé jusqu’à Marseille.
Jean Prod’hom
76

A trop prêter l'oreille à ce sur quoi l’autre s’étend, on devient muets d’abord sourds bientôt ensemble. Cette règle ne souffre d'aucune exception.
Jean Prod’hom
Après 1968

La cohorte des maoïstes, des staliniens, des trotskistes ont trouvé refuge dans le journalisme, l'instruction publique, les officines de médiation, à deux pas des champs de bataille qui font rage sans y mettre les pieds. Mais dites-moi, qu’aurait-on fait et que serait devenu le monde sans eux ? Que ferons-nous quand ils se seront tus, lorsque ces rêveurs auront rejoint le rivage des vieux combattants ?
S'il faut craindre chaque jour davantage que des enfants ne viennent armés dans les établissements scolaires et ne lâchent de dépit une rafale sur leurs camarades et leurs enseignants, ne faut-il pas s’attendre à ce que ceux-ci ne les singent pas un jour ?
Il ne faut pas s’en inquiéter pour l’instant, me dit Samuel, ce sont tous d'anciens gauchistes qui font du tir à l'arc.
Mais quand ceux-ci ne seront plus ?
Et hop! se dit-il fatigué d'avoir le cul entre deux chaises. Et il vécut debout.
Jean Prod’hom
Il y a l'intraitable pauvreté

Il y a l'intraitable pauvreté
le rock'n'roll
les reins des péniches contre les talus
les coups de pouce
il y a les bribes de conversation
les forfaits fiscaux
il y a le soleil
les tomates
et les aubergines
Jean Prod’hom
Une dernière clope

Deux hommes d’âge mûr conversent à la table voisine, le visage marqué, passent en revue les épisodes de leur chemin de croix, s’étonnent : « Tiens, on vit le même calvaire ! » Les deux lascars ont en effet cessé de fumer un nombre incalculable de fois, ont recommencé autant, ils rient heureux d’être semblables, ils avaient juré pourtant par tous les dieux qu’on ne les reprendrait pas, que c’était la dernière fois et la dernière clope qu’ils le disaient et sur laquelle ils tiraient. Le vice les tient fermement dans sa pince, ils oscillent entre les plaisirs qu’on se doit de ne pas refuser, on va tous crever, la vie est courte et les séductions d’une vie marquée par la vertu, le courage et les sacrifices. Ils racontent à tour de rôle leur inépuisable aventure, même rengaine, raisons, explications, justifications.

L’un d’eux l’affirme bien haut : coupables son père et sa mère, indécrottables fumeurs et cause première de son vice, qui fumaient à tout-va, jour et nuit, dedans comme dehors. L’autre raconte la pression qu’ont exercée sur lui les groupes d'adolescents au tournant de sa seizième année, le sésame que représentait une cigarette au bout de ses doigts pour être des leurs. J’hésite à m’inviter à leur table et verser ma contribution à ce procès. Je tiens moi aussi pour responsables de mon addiction mes copains d’alors, Michel, mon père et ma mère, mes parents et les lobbys de potaches. Mais je m’abstiens. (A suivre)
Jean Prod’hom
74

Il a neigé, tout est blanc, blanc comme l’hermine installée dans les sous-sols du pré à Max, elle hésite à se lancer incognito hors du terrier n’était le plumet noir à l’extrémité de sa queue.
Jean Prod’hom
Echec eschac skak

Une collègue me fait part cet après-midi de son étonnement. C’est incroyable, me dit-elle, les élèves ne supportent pas l’échec. Je me retiens de lui répondre parce que je ne sais ni quoi lui dire ni par où commencer. Et puis je connais la suite : la vie est ainsi faite, les enfants dont nous avons la charge doivent s’y faire, la vie est dure, il faut apprendre à rebondir, on ne réussit pas toujours, l’échec constitue une excellente préparation à la vie professionnelle,… Je décide de me taire et me dépêche de rentrer au Riau pour lire le Dictionnaire Historique de la langue française d’Alain Rey.

Deux histoires sont en concurrence sur l’origine du mot échec. Ce mot pourrait être une altération du latin médiéval eschac qui désignerait à l’origine l’interjection d’un des deux joueurs d’une partie d’échec, avertissant que le roi de l’adversaire est menacé. Ce mot serait emprunté au persan sah mat « échec et mat » qu’il faut traduire par « le roi est mort ». Une seconde origine proposée par Alain Rey et ses collaborateurs fait l’économie d’un détour non attesté par le persan. Il faudrait faire remonter l’origine du mot échec à l’étymon francique skak « butin, prise », si bien que l’ancien français eschac « prise de guerre » et eschac « pièce du jeu d’échec » seraient le même mot. Echec au roi signifierait « butin, prise de guerre », échec et mat signifierait « pris et détruit, mort », qu’on joue ou qu’on fasse couler le sang.
L’école est-elle pour nos gamins un divertissement au même titre que le jeu d’échec, ou une partie qui se joue au péril de leur vie ? une propédeutique où les coups se font pour semblant ou une première aventure à la vie à la mort ? Notre société hésite mais ne tranche pas.
Dans les mondes scolaires et professionnels, le mot échec est rapproché la plupart du temps du mot échouer qui semblent appartenir à la même famille, ce n’est en réalité pas le cas. Si l’origine du verbe échouer est incertaine – on a rattaché ce mot à échoir (excidere « tomber »), à escoudre « secouer » et à exsuccare « faire sécher » – tout devient plus clair du côté de son emploi. Echouer se dit en effet des embarcations qui filent le mauvais coton, celles qui « touchent le fond » et « ne peuvent plus naviguer ». On rencontre aussi un usage transitif de ce verbe, voici les vents, ils « poussent la frégate vers la côte » où ils l’échouent. C’est depuis 1660 seulement que ce verbe a pris le sens de « ne pas réussir » avant de donner à l’homme usé par la vie, deux cents ans plus tard, l’occasion de « s’arrêter en un lieu par lassitude ».
J’ai aperçu au tableau noir d’une classe où je me trouvais ce matin le mot de résilience, on l’enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge, ça peut servir. J’en rigolais hier, je me demande très sérieusement aujourd’hui pourquoi les parents et les avocats dont ils s’entourent depuis quelques décennies ne se sont pas mis à l’ouvrage et n’ont pas déposé une plainte devant la Cour pénale internationale de La Haye contre l'école qui met trop souvent leurs enfants en danger en les faisant échouer.
Il est heureux que les élèves ne supportent pas l’échec, mais qui bon dieu va nous faire sortir du Moyen Âge ?
Jean Prod’hom
Mon second film

Rome, Villa Adriana, 1973
Depuis Remparts, le film que nous avions tourné Jacqueline S, Michel S et moi en 1974, je n'ai plus touché une caméra. C'était un film d’adolescents attardés, une adaptation d'une nouvelle de Gilles Anex parue dans Ecriture 9, l’histoire d'une jeune fille qui se souvient de je ne sais plus très bien quoi. De cette aventure me restent en mémoire, à côté de l’amitié, une journée dans l'enceinte des ruines du théâtre romain d’Avenches et de quelques journées de tournage dans une maison de maître sur les rives du Léman près de Nyon, le château de Promenthoux je crois. De Michel en équilibre sur le dos de la Dauphine filmant l’héroïne sur le point de franchir un fossé, du bras droite de la comédienne, qui allait en tous sens mais dont on ne s’était aperçu qu’au montage,…
Michel venait de passer son permis de conduire, et on roulait avec la Dauphine que lui avait refilé son grand-père. On avait notre matériel dans le coffre, pas grand chose, une caméra, un trépied et deux heures de pellicule super 8 que nous avait fournie un cousin de Michel, Ernest Ansorge, cinéaste d'animation.
Ce film dont plus personne heureusement ne possède de copie avait eu les honneurs de la télévision suisse romande, un samedi en fin d'après midi. Marie-Madeleine Brumagne, la femme de Freddy Buache recevait de jeunes cinéastes. Ce samedi-là Michel Rodde, qui a fait une belle carrière depuis, a été interrogé d’abord, on a parlé ensuite, on a répondu tant bien que mal, je préfère ne pas trop savoir quoi.
Depuis plus rien, silence ou presque, quelques images en 1975 et 1976 dans le cadre du cours assez déjanté de René Berger à l’Université de Lausanne, intitulé Esthétique et mass-média : Les Voyages de Bougainville avec Christophe C, La Prise de Phnom Penh par les Khmers rouges avec Denis A, Une journée bien ordinaire avec Yves T et Françoise V.
René Berger est mort, la Revue Ecriture n’existe plus, plus personne ne cherche des pellicules, le montage ne se fait plus au scotch.
J'ai pourtant réalisé hier un nouveau film. Film c'est peut-être beaucoup dire, Arthur dit que c'est plutôt un diaporama. Il a raison je crois, mais c’est un début. Il est constitué de deux photos réalisées le matin même avec mon iPhone lors d'une promenade avec Oscar : une partie de la façade orientale du château des Jaunins, volets clos, avec à sa droite le rural, la maison des fermiers et le nouvel hangar ; la façade occidentale ensuite et l'entrée au bout de l'allée près de la fontaine. J’ai enregistré l’après-midi des bruits, sur mon iPhone encore : des pas sur un chemin enneigé dans le bois entre les hauts de Montpreveyres et la Goille, l’eau de la Broye lorsqu’elle coule au creux de Châtillens, les cris et les rires dans l’enceinte de la petite patinoire que les autorités locales ont installée cet hiver près de la gare, des conversations au café de l’Union, trois des quatre coups des cloches du collège secondaire d’Oron.
J'ai terminé le montage à minuit après avoir résolu tant bien que mal les problèmes techniques. Ce film dure un peu moins d’une minute et demie, je ne pouvais guère faire mieux, ni plus. J’aurais voulu le dédier à Fernand Deligny, à Robert Flaherty ou à Jacques Tati, mais j'ai préféré me taire pour ne pas me couvrir de ridicule. Je trouve pourtant que l’enchaînement des deux images, entre la 25ème et la 35ème seconde, avec les cloches et les bruit de pas, est assez bien réussi, mais j’avoue que la fin laisse à désirer, tout cela tient à si peu.
Jean Prod’hom
Il y a le prix d'une chèvre de qualité

Il y a le prix d'une chèvre de qualité
l'autre côté de la rivière
les phrases qui reviennent en refrain
il y a la ligne de flottaison
l'habitude de vivre ensemble
le zèbre qui sort de nulle part
il y a le lilas
la menthe
l’ancolie de l'Annonciation
Jean Prod’hom
Je fais les lits mais je passe l'aspirateur

C’est par ces mots que notre mère nous accueillait, Françoise, Elisabeth et moi le mardi dès le saut du lit, c’est par leur analyse que j’aborde ce matin le fonctionnement du connecteur mais avec les élèves de la classe 9. Ils hochent du bonnet, songeurs. Je m’avise alors que l’expression faire son lit n’a plus vraiment cours. Fini le temps du drap blanc de dessous qu’il fallait tendre au quatre coins du lourd matelas, de celui de dessus sous lequel on se glissait et qui était recouvert d’une robuste couverture, brune, qu’un pli du drap de dessus tenait éloignée de notre visage. Fini aussi le couvre-lit coloré – je m’en souviens d’un, orange – fini le maigre duvet à la housse blanc cassé parsemée d’innombrables petits ronds bleus, roses et jaunes que je glissais le matin au forceps dans ce qu’on appelait chez nous un pelochon – orange lui aussi.

Ces deux énoncés connectés par un mais à la mystérieuse évidence, je fais les lits mais je passe l'aspirateur, enveloppaient deux conclusions contradictoires. Notre mère nous informait en effet qu'elle ferait ce jour-là notre lit et qu’elle nous libérait de cette tâche quotidienne, mais elle nous interdisait de conclure que nous étions libres de tout. Le mais qui suivait nous en avertissait et préparait l’énoncé qui allait renverser d’un coup la conclusion attendue. En nous annonçant qu’elle passerait l'aspirateur, elle nous signifiait sans le dire explicitement que nous allions devoir, avant de partir à l’école, débarrasser du plancher tout objet qui traînait et qui pourrait l’empêcher de travailler efficacement. A nous de conclure et de nous acquitter de l’implicite injonction en retirant des quatre coins de notre domaine et du dessous de notre lit ce que nous y avions glissé le reste de la semaine pour le répartir à la sauvage en altitude, là où il ne dérangerait pas.
Lorsque j’y songe, ce que nous n’entendions pas dans ce qu'elle nous disait et qu'elle gardait soigneusement pour elle, c'est que si de notre côté nous ne perdions rien au change, elle doublait de son côté sa tâche, nous n’en avons jamais rien su, elle le voulait ainsi, nous ne lui sommes redevables de rien, je lui en suis reconnaissant.
Jean Prod’hom
Le moindre geste

Au beau milieu de l'année scolaire, je suis resté dans le petit bistrot au bord du terminus du tram. Impossible d'aller me rentrer dans ce lycée surnommé Faidherbe que je fréquentais, si on peut dire, depuis douze ou treize ans. Je suis resté dehors. D'être là, dehors, alors que ça n'était ni un jeudi, ni un dimanche, ni un jour de vacances, c'était la fête.
Fernand Deligny, cité dans l’Express Méditerranée, 2007

Voir la terre d’avant que l’homme assourdi par les formules du récit y établisse ses quartiers, la faire voir en écoutant les yeux fermés les refrains des hommes et le chant insensé des bêtes, en décalant les images de ce qu’on en dit, en dégageant nos gestes de nos intentions, en les suivant comme sur un écran, bref en rendant les images à elles-mêmes et des ailes aux mots, en leur laissant la bride sur le cou au risque de perdre le fil ou la raison, ou qu’il n’en reste qu’une, celle d’être là sans avoir à en répondre. On verrait alors que la terre tient ses promesses et qu’il n’y a aucune raison de s’en plaindre.
Jean Prod’hom
Balle de brouille

Une journée dans le ciel avec ceux d'en face qui regardent de notre côté, haut perchés comme nous à la Mussily ou aux Chênes, sur les flancs du Moléson, du Niremont et des Alpettes, sous le porche de la chapelle de Vucherens, sur le chemin de ronde de la Tour de Gourze ou à la buvette du Mont-Cheseaux, penchés au-dessus de l'immense édredon qui recouvre ce matin les vallées de la Broye, de la Bressonne et de leurs affluents au chevet desquels ceux d’en-haut veillent, on n’observe aucun mouvement dans la balle de brouillard, aucune fuite et on s’inquiète un peu.
On devine qu’en-bas personne n’a rien vu venir, tout s’est établi avant que le jour ne se lève. On les imagine fantômes, gris, la tête dans les talons – à quoi bon jeter un oeil au ciel puisqu'il n'y a pas de ciel –, ils respirent à peine et des pensées lourdes et humides pèsent sur leurs cabas remplis jusqu’à la gueule, ils sont comme à l’arrière d’une guerre oubliée, ils ont allumé les réverbères.
Nous, on aurait voulu qu’ils se réveillent et s’ébrouent, montent, désobéissent. Ils auraient pris la route d’Hermenches, une lueur serait apparue au-dessus de Rossenges, orangée, puis une autre bleutée qui aurait fini par prendre le dessus et les aurait enfin tirés du lit. On aurait vu d’abord leur tête dépasser, puis leur sourire, et le soleil aurait éclaté et ils auraient senti sur leur peau la chaleur de la laine rôtie.
C’est à cela qu’on pensait.
Mais aucune tête ne dépassa de la balle de brouille hormis le clocher de Mézières, égaré, déplumé, inutile pour ceux d’en-bas qui en auraient tant eu besoin. Et nous, nous étions à ses côtés, aveuglés sur la route qui monte des fonds de la Carrouge jusqu'au cimetière de Ferlens, une route à la verticale qui, du temps de leur vivant, les gens de Ferlens appelaient la route du Paradis.
Jean Prod’hom
Avocat ou oignon

Lorsqu’elle eut détaché de son petit gars, feuille à feuille, tout ce qui l’empêchait d’être l’enfant qu’elle souhaitait, l’élève qu’elle rêvait, lorsqu’elle eut décapé chacun de ses défauts, mis de côté ce dont elle voulait qu’il se débarrasse, sa dyslexie, son manque d’organisation, son attention vagabonde, le divorce de ses parents, ses pannes de conscience, ses rêveries, l’étroitesse de son bureau, ses petites nuits, lorsqu’elle eut annulé d’un geste les handicaps d’une hérédité dont elle n’avait naturellement pas à répondre, lorsque elle eut écarté les quartiers de l’ange qui n’étaient pas de noblesse, je la vis soudain perdre pied. Encore un pas et il allait falloir que la mère choisisse, faire de son fils un noyau dur, avocat sans défaut, être sans coeur qui répudierait à coup sûr l’imparfaite qu’elle était ? Ou pleurer les mains vides devant celui qui n’était déjà plus qu’un souvenir, petit rien qui avait filé entre ses doigts comme ce petit air qui s’échappe du coeur de l’oignon effeuillé ?
Elle revint en arrière pour remettre son gamin en l’état, comme elle l’avait trouvé au début de cette histoire.
Jean Prod’hom
Il ne faudra pas s'étonner, disait Deligny

Quand la mer sera morte
la mer océane
et le silence tant embruité
qu'Image aura disparu
à tout jamais
restera l'homme arrivé à ses fins
Fernand Deligny, A propos d’un film à faire (1989)

Le langage étant ce qu’il est, il faut bien qu’il parle de quelque chose, disait Fernand Deligny à Renaud Victor en 1989. Pensez donc, s’il ne parlait que de lui… il le fait d’ailleurs largement. Mais que le langage soit tout, ça paraît quand même beaucoup.
Tout n’est pas langage, tout c’est trop. C’est de notre devoir, un devoir éthique, disait-il, de donner de la tête contre les bornes du langage, sachant qu’il retient dans ses nébuleuses un secret qui le porte mais qu’il ne percera pas. Lorsque celui-ci frôle de la plume l’eau sur laquelle le radeau de l’enfant autiste s’éloigne, le langage doit renoncer à ses ambitions de tout vouloir dire et céder la main à l’image au sens où celle-ci ne dit rien, et le faire de telle façon que personne ne lui fasse dire n’importe quoi, image précaire, précaire au point d’être inconcevable, la faire tout de même comme un castor ferait sa digue, là où elle est, là où il est, quelque part, et donner à voir ensemble les coïncidences qui constituent hors le langage ce qui nous reste.
Jean Prod’hom
Remède de sorcière et remède de fée

J’apprends aujourd’hui qu’en Mayenne on conseillait aux tuberculeux d’avaler des limaces vivantes, le matin à jeun (Jean-Loup Trassard, L’Espace antérieur) ; il y a décidément des ordonnances qu’aucun médecin n’a écrites mais qui franchissent les frontières ; d’autres de mes sources indiquent en effet que les limaces ont de mystérieuses vertus sur les maladies pectorales. Je ne doutais pas pour ma part de ce que me racontait ma mère autrefois pour forcer mon maigre courage à saisir la cuillère d’huile de ricin qu’elle me tendait, son père se levait à l’aube, à l’automne en guise de prévention ou au printemps pour se requinquer, en ramassait deux dans la rosée matinale, belles et dodues, qu’il laissait glisser dans sa gorge puis dans son oesophage.

Si je concevais volontiers de tels gestes de sa part, c’est parce que mon grand-père avait d’autres idées qui lui appartenaient en propre et qu’on n’était en conséquence nullement obligés de partager. Je n’aurais en effet jamais osé le suivre sur cette pente, incapable d’imaginer non plus une limace dans mon gosier. J’ignore aujourd’hui si cette histoire n’a pas été colportée à leur insu par l’un ou l’autre de ses proches avec pour seule fin d’entourer d’un halo légendaire la figure de celui dont on n’est toujours à la fin que le triste et quelconque rejeton, mais cette histoire, légendaire peut-être, que racontait ma mère a eu des effets sur un interdit culinaire qui a pesé sur les premières années de ma vie, un dégoût devant la langue de boeuf dont on trouve pourtant la préparation, contrairement à l’utilisation médicinale des limaces, dans une kyrielle de livres. Qu’elle soit accompagnée d’une sauce blanche ou d’une vinaigrette, d’une sauce aux câpres éric, verte ou blanche, sauce madère, rien n’y a fait.
Rien n’y a fait jusqu’à ce que je découvre que la source profonde de ce dégoût pouvait être à l’origine d’un plaisir céleste. Les choses ont en effet changé à l’adolescence lorsque j’ai goûté aux langues suaves et goulues, tortillantes, chaudes, logées dans l’ombre des palais des fées de la salle paroissiale de Pully que m’avait fait découvrir Georges. Nous nous y sommes rendus à quelques reprises et avons pris la mesure de l’étendue et de la variété des plaisirs de la bouche.
La crainte que ma langue puisse finir en petits cubes dans la bouche d’une fée s’était rapidement dissipée et avait laissé la place à l’assurance que cette affaire relevait du donnant donnant. J’ai embrassé à tout-va, pendant plusieurs semaines à toutes les sauces et mes goûts culinaires ont suivi. Je mange depuis avec un plaisir rare la langue de boeuf sauce vinaigrette ou sauce blanche, et si je ne suis pas prêt encore à avaler une limace, d’un coup et toute crue, je m’en approche comme de l’inaccessible sagesse.
Jean Prod’hom
Sésame

A François
Faire attention, faire bien attention à ce qu’elle ne tombe pas au fond des vingt centimètres de neige fraîche tombée la veille sur le plateau du Niremont que nous traversons aujourd’hui, les raquettes aux pieds. Cette clé que je lui tends, au panneton de fer inoxydable et à l’anneau à trois ellipses de caoutchouc noir, acquiert soudain un pouvoir que je ne lui soupçonnais pas.
On n’avait rencontré personne depuis le sommet, et on allait tête baissée, l’esprit occupé, creusant un chemin qui devait nous conduire si tout se passait bien jusqu’à la gare de Vaulruz, de Vuadens ou de Bulle, ou si les choses se précipitaient – la bise, le brouillard, le froid –, nous obliger à revenir tristement sur nos pas.
L’homme a enlevé l’un de ses gants de laine, il pince la clé que je lui tends et la glisse dans la poche de sa veste doublée de molleton. Nous ne les connaissons pas, les avons aperçus de loin, presque par hasard, un homme, une femme et leur chien. François a pris les devants, on s’est arrêtés pour faire le point, considérations sur le temps, brèves de clocher, où allez-vous et d’où on vient.
Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais tout m’a semblé soudain si évident que j’ai proposé à cet homme un marché, une transaction pure d’avant l’usure, le degré zéro des affaires. L’inconnu a une quarantaine d’années, il a dit oui sans broncher. La rencontre aura duré quelques minutes, le temps de se mettre d’accord sur l’essentiel : ma voiture est au-dessous des Pueys, au pied du Niremont sur la rive gauche du Rathevi, l’inconnu qui connaît l’endroit la conduira. Ils rejoindront Vaulruz au pied des Alpettes, la parquera devant le garage Agip sur la route de Semsales où il a déposé ce matin la sienne, il glissera la clé sous le pare-soleil, ça suffit.
On s’est séparés grandis, grandis d’avoir transgressé la sacro-sainte loi de méfiance, heureux d’avoir trouvé en si peu de temps ce quelque chose qui aurait pu caractériser le fonctionnement de notre espèce et alléger nos vies. L’homme, sa femme et son chien se sont éloignés dans la tourmente en direction du Niremont, le chien gambadait, ils suivaient les traces que nous avions creusées dans l’épaisse couche de neige, on a suivi de notre côté les leurs.
On a marché deux heures dans leurs pas, à travers le bois du Châble des Puits, au bord du Creux des Enfers, à travers le plateau blanc des Alpettes. Le brouillard était dense, on ne voyait rien sinon à nos pieds les empreintes d’inconnus qui ne l’étaient plus tout à fait, dont à la fois on allait à la rencontre et dont on s’éloignait. On a piqué à l’ouest lorsque nous sommes parvenus à l’extrémité de la Queue des Alpettes, j’avais l’impression de les connaître un peu mieux, en creux ou à l’envers, de lire dans leurs pas quelque chose d’essentiel, les détours qu’on est amené à faire, les raccourcis qu’on emprunte, les hésitations qui ne manquent pas, les objectifs qui changent, le chien qui tire sur sa laisse, qu’on ramène à soi ou auquel on donne un peu de liberté. A mesure que je m’en éloignais je croyais lire un morceau de leur vie, sachant qu’au même moment je leur offrais à l’autre bout un peu de la mienne. Au-dessus du Cergny, leurs pas ont fait mine de continuer sur la route, mais ils ont fait volte-face et se sont engagés résolument à même la pente, loin des chemins battus, sur ce sentier passe-partout qu’ils ont ouvert jusqu’à nous. Tandis que le temps se bouclait sur lui-même et que notre arrivée était sur le point de se confondre avec leur départ, une chevrette suivie de son chevrillard ont coupé notre route comme un éclair. Nous sommes arrivés dans le parking de l’autre côté de la Sionge, plus de neige plus de trace, la voiture était là, la clé sous le pare-soleil, pas un mot, exactement comme cela devait être.
On ne s’est pas revus, on ne se reverra pas, les vies parfois se croisent et leurs pas s’emboîtent comme les dents d’une fermeture-éclair, ils font tenir ensemble quelque chose avant quoi et après quoi il n’y a qu’un tapis blanc.
Jean Prod’hom

Double bind

L’école propose à ses élèves des ouvrages indigestes, aussi indigestes que les gros bréviaires d’autrefois, mais elle n’hésite pas à égayer leurs pages austères d’illustrations réalisées par nos plus fins humoristes, déroutant ainsi ceux qu’elle a mission de mettre au pas.
Jean Prod’hom






