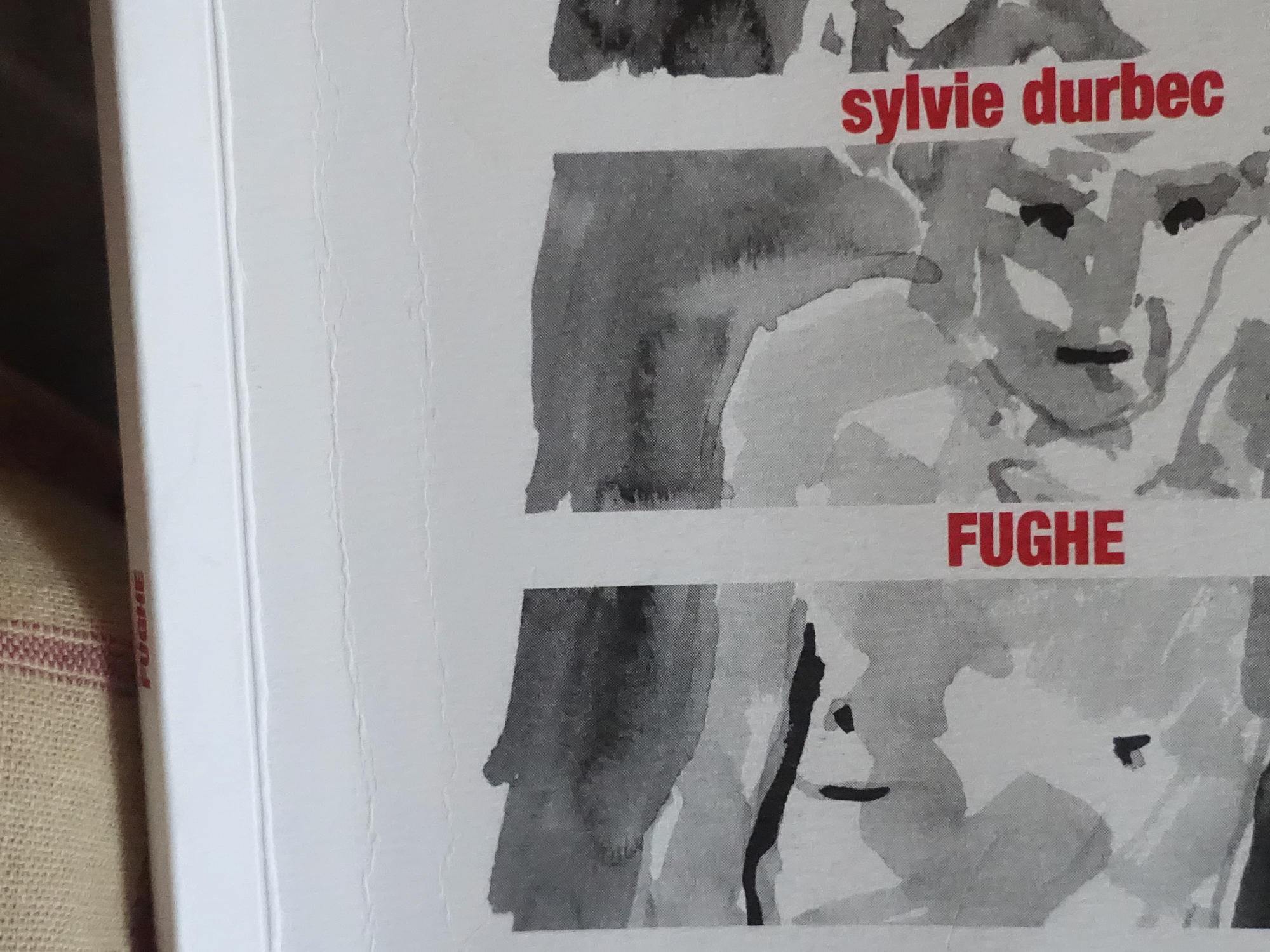 Riau Graubon / 14 heures
Riau Graubon / 14 heures
Le motif bondit, rebondit; ricochète, transite; mêle son grain à celui d’une voix avant de se relancer dans celui d’une autre; il se déplace, fait un pas de côté ou de travers, se fixe sur un visage, disparaît à Linz et réapparaît à Helsinki, élargit notre attention en la fixant sur ce qui se donne simultanément comme évidence et coïncidence.
Sylvie Durbec fait entendre dans ses fugues, qui marient l’art du contrepoint à celui de la divagation, les voix de Lenz à Walbach, de Stifter à Linz, celles de Walser autour de Hérisau, de Sebald à Norwich et de quelques autres sur les routes de l’exil. On croit y percevoir le bruit ténu des batailles qu’ils ont livrées pour obtenir un peu de repos. Avec pour seule arme, dit-elle, une botte de trèfle parfumé.
Sylvie Durbec ne quitte donc pas seule Marseille pour rejoindre les brouillards du nord; les écrivains qui l’accompagnent attirent son attention nous seulement sur des visages, mais encore sur ce qui a rassemblé par accident ces âmes blessées: une fontaine moussue à la sortie d’un village, du linge mis à sécher au pré, des chiens, le rivage, une gare désaffectée, une montgolfière. Elle met un peu d’ordre dans les marches du monde, en levant ce qui toujours se dérobe mais dont on soupçonne l’existence, reconduit plus loin ce qu’on croyait avoir perdu mais qui oriente nos pas.
Elle se détourne un instant du soleil du sud pour se pencher sur ce que celui-ci éclaire dans l’obscurité des geôles du nord, ce qui s’enfuit, s’enfonce à l’infini, en un endroit jamais atteint, avant de revenir d’où elle est partie.
Ses fughe nous invitent à longer, du dedans, ce territoire que les écrivains qu’elle aime tant ont habité, mêlant le passé au présent, l’oubli au souvenir, une langue à une autre, jusqu’à disparaître en leur compagnie. Pour que la lourdeur ne nous anéantisse pas et que nous croisions chemin faisant la beauté, comme elle et Pessoa nous y invitent, au moins une fois par jour.

SYLVIE DURBEC, FUGHE, PROPOS2, 2015