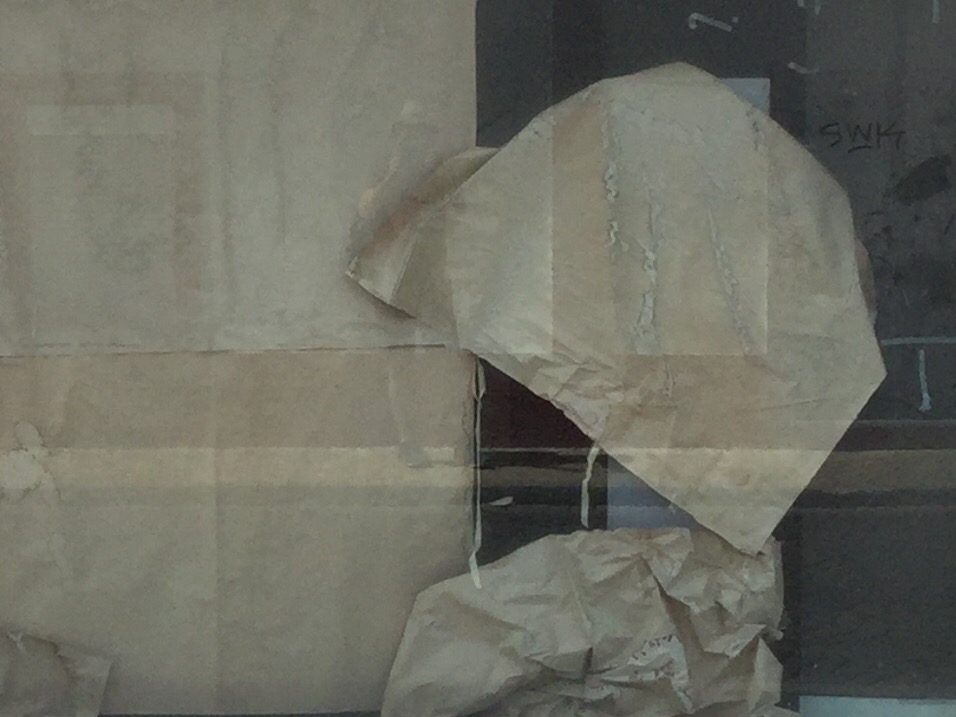Montijo / 15 heures
Cher Pierre,
Ils sont chaque jour des dizaines et des dizaines à râteler le vaste lit du Tage pour en tirer des centaines de coques prises dans la vase, qu’ils revendent au noir pour trois fois rien aux restaurants de Lisbonne. Beaucoup, lorsque c’est possible, embarquent à Montijo ou à Alcochete sur de fragiles rafiots qui les déposent sur leur gisement. Certaines d’entre eux enfilent même de vieux vêtements de plongée rafistolés pour remonter ces mêmes coques, mais avec de l’eau jusqu’à la taille, ou par-dessus la tête, en prenant des risques considérables. La courbe du chômage est toujours plus forte dans la région, aussi forte que les courants dans le ventre du Tage, on y meurt pour des palourdes. Le bateau qui relie Montijo à Lisbonne provoque un peu d’agitation chez les pêcheurs qui évitent, en faisant de petits bonds, les vagues nées de notre passage.
Il n’a pas été simple de rejoindre, depuis Alcochete, le débarcadère de Montijo, et je n’y serais certainement pas parvenu sans l’aide d’un curieux personnage rencontré à l’arrêt de bus, un Russe de 45 ans né à Saint-Petersburg, ville qu’il a quittée dans les années qui ont suivi la dislocation de l’URSS, regrettant, aujourd’hui encore, cette sainte union qui garantissait à chacun, dit-il, de beaux salaires; il a des mots très sévères à l’égard de Gorbatchev qui a, ce sont ses mots, liquidé un bel héritage.
Il est donc parti à un peu plus de 25 ans pour s’établir à Lisbonne où il a obtenu la nationalité portugaise; mais pendant son séjour de près de quinze ans à Lisbonne, il a eu l’occasion de se former à tous les métiers du bâtiment, qui lui permettent de travailler depuis cinq ans en Suisse et en France – électricité, menuiserie, couverture, peinture,… – pour un salaire qui illumine son visage. Il a travaillé l’année dernière dans le Pays de Gex et skie volontiers à Saint Luc. Je n’en saurai pas plus, on se sépare à Cais do Sodre.
Je tente de m’introduire dans la ville, mais il y fait trop chaud et il y a trop de monde; je bois un café sur une terrasse d’une rue tout près du port, mange à la hâte un plat de morue avant de reprendre le bateau de 14 heures pour Montijo.
Peu de bruit l’été dans cette ville de 40 000 habitants, sans véritable attrait touristique mais qui sait faire la sieste; je m’installe sur l’une des nombreuses terrasses de la Place de la République, en face de la station de taxis; les cinq ou six chauffeurs ont coupé les moteurs de leur véhicule et, lorsque le premier de la file, après avoir reçu un coup de fil du central, s’en va chercher ses clients, les autres poussent leur taxi à la main, histoire de ne pas faire de bruit et de ne pas faire le jeu de la canicule; ce sont les petits pavés de calcaire, presque roses, brillants, irréguliers, serrés, nerveux – il en faut quatre pour en faire un de chez nous – qui maintiendront après quelques hésitations les voitures immobiles.
Ces villes un peu quelconques, qu’habituellement l’on traverse, ou que l’on évite, font naître immédiatement le sentiment, lorsqu’on prend le temps de s’y arrêter, qu’il n’y a rien après elles, qu’elles sont les dernières avant le bout du monde. Tout semble y concourir, l’heure à laquelle on y arrive, le silence qui y règne, le désintérêt et la crainte qu’elles induisent.
Le terminal des bus de Montijo est désert mais le bureau des billets est ouvert, une employée me répond à contre-cœur mais finit sans raison par me sourire. On se croirait dans un film de Tanner mais en beaucoup plus étrange: l’horloge de l’église en atteste, il est 12 heures 35 à toute heure du jour et de la nuit et le ciel est bleu au-dessus de la place, bordée d’enseignes mystérieuses: la Sociedade filarmonica 1° de Dezembro, le siège du Partido Social Democrata, l’Espaço Esoterico Maria Martins, le Novo Bazar, le Salâo de jogos, le café Benfica, le Centro de Convivio dos refirmados pensionistas e idosos,…
Ces villes des confins dégagent presque simultanément un poison ou un parfum, un air de milieu du monde envoûtant; on y est si bien accueilli qu’on est bientôt chez soi et entre nous. Que demander d’autre. Je crois que ce nom qui chante comme une sirène, Montijo, n’y a pas été pour rien; j’ai imaginé un bref instant y rester jusqu’au soir, m’égarer dans un bonheur venu de nulle part, au risque que Montijo remplace Alcochete dans mon cœur. Beaucoup de gens qui disparaissent sans avertir l’ont fait dans de telles circonstances, à cause d’un nom ou d’une horloge silencieuse, ou d’une rangée de vieux assis sur une terrasse, le dos appuyé contre un vieux crépi. Pourquoi aller plus loin? Pour quelles autre merveilles? Une philosophie qui évidemment ne convaincra personne.
Je prends le bus de 17 heures 20 pour Alcochete, en répétant chaque fois que je le peux ce sésame, muito obrigado, qu’on échange ici comme du pain béni.