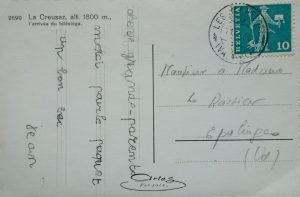Le Mont-sur-Lausanne / 11 heures
Ce mot de science, auquel nous nous sommes déjà longuement attaqués, a trop lié son destin à cette autre notion: le progrès. Et qui dit progrès dit marche en avant, et dédain plus ou moins injuste, plus ou moins dangereux, des pensées et des techniques du passé, comme si le progrès lui-même n’était pas fonction de ce passé, et s’il n’était pas le long et humain aboutissement des erreurs, des expériences, des tâtonnements, de la lutte obstinée des bons ouvriers qui nous ont précédés. […]
Vous êtres trop, vous autres thuriféraires de la science et du progrès, comme ces fils qui, parce qu’ils se sont élevés quelque peu dans l’échelle économique – qui n’est pas forcément l’échelle sociale, et encore moins l’échelle humaine –, parce qu’ils portent beau, habitent des maisons claires et propres et voyagent en auto, regardent avec commisération et parfois avec dédain leurs parents restés pauvres et humbles. Pourtant, tout ce qu’ils ont de bon, hors ce vernis extérieur qui ne fait pas longtemps illusion, ce qu’ils ont de courage et d’élan, et de confiance ancestrale en la vie, et ce qui leur reste de droiture d’esprit de bon sens, tout cela ne leur vient-il pas de leurs parents, ou des parents de leurs parents, ou de leurs proches?
Vous procédez comme ces inconscients prétentieux: vous habillez la civilisation – ce que vous appelez la civilisation – d’ors et de brillants, de clinquant plutôt; vous couvrez le passé d’un gris d’obscurantisme et vous triomphez: «Voyez où se trouvent la lumière et le progrès!… »Célestin Freinet, Oeuvres pédagogiques I,
Le clinquant. L’or et l’argent