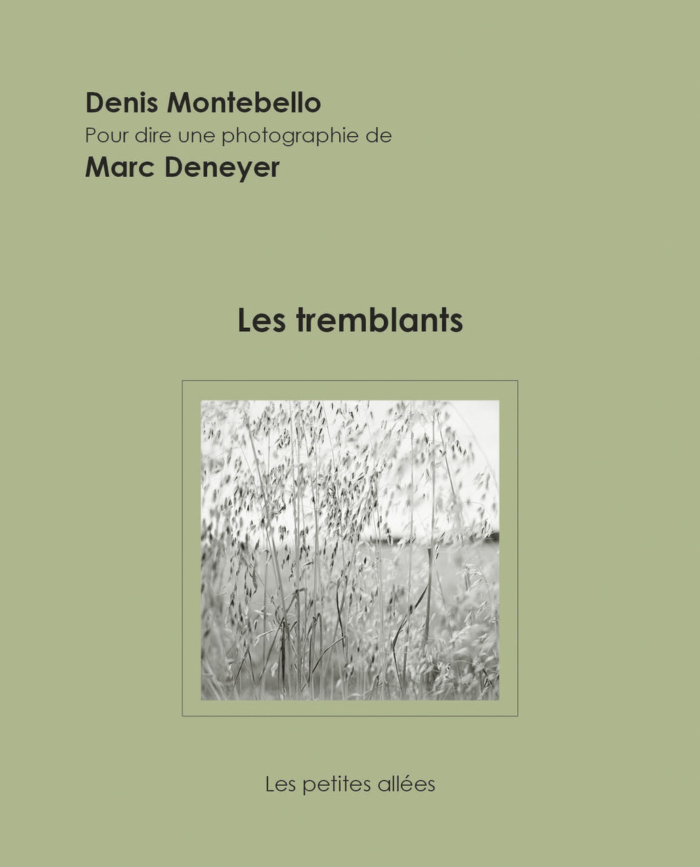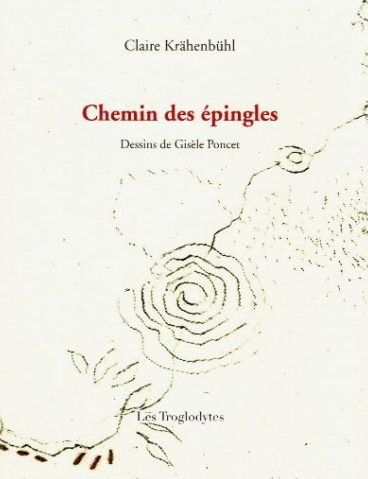Cher Pierre,
On ne se plaindra évidemment pas de la prolifération des livres; ils témoignent de l’indéniable santé de la littérature, disons d’une forme de santé et d’une forme de littérature. Cette richesse n’est toutefois pas sans effet sur celle des auteurs: le revenu qu’ils tirent de leurs livres les nourrit si mal qu’ils sont amenés à chercher ailleurs un complément. Ils s’organisent, monnaient leurs apparitions, multiplient les lectures, séduisent, signent dans des librairies, gesticulent sur les réseaux sociaux, rivalisent de trouvailles et de coups publicitaires. Les médias font ce qu’ils peuvent pour commenter et relayer leur travail.
On s’est vu, Evelyne Thomet et moi, pour la première fois, je crois, à la Sauge; c’était en octobre de l’année dernière, puis à Estavayer-le-Lac et à Morat. Evelyne a lu NOVEMBRE en décembre. Nos routes se sont à nouveau croisées en mars dernier, à Ins, à l’occasion d’une rencontre d’agriculteurs, d’ingénieurs, de cimentiers, de paysagistes, de pédologues et de politiques qui s’étaient donné rendez-vous pour évoquer les problèmes liés à l’utilisation des sols du Grand Marais. Evelyne est la présidente de DSP, une PME active dans le secteur des semences, qui fait le lien entre la sélection et la multiplication des semences. Elle m’a expliqué au moment de l’apéritif que DSP fêtait en juillet les 25 ans de son existence; elle m’a proposé alors de participer à cette fête en écrivant quelques mots, quelque chose qui aurait les dimensions d’un chapitre de NOVEMBRE. Elle a ajouté pour me convaincre que j’aurais, si j’acceptais, une entière liberté et que les portes du château me seraient ouvertes. C’est fait, trois mois ont passé, je lui ai envoyé début juin une dizaine de photos et un peu plu de 40 000 signes. Rendez-vous à Delley est là, tout frais sorti de chez le graphiste et l’imprimeur avec lesquels travaille cette PME. C’est un supplément au chapitre VI de novembre. J’y évoque Jean-Loup Trassard et Dormance, Gustave Roud et son Journal, Mendel et ses lois, Darwin et Caillois, une grande famille patricienne du canton de Fribourg ; mais aussi les Révolutions française et helvétique, la division du travail, l’efficacité et l’espèce de tristesse qui en est née ; le Musée romain de Vallon et la multiplication des pains de l’église de Ressudens, les moulins Bossy et l’Oxford Pub de Corcelles. Mais aussi et surtout une poignée de grains qui nous vient de la nuit des temps, que l’homme relance depuis et dans lesquels il joue sa vie et ses rêves.
Combien j’ai touché pour le taf ? Dix sous de l’heure, moins que les paysans et les employés de commune. C’est naturellement peu, trop peu. Mais la liberté gagnée restera ce cache-misère aussi longtemps que l’écriture – et la littérature avec elle – dédaignera ces territoires triviaux dans lesquels nous vivons. Cette expérience me fait espérer aujourd’hui que les entreprises ont elles-aussi quelque chose à gagner en laissant librement parler d’elles. Si la littérature, comme je le crois, se nourrit du monde tel qu’il va, elle a aussi pour tâche de regarder au delà de ce qui est, c’est-à dire d’élargir le regard en direction de ce que d’emblée on ne voit pas, et qui soudain remue, interroge, enchante. Si vous êtes intéressé et m’envoyez votre adresse, je vous ferai volontiers parvenir ce texte qui, au vu des circonstances, constitue un exemple, modeste certes, d’une autre manière d’inscrire – écologiquement – l’écriture dans la marche du temps.
Amitié
Jean