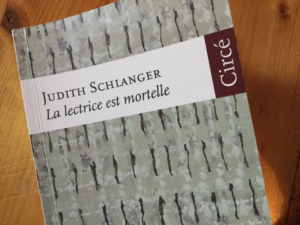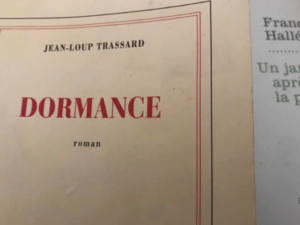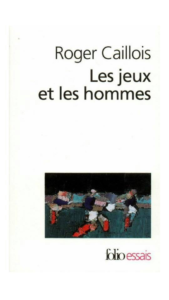Thomas Jones est né en 1743 au pays de Galles; il le quitte en 1775 avec tout l’équipement du sublime, c’est l’heure de l’Italie et du Grand Tour.
Mais c’est aussi l’heure d’une résistance: Jones préfère Naples à Rome, Torre Annunziata à Pompéi, aime autant les fabriques de macaronis à la grande peinture.
En 1782, il se retire sur une terrasse à Chiaia; il peint comme il n’avait jamais peint auparavant, sur papier, une cinquantaine d’huiles, rêveusement, loin du tumulte des reconnaissances: Mur à Naples, Maisons à Naples, Toits à Naples…
Jones s’est évadé, a atteint un rivage. Consolation. Il cesse de peindre et rentre au pays de Galles.
Thomas Jones et Jean-Christophe Bailly partent de loin. C’est beau comme un ricochet.
On guigne à gauche sur la maison natale de Dylan Thomas, on traverse Swansea jusqu’à la mer. On laisse à l’est les aciéries de Port Talbot, pour longer le rivage à l’ouest, jusqu’au Pier de Mumbles puis, jusqu’à Laugharne.
On remonte l’estuaire du Tãf jusqu’au cabanon de la Boat House où la vie et l’écriture du Gallois ont coulissé l’une contre l’autre puis glissé l’une dans l’autre, emportant avec elles la rumeur qui les a engendrées.
Ce sont d’anciennes voix, décollées du petit matin, porteuses de rêves de rien du tout, décalées à peine – comment sinon les faire entendre et offrir ainsi, ensemble, à celui qui passe un lieu où se replier et un ciel où se déployer?
Du séjour de Jacques Austerlitz à Barmouth, rien ne porte trace, hormis des lieux et leur nom.
Mais la flânerie entêtée – oui cela se peut! – de Jean-Christophe Bailly donne à entendre l’omniprésence de la voix de G. W. Sebald; et on saisit mieux, par le relevé et le dépôt de traces invisibles, ce que la fiction doit à la réalité, ce que la réalité doit à la fiction. Pour autant que le lecteur s’en mêle.
Les temps s’enchevêtrent et les apparitions se superposent. Le sculpteur Piotr Kowalski s’invite dans le récit comme le narrateur des Émigrants dans la vie de Max Ferber. Gilberte et Jean Christophe Bailly s’imaginent vivre dans une maison au pied du Cader Idris tandis que Clara et W. G. Sebald partent en quête d’un logement dans les environs de Norwich. La nuée d’éphémères qui s’étaient donné rendez-vous en 1982 sur les rives de l’Ardèche en s’échappant d’un édredon géant trouvent leur écho derrière Andromeda Lodge, dans une combe couverte de bruyère. Une scène que Bailly est persuadé d’avoir vue mais qui, en réalité, le ramène à l’amitié, celle de son ami Kowalski.
C’est parce que nous cherchons un lieu où habiter que nous voyageons.
Robert Frank et W. Eugene Smith ont réalisé au sud du pays de Galles des photographies de mineurs, traces de l’âge d’or du coke, qui a nourri dès la seconde moitié du XIXe siècle le rêve enflammé d’autre chose. Il ne reste rien de ce rêve sinon son abandon lui-même.
Les visages noirs et blancs des mineurs surgissent comme les négatifs de photographies perdues.
Et si Jean-Christophe Bailly atteste de la disparition du lien réciproque attachant le monde et les hommes, l’écriture le rétablit. Quelque chose se dilate, soulève le paysage et ses habitants pour laisser la vie, invisible, les envelopper à nouveau, comme un liquide. Et les choses défaites se rassemblent, le monde remue comme un corps qui se réveille, s’ébroue et se lève, omniprésent, sous le regard du passant qui sait et se tait.
*
Contrepoint
C’est en novembre 2017 que j’ai croisé W. G. Sebald, sur les hauts de Ins, en suivant les traces qu’il a laissées lors de son passage en septembre 1965, sur le flanc du Schlaltenrain qui domine le Grand Marais et le lac de Bienne. Le premier était noyé dans le brouillard ce jour-là, il n’eut d’yeux que pour le second qu’il aperçut des hauts de Lüscherz, puis l’île Saint-Pierre lui apparut baignée d’une lueur blanchâtre et frémissante…
(La suite, c’est ici: W. G. Sebald, « Comme un chien qui court »)