
Dernière lecture, une merveille…
Judith Schlanger, je l’ai croisée au milieu des années huitante. Ou plutôt j’ai lu son Invention intellectuelle (1983) alors que je participais à un séminaire d’épistémologie. La philosophe posait alors une question essentielle et naïve: comment se fait-il que les lecteurs comprennent le nouveau lorsqu’il est exposé pour la première fois, et qu’ils le trouvent même éclairant? L’exposé qui suivait était plutôt classique; la philosophe s’appuyait sur d’anciennes positions, Bergson, Cassirer, Feyerabend, Gadamer, Kuhn, Lakatos, Poincaré, Popper, Valéry, pour dessiner la sienne, souligner la sienne, les proximités et les divergences.
Si cette réflexion épistémologique s’est épuisée et rejoint le royaume des oeuvres bientôt disparues, la philosophe n’a rien perdu de sa fraîcheur première. Elle s’interroge en effet dans Présence des oeuvres perdues (2010) sur le mystère qui entoure tout ce qui n’est plus là, qui l’a été ou qui a failli l’être, et qui remplit les alentours de l’étrange présence de leur absence. Judith Schlanger s’attache à faire voir comment les oeuvres qui ont trouvé une place s’organisent dans l’ensemble indéterminé et illimité des oeuvres perdues, et grâce à elles.
Et c’est un nouveau monde qui surgit sous sa plume, dont nous ne pouvons ni évaluer objectivement la teneur ni circonscrire l’étendue, plein d’histoires qui ont failli avoir lieu ou qui ont eu lieu en partie, si bien que le monde n’apparaît plus seulement gros de ce qui est et de ce qui a été, mais aussi de ce qui aurait pu être et de ce qui n’a pas été, et dont les restes – un nom, une ombre, un éclat, émergent parfois, relançant notre compréhension de notre être-là, de notre milieu et de notre égarement.
Il suffit de tendre l’oreille pour entendre les échos de chants disparus, de se pencher pour relever les traces de récits oubliés, avortés, rêvés, restituant ainsi une étendue et une allure généreuses au passé, que l’orchestration assurée par les funambules de la raison avait appauvri jusqu’à la corde, offrant enfin un adversaire sérieux au règne mortifère des calendriers et des horloges.


Dernière danse avec Nolde et Klee à Berne.
Dahlias, masques et cotillons.


Le maître du Jardin de paradis | La Madone aux fraisiers | 1420 | Soleure
Davantage de courage, une réduction des peines, la multiplication des pains; un lit, de longues nuits, des éclaircies; les coudées franches, le chant des oiseaux et le vent. Toi, eux et moi; le pardon et la fidélité à l’aube.
Mais aussi ce qu’on ne saurait différer, chaque jour, l’étonnement et la joie. L’élargissement de leur territoire, sans quoi le travail et les loisirs auront notre peau. Ralentir, nous attarder, nous égarer.
Nous sommes nés de dessous la terre, sortons de la nuit; rêvons d’un abri, peignons le mur de nos prisons. Qui d’entre nous n’a pas jeté sa tête en arrière, une pleine poignée de framboises dans la bouche, roulant dans la gorge, bain et poignard du premier baiser? Air libre air tiède.
C’était hier, c’est aujourd’hui, aller ainsi demain, passer, passeur et passant.

Reçu ce matin,
une belle lettre de Sylvie,
et un mail d’Yvan,
à propos de NOVEMBRE, cette promenade endeuillée.


2.
Le Nom des dieux est l’autre nom de ce qui est
le plus réel.
A tous les partis, pourtant, cette évidence est obscène.
3.
Aucun homme n’apprend d’aucun homme.
Chacun doit refaire en son entier le chemin de l’erreur.¨
8.
Le nom vrai d’être est Chance.
L’autrement nommer diminue.
13
Le mendiant est le frère du Roi. Le Roi le sait.
Le mendiant l’ignore.
30
On écrit de n’avoir pas de Père.
(Jean-Paul Michel, Les signes sont être de l’être (1998), Flammarion, 2010)


« Ecrire, c’est prier. Cela doit être entendu littéralement. Il n’est de livre possible qu’à la condition de ce pari sur une action à distance, relevant d’une causalité non mécanique (mais peut-être n’est-ce qu’une mécanique particulière, la mécanique du symbolique) – qu’à la condition d’une attente, d’une confiance, du sentiment d’un impouvoir fatal, n’était ce pari sur un pouvoir de nos signes. »
(Jean-Paul Michel, La vérité jusqu’à la faute, Verticales, 2007)


Il a fallu du temps pour m’aviser que j’avais été berné, moi aussi, que la disparition du soleil était le fait de paysans de montagne crédules et ignorants. Le roman perdit d’un coup tous ses pouvoirs.
Les décennies qui ont suivi m’ont donné raison: oui! le soleil pourrait ne pas revenir, les glaciers fondre et les lacs de montagne bouillir.
Il est décidément top tard pour relire «Si le soleil ne revenait pas».


«Un livre vaut à proportion de sa puissance d’inventer des lecteurs. Non de les suivre, de satisfaire à quelque demande préexistante d’un groupe, mais de les arracher à ce groupe: de prendre sur eux cet étonnant pouvoir de les faire se découvrir à eux-mêmes étrangers, de les nourrir, presque les constituer neufs à leur tour.»
Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie (1981-2012), Flammarion, 2013


Alors qu’il pleuvait et que la nuit tombait sur la Loire, j’ai cru distinguer sur les visages des femmes et des hommes qui faisaient leur quart sur un rond-point près de Feurs, mais ailleurs aussi dans l’Ain, une joie singulière, que j’appellerais volontiers, après Jean-Paul Michel, une joie d’histoire, une joie débarrassée des discours qui s’obstinent à écarter ce qu’on n’a encore jamais vu, une joie qui ramène quelques-uns des rêves – plus importants que les revendications – qui se lèvent malgré les fatigues et les peines, mais aussi à cause d’elles.
Chacun se souviendra de ces journées et de ces nuits pendant lesquelles la vie s’ébrouait, ignorant ce que l’avenir lui réserverait.
Ceux qui étaient en place risquaient gros, ils ne s’y méprenaient pas, quelque chose tremblait et la vie avait fait son retour; elle menaçait d’ignorer tout ce qui s’y opposerait, les brasiers tenaient à distance les parasites et les chandelles remplaçaient les explications.
Il y a des heures qui nous rendent à nous-mêmes; on s’avise alors dans un désordre réconfortant que nos vies, si courtes, peuvent être à notre main.
«Le retour à la vie finie comme finie, non comme malheur, mais comme chance, – puisque tout recommence, avec chaque nouvelle jeune vie. Le contenu des existences effectives pris au sérieux: celles qui n’ont lieu qu’une fois.»
(Jean-Paul Michel, Première tentative de sortie des logiques du ressentiment, Le hasard d’être, 2008)


C’est un langage qu’on bricole à quelques-uns le matin, lorsque la circulation est dense et que les automobilistes venant de Peney ou de Villars-Tiercelin manifestent, au Chalet-à-Gobet, le désir de se glisser sur la route de Berne.
Il arrive en effet, depuis plusieurs années déjà, que l’un de ceux qui roulent sur la voie prioritaire signale à l’automobiliste de la voie secondaire qui s’impatiente, par un double appel de phare, que la voie est libre et qu’il lui cède sa place.
Et tandis que le nouvel arrivant remercie celui qui le suit désormais, par un double clic et le rouge de ses feux arrière, ils se réjouissent l’un et l’autre d’apercevoir dans leur rétroviseur, toujours plus loin, deux, quatre, six nouveaux éclairs blancs, qu’ils savent ne pas leur être destinés mais qui prolongent ce qu’ils ont initié.
Et tous bientôt regardent vers l’arrière, sourient en rêvant que ce miracle fasse tache d’huile et rassemble sans un mot ceux qui auraient pu se déchirer, dans un anonymat que souligne la nuit qui les entoure.
Chacun ignore tout des autres, ils viennent de partout, leurs pas s’emboîtent comme les dents d’une fermeture-éclair, qui fait tenir ensemble quelque chose avant quoi et après quoi il n’y a rien.


L. me confia qu’il n’avait pu, plusieurs années durant, écarter de l’horizon la vision des jours sombres auxquels mènerait immanquablement, pensait-il, la guerre de notre temps, diffuse, rampante, parfois silencieuse; l’effondrement de nos maisons, de nos villes, les pannes, les abandons, les malentendus qui font tache d’huile; la guerre de tous contre tous.
Il décida un jour, c’était un matin, de passer sur l’autre rive et de vivre désormais comme si le désastre avait déjà eu lieu, d’aller et venir au milieu des ruines et du silence d’après la fin, dans les bois et les campagnes où tout avait été oublié depuis longtemps, mais où tout aussi, discrètement, avait recommencé.


Archives de la ville de Lausanne

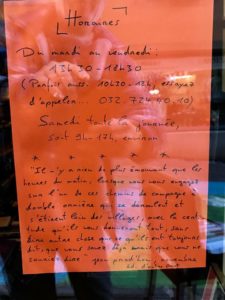






« On ferme le livre dont on a tourné la dernière page. On lève un instant les yeux; puis on le feuillette distraitement une dernière fois tandis que l’aventure reflue, laissant dans la mémoire quelques traces, un épisode, un ciel, une silhouette. » Novembre, éditions d’autre part.
Terminé ce midi à Chardonne. Moi je garde en tête ce paysage qui n’avait guère changé, ces tas de betteraves et ce fond de ciel avec de lourdes fumées d’Aarberg mêlées aux nuages. Ce livre, c’est ma plus belle découverte littéraire en 2018. J’ai bien sûr déjà dit ça pour d’autres lectures cette année. Je suis du genre enthousiaste pour ce qui est des livres. N’empêche, pensez-y à novembre, vous qui aimez la géographie, l’histoire, les histoires et la poésie.


C’est donc la correspondance de deux amis qui se sont rencontrés au lycée en 1965. Fidèles depuis, tablant sur la seule expérience qui vaille la peine, l’enfance, ses mystères et les énigmes qui y ont trouvé leur terreau.
Si quelque chose s’est dispersé ensuite, ce quelque chose brûle encore dans ces lettres et l’éclaire à son tour: l’amitié.
Ils sont peu nombreux à avoir eu le courage qui s’en est suivi, comme eux continué sans jamais remiser leurs anciennes promesses. Et leur émerveillement se propage bien au-delà des pages qu’ils ont laissé s’échapper.
On se sent moins seul. Et on se surprend à penser que leur courage relance le nôtre. Nous sommes nous aussi capables de tenir nos engagements et de ne pas trahir l’innocence qui nous habitait autrefois.


Reçu hier soir un petit bonheur portatif de La Rochelle, un courrier relayé par Philippe G de retour d´Islande.
Cher Jean,
Mon voyage s’est bien passé.
Je suis arrivé ce matin dans la petite librairie et j’ai été vite pris en main par ce lecteur amical, qui m’y attendait.
La Rochelle semble une ville paisible. Pour le moins, la lumière de décembre y est douce.
Je t’écrirai.
Bien à toi,
novembre


Derrière le bruit et la fureur de ces dernières semaines, j’ai cru entendre, à plusieurs reprises, un déplacement du discours sur le climat. L’occasion était rêvée.
Certains scientifiques – comme on les appelle – et certains de leurs vulgarisateurs ont «profité» en effet de la tempête sociale pour, à la radio et à la télévision, ne plus tirer la sonnette d’alarme et renoncer à énumérer les conditions qu’il faudrait remplir pour éviter le réchauffement climatique et ses conséquences.
Ils ont entériné le fait et demandent de penser désormais aux dispositifs qui devraient permettre de répondre aux conséquences de cet inévitable réchauffement. On a passé d’un discours axé sur l’urgence à un discours centré sur l’après catastrophe.
Cette bascule a eu lieu, je crois, au cours du mois de novembre 2018. Ce n’est pas sans risque et ça change tout, évidement.