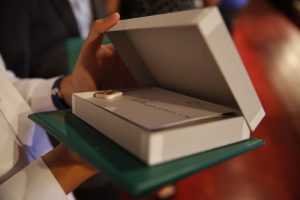Annecy / 11 heures
C’est pourtant ce que vous avez essayé dans vos classes: vous avez cru possible, vous autres éducateurs, la réalisation d’une école semblable au cours du professeur isolé de la vie, d’une école qui, négligeant ces questions que vous considériez comme trop terre à terre, prétendrait, comme sous l’effet d’une baguette magique, transposer d’un coup les individus dans une zone idéale où règne le pur esprit. Vous avez, j’espère, compris la vanité et les risques d’une telle « transposition ».
L’enfant, moins que l’adulte encore, ne saurait être considéré à l’origine comme un être pensant et philosophant. Sa fonction, sa raison d’être, c’est d’abord de vivre; et où peut-il vivre, si ce n’est dans le présent, au gré des contingences nées de la vie et du travail des parents et de l’organisation sociale? Ces contingences sont déterminantes: que vous le vouliez ou non, c’est à partir d’elles qu’il faut construire. Ah! je sais: ce sera plus difficile et plus compliqué que de se mouvoir logiquement sur le plan de l’idéal et de l’esprit; on se heurtera à tant d’obstacles… mais ce n’est pas de tout cela qu’il s’agit: oui ou non , pensez-vous que l’école doit œuvrer à partir de l’enfant réel et du milieu qui décide de sa vie? ou bien, minimisant l’influence de ce milieu, tentera-t-elle prématurément de modifier, de transformer, par le haut, une nature humaine si délicate à influencer et à diriger? […]J’insiste un peu trop à votre gré peut-être. C’est que nous sommes au noeud du drame, que nous touchons aux raisons profondes de l’erreur scolastique et pseudo-scientifique dont nous supportons les conséquences.
Nous allons reconsidérer loyalement le problème, prendre l’enfant non pas dans le milieu hypothétique et idéal que nous nous plaisons à imaginer mais tel qu’il est, avec ses imprégnations et ses réactions naturelles, avec aussi ses virtualités insoupçonnées, sur lesquelles nous aurons à baser notre processus éducatif.Célestin Freinet, Oeuvres pédagogiques I,
L’Education du travail, 1949
A la recherche d’une philosophie