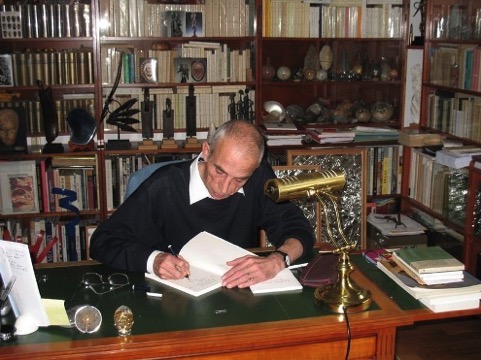Cher Pierre,
Les jours décroissent, on ne les retient pas, c’est déjà l’automne, bientôt l’hiver. Je me retourne parfois sur ce qu’il m’a fallu laisser autrefois et dont il faudra que je me sépare, bientôt, une seconde fois…
Les deux vieux mènent une vie discrète au cinquième étage d’un immeuble cossu du centre-ville; sans faire de vague mais avec un secret, un privilège dont ils se réjouissent depuis toujours et qu’ils ne lâcheraient pour rien au monde: le lac.
Autrefois, le dimanche, la maîtresse de maison ouvrait les deux battants de la porte-fenêtre de la salle à manger et invitait ses hôtes, moins chanceux, à suivre monsieur sur le balcon; elle désignait alors d’un geste ample la merveille dans son écrin. Personne n’y croyait vraiment, ne savait trop quoi dire ; ils fermaient les yeux, puis les ouvraient, les refermaient et soupiraient. C’est comme si le lac n’existait plus; on aurait dit un tableau, un tableau aux couleurs fragiles, passées, lointaines, comme celles du décor de leur vieux service à thé. Ils rentraient bientôt à la salle à manger et appelaient les enfants pour le dessert. Calmez-vous! c’est promis, nous irons faire un tour après le café; nous prendrons la Ficelle et longerons les quais.

J’ai eu beau lever la tête, me mettre sur la pointe des pieds et fermer les yeux, je suis resté aveugle; je n’ai jamais goûté à leur bonheur, si proche de celui qui animait, un peu plus tôt le dimanche, le visage des fidèles priant et conversant derrière leurs paupières avec Dieu. Et, tandis que leur esprit baignait au large, je demeurais sur la rive, jetant de temps en temps un coup d’oeil au-delà de l’horizon, du côté de ce pays lointain dont je peinais à imaginer la nature et qui semblait, aux yeux de mes aînés, une évidence.
On rejoignait donc, après le café, le bord du lac; on longeait les quais sur des chemins bétonnés, pavés, gazonnés, sautillant sur les obstacles dressés par l’homme pour stabiliser ses rives et l’empêcher de déborder, l’obliger à se contenir en le ligotant comme les pieds d’une chinoise.
Pas tout à fait. Le pont sur la Vuachère, tout à l’est de la ville, nous rapprochait en effet de quelques-unes des reliques d’un autre monde, des grèves orphelines sur lesquelles le Léman va et vient depuis toujours. On ôtait alors nos mocassins au fond desquels on glissait nos soquettes et on avançait en claudiquant aussi loin qu’on le pouvait. Nous nous immobilisons bientôt au large, l’eau à mi-mollet, un peu ivres, avec la fraîcheur qui nous montait à la tête. Lorsque nous revenions sur terre, notre mère nous autorisait à rester pieds nus sur la grève, à nous pencher sur ses laisses, à remuer les restes des trois règnes, bois flottés, galets et coquillages, à choisir les éclats de verre et les morceaux de terre cuite qui rejoindraient notre boîte à trésors avec, dans nos mocassins vernis, un peu de sable et de gravier de la dernière glaciation de Würm. C’est ainsi que j’ai rejoint le lac des premiers arrivants, un lac sans limites assignées, sans bords assurés, un lac frangé, celui que nos ancêtres magdaléniens ont découvert, il y a 10’000 ans du balcon de Jaman ou de Naye, le lac tout entier, avec ses respirations et ses promesses, invitant ceux qui viendraient après eux à le regarder une seconde fois pour la première fois et à dire un peu du ravissement qui les saisit.
Ce qu’ont vu nos ancêtres magdaléniens et que je ne suis pas parvenu à distinguer du cinquième étage des immeubles cossus de la ville, je le distingue avec ravissement aujourd’hui, au détour d’une des nombreuses avenues de la ville qui, par un trou de souris, plongent dans le lac, en haut Jurigoz, l’avenue de Savoie. C’est là qu’il est le plus beau, le plus étrange, c’est là qu’il réitère au mieux ses promesses, lorsqu’il se montre à la va-vite, au milieu de la ville, et qu’il se confond avec le ciel, pas plus gros qu’un timbre-poste.
Je vois alors, dans cette échappée, par-delà la Belle Époque qui veille aux devantures des tabacs et des magasins de souvenirs, non seulement ce qu’il est – ses énigmatiques profondeurs –, mais aussi ce qu’il indique en creux, ce pays, cet autre pays qu’il s’agirait de rejoindre, comme nos ancêtres l’ont fait avant nous, en empruntant des chemins qui se perdraient dans le bleu du ciel, le vert des épicéas et des sapins blancs ; on longerait les ruisseaux et leur lit de molasse, on irait de village en village, d’auberge en auberge, ailleurs et chez soi, renouant avec l’errance qui est la nôtre, entre friches et prés, champs de blé et d’orge qui ondulent comme l’océan.
Je suis descendu ce matin à Vidy, il pleut; je ramasse près de l’embouchure de la Chamberonne quelques morceaux de terre cuite; j’aperçois un genévrier, deux saules et, de ricochet en ricochet, trois ou quatre bouleaux, une poignée d’aulnes: tout est à faire.
Amitiés.
Jean