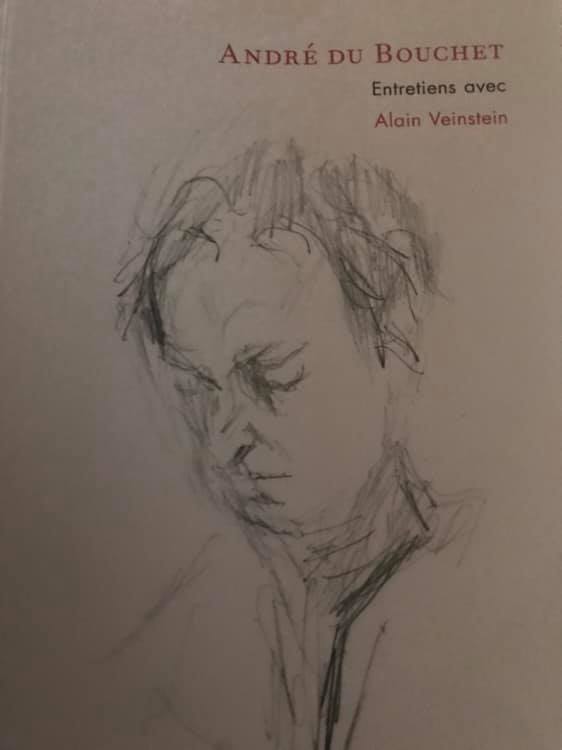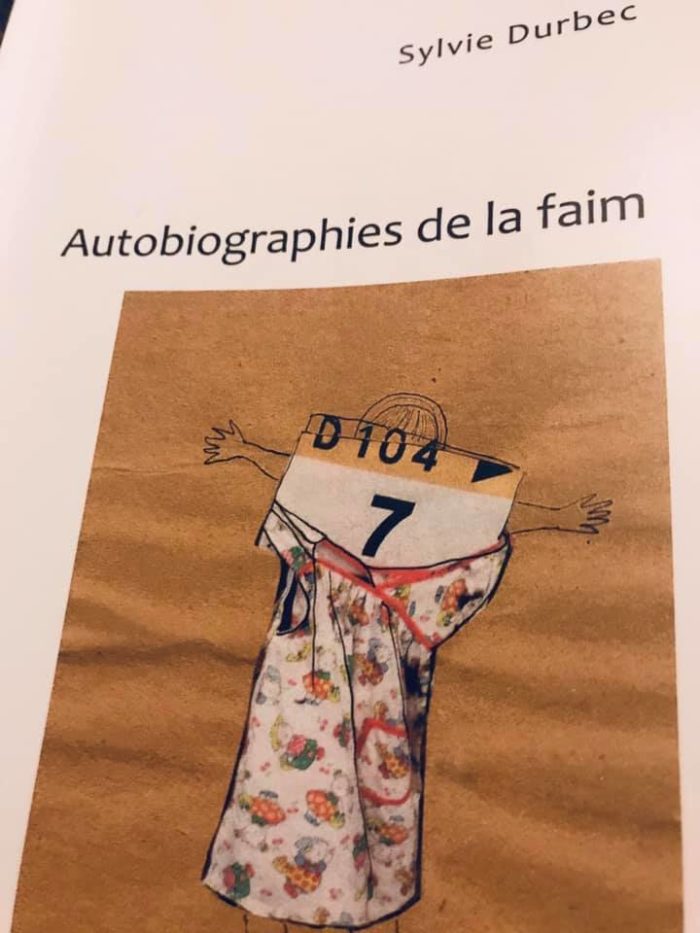Les mots qui suivent ont été adressés aux membres de la première assemblée ordinaire de l’association Avenir Pays des Trois-Lacs, le 15 novembre 2019 à Ins.
Le canal qu’Elie Gouret rêva au milieu du XVIIe siècle devait relier le Rhône au Rhin par la cluse d’Entreroches. Il fut réalisé en partie de Cossonay à Yverdon, avec ses quais, ses entrepôts et ses treize écluses. Les barges naviguèrent, côté Rhin, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, puis le trafic diminua.
En 1830 ne naviguaient plus que huit barques dans la Plaine de l’Orbe et le canal redevint bientôt un rêve. La route et le chemin de fer avaient gagné la partie.
Qui tend aujourd’hui l’oreille le long de la Thièle entre Orbe et Bienne, ou le long de l’Alte Aare, entend distinctement encore l’écho des anciens passages, les embarcations chargées de vin, de sel et de grain. Les canards aussi, les oies et les aigrettes qui mêlaient le froissement de leurs ailes aux chants et aux cris des bateliers.
Ce rêve d’eau à pente nulle au milieu des marécages, je ne puis m’en défaire lorsque je songe à l’avenir du Seeland, lorsqu’un bateau glisse sur le canal de Nidau-Büren entre Port et Aegerten; lorsque des pêcheurs, assis sur les talus de la Sauge, lancent leur hameçon dans le canal de la Broye.
Alors oui, cette vie le long de l’eau, peuplée d’âmes et de mystères me comble, elle a un sens et mérite d’être vécue.
Le pharmacien Rudolf Schneider fit un autre rêve en 1820 à Meienried. Il lui fallut plus de trente ans avant que ses contemporains lui prêtent l’oreille, vingt encore pour que les travaux démarrent en 1868. Ils prirent le nom de Première correction des eaux du Jura et contribuèrent, par l’abaissement du niveau des trois lacs, à une amélioration sans précédent de la santé du petit peuple des agriculteurs qui vivaient à la peine dans le Grand Marais, les plaines de l’Orbe et de la Broye, dix ans de travaux de Titan pour creuser les canaux de Nidau-Büren et de Hagneck, élargir ceux de la Broye et de la Thièle.
Le système des vases communicants que Rudolph Schneider imagina tint ses promesses; il soulagea des milliers de familles, leur santé s’améliora, elles n’eurent plus à pleurer les récoltes si souvent inondées. Et dans les anciens marécages où l’on fauchait autrefois des foins de litière, on vit apparaître des légumes, du colza, des céréales, bientôt des betteraves.
Si cette Première correction améliora la santé des hommes et leur offrit de nouvelles terres arables, elle fut à l’origine d’un immense désastre, de la disparition d’autant de marais. Les oiseaux et les grenouilles manquèrent soudain de tout et cherchèrent asile ailleurs.
On ne prit la mesure de l’événement que dans la seconde moitié du XXe siècle. Il fallut alors agir vite, avant que les paysans assèchent les sols, que les entrepreneurs les imperméabilisent et que le monde d’Elie Gouret disparaisse tout à fait. C’est ainsi que naquirent les réserves du Fanel, de la Grande Cariçaie et du Häftli.
Le temps a passé, aux premières corrections du XIXe siècle ont succédé celles du XXe. On songe aujourd’hui à de nouveaux travaux; les terres agricoles sont en effet en mauvais état; elles manquent d’eau et les drainages glougloutent. Les citoyens exigent de nouvelles infrastructures pour leur bien-être. Quant à la biodiversité – oh le vilain mot! – elle se réduit comme peau de chagrin. Il va falloir se concerter et prendre des mesures.
Nous sommes beaucoup à vouloir concilier le rêve de Rudolph Schneider et celui d’Elie Gouret, disposer d’un sol, d’un lit et d’une maison étanches, mais aussi d’une barque pour nous en échapper. Comment pourrions-nous en effet vivre sans école buissonnière et sans lenteur, sans marécages, sans vanneaux huppés et oies sauvages. A quoi rêverions-nous?
Nous, nous… mais qui est ce « nous »?
Longtemps il fut local: la commune, ses notables, ses bourgeois, ses résidents. Mais il s’est vidé toujours davantage de sa substance. Les habitants ont confié en effet, dès 1848, la défense de leurs intérêts à ceux qui les représentaient, à Berne et dans les chefs-lieux des cantons, mais aussi, suivant les secteurs dans lesquels ils oeuvraient, à des associations transversales – agriculture, protection de la nature et du paysage, industrie, tourisme – qui ont été amenées, chemin faisant, à s’opposer les unes aux autres lorsque leurs intérêts divergeaient.
Cette centralisation et les différentes formes de délégation, couplées à la division du travail, ont permis – il faut s’en réjouir – la mise en place et l’extension des réseaux autoroutier et ferroviaire, l’alignement des poids et mesures, la régulation des relations internationales, la solidité des digues et des voies de communication, l’établissement de normes pour la santé et le travail. Elles ont contribué à l’accroissement du confort de chacun et à une rallonge dans notre espérance de vie, mais elles ont conduit également à la réduction des initiatives et des responsabilités des individus, au sacrifice de nombreuses prérogatives des collectivités locales, qui se contentent aujourd’hui d’appliquer ce qui a été décidé en haut-lieu. Si bien que cette organisation rationnelle, efficace, centralisée, menace aujourd’hui l’existence même de ce «nous» différencié et actif.
Nous sommes beaucoup à rêver aujourd’hui que ce «nous» s’émancipe à nouveau, retrouve une âme et s’affranchisse de l’état d’infantilisation dans lequel la multiplication des lois et l’anonymat des décisions administratives l’ont plongé, que les collectivités locales reprennent la main et redeviennent les dépositaires de l’avenir des terres qu’elles auront à remettre à leurs enfants. Et c’est autour d’une table ou sous un tilleul, à Bavois et à Aarberg, à Ins et à Chiètres qu’on offrira un avenir au Seeland. Les habitants sont seuls habilités, là où ils sont, à réinitialiser les rêves, raccourcir les circuits, réanimer les lieux qu’ils habitent. Il est temps que les collectivités locales, orientées par les politiques fédérale et cantonales, soutenues par les associations, décrivent très exactement la situation dans laquelle elles vivent, identifient leurs maux, leurs bonheurs, leurs besoins; se concertent avant de prendre en main, à des vitesses différentes, l’avenir du lieu qui leur a été confié.
Serons-nous capables d’emprunter cette voie après tant d’années d’infantilisation? Aurons-nous assez confiance en nous-mêmes pour redevenir les acteurs d’une vie qui ne nous appartient plus tout à fait?
La situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, ici comme ailleurs, est si grave qu’elle exige qu’on remette la démocratie à l’endroit, sur ses pieds, en pariant sur la responsabilité de ceux qui auront à répondre, devant leurs enfants, de l’avenir des terres confiées.
En parant au plus pressé, c’est-à-dire en suivant les décisions prises par nos élus, instruits par les universitaires et les spécialistes des sciences de la vie et de la terre, de la biodiversité, du climat, des sols, de l’eau, des forêts.
Mais aussi en donnant une chance à la liberté et à la lenteur que suppose toute mise en oeuvre responsable. Aucune peine, aucun effort n’a de sens si le monde qui nous entoure et la vie tremblante qui l’habite nous sont retirés: les oiseaux dans le ciel et les barques sur les canaux, la nonchalance des poules d’eau et le miroir du lac. On n’obtiendra absolument rien de durable sans lenteur, sans poésie, si l’on ne tend pas l’oreille à ce qui nous vient du fond des temps. L’avenir est à ce prix.
Aussi longtemps qu’on attendra des autres le salut, qu’on calculera notre bonheur à l’aune de celui de nos voisins; aussi longtemps qu’on mettra au premier rang nos passions aveugles et le rêve américain, une villa sur les rive du lac, une place au port de Chevroux, des fraises en janvier et des vacances aux Maldives; tant qu’on s’encombrera des signes de la richesse pour étouffer notre insatisfaction et notre désarroi face à la mort, nous ne ferons que différer davantage le règlement des problèmes qui grossissent chaque jour davantage et menacent l’avenir. La tâche est à la fois simple et immense.
Le Seeland ressemblera demain à celui d’aujourd’hui. Quelque chose d’essentiel pourtant aura changé: l’avenir sera à nouveau la grande affaire. Chacun aura fait sienne cette discrétion et cette retenue auxquelles nous invite notre condition de mortel, attaché à un sol et soucieux de bien le quitter. Le temps aura pris ses aises, il y aura à nouveau du jeu entre les choses et un café dans chaque village.
Et puis, partout où fera halte un étranger, partout où naîtra un enfant, à la campagne, dans son quartier ou au diable Vauvert, il existera un «nous» qui l’accueillera et l’emmènera, là tout près, aux lisières ou au fond du ravin, dans le parc ou derrière le battoir, là où vivent de mystérieux locataires et de très anciens dieux.
Les hommes auront tenu leurs promesses, ils auront rendu Seeland l’âme dont ils avaient trop longtemps cru pouvoir se passer.