Oui, mais Monsieur Berset, à quoi ça sert la politique ?

- Comment t’appelles-tu ?
- Louise.
- C’est un bien joli nom.
- Oui, mais Monsieur Berset, à quoi ça sert la politique ?
- Et bien, ça sert à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. C’est ce je dirai d’abord ce soir sous le grand chapiteau à l’occasion de notre fête nationale, à tes parents et à tous ceux qui viendront. J’essaierai de leur donner du courage car nous vivons une période mouvementée, instable, et les adultes ont tendance dans ces situations, un peu par crainte, à se replier sur eux-mêmes, à parler du passé : « C’était mieux avant. » Pas seulement en Suisse, dans les pays qui nous entourent aussi. Et personne ne sait quand les choses vont s’améliorer. Dans certains pays, plus de la moitié des jeunes ne trouvent pas de travail. Alors bien sûr, ici, nous nous portons mieux que chez nos voisins, et je le leur rappellerai, ça fera du bien à mes concitoyens. Mais tout n’est pas pourtant si rose chez nous, toute personne de plus de cinquante ans qui perd son travail a de la peine à en trouver un autre. Sur ce type de problème, un conseiller fédéral comme moi ne peut pas agir seul, les pays sont obligés d’agir ensemble. Pour agir chez nous, on ne peut ignorer ce qui se passe ailleurs, dans un monde où tout va si vite, dans lequel l’Europe cherche sa place, et au milieu de cette Europe la Suisse aussi, la sienne, C’est difficile de trouver des équilibres. Mais nous devons tous nous mobiliser pour intégrer chaque personne, de 7 à 77 ans. On ne peut pas se permettre de laisser de côté ceux qui sont dans des difficultés, c’est un des éléments qui a assuré le succès de la Suisse, sans jamais perdre de vue que nous ne sommes pas seuls. Voilà ce que je dirai ce soir sous le chapiteau. Et demain on devra répondre à tous ceux qui nous interrogent sur le fonctionnement de nos banques, la crise de la dette, l’échange automatique de données, la transparence fiscale,...

- Je comprenais un peu au début, mais maintenant...
- Comment t’appelles-tu ?
- Lili.
- Et bien, Lili et Louise, je vais essayer de dire les choses plus simplement. Disons que certaines personnes, parce que la vie est difficile, préfèrent ne pas affronter le présent, se rappeler le passé, les serments du Grûtli, la belle époque de la guerre froide, le monde était divisé en deux, les communistes et les capitalistes. Tout a bien changé et nous devons accepter ce changement. Mais les nouvelles réalités n’ont pas surgi de nulle part, il y a un lien évident entre le passé et le présent, et le passé est plein d’enseignements, il est le creuset de valeurs qui sont essentielles. Ce soir je parlerai de 1830 et de la paix du travail, de 1848 et du fédéralisme, de la démocratie directe, du plurilinguisme, des choses simples sur lesquelles repose notre pays et que tu comprendras mieux demain à l’école. J’évoquerai les capacités industrielles de la Suisse du XIXème siècle dont le développement a été presque aussi rapide que celui du Royaume-uni, ses capacités d’innovation sur le plan technique et scientifique. Mais je dirai ce soir aussi notre confiance et notre audace comme notre respect des traditions. Ce point est essentiel, une constante dans notre histoire, notre pays a vu naître aussi bien des constructeurs de ponts et des ingénieurs que des figures critiques. Tout progrès doit en effet être considéré d’un oeil froid, sévère même, sceptique, mais ce scepticisme ne doit pas coûter plus d’énergie que le progrès lui-même. La foi en l’avenir et les égards que l’on doit à notre passé sont les piliers de notre pragmatisme.
Je parlerai aussi ce soir d’un défi majeur, celui de l’évolution de la population, on doit se réjouir de vivre toujours plus longtemps en bonne santé, mais cet événement considérable dans l’histoire de l’homme nous oblige à nous engager dans des réformes importantes pour que nos assurances sociales restent performantes, il en va du lien entre les générations.
Je leur parlerai enfin d’une question qui fâche, de la politique suisse à l’égard de l’Europe, quelques mots seulement, immanquablement un peu vagues, je leur parlerai du pragmatisme qui commande nos actions. Aujourd’hui nous ne sommes pas menacés, aucune raison dans ces circonstances de rester sur la défensive, nous pouvons nous montrer sûrs de nous, créatifs et actifs, sans nous enliser dans nos mythes, en tirant du passé des sources d’inspirations qui nous permettront d’avancer. Ne pas fermer les portes, ce ne serait pas une attitude digne. Voilà !
- Comme tout cela est difficile !
- Pas tout compris !
Jean Prod’hom
Les "cheneviéres" de Corcelles-le-Jorat

La culture du chanvre, diabolisée dans les années 60 mais remise à l’honneur dans les années 90 par des agriculteurs qui peinaient à survivre, jouissait autrefois dans la région et jusqu’à la dernière guerre de faveurs et de soins qui en attestaient le prix. De cette culture à Corcelles-le-Jorat ne restera bientôt, je le crains, que le nom des Chenevard et de leurs descendants. Et une trace dans les archives. Les cheneviéres ont en effet l’honneur d’être désignées dans le relevé de 1852 par un nom spécifique, à côté des prés, des champs, des jardins et des bois.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat, A la Grange ès Roud
Les cheneviéres sont des parcelles qui jouxtent les habitations. Elles ont en 1852, comme les jardins, une valeur fixe dans le cadastre, 1522.50 francs la pose, tandis que la valeur des prés, des bois et des champs varient selon leur situation. La chenevière est travaillée à deux pas de la maison sous étroite surveillance, pour s’assurer qu’aucun oiseau ne détruise les précieuses graines, qu’aucun animal ne fouisse la terre retournée préalablement, fumée et hersée, tapée au moyen de larges planches au milieu desquelles était fixé un manche en bois. Il fallait, précise l’auteur de l’article de l’Encyclopédie de Diderot, que toute la cheneviére soit aussi unie & aussi meuble que les planches d’un parterre. Attendre ensuite, simplement attendre en empêchant la mauvaise herbe d’étouffer la croissance du chanvre.
On semait le chenevis au mois d’avril ou de mai, le jour de la Saint-Urbain, ni trop serré ni pas assez – il faut observer un milieu, qu’on atteint aisément par l’usage, avertit l’Encyclopédiste –, puis le pousser dans la terre à la herse ou au râteau.
On arrachait en septembre les fagnes par poignées qu’on mettait en gerbes dans un pré fauché. Dès le lendemain on les étendait et on les retournait régulièrement durant une vingtaine de jours, c’était le rouissage. On remettait les fagnes en gerbes et on les conduisait en char dans une remise où elles étaient entreposées.

Au printemps suivant, on terminait le séchage, au four s’il le fallait, avec les risques d’incendie que cette opération entraînait, raconte un vieux Broyard en 1931 dans la Feuille d’Avis, puis on procédait au broyage pour en tirer la filasse. On plaçait une poignée de tiges entre les deux longues et solides mâchoires de chêne du batioret qu’on ouvrait et fermait lourdement. Les gosses collectaient dans les débris les fils afin de faire la ficelle pour les liens, licols, cordeaux, cordes de chars, longes. Plus tard dans l’année, le sérancier passait pour carder le chanvre qui serait filé l’hiver suivant.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat, Vers chez les Chênes, 1852
M’aura suffi d’une petite matinée pour faire l’inventaire des cheneviéres de la commune :
Vers Chez Porchet : 51.60 toises
A la Grange ès Roud 95.50 toises
Vers chez Charbonney 54.45 toises
En Gilletaz : 58.60 toises
Es Garres : 46.30 toises
A la Mollie : 37.25 toises
Vers chez les Chênes : 88.97 toises et 142 toises
Es Tailles : 75.75 toises
Au Chalet d’Orsoud : 44.50 toises
Vers chez Porchet : 64 toises, 39 toises et 40 toises
Praz à L’Armaz : 34.55 toises
En Rachigny : 46.95 toises
Et en tirer comme un poème : 919.42 toises, c’est-à-dire 8274m2, c’est-à-dire un peu moins de 2 poses, et le beau nom de cheneviére écrit par un géomètre consciencieux.
Jean Prod’hom
L'envers d'une ligne de désir

Cela fait un bail qu’on dépose chaque matin nos enfants au bas du Torrel, là où s’arrête le bus scolaire, tout près d’un pont qui enjambe dans l’ombre vert sombre le ruisseau du Riau. Le chemin mène à la mécanique, un bâtiment en retrait dans lequel les paysans d’aujourd’hui logent quelques têtes de bétail, entreposent une ou deux machines agricoles et des balles de paille.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
C’était un ensemble comprenant autrefois un logement, avec devant un demi-rond d’herbe tendre, un carré de bettes, du fenouil et du persil. A l’arrière une grange et une écurie auxquelles s’adossait un couvert abritant une scierie et une machine à battre le grain, avec une vaste place de terre battue pour entreposer des chars, stocker le bois, manœuvrer. En 1852 ce domaine appartenait à Jean Rémi Steiner.

Plus trace de la fontaine indiquée sur le plan, plus trace non plus de l’eau détournée du ruisseau par un canal, 250 mètres plus haut, sous la Mollie Cheiry. Une trace seulement sous la peau du pâturage, comme l’envers d’une ligne de désir, celle d’une ancienne passion, la courbure d’un rêve dont les lèvres n’en finiraient pas de se refermer, pure cicatrice sans bord, sourire d’aquarelle à ciel ouvert au-delà de tout repentir.
Jean Prod’hom
Quelque chose ne vient pas

Il y avait en contrebas du cimetière de Gillabert, le long de son ruisseau, une tannerie appartenant à Alexandre Philippe Ramuz d’un peu plus de 9 toises. Suis redescendu ce matin les pieds dans l’eau, en amont de l’ancien chemin qui monte Vers chez Porchet, à la recherche des restes d’une arrivée d’eau dont la dérivation devait se trouver à l’entrée du bois, à cent mètres de là, au pied du Champ Borgey que le ruisseau de Gillabert contourne. Aucune trace du bâtiment inscrit en 1852, ou si peu, une pierre peut-être et une trifurcation en mauvais état qui pourraient faire partie de la petite entreprise d’autrefois.

Continue dans le lit du ruisseau de Gillabert dont les lueurs troubles ressemblent à celles de l’Argens, cette rivière du Var à laquelle René Boglio s’abandonne le temps d’une matinée, laissant au silence des rentrées scolaires les ruelles de Correns fendues par le soleil. René ne s’est pas dégonflé, a jeté du pont son cartable dans la rivière, René s’en fout, René n’ira pas en classe. A l’appel de l’instituteur a répondu celui de la rivière. Ses souliers prennent l’eau qui monte jusqu’à la taille. Que les autres s’occupent de leurs affaires, je m’occupe des miennes les bras en croix, René nage dans la lumière du temps volé, danse avec une vipère d’eau, suit son ombre trouble dans la rivière, René a perdu ses souliers, il croque une figue, se douche sous une cascade. Mais René ne perd pas la raison, personne n’en saura rien, il retrouve ses souliers et son cartable, rejoint ses camarades, il s’est passé une éternité.
Je laisse la tannerie derrière moi, René sourit, René nage, absent pour personne, le cartable et mes projets au fil de l’eau, faites donc des théories, on n’entend rien sous le bruit du vent et des grillons, de l’eau, je glisse comme sur une barque caressée par les branches souples des saules, persiennes ajourées, voix indistinctes piquées par le bleu des libellules et le blanc des papillons. Je croise de petits affluents qui rient lorsqu’ils se jettent dans dans le ruisseau la tête la première, jusqu’au menton, une flûte enchantée se mêle aux tourbillons, dérive des sentiments. René croque une figue, c’est pas une heure pour rentrer, dit la lavandière, nous sommes en 1956 et je viens de naître.




M’arrête à l’auberge, personne n’a entendu parler de cette tannerie. Je rentre avec le sentiment d’être en retard, Sandra sourit, elle s’en va avec Lucie, les enfants et Oscar tremper leurs pieds dans la Carrouge. Chacun son tour. Regarde le film de Jacques Rozier. René a ramené une vipère dans son cartable, je ramène de cet enchantement un gourdin de salon.
Jean Prod’hom
,
Histoire du cimetière de Corcelles-le-Jorat

Chaque commune du canton de Vaud tient entre ses murs quelques-uns des éléments de son histoire, dans des armoires ignifuges ou de simples casiers si la place manque, clés à la bonne franquette, tant mieux. J’ai passé ces dernières semaines quelques journées dans l’une des deux salles de classe du collège de Corcelles-le-Jorat que les enfants ont abandonné depuis peu, une salle au bord de l’abandon, un ameublement sommaire, un massicot, un rétroprojecteur, de vieux ordinateurs, quelques bannières mais une fraîcheur que les vieux bâtiments conservent comme leur vrai trésor. Je ne suis pas du métier mais j’aime me laisser envahir par des questions idiotes qui viennent tout naturellement lorsqu’on leur laisse le temps de sortir des cartons et des vieux registres de comptes. J’y suis retourné ce matin pendant que Sandra, Louise et Arthur étaient au marché et que Lili nourrissait sa passion pour les chevaux.

Ai tourné les premières des 44 pages du Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat levé en 1851-1852, avec l’intention initiale d’inventorier les fontaines. Me suis égaré finalement dans les fours à pain, les latrines et les porcheries, les pressoirs et les chènevières. Sans rien de bien solide. Mais chaque heure passée avec ces documents permet de mieux les apprivoiser, j’en ai fait l’expérience encore une fois ce matin lorsque je suis tombé sur une information cherchée depuis longtemps et à côté de laquelle j’avais passé jusque-là. C’est à la page 23 du Plan, un rectangle longe le chemin de la Moille au Blanc à Corcelles, il porte le numéro 58. Dans le Renvoi , on peut lire à côté de ce nombre : Cimetière à la Commune de Corcelles. Tout s’éclaire, les pièces du puzzle se mettent en place. Voici.
1.
Les Corçalins enterrent leurs morts autour de leur église, plus précisément au nord, sur une place désignée en 1852 comme Ancien cimetière (29) avec la Remise de la pompe à feu tout près (32). C’est ainsi dans la majorité des communes vaudoises jusqu’en 1803, les morts font bon ménage avec les vivants au centre du village, près de l’auberge et de l’église, le four à pain et le pressoir.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
2.
A la fin de l’Ancien Régime, en 1810, Corcelles doit mettre à exécution l’arrêté du 16 janvier 1812 promulgué par le Petit Conseil du Canton de Vaud et déplacer son cimetière hors du centre du village. Corcelles ne s’exécute pas immédiatement. C’est seulement le 16 avril 1834 que la Municipalité, sous la présidence de Jean Louïs Henry Chenevard, s’exécute en entreprenant après discussions des travaux à Gillabert (58).
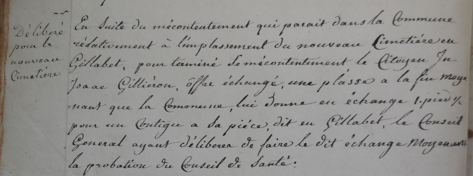
Registre des délibérations du Conseil général : 3 mars 1834
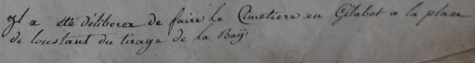
Registre des délibérations du Conseil général : 16 avril 1834

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
3.
Le 28 septembre 1907, l’achat d’un terrain pour agrandir le cimetière est mis à l’ordre du jour par la Municipalité qui a fait des demandes d’achat auprès de divers propriétaires, les morts manquent de place. Louis Porchet refuse en indiquant que la pièce de terre convoitée en Verniaux n’est pas propice pour un cimetière (correspondance du 31 août 1907), Emile Gillééron n’est pas disposé à céder la sienne en Champ la Pierre (correspondance du 27 août 1907), un seul y consent, c’est Louis Chenevard, au lieu-dit au Publoz, un champ qui, vu sa proximité du cimetière actuel est reconnu d’après sondages propre à l’usage auquel il est destiné. Le Conseil après discussion, au bulletin secret, par trente-et-une voix contre une, donne plein pouvoir et accorde le crédit nécessaire à la municipalité. Nous en sommes là, le cimetière n’a pas migré depuis.
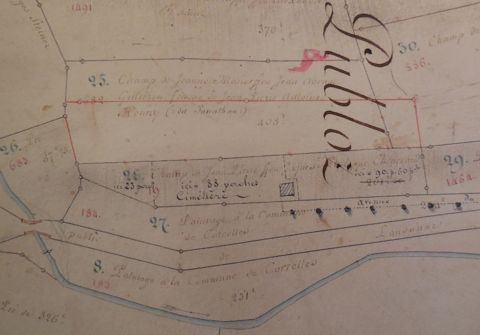
Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852
Le cimetière de 1907 est bien inscrit dans le Plan de 1851, mais c’est un ajout.
Je quitte l’ancien collège et sa fraîcheur, descends dans le lit du ruisseau. Plus trace de l’ancien champ de repos, mais un pré aux herbes folles. Cherche la prise d’eau de l’ancien canal qui alimentait une tannerie dont personne ne parle plus, ne trouve que le ruisseau de Gillabert dont je descends le cours jusqu’au chemin – route aujourd’hui – qui monte Vers chez Porchet, l’eau fraîche me monte à la tête, avec dessous les pieds l’épaisseur de mon ignorance, par dessus laquelle j’ai tendu un fil sur lequel j’avance pas à pas, émerveillé.
Jean Prod’hom
101

Ils sont légion les performers qui reviennent des enfers ou s’y rendent, expérience limite ou mort imminente, vie en aquarium ou macération lente. Trop tôt souvent. J’aurais préféré qu’ils insistent et creusent plus encore leur galerie au risque d’y rester et d’être admirés pour leur obstination.
Bernadette L. est morte, culte et tintamarre, gueules ouvertes et mort passepartout, grilles et haies. Mais tohu-bohu assez efficace pour creuser ailleurs un peu de silence dans le silence. Foule dense et modeste dans l’église de Corcelles, Henri s’éclipse sur la pointe des pieds. Je me souviens, Pauline m’avait enchanté, Henri avait construit le poulailler qui a mis nos poules à l’abri du renard des années durant avant que celui-ci, comme il se doit, ne croque la dernière.
Le papa d’Arthur avance d’heure en heure, de jour en jour, de saison en saison. Comme moi. Mais sans personne ni devant ni derrière.
Jean Prod’hom
Dizy - Vallée de Joux

Bientôt huit heures et branle-bas le combat dans la salle de l’ancien café de Dizy où nous rejoignons les deux Bataves de la veille qui se préparent pour une nouvelle étape, chaque année une vingtaine de jours pour rejoindre Rome. Je déjeune à pleines dents, mais pas question pour Arthur de mêler son couteau et sa cuillère à ceux des autres, qu’ils passent ou qu’ils restent, si bien qu’Arthur jeûne. Tous à la même table, pèlerins et employés de la ferme, noires du Togo, crème de Chine, orange d’Amsterdam, rousses d’Irlande et blancs de Londres. On est les derniers à quitter les lieux.
Dizy
Cimetière
Bois du Prieuré
Ferme du Bois de Fey
Le Veyron
La Tine
La Venoge
Ferreyres
La carrière de calcaire jaune de Bellerive
Bois des chênes d’Echilly
Four à fer des Bellaires
Four à chaux
Envy
Sinjin
Rouge Bou
Juriens
Voiture du boisselier de La Praz
Café du Jura de Nelly à La Praz
CImetière
Combe du Renard
Côte de La Praz
Chalet Lyon (1257)
Boutavent Dessus
Pré de Joux
Crachin
Col du Mollendruz
Restaurant du col
Pétra Félix
Communal du Pont
Sagne Vuagnard
Le lac de Joux
Le Pont
Il est 18 heures, la pluie redouble, on attend le train de 18 heures 30 pour le Day et Lausanne. Encore un hamburger au Mac do de la gare, et puis le M2 jusqu’aux Croisettes. On trouve une borne sur laquelle s’asseoir en attendant Sandra, on en a plein les jambes.
Et voici que celui à qui je répète depuis plus de treize ans qu’il convient de remercier les gens qui offrent un peu de leur temps ou de leur argent, ou même un peu de ce rien qui fait tant de bien, voici donc que celui que j’aurais voulu remercier pour ces deux belles journées en sa compagnie me précède d’un rien.
Jean Prod’hom
















Riau Graubon - Dizy

Il est 8 heures, encore frais, départ pour la Vallée. Peu de mots, on se l’était promis avant l’été. Aller au plus court, direction ligne d’horizon, ce qu’on a sous les yeux. Disons en deux étapes, Arthur et moi.
Riau Graubon
Messelly
La Corbassière
Jorat de l’Evêque
Route des Paysans
Jorat d’Echallens
Maupas
Froideville
Epicerie du Mille-Feuilles
Fontaine de Froideville
La Rustériaz
Bottens
Le Château
La Tuilière
Le Talent
Malapalud
Assens
L’église d’Assens
Terrasse de l’Epi d’Or
Boulangerie Fornerod
Bois d’Orjulaz
Chevrine près de Boussens
Sellerie Rochat
Bournens
Fontaine de Bournens
Cimetière de Bournens
Pont sur l’autoroute
Penthalaz
Piscine de la Venoge
Orage
Funiculaire Cossonay-Gare-Cossonay
Achat du pique-nique à la Migros de Cossonay
Tuilerie
Bois du Sépey
Arrivée à Dizy
Refuge de la Venoge
A 18 heures, avec trente kilomètres dans les jambes et le feu dans le ciel, Arhur demande :
- Dis papa, C'est quoi le plus proche de nous. Les pieds ou la tête ?
Jean Prod’hom
















Au Riau

Passe la journée à l’ombre, dans l’ancien collège, y consulte les archives de la commune de Corcelles-le-Jorat avec une idée fixe mais sans méthode, en sors épuisé. Le cimetière de Corcelles a bel et bien été décollé de l’église et déplacé du centre du village au milieu du XIXème siècle. Plus précisément entre 1834 et 1837, années durant lesquelles différents travaux ont été réalisés, les comptes communaux en attestent : niveler le terrain, poser des coulisses, voiturer le sable et les cailloux pour le hangar - qui n’existe plus -, descendre à Lausanne acheter des fermentes – chez Francillon –, charpenter le couvert de l’entrée,…
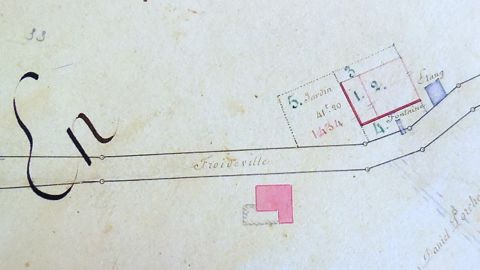
Mais de ces heures passées à faire la taupe, je ne ramènerai ce soir qu’une image, celle tirée du Plan de territoire de la commune levé en 1851 et 1852. On y voit là où j’habite aujourd’hui, une étable rose et une remise sans nom ni chiffre, avec derrière un chemin de terre qu’empruntait le propriétaire d’alors, Jean-Pierre Porchet. On aperçoit sa ferme, une ferme avec son habitation ouverte au sud et à l’ouest, puis son rural constitué d’une grange, d’une écurie et d’une remise, un grand jardin et deux places de terre battue devant et derrière – avec côté midi une fontaine. Un peu plus loin à l’est un étang.
Cette ferme n’existe plus, elle a brûlé, on raconte qu’un char cité par deux chevaux l’a quittée le soir de l’incendie bourré jusqu’à la gueule de meubles et d’ustensiles.
L’étable et la remise d’en face ont pris de l’importance, un peu plus encore lorsque le propriétaire qui nous a précédés les a rachetées, a rehaussé le toit et créé un appendice pour des enfants qui n’y ont jamais habité. Nous avons récupéré il y a une dizaine d’années la part d’eau qui nous revenait, trouvé un bassin de granite, le trop plein alimente aujourd’hui un petit étang creusé au fond du jardin.
Pour le reste, les fermes, le blé, l’orge, les pommes de terre et les betteraves sont les mêmes, le ciel aussi. Et le ruisseau du Riau serpente dans les bois comme autrefois même s’il coupe plus tôt la nouvelle route qui monte à la Moille-au-Blanc, peu avant la poche herbeuse dans laquelle s’enfonce sans disparaître le tracé de l’ancien chemin.
Jean Prod’hom
Pacoton



Les prés s’écaillent, tas de barres, tas de rouille et volets clos, la mécanique déborde, des fils de fer sortent raide d’une boîte d’Ovo, les araignée prises au piège sèchent et cassent à côté d’une poignée de clous orphelins, la vie fait vis sans fin à Pacoton.
Pas de taille cette année, ni essence là où scies et fils se sont succédé à l’établi, on huilait les gonds en toute fin de saison, jetait des fagots et des taillés dans le four à pain, personne ne saura le nombre exact des bouteilles bues à Pacoton. Je marche sur les jours d’une autre saison, on a brûlé les outils de l’autre siècle, skis de bois sans bâtons. Seuls les légumes du potager chantonnent encore au-delà du jour fixé par le jardinier, picoti picoton, ne restera de cette chanson qu’un linteau de molasse avec écrit 1865 dessus, près de la cheminée d’un salon bourgeois.
Jean Prod’hom
Le temps s'ouvre et se ferme comme un accordéon

L’oeuvre aboutie est voisine du suicide. Modgliani s’est tué parce qu’il ne pouvait supporter l’insuffisance de son oeuvre, comparée à la grandeur de son désir. Il existe des sages qui ajoutent lentement à leur oeuvre, il existe des Dieux qui meurent de leur impuissance. Je n’ai rien fait, je n’ai fait que rêver, imbécile. Mon Dieu je vous aime et vous supplie.
Ouvre l’oeil à 7 heures la tête pleine, retourne dans le tambour jusqu’à plus de 10 heures. Premier matin de vacances, c’est-à-dire premier matin à ne pas avoir besoin de me demander comme chaque matin de quoi les enfants ont réellement besoin, ne pas avoir à saisir les urgences devant lesquelles il est judicieux de les placer, ne rien faire, ou qu’ils s’ennuient, attendent, se taisent, placer des obstacles, prodiguer les premiers secours, écouter, dire deux mot, aller au plus court,...
Décide de descendre au marché avec Sandra et les trois petits, de m’éclipser vers l’une ou l’autre des manifestations que Lausanne propose. Plusieurs vernissages ont eu lieu hier, le XVIIIème siècle dans les collections du Musée des Beaux-Arts, Miró à l’Hermitage, mais il y a aussi l’exposition que le Mudac consacre aux sacs en plastique, Louis Rivier et Marcel Poncet au Musée historique, Amadou et Pierre Bataillard à l’Espace Arlaud. Me décide pour le Musée historique à cause d’une peinture sombre qui veillait au fond d’un couloir au Carillet à Pully et qui me revient à l’esprit.
Les amis et les petits enfants de Louis Rivier sont à l’étage, ils parlent haut et fort, comme l’autre jour, bénéficiant aujourd’hui encore de ce que leur ont laissé ces grandes familles bourgeoises et protestantes de Jouxtens-Mézery et de Mathod. Les Rivier et les de Rahm traversent notre temps en chevauchant des points d’orgue, honorant les héros de leur lignée peints sous les traits des princes toscans, amis des arts et des hommes, invisiblement généreux dans les jardins de leur château.
Au sous-sol désert un Socrate, défiguré comme de juste par l’un des fondateurs de la Société d'art religieux de Saint-Luc et Saint-Maurice, Marcel Poncet, défenseur de l'art sacré en Suisse romande, le prince Mychkine, une lettre de Louis Soutter que Marcel Poncet a mis sur les rails de la peinture, une gravure tourmentée de Jacqueline Oyex, deux autoportraits, une bouteille et un citron, assiette verte, napperon bleu, nappe rouge. J’aperçois dans une vitrine des poèmes de Jean Follain, aux éditions de La Rose des quatre vents que le catholique genevois a illustrés. Jean Follain réapparaît sur un écran de télévision dans une courte séance tournée, peut-être, dans la maison Saint-Christophe de Vich. Poncet y fait le clown entouré d’enfants.

A la fin du livre que Jaques Chessex et Valentine Reymond ont consacré au peintre et verrier, il y a une photographie réalisée à l’ouest du Bois de Chênes entre Vich et Genolier, près de la Baigne aux chevaux. On y voit Philippe Jaccottet et Marcel Poncet, mais aussi Jean-Claude Piguet tout jeune alors que j’ai assisté une année durant à l’université de Lausanne, un peu par hasard, à l’occasion d’un séminaire qu’il avait conjointement organisé au début des années quatre-vingts avec Pierre Gisel autour du requiem, et plus particulièrement du War Requiem de Benjamin Britten. Le monde se rétrécit soudain et le pavé sur lequel je pose le pied en sortant du musée se souvient. Est-ce ainsi qu'on se cherche des racines ou est-ce ainsi qu'on les trouve, parce que le temps soudain se confond avec lui-même, s’ouvre et se ferme comme un accordéon.
Jean Prod’hom
On touche du bois

Matinée au CHUV, le test au synacthène réalisé il y a un mois montre que les glandes surrénales de Louise répondent tout à fait normalement au stress et sécrètent la quantité de cortisol qui convient. Pour le reste tout va bien, on touche du bois, les paperasses qu’on est invité à compléter ne constituent pas aujourd’hui une corvée, on se réjouit d’écrire oui ou non en face des questions qui nous sont posées, elles font même un peu sourire. Le service de pédiatrie, qui ressemble en temps de crise à l’antichambre du cercle le plus sombre des enfers, n’est pas loin dans ces circonstances d’avoir les allures d’une chocolaterie où l’on accueillerait les enfants du paradis au pays des merveilles, on aimerait même que notre séjour se prolonge pour revoir le gamin qui a disparu sur son tracteur à l’autre bout du couloir, suivre encore un instant les allées et venues des infirmières et des médecins, écouter le bruissement de la vie là précisément où elle hésite.
Et puis la bienveillance des médecins, le temps que mettent les professeurs à la disposition de nos enfants pour qu’ils comprennent ce qu’il en est, saisissent au mieux leurs intentions et leurs actions en leur donnant des explications suffisamment sommaires nous permettent à nous aussi de nous rassurer et de savoir un peu mieux ce qu’il faut en penser.

Il est un peu plus de onze heures et quart lorsque nous quittons le CHUV, je reconduis Louise à Vucherens où elle va pique-niquer et répéter le spectacle de fin d’année, elle refuse comme d’habitude de prendre une aspirine. On compte les balises anti-gibier à ultrasons posées l’année dernière entre le Chalet-à-Gobet et le bout du plateau de Sainte-Catherine, près de cinquante, chargées de tenir à distance les chevreuils, les renards, les blaireaux, les hérissons et leur épargner ainsi de se trouver nez à nez avec les quarante tonnes circulant sur la route de Berne. La campagne est devenue pour le bien des bêtes, et c’est tant mieux, un immense zoo entouré de grillages parfois invisibles. Mais si les hommes se sont révoltés (et se révoltent encore) à l’encontre des murs de pierres que certains d’entre eux ont dressé pour en séparer d’autres de leurs parents et de leurs amis, ils acceptent tous aujourd’hui sans broncher le mur infranchissable qu’ils dressent entre eux et les bêtes.
M’arrête au retour sur la colline de Vucherens, relève la date de 1839 inscrite sur le tympan du porche du cimetière près de la chapelle érigée en 1737. Cette date renvoie-t-elle à l’adjonction de ce porche ou à la création du cimetière ? A un agrandissement ? Existait-il avant 1737 un cimetière ailleurs, près de cette chapelle dont parle Marcel Grandjean, incorporée à une maison communale dans le village ?
Je monte au pas le raidillon de la Moille Cherry, une bossette à lisier me précède, tuyaux hirsutes dressés sur la tête, que le chauffeur fera traîner tout à l’heure sur les prés, évitant ainsi de repeindre le printemps à l’ammoniac, en passant comme autrefois 20 000 litres de lisier à la moulinette. On se sépare au tilleul, le convoi monte en direction de la Moille-au-Blanc.






Aujourd’hui encore il m’apparaît que les choses vivent en paix côte à côte, sans lien de subordination, avec en chacune d’elle un monde, comme devant la forge de Vincent Desmeules à Ropraz où je m’arrête un bref instant après avoir déposé Lili et Mylène à l’arrêt de bus : des abeilles bruissent à l’entrée d’une ruche bleue, à l’abri sous des plaques de fer, rouillées, brutes, inertes, d’un autre âge, d’un autre règne.
Jean Prod’hom
Faire un livre

Le grondement sourd qui nous parvenait ces derniers jours de la soufflerie des greniers de la Moille-au-Blanc s’est tu, l’herbe est sèche. Si Freddy a entamé hier un second passage dans le pré à Max, ce matin la faucheuse est bâchée, il a plu toute la nuit. Le vent est tombé, les fenêtres sont fermées, on ne verra pas les enfants avant huit heures, tout est en place pour un dimanche pot-au-noir. Des bruits il y en a, mais le vide que le vent a creusé depuis qu’il est tombé les maintient séparés les uns des autres, dans une solitude presque désespérée : un grillon se noie, les bris d’un merle de cristal, les cris d’une corneille ou un âne qui brait, à moins qu'il ne s'agisse d'un pic sur une vieille plaque d’éternit. Douceur, désolation, mais sans risque et sans heurt, sans contagion. La pluie soudain reprend et s’abat sur le toit, on ferme les velux, on se retire, nous de notre côté et la campagne du sien.
On boit un café, Sandra lit, Louise nous rejoint. Je relève mon courrier, un gentil mot de François Bon sur Tiers Livre, ce n’est pas la première fois et je m'en réjouis. Me réjouissent également ces mots des lecteurs qui me parviennent : Justine, Murielle, Julien, Yvan, Sylviane, Brigitte, Murièle, Alexandre, Francis, André, Anna, j’en oublie.
Bientôt cinq ans. Un billet chaque jour, chaque jour ouvrable d’abord, quotidien depuis juillet 2012, des billets qui donnent un rythme à mes journées, parfois bien plus. Observer, comprendre, aimer, tout et n’importe quoi, ce qu’on finit par regarder, d’autres couches, d’autres cercles. Même si – et c’est l’une peut-être de ses leçons essentielles – écrire n'est pas tout, tout au plus un attribut, j'entends par attribut ce que l'intellect perçoit de la substance.
Je tente de placer au bon endroit le numéro ISSN qu'une dame de la BNF m'a envoyé la semaine dernière. Malgré les conseils avisés de François Bon et Christine Genin je n’y parviens pas et y renonce assez vite, il n’y a pas le feu. Même chose avec Prolitteris, Claude qui m'avait encouragé il y a 6 mois à adhérer à cette société chargée de veiller aux droits d'auteur, a réitéré ses encouragements l'autre soir sur le seuil de la librairie Basta, avec d’autant plus de raisons qu'on a reparlé de ce livre qu'on va faire ensemble.
Il me dit où il en est, ce qui pourrait constituer le centre de ce livre, et j’imagine les cercles qui en feraient le tour, toujours plus larges. Et cette idée de faire un livre – Je ne sais pas si tu as déjà envisagé de réunir un choix de tes textes dans un livre en papier ; si ça te tente, je serais très intéressé à les publier – je ne m'y suis pas fait immédiatement, mais je peux aujourd’hui le concevoir à condition qu’un maître d’oeuvre aux reins assez solides prenne l’initiative des travaux. Ce maître d’oeuvre m’obligerait ainsi à reconsidérer ce qui existe aujourd’hui dans les limbes, et à concevoir des cercles inédits susceptibles de m’accueillir moi et mon purgatoire, mes enfers et mes paradis.

Comme chaque dimanche depuis quelques semaines, Louise et Lili descendent chez Marinette lui donner un coup de main, nettoyer le parc de l’âne Ziggy et Sahita le poney, Sandra les accompagne. Arthur, qui a été privé d’écran toute cette semaine, part en trombe avec Oscar remplir sa tâche dominicale, fait le petit tour au pas de course, revient à 10 heures sonnantes. Il se cale devant l’ordinateur pour jouer et aménager la plate-forme Minecraft qu’il souhaite administrer avec sa soeur.
Passe en coup de vent chez Marinette qui prépare un thé, pour avertir Sandra et les deux filles qui ont nettoyé les box et ramasser les crottins du parc que je descends en ville au Musée historique de Lausanne où je compte m’arrêter dans quinze jours avec les élèves de la 11. Les gardiens du musée coopèrent si bien qu’il ne me faudra que quelques minutes pour régler l’affaire. Monte au deuxième étage jeter un coup d’oeil à l’exposition consacrée à Louis Rivier dont je ne connaissais en fait que la Mater dolorosa de Bottens, étape naturelle du pèlerinage qui va de Corcelles à Echallens. Y reste finalement deux bonnes heures, Louis Rivier y apparaît entre deux mondes, pseudo-idôlatre au coeur de la communauté protestante fâcheusement iconoclaste, dernier artisan de la générosité discrète de la grande bourgeoise vaudoise avant son déclin.
Lausanne est immobile, bien droite dans le vent, les yeux fixés sur le lac, il y a du monde sur l’esplanade de la cathédrale, peu de Lausannois. Une femme cachée derrière un niqab me rend songeur, elle photographie les alpes françaises de l’autre côté du lac, les toits du quartier de la Palud, son mari ou son ami, les jardins de l’Evêché, mais que voit-elle ?
L’homme fait lui aussi quelques photos, les Alpes, les toits, les jardins, pas un regard pour elle, moi si, et elle pour moi.
Jean Prod’hom
Trapèze et chute libre

Il en faut de la volonté pour pencher la tête et retrouver sous le badigeon immanquablement gris des jours ouvrables, ne serait-ce qu’un instant les couleurs d’origine, il en faut du courage pour suspendre les trajectoires que des disciples de Laplace semblent imposer à chacun d’entre nous et prendre la tangente. Je n’y parviens qu’à moitié, avance actif et docile jusqu’à midi en anticipant les désagréments des jours prochains. Nous avons, les élèves de la 11 et moi, étêté les piles qui menaçaient au sommet des étagères en mettant le surplus à la benne ou dans des cartons, en vue du déménagement qui va nous conduire dès le mois d’août prochain dans le nouveau bâtiment scolaire. J’en profite pour verser tout ce que j’avais cru bon garder des années durant dans la poche sans fond de l’inutile. On entrepose ce qui est à garder dans l’ancienne salle de sciences. La classe 11 reprend une existence indépendante à mesure qu’on la libère, les élèves rentrent chez eux avec des livres et des boîtes vides sous le menton. De six heures à midi sans discontinuer, une seule trajectoire, de porte à porte, comme suspendu à un trapèze tenu par une main invisible.
Chute libre ensuite au Riau où je me couche une bonne heure, ramolli, avant de corriger assis devant un café les vingt-deux dernières copies de l’année.
Je suis debout à cinq heures et on va, avec Sandra, sur le chemin qui conduit au refuge de Corcelles, on décide de prolonger notre escapade, une piéride bat des mains, on la suit une bonne centaine de mètres. Me reviennent en mémoire celle qui m’avait précédé tout un matin sur un chemin de l’Emmental entre Eggiwil et Trubschachen, cette autre qui m’avait ouvert tout l’après-midi un allée royale dans les bois au nord-est de Chinon. Prise en écharpe par Sandra et moi, la nôtre décide d’aller de son côté sans cesser d’applaudir. De l’autre côté du chemin les abeilles travaillent dur, on les entend entrer et sortir des huit ruches cachées par les lourdes branches des foyards. On parle de choses et d’autres, de cette fin d’année scolaire et de nos enfants, on passe par le chemin creux. On s’emballe en évoquant les mardis de la rentrée, c’est un peu tôt, il est préférable de se taire.
Jean Prod’hom
Le champ de blé vert

L’image d'un jeune homme qui a tout laissé, décidé et silencieux. Il a mis la poésie sur orbite, hors d’elle-même et sans lui, pas le temps, il y avait la mer.
Sous une aubépine, des iris.
Sur la tête un tout nouveau chapeau de paille, ai cherché tout le jour un chemin sur lequel m’engager, aucun n’allait nulle part.
Jean Prod’hom
Longue liste des merveilles

Me voici la tête dans le pare-brise, passant à côté de ces premiers jours de printemps qui n'attendront pas, je cours sur la route de Berne en file indienne.

Au Riau les beaux jours ont installé leurs quartiers dans les vergers, les brins des prés gonflés d'eau battent l'aile. Je regarde par la fenêtre de la salle des maîtres, les bouleaux jettent par poignées des pièces d'argent dans le ciel, les filles et les prunelliers découvrent leurs bras blancs, les bois des cerisiers rosissent. Une bergeronnette fait ses ablutions dans une gouille, un rouge-queue des génuflexions. Me revient un air de Tarente sur le chantier d'à côté, un pic sur une boîte à rythme, deux pies au balcon, et tout autour la longue liste des merveilles.
Faudrait-il être poupon, idiot ou des bois pour goûter sans laisse à ces parfums ? Ou doit-on remercier Dieu de pouvoir les nommer ?
Il est 18 heures, je laisse les filles à leur maison établie tout près du ciel, ce qu'il me plaisait d'imaginer ce matin est là, le bois Vuacoz m'offre un peu de ce quelque chose à côté de quoi j'ai bien failli passer.

Jean Prod’hom
Le Riau de Corcelles

Le Riau de Corcelles, retenu ici par un affleurement de molasse, là par les restes d'un bloc erratique ou d’un amas de bois morts, culbute et tourbillonne au détour des gorges liliputes qu’il s’est ménagées dans la tourbe.
On peut, si l'on s’étend sur l’une de ses rives au printemps et qu’on ferme les yeux, écouter simultanément trois ou quatre de ces délicats incidents sonores qui ponctuent le cours des ruisseaux à leur naissance, ronds et souples comme des pelotes de laine, mais de profil si différent qu’on se met immanquablement à identifier les secrets d’un autre monde : le petit lait tout à côté contre lequel vient buter en amont le roulement d'argent de billes bien graissées. En aval des bouches de tuba qui dégringolent, plus loin une caverne qui se gargarise.

C’est d'être deux dans son lit et hors de lui que le Riau de Corcelles est un, ce sont ces motifs sonores bien distincts les uns des autres qui attestent d’un second ruisseau par-dessus le premier.
L’un est sombre, obstiné, bitumeux, c’est lui qui porte sur sur son dos le second qui s’agite, jette des éclats, rit, babille sans qu’on puisse, si l’on cède à l’appel et entrouvre un oeil, localiser précisément le lieu de ses vocalises. C’est dans ces chutes infimes que le ruisseau du dessus cascade et s’allège battu comme un blanc d’oeuf.
Jeune encore, il n’hésite pas à se mouiller les mains, puis il reprend son souffle une dernière fois, se gargarise d’aise avant de plonger la tête la première, de mêler ses eaux à celui du dessous, ne faire à deux plus qu’un à l’entrée de la plaine limée par la Broye qui file les mains moites jusqu'à la mer.
Tandis que tu tends l'oreille pour en savoir plus, les hôtes que tu avais oubliés reviennent occuper leur place, le merle et son chant, le bruit des feuilles qu’il remue, les cris du geai et de la corneille, le bourdon de l’avion et l’abeille, les bruits liquides, la litanie des « l » et des « r ».
Si tu t’éloignes de quelques pas sans les mêler aux feuilles mortes, tu te rends compte soudain que le Riau de Corcelles fait entendre tous les chants du monde, il suffit de se déplacer d’un pas pour que le petit lait se fasse crème. Le roulement à billes se fait pâte pétrie et les bouches de tuba toux grasse.
Le ruisseau aurait pu se vanter de son répertoire infini mais le diable est discret. Si tu lui dis qu'il partage le monde en deux comme le Rhône et le Rhin, il te rit au nez, il a d’autres choses à faire.
Jean Prod’hom
La pince se desserre

Les enfants sont à l’école, Sandra au Mont, c’est mardi et il fait soleil au Riau. Je laisse en arrière tout ce qui est susceptible de se transformer en remords et envoie à trois jets de pierre les urgences. Je fais un pas, puis deux, trois, ça suffit pour que la pince se desserre.

Vingt-deux degrés, je me réjouissais de cet instant, retrouver le bois Vuacoz où j’ai vécu tant de belles heures l’année passée, choisir une souche et m’y adosser, avec le chien qui vaque à ses affaires et ce bonheur enfantin d’être dehors et d’y rester.
Eux aussi sont au rendez-vous, mais ils sont à l’air libre depuis samedi à l’aube. Je n’ai besoin de rien sinon de mes mains nues pour disposer d’un peu de place au milieu de leurs chants. Je ne les vois pas mais leurs sifflements montent à la verticale avant de retomber comme des feux d’artifice, ils semblent se comprendre, je ne comprends pas, c’est réconfortant.
Un peu de lecture, de la bruyère, un tapis de mousse et des bouquets de prêles avant que mon corps se défasse, se fragmente, menus atomes qui se dispersent comme des grains de poussière dans un rais de lumière, mon visage tient tout seul près du feu de la forge. Tout se juxtapose mais les choses ont les coudées franches, celles qui portent un nom et celles qui restent muettes, si bien que le verbe se lève : il ôte ses gants et se fait brise.
Jean Prod’hom
Oscar

Oscar passe une partie de la matinée dans le jardin tandis que je brûle les dépouilles du tilleul que Daniel a fait tomber vendredi. Il s'affaire sur un morceau de bois, le ronge, court après son ombre et les bruits, lève la tête, se roule dans les copeaux, aboie, disparaît, revient. Lorsqu'il m'aperçoit avec un bout de tilleul à sa taille, il s’approche, me regarde, attend. Mais je n'ai pas le temps ou ne le prends pas, ou ne le lui donne pas. Il penche la tête à gauche, à droite, je fais de même, à droite, à gauche, je joue, il reprend, je ris, lui pas, il ne joue pas, c’est autre chose.
Son insistance muette – elle me fait penser à celle des innocents, des enfants, des oubliés, ou à celle des pauvres – fait tomber mes dernières résistances, je jette en direction du hangar un os de bois avant de retourner à ma tâche.
On se sera donc croisés quelques secondes avant de rejoindre chacun de notre côté notre ventre et le gros de notre vie, dans un jardin où coexistent d’innombrables mondes, il rejoint le sien, je rejoins le mien. Je l’observe pourtant à la dérobée et, alors qu’il reprend place au centre de son domaine et se livre aux circonstances en cueillant quelques fruits du hasard, je m’interroge, cherchant la clé de ses actions. Je radote, il se tait, c’est évident, il me montre la voie, il fait rayonner en effet une autre vie à quelques lieues des boulevards du langage et de la raison.
Son esprit n’est décidément pas soumis au déroulement linéaire qui nous éloigne de la coexistence et de la diversité des mondes. Les décisions qu’il prend sont justes, ne le conduisent pas au désastre, mais elles n’obéissent pas aux règles qui président aux miennes. Les étoiles tombent de partout autour de lui, monde ouvert qui ne change pas et qui semble clignoter continûment tandis que j’avance entre deux haies de raisons, au coup par coup, comme dans un récit taillé à la machette et dont l’imprévu a été exclu.
En affinant ses rapports au monde par le langage, l’homme s’est coupé d’autres manières de l’habiter, l’oubli du temps d’avant l’enfance en témoigne. Comment Oscar fait-il pour s’y retrouver, ne pas devenir fou, aimer ? Oscar est un philosophe qui s’ignore, me voilà moins seul dans le monde du langage, ensemble dans le jardin. Je le sais seul loin de moi dans le sien, ne veux ni le rejoindre ni le rapatrier dans le mien.
Jean Prod’hom
Habemus papam

Dans chacune de nos maison un foyer où couvent des secrets, une cheminée d’où s’échappent des légendes.
La bise s’est levée et secoue des deux bras les contrevents : des giboulées dansent aux fenêtres et la grande noiseuse trace des messages sans queue ni tête. Le soleil est vite refroidi, le foyard crépite, arabesques au-dessus des cheminées, on n’est pas tous logés à la même enseigne : bois jeune noyé de paille, fumée noire, on bataille ; vieux bois mort d’âge, dix ans au sec, fumée blanche, réjouissances.
Jean Prod’hom



Deuxième poussée du printemps

On attendait une réplique à la poussée noire de la semaine passée, c’est fait, les arbres nus n’offrent plus aucun abri, le roquet aboie, trois chevreuils fuient. La glace cède, l’eau remonte jusqu’aux chevilles, le carton est détrempé. Dans l’ombre des dépouilles de l’hiver, un cortège de signes qu’on ne sait par quel bout prendre s’allonge sur le chemin : animaux de basse-cour qui dansent, animaux des bois qui fuient, mais aucun chiffre, aucune clé, une succession d’approximations passagères. Bouffées d’air chaud dans le ciel blanc au-dessus de la Mussilly, coup de fatigue, tout ira vite désormais, tout est beaucoup plus clair, un merle siffle le rassemblement.
Jean Prod’hom
Première poussée du printemps

C’est venu de dessous, une poussée noire qui a desserré les pinces du gel, ça se préparait depuis quelques jours, elle est là, vague et débâcle, boue noire dans laquelle le premier printemps essaie de se tenir debout, mais il s’enfonce parce que ses appuis se dérobent comme les pieds d’une échelle auxquels on aurait oublié d’enfiler des bottes.
Le foehn a ouvert d’immenses chantiers, l’eau noire des rivières s’est attaquée aux talus. Dans les champs et les jardins détrempés, le bric-à-brac laissé à l’automne réapparaît, on croyait les canettes enterrées, les guirlandes des nuits de Noël au grenier : la campagne ressemble à la baie des Trépassés.
Ce matin les moineaux et cinq petites boules jaunes dans la plate-bande ont pris les devants, on est plusieurs à avoir desserré les dents. On attend confiants les répliques de cette première poussée pour fêter le nouvel an.
Jean Prod’hom




Une dernière clope

Deux hommes d’âge mûr conversent à la table voisine, le visage marqué, passent en revue les épisodes de leur chemin de croix, s’étonnent : « Tiens, on vit le même calvaire ! » Les deux lascars ont en effet cessé de fumer un nombre incalculable de fois, ont recommencé autant, ils rient heureux d’être semblables, ils avaient juré pourtant par tous les dieux qu’on ne les reprendrait pas, que c’était la dernière fois et la dernière clope qu’ils le disaient et sur laquelle ils tiraient. Le vice les tient fermement dans sa pince, ils oscillent entre les plaisirs qu’on se doit de ne pas refuser, on va tous crever, la vie est courte et les séductions d’une vie marquée par la vertu, le courage et les sacrifices. Ils racontent à tour de rôle leur inépuisable aventure, même rengaine, raisons, explications, justifications.

L’un d’eux l’affirme bien haut : coupables son père et sa mère, indécrottables fumeurs et cause première de son vice, qui fumaient à tout-va, jour et nuit, dedans comme dehors. L’autre raconte la pression qu’ont exercée sur lui les groupes d'adolescents au tournant de sa seizième année, le sésame que représentait une cigarette au bout de ses doigts pour être des leurs. J’hésite à m’inviter à leur table et verser ma contribution à ce procès. Je tiens moi aussi pour responsables de mon addiction mes copains d’alors, Michel, mon père et ma mère, mes parents et les lobbys de potaches. Mais je m’abstiens. (A suivre)
Jean Prod’hom
74

Il a neigé, tout est blanc, blanc comme l’hermine installée dans les sous-sols du pré à Max, elle hésite à se lancer incognito hors du terrier n’était le plumet noir à l’extrémité de sa queue.
Jean Prod’hom
Balle de brouille

Une journée dans le ciel avec ceux d'en face qui regardent de notre côté, haut perchés comme nous à la Mussily ou aux Chênes, sur les flancs du Moléson, du Niremont et des Alpettes, sous le porche de la chapelle de Vucherens, sur le chemin de ronde de la Tour de Gourze ou à la buvette du Mont-Cheseaux, penchés au-dessus de l'immense édredon qui recouvre ce matin les vallées de la Broye, de la Bressonne et de leurs affluents au chevet desquels ceux d’en-haut veillent, on n’observe aucun mouvement dans la balle de brouillard, aucune fuite et on s’inquiète un peu.
On devine qu’en-bas personne n’a rien vu venir, tout s’est établi avant que le jour ne se lève. On les imagine fantômes, gris, la tête dans les talons – à quoi bon jeter un oeil au ciel puisqu'il n'y a pas de ciel –, ils respirent à peine et des pensées lourdes et humides pèsent sur leurs cabas remplis jusqu’à la gueule, ils sont comme à l’arrière d’une guerre oubliée, ils ont allumé les réverbères.
Nous, on aurait voulu qu’ils se réveillent et s’ébrouent, montent, désobéissent. Ils auraient pris la route d’Hermenches, une lueur serait apparue au-dessus de Rossenges, orangée, puis une autre bleutée qui aurait fini par prendre le dessus et les aurait enfin tirés du lit. On aurait vu d’abord leur tête dépasser, puis leur sourire, et le soleil aurait éclaté et ils auraient senti sur leur peau la chaleur de la laine rôtie.
C’est à cela qu’on pensait.
Mais aucune tête ne dépassa de la balle de brouille hormis le clocher de Mézières, égaré, déplumé, inutile pour ceux d’en-bas qui en auraient tant eu besoin. Et nous, nous étions à ses côtés, aveuglés sur la route qui monte des fonds de la Carrouge jusqu'au cimetière de Ferlens, une route à la verticale qui, du temps de leur vivant, les gens de Ferlens appelaient la route du Paradis.
Jean Prod’hom
Arthur le poète

La nuit est tombée, il est temps d’aller se coucher. Arthur monte dans les combles saluer sa mère, les escaliers craquent à chacun de ses pas. J’entends sa voix douce qui s’élève. Quel est ce poème ? Peux-tu le répéter ? Il dit alors le premier vers d’une complainte dont il ne connaît pas la fin, les marches en bois de l’escalier craquent à nouveau, il sourit et répète une fois encore.
- Fleur de verdure et de juillet, que ferais-tu si je n'étais pas laid ?
Je demande à l’enfant son inspiration, il sourit encore.
- Venus tout seuls en montant du salon, ne sais pas d’où.
Il sourit encore, je veux en avoir le coeur net, l’enfant serait-il un coquin ? Je soumets ces mots à Google qui les passe à l’essoreuse : 0.49 secondes pour 11’700 résultats. Ce vers est unique, il n’est pas indexé. Mais on le trouve en morceaux dans l’oeuvre des géants, la première page que propose Google à ma requête nomme Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Mary Schelley, Marcel Proust, Franz Kafka, André Gide. Un poète nous est-il né ?
Me hâte d’ouvrir son journal que je n’ai plus consulté depuis quelques mois et découvre à nouveau l’observateur sensible des saisons, le frère de ses soeurs amateur de pizza et l’ami de son chien, le sauveur de l’humanité, l’infatigable voyageur, l’ambitieux champion, l’ami des écrivains…
Mais aujourd’hui c’est l’autre face de l’enfant que je découvre, déchiré, oublié. Je suis totalement ruiné, écrit-il dans son dernier billet, et le père que je suis s’interroge.
Jean Prod’hom
Foi

La sagesse populaire rabâche à nos enfants que le travail est une valeur fondamentale, la persévérance une vertu cardinale. Arthur bute pourtant ce soir sur les mots que sa prof d’anglais a inscrits en tête de l’épreuve qu’elle leur a remise ce matin : Good luck !
C’est vendredi, Arthur songe, Arthur calcule, confiera-t-il la semaine prochaine son sort à Dieu ou au calcul des probabilités ?
Jean Prod’hom
Boules à neige

Voile ronde, tendue au matin par les drisses des rêves, bordée le soir par le battement des paupières, ou voûte c’est selon, il a neigé toute la nuit sur le dos de la terre. Nous n’aurons pas vu de la journée les enfants qui ont glissé au-dessus de nos têtes à deux pas du ciel, pente douce vautrés dans un édredon.
Il y a des jours où le jour ne passe pas, se dilate jusqu’à midi puis fraîchit. Les enfants auront fait la fête en sillonnant en tous sens le dessus de l’édifice, ils auront planté leurs griffes dans le mou des choses. On les aura écoutés de notre côté, dans les combles, immobiles comme dans un igloo avec un peu de lumière entre les jointures.
J’aime ces jours de décembre semblables aux boules à neige où rien ne vient remuer le temps. Bien des choses comptent pour beurre au milieu de nos habitudes, jours perdus dont il n’y a rien à dire, ajoutés aux babioles sur nos commodes, jours de pluie d’automne à côté des poupées bretonnes, fournaises d’été et restes de terre cuite, journées qui ne comptent pas, livrées en bloc. Des journées qui nous laissent avec nos respirations, hors tout, des journées qui ressemblent à des dimanche même le samedi.
Jean Prod’hom




Qu’est-ce que tu fais ?

- Qu’est-ce que tu lis ? R… a… muz ?
- Ramuz, c’est le nom de l’auteur.
- Derborence, c’est quoi alors ? l’endroit où il est né ?
- Non, Derborence, c’est le titre de ce récit. Souviens-toi de la yourte dans laquelle tu as dormi cet automne. En face, on apercevait un lac, c’était le lac de Derborence, au-dessus on voyait le Pas-de-Cheville et les Diablerets.
- Je me souviens de la yourte mais pas du reste. Dis voir, ton livre c’est pas un gros livre.
- Louise, tu me laisses tranquille, j’aimerais terminer la première partie.
- Pourquoi tu soulignes des mots ?
- Pour y voir clair. Et maintenant, tu me laisses terminer.
- Mais les pages qui suivent sont aussi soulignées.
- C’est pas la première fois que je lis ce texte, tu me laisses terminer ?
- Combien de fois tu l’as-lu ?
- Quatre ou cinq fois.
- Pourquoi tu lis plusieurs fois, c’est idiot.
- Parce que j’aime ce livre et parce que j’aimerais terminer la première partie.
- C’est quoi qui est bien ?
- Tout et le détail, tout et tout dans tous les sens. Ma petite Louise, ce livre est extraordinaire, c’est un des plus beaux livres que j’aie lus.
- On voit que tu n’as pas lu le Club des Cinq et Game Over.
- J’ai lu le Club des Cinq, plusieurs aventures même. Mais pour l’instant j’aimerais terminer la première partie. Veux-tu peut-être que je la lise à haute voix ?
- Oui !
- Oh! a-t-elle dit à sa mère, et toi, est-ce que tu crois qu’il est mort ?
- Lui c’est son mari, Antoine. La mère, c’est Philomène, Thérèse c’est sa fille.
- Celui qui est monté dans le pâturage accompagner son troupeau ?
- Comment sais-tu ça ?
- Je viens de lire ça au dos du livre.
- Oui, c’est Antoine qui a disparu dans l’avalanche.
- Il est mort ?
- On ne sait pas encore. Il faut attendre. On ne sait rien ; ils viennent seulement de partir.
- Qui ?
- Le médecin et la justice.
- Ah ! a-t-elle dit, il faut attendre ? il faudra attendre jusqu’à quand ?
- Jusqu’à demain ou après-demain. On te promet qu’on te dira tout.
- Il va revenir ?
- Oui, au début de la seconde partie.
- Oh! a-t-elle dit, c’est pas la peine.
Elle a dit .
- Pourquoi est-ce qu’ils se dérangent ?
Elle dit :
- Et moi, est-ce que je ne pourrais pas monter avec eux ?
Elle s’est assise sur son lit, pendant que les deux femmes accourent, l’ayant prise chacune par une épaule et l’obligent à se recoucher.
- Elles sont deux ?
- Il y a aussi sa tante Catherine.
- A quoi est-ce que tu pourrais bien servir là-haut, ma pauvre fille ? Il n’y a qu’attendre, vois-tu. Fais comme nous. Car qu’est-ce que nous pouvons faire, je te demande un peu, ah ! oui, qu’est-ce que nous pouvons faire, nous autres, ma pauvre fille ?
Parmi les larmes qui lui coulaient le long des joues :
- Et il te faut penser à lui.
- Qui ? Lui ?
- Le fils d’Antoine et de Thérèse. Thérèse est enceinte.
- Qui ?
- Lui, le petit, s’il doit venir.
- Bon !
Elle se laisse faire, elle se laisse aller en arrière, elle est de nouveau toute tranquille sur son oreiller. Elle a croisé les mains sur le drap. Les montagnes vont bientôt devenir roses. Les montagnes nous tombent dessus. C’est beau à voir, mais c’est méchant.
- Méchant ?
- Parce que l’avalanche a tué son mari, je pense.
Elle a dit :
- Et si j’ai un enfant ? Si j’ai un petit enfant d’Antoine ? Lui je sais qu’il ne reviendra pas. Mais alors, ce petit enfant, il serait orphelin, il serait orphelin avant d’être né ?… Ah ! a-t-elle dit, ça lui aurait fait pourtant bien plaisir, à Antoine. Je lui aurais dit le secret à l’oreille… Et bien ! je ne lui dirai rien. Il ne saura jamais rien, jamais. C’est drôle.
Tout à coup elle a crié :
- Et bien, je n’en veux pas… je n’en veux pas. Un enfant qui n’aurait pas de père, est-ce que c’est encore un enfant ? Oh ! ôtez-le-moi, disait-elle, ôtez-le-moi, ôtez-le-moi !
- On va le lui ôter ?
- Je ne m’en souviens pas, je te lirai la suite un autre jour si tu veux.
- Lire cinq fois le même livre et ne pas se souvenir de ça ! Vraiment, je ne sais pas à quoi ça sert.
- Je ne sais pas exactement non plus et je ne sais pas par où commencer.
Jean Prod’hom
A table

Louise :
- Maman, tu sais quoi ! j'ai vu une dame en string sur internet. Je comprends vraiment pas, je cherchais des images de cochons d'Inde.
Arthur
- Ouais, sur internet, tu finis toujours par tomber sur une dame en string.
Sandra :
- Ou sur un cochon d'Inde...
Lili
- Même si tu tapes pompon ?
Jean Prod’hom
Laver cette coulée de boue

Bien peu d'humeurs résistent aux noces visqueuses du noir et du blanc. Elles y succombent pourtant lorsqu'elles entendent le bruit étouffé du bâton dans les cendres, en prenant un air pâle, tandis que les glaires du brouillard et les grands corbeaux vont à lents coups d'ailes semer leur poison ailleurs. Puits et tombes profanés, entonnoirs sans mémoire, c'est une peau morte qui double le ciel et tapisse nos palais, blanche et froide comme une tripe. Tout, il manque soudain tout, et d'un coup. Où est celui qui lavera cette coulée de boue et nous convaincra qu'un suaire ça s'égoutte et qu'une poche déchirée ça se ravale ?






Aux margelles des fourrés brûlés, les merles ont assuré la permanence et sifflent les mesures d'urgence. Les corps laiteux des bouleaux s'étirent hors du bitume. Une silhouette suivie d'une ombre indécise passe la lisière de cette veillée funèbre. Revient l'heure des pâmoisons : les idées sèchent, on s'amollit au feu profond. Oh ça oui, et sans aller jusqu'en Corse. Il est temps encore de prendre le chemin en marche, de suivre les signes qui tombent du ciel, le jaune des citrons, l'orange des sorbiers, le vin sur la treille, le lierre, le gui, les mousses dans la rivière et la rouille du hêtre. Les fruits se hâtent de remonter sur l'arbre, la vieille de Pra Massin fait une lessive, les poules rattrapent le temps perdu, Au printemps on repeindra les volets. N'est-ce pas ? Et tu réponds : peut-être.







Jean Prod’hom
Le bruit de la pluie bien serrée qui pianote

On traversait le gros des jours sans y toucher, à l'abri derrière de lourdes pierres et une porte de châtaignier à laquelle pendaient de vieux manteaux dépareillés et des parapluies hors d'usage, des fichus de feutre usé et des casquettes à la visière baissée. Les eaux du Vidourle ne cessaient de gonfler, on le savait, mais ne nous parvenait de l'extérieur que le bruit de la pluie bien serrée qui pianotait sur les tuiles. Quant aux brouillards inoffensifs ils se mêlaient aux fumées du poêle et de l'âtre. On ne se demandait plus si le ciel allait pouvoir sauver sa peau, on avait assez de bois, assez à boire, ça pouvait continuer ainsi. Et à mesure que les jours passaient, il nous semblait toujours plus enivrant de vivre en fond de cale, insouciants derrière les murs crépis de ces vieilles magnaneries dont la haute charpente n'a jamais obligé quiconque à courber l'échine. On se faisait à l'idée que le soleil ne reviendrait pas, prêts à tout, mais désireux surtout de goûter à ce peu qui était sous la main, pain, livres, vin et miettes.
On entendait claquer parfois le fermoir de la porte d'entrée ou celui de la porte du jardin, on apercevait en passant sur la table de la cuisine les restes de passages récents : une grappe de raisin, un couteau beurré, des châtaignes, une arrière odeur de café ou un fond de thé tiède, un stylo à côté du mot fléché de la dernière page du Midi-libre, le dos d'un livre oublié. Nul ne savait comment les choses en étaient arrivées là, on se croisait parfois, avec les égards qu'on a les uns envers les autres sur les embarcations de fortune, sans qu'aucune question ne se pose, chacun étant à ses affaires, sur le point de retourner sous un de ces vieux sacs de couchage qui voisinaient sur nos paillasses avec de vieilles couvertures trouées. Chacun reprenait sa lecture avec la pluie sur les tuiles, qui ne s'arrêtait pas, avant que les paupières ne vacillent et que la rêverie ne nous éloigne un instant de ce qui traînait en largeur et en longueur tout au long de ces semaines-là.
Pas grand chose, surtout pas, excepté le feu que l'un de nous réveillait dans l'âtre à l'aube ou le chêne vert qu'un autre allait chercher au bûcher, à voix basse, au cas où quelqu'un dormirait. Mais personne ne dormait vraiment, quand bien même il n'a jamais fait tout à fait jour ces semaines-là, si bien que les lampes dans les chambres et les suspensions ne s'éteignaient pas. C'étaient des journées du creux de l'an, de ces journées qui s'étendent lorsque tout est terminé et que rien ne veut recommencer, nous étions au début de nos vies, dans un pot au noir lâche nichant au voisinage de l'insouciance, avec des chats qui levaient la tête lorsque le vent fouettait le toit. Mais l'averse reprenait et émiettait le temps comme une herse.
Ce bonheur nonchalant aurait pu essaimer en toutes saisons si nous l'avions voulu, il n'en a pas été ainsi. Je me souviens du dernier jour avant qu'on ne se quitte pour toujours : celui que personne n'avait vu sortir était revenu le soir trempé jusqu'à l'os avec un panier d'oronges.
Tout ce qui sert aujourd'hui a servi hier et servira demain, c'est dans les recoins des saisons que chacun d'entre nous grandit en traversant le gros du jour sans y toucher. J'écoute aujourd'hui, sous la couette, le bruit de la pluie bien serrée qui pianote sur les tuiles.
Jean Prod’hom
Il neige même dedans

Les chutes abondantes de la nuit ont rejointoyé les pentes du ravin, le barbelé des clôtures a disparu, les pièges se dérobent, on oublie même les morts. Un bruit d'étoffe fait taire toute velléité de sortir dans cette copie flamboyante du sommeil, il neige dedans. Les récits se sont tus, l'avant et l'après recouverts par une épaisse couche de neige. Il faudrait peut-être faire un pas dehors, mais que feras-tu dans cette immense salle d'attente ? Pas bouger, maintenir le pouls au ralenti jusqu'à la nuit que tu aperçois, trou noir autour du filet d'eau et le merle près de la haie. Tu rêves alors, pour durer encore un peu, à la rose de novembre et aux fruits du sorbier.
Jean Prod’hom
A égale distance les uns des autres

En marchant sans but, on côtoie parfois à deux pas l'intérieur des choses dont on a l'impression soudain de partager le sort, sans y voir très clair, mais avec la certitude d'en être, grand visage tourné vers le ciel, visage immense, immense comme l'oeil de la bête croisée l'autre jour à la patte d'oie. Mais là ce sont des arbres.
Ils sont à leur place, ensemble sans être contemporains, à bonne distance les uns des autres, vicaires dans un espace désencombré des trajectoires qui superposent les temps, hors du labyrinthe qui nous tient en laisse, en un carrefour où il n'y a plus rien à décider, carrefour sans route, sans croix – plus donc de regret – et où se manifeste le dedans dans le dehors qui se dérobe. Les arbres ne font rien pour durer, ils en sont revenus, rien sur les lèvres, les yeux ouverts seulement jour et nuit. Et la promesse qu'ils demeureront lorsqu'on s'éloignera, c'est tout ce qu'on sait, comme des figurants qui n'ont rien demandé. Les vertus ont leur temps propre, la scène émeut, quelque chose monte depuis le dedans, comme la sève, c'est un peu de vertu. Ils ne s'en attristent ni ne s'en réjouissent, pas de quoi s'apitoyer, c'est ainsi depuis toujours.
L'autre monde est sans doute dedans le nôtre, hésitation sans fin pour deux fois rien au regard des anciennes croyances, appelé à disparaître à midi lorsque les enfants rentrent de l'école. En attendant la partie d'échecs est suspendue et, tandis que les arbres enfoncent leurs épaules dans la terre, le sursis se prolonge en une éternité sans couvercle, le ciel.

Jean Prod’hom
Les enfants

Arthur peine ces jours à se lever parce que, dit-il, la lumière violente du spot – ou celle du jour – l'éblouit si fort qu'elle l'oblige à maintenir les yeux fermés ; il ajoute qu'il ne voit aucun intérêt à les ouvrir s'il fait encore nuit. Je crains qu'Arthur, comme l'Ernesto de Marguerite Duras, ne refuse sous peu d'aller à l'école, parce que l’on y apprend ce que l’on ne sait pas.
Jean Prod’hom
Labours

Sous le Chauderonnet Daniel retourne le champ qui se laisse aimablement faire, les glèbes noires s’ajustent derrière sans déborder du sillon. Une nuit suffira pour que tout se tasse. Et à l’aube la terre aura retrouvé son ventre rond.
Jean Prod’hom
Portes d'automne

C’est le dernier moment pour ramasser ce qui traîne dans le jardin, avant que les feuilles du tilleul, celles de l’érable, des foyards et des chênes ne les ensevelissent : la brouette, les outils laissés devant l’atelier, la trottinette de Lili... et la neige finira le travail. Dans quelques jours on aura tout juste le courage d’aller chercher les derniers oeufs au fond du jardin. Il nous faudra attendre le printemps pour aller au bout du monde.
Les enfants jouent au lit et leur mère dort. Leurs chicanes étouffées, le silence et la pluie sur les tuiles molletonnent ce premier des mauvais jour. On voyait hier soir sur le Jura les nuages dans le ciel annoncer la nouvelle et emmener la belle saison. Ce matin, en lançant le premier feu dans le poêle, j’ai donné mon accord à ce contre quoi il ne sert à rien de s’opposer. C’est fait, il convient désormais de s’y faire : les poules se réjouissent de la terre meuble, on devine la couleur d’or et l’odeur de miel des chanterelles d’automne.
Et puis il suffira de laisser l’échelle dans le verger pour aider les saisons à tourner rond.
Jean Prod’hom
XCIV

Ils sont une ribambelle, Eliott, Jérôme, Louise et les autres, affairés au centre de la place sur laquelle s’arrêtent les bus scolaires. Accroupis, ils grattent consciencieusement le terre-plein, ils ne m’ont pas vu. Mais lorsque je m’approche pour les embarquer à la maison, ils se relèvent précipitamment, un silex tranchant à la main. Quel mauvais coup préparent-il ?
- Que faites-vous Louise ?
- Papa, on libère les cailloux.
Jean Prod’hom
XCIII

- Maman ! c’est vraiment énervant, c’est comme si j’avais du caca de nez dans les oreilles.
- Mais non Lili ! c’est là pression, ça va passer. Essaie de bâiller, ça ira mieux.
- J’arrive pas.
- Alors fais bouger ta mâchoire inférieure horizontalement.
- Horizontalement ? Comprends pas ! Et ça devient vraiment énervant, très énervant, de plus en plus énervant ! tu n’aurais pas des cure-dents pour les oreilles ?
Jean Prod’hom
Dimanche 21 août 2011

Mégots rivés dans les interstices des pavés, confettis décolorés, ketchup coagulé, le poisseux qui colonise la pagaille, bouteilles vides, couverts enmoutardés, traces de doigt, verres brisés, des rêves en morceaux débordant des sacs à ordures, des odeurs de chair à saucisse. Pourtant le soleil se glisse dans ce saint désordre et éclaire les restes de pain. C’est toujours ainsi que se présentent les lendemains des jeudis saints, lorsque les convives abandonnent tard dans la nuit, dans l’oubli d’eux-mêmes et de l’avenir, la table du festin. Souvenez-vous ! On a beau chercher, on se ne souvient de rien.
De quoi ce matin prendre les jambes à son cou, se saisir de la clef des champs et rejoindre le vallon de la Carrouge ou de la Bressonnaz qui se sont levées sur un autre pied.

On reste pourtant, avec ceux qui sont arrivés il y a peu, silencieux, un peu hagards de ne pas savoir par où commencer dans la moiteur estivale. Ça démarre curieusement, par rien ou presque rien, on déplace une ou deux choses, on empile deux chaises, cherche de l’aide, personne, aucune voix pour diriger le chantier. On reprend, il faut s’y faire et commencer par rien, tiens un gobelet fendu, un autre à demi-plein, là-bas un autre encore. Ensemble ils font une petite pile, avec les autres une grande. Il aura fallu prendre par un petit bout pour sortir du fond et faire une saignée dans la débâcle, les assiettes en carton puis les couverts, les sets de table. Luc recueille les bouteilles vides dans des caisses, un balai émerge, c’est Marc qui s’en empare. Tiens les tables sont libres, Line porte un seau d’eau chaude qu’elle ne lâche pas et frotte les tables de bois. Justine se baisse avec une balayette et une ramassoire. A la cuisine, on fait des sandwiches et la vaisselle.
On a l’impression soudain d’avoir la tête hors de l’eau et la place a bonne façon lorsque les premiers campeurs s’approchent du bar, un café et un croissant, ils soulèvent une paupière, trois thés et deux limonades, tout le monde lève son verre : Donnez-nous, Seigneur, encore de ce pain-là !
La fête peut recommencer, benevolente.







Jean Prod’hom
Dimanche 7 août 2011

Il se confectionne des chewing-gums avec des grains de blé, de la salive et un peu d’ivraie. Il sait qu’on ne sait jamais exactement où l’on est, mais ne s’en inquiète pas outre mesure, ou juste ce qu’il faut. Arthur ne connaissait pas Etagnières mais a repéré le château-d’eau de Goumoens d’où rayonnent bien des choses du canton, n’est pas mécontent qu’on ne fasse pas un détour pour jeter un coup d’oeil au retable de l’église d’Assens, n’hésite pas à couper à travers les champs moissonnés ou les prés fauchés. Arthur évalue curieusement les distances et le temps, goûte aux équilibres précaires, débusque les grenouilles au bord de l’étang. Il aime jouer à l’aveugle, démêler les pas des chevaux pour connaître leur nombre et imaginer le visage de leur cavalière. S’en fout cordialement du tumulus celte du bois des Allemands, imagine les églises bien plus grandes qu’elles ne le sont, va nus-pieds sur le bitume. Il se demande jusqu’où se prolonge la mine à Nichet creusée dans la molasse près de Malapalud, planifie son retour dans le coin, avec une lampe de poche, le plus tôt possible lorsque je lui apprends que Nichet a creusé cette grotte pour récupérer le trésor de l’ancien château de Bottens.






Arthur se prend d’amitié pour un cheval à la sortie de Bottens, qui la lui rend bien, n’est jamais effrayé par l’idée de quatre heures de marche, regrette comme moi les bistrots fermés le dimanche, les terrasses désertes du Gros-de-Vaud au mois d’août, aime les chemins de terre, à l’ombre lorsque le soleil tape, désespère autant du silence des fontaines que de la qualité douteuse de leur eau quand elle coule. Saute de pierre en pierre dans le Talent en espérant un faux pas, et son ombre qui s’amuse le tire vers le haut.
Jean Prod’hom
Sébastien Chabal et moi on se ressemble

C’était samedi soir la fin du stage de préparation du Racing Metro 92, une équipe dont j’ignorais tout jusque-là, comme du rugby dont ces grands gaillards passionnés ont fait leur gagne-pain. Non, je ne connaissais pas Sébastien Chabal, sportif préféré des Français que les journaux locaux nous ont fait connaître les jours passés.

L’équipe s’est en effet arrêtée dans la région pendant une semaine et, pour la soirée d’au-revoir, à Ropraz chez Jean-Daniel. A cette occasion, Arthur et Yann avaient été invités à faire une démonstration de trial. Mais les sportifs, qui avaient déjà commencé à fêter la fin de leur séjour dans la grande salle de Corcelles-le-Jorat, n’avaient pas fini leur bière si bien qu’ils sont arrivés avec du retard, beaucoup de retard, alors que la nuit tombait déjà. Il a fallu s’y faire et comprendre encore une fois qu’on n’est pas le centre du monde. Arthur et Yann ont finalement fait leur démonstration dans la pénombre, éclairée par les encouragements, les rires et les rengaines. Tout le monde était je crois aux anges, ils étaient une bonne soixantaine, joueurs et membres de l’encadrement. Je suis sûr qu’Arthur se souviendra de cette soirée, de ces grands gaillards insouciants, rigolant comme des enfants.

Et puis Sébastien Chabal et moi, je crois qu’on se ressemble. C’est un passionné, moi aussi ; il a une fille qui s’appelle Lily Rose, moi aussi... enfin Lili tout court. On a tous les deux des carrières professionnelles qui s’achèvent, Sébastien Chabal n’a pas de regret, il a un compte twitter et une page facebook. Je ne vois qu’une seule grosse différence, il a accepté de figurer au musée Grévin ; vous allez me dire que les choses peuvent encore changer, c’est vrai. J’ai dit à Louise que j’étais content de l’avoir rencontré, alors on a fait une photo. Quand on les a tous quittés tout à l’heure, ils chantaient à tue-tête, s’amusaient et buvaient. La fête risque d’être longue. Pourvu qu’ils ne cassent rien, le monde est si fragile.
En rentrant j’ai lu les twitts de Sébastien Chabal pour savoir comment il voyait le coin. Ça fait un joli texte je trouve.
Direction Lausanne, stage d'avant saison avec le Racing
Lausanne aussi c'est valonné
Et ne venez pas me dire que je ne suis pas affûté
La montagne ça nous gagne
Après un bivouac d'une journee en montagne
Après les sprints en côte dans les bois, la récompense
J’aime bien Sébastien Chabal, il me donne envie, ce soir, de lire quelques pages de Robert Walser.
Jean Prod’hom
Lundi 1 août 2011

En revenant cette nuit de la fête du premier août organisée à la Moille-aux-Frênes, on voyait les étoiles et ça sentait le foin. Mais parce que la fête nationale tombe cette année un lundi et en raison de décisions administratives, j’ai vécu dimanche comme un samedi et pris lundi pour un dimanche.
Je suis à la Mussilly lorsque le soleil se glisse dans les allées creusées par les chemins, et de fines poussières d’or piquent de gros grains le vert encore sombre des bois. J’avance comme un grand, fier même, heureux d’être accueilli par les oiseaux tandis que le gros de l’espèce fermente dans son clos. Vanité des vanités, un peu trop fier si bien que les choses se retournent et que je me sens soudain incapable de me glisser dans le lit du jour, inquiet de ne pas être à la hauteur et mis en demeure de répondre de ma présence. Devenu d’un coup petit parmi les grands, fautif et présomptueux, je réplique, balbutie. Que dire à celui qui m’interroge et qui avance dos au mur des origines, sans avance et sans retard, sans lassitude, au tempo de l’eau et du vent ? Pourquoi ai-je donc hier soir tourné le dos à la nuit ? Puis-je saisir quoi que ce soit du jour en gardant les yeux ouverts et de la nuit en dormant ? Serais-je donc de ceux que la nuit lasse ?
Cette voix n’avait pas tout à fait tort de m’interroger de la sorte mais je ne la suivis pas et pris un chemin de traverse qui suffit à me mettre à bonne distance d’une discussion juste mais sans fin.

Pendant ce temps le jour s’était installé, j’ai longé l’allée qui conduit au cimetière où l’on avait préparé une nouvelle fosse, poursuivi ma promenade en me réjouissant de ces paysages d’un seul tenant dont on fait, pour passer le temps, des puzzles de 1000 pièces. En remontant du Torel, la pirouette et l’andéneuse avaient préparé les lignes d’une page sur laquelle, comme d’habitude, rien ne serait écrit.
Jean Prod’hom
De ma lucarne

Laisse dériver les lambris vernissés, les rouleaux de bande à masquer, les plinthes et les baguettes d’angle, laisse les choses se défaire, cale le safran et tourne l’espagnolette vers le large. Car ce matin on se baigne dans les plis d’août que dénoue la brise, nus dans le jour bleu qu’accueillent les ébrasures de la fenêtre taillées dans l’épais. Ecoute en-bas le claquement des sabots du cheval sans son maître, ce matin le jour est à marée basse.
Jean Prod’hom
Entre le Riau et le Torel

Plus d’un sage a loué son allure, sa légèreté, sa vivacité, sa fidélité aussi. Elle constitue peut-être ce qu’on peut faire de mieux au cours de notre existence, mais celle qui nous accompagne ne nous appartient qu’à moitié. Appendice d’une autre nature, elle est comme un rebord de nous dans le monde, ce qui nous y tient, ce qui coule de nous en lui et qui remonte pour nous y attacher par un bout. Elle est peut-être, s’il en faut, la plus haute des preuves de notre existence et de nos relations.

Elle fait un peu peur, te regarde tandis que tu gesticules, ou te tourne résolument le dos quand elle enfonce son nez dans le bitume.
J’aime les grandes ombres, démesurées, et les ombres joueuses qui font de nous des pantins au mouvement imprévisible, anges noirs libérés de la gravitation. J’aime aussi les ombres la nuit, les innombrables petites ombres nées de soleils de fortune, pâles copies, fantômes tremblants, ombres sans amarres, flottantes, indécises, qui rappellent lorsqu’on ferme les yeux la fragilité de nos existences.



Jean Prod’hom
39

On reviendra demain, et on remontera la Corcelette, à l’ombre, jusqu’à la grande cascade. Et plus tard, juste avant d’avoir froid, pendant que tu joueras sur la place de jeux devant le collège avec Roxane et Louise, sous le soleil, j’irai chercher la voiture qu’on aura laissée près du pont sous le cimetière.

Jean Prod’hom
Dimanche 3 juillet 2011

Quelques rires encore puis plus rien, sinon le bruit de l’eau et l’ombre, et la fraîcheur qui peinent à se faire entendre ou qu’on devine à peine. Tous trois se sont éloignés et, de fil en aiguille, ont disparu en amont derrière les branchages qui encombrent le lit de la rivière. Arthur est grand, pas d’inquiétude. Et puis il suffit de laisser faire la rivière qui les tient en laisse.
Me marre en lisant adossé à un hêtre quelques pages du texte que Cendrars consacre dans la première partie du Lotissement du ciel à Joseph de Cupertino, patron des aviateurs. Les choses, c’est-à-dire les faits historiques, biographiques, littéraires, les souvenirs – les vrais et les faux – les canulars, les procédés littéraires, les citations, les réflexions sont si bien huilés ensemble qu’on peut marcher léger dessus et qu’on finit par éprouver un plaisir comparable à celui qu’on éprouve lorsqu’on marche sur l’eau.
M’égare pourtant à vouloir suivre l’esprit de Cendrars qui s’égare à vouloir suivre, situer, identifier, localiser la survie d’une main coupée qui se fait douloureusement sentir, non pas au bout du moignon ni dans l’axe radial ni dans le centre de la conscience, mais en aura, quelques part en dehors du corps, une main, des mains qui se multiplient et qui se développent et s’ouvrent en éventail, le rachis des doigts plus ou moins écrasé, les nerfs ultasensibles qui finissent par imprimer à l’esprit l’image de Çiva dansant qui roulerait sous une scie circulaire pour être amputé successivement de tous ses bras, que l’on est Çiva, lui-même, l’homme divinisé. M’arrête là, renonce à le suivre vers la fin et reviens à la survie d’une main coupée qui se fait douloureusement sentir,..., en aura, quelques part en dehors du corps, en éventail. Je m’en souviendrai ce soir.
J’ai beau appeler, les enfants ont disparu quelque part en dehors de moi, les voici coupés de ma sphère d’influence. Et l’angoisse monte comme la marée, il faut faire vite. Trop tard, serait-il trop tard ? Lili s’est noyée dans le go sous la cascade, Arthur ne l’a pas aidée, qu’elle se débrouille, elle l’a assez enquiquiné les jours passés. Pauvre Lili, pauvre Arthur, pauvre Louise qui ne sait pas trop bien quoi faire, pauvre de moi. Que vais-je dire à leur mère ? Peut-on vivre après une telle tragédie ? C’en est fait de moi, amputé d’un coup de mes trois enfants et de ma femme, il faudrait... Miracle ! les voici, la moyenne en éclaireuse, la petite dans les bras du grand, tous trois revenus de nulle part. Quel bonheur ! Quelle belle après-midi !

On se retrouve plus tard sous le cerisier, les fruits sont bien visibles, rouges et immobiles, c’est tout simple de les pincer et de les croquer, on ne dit pas assez cette facilité. Et quoi qu’il se passe dans l’avenir, de la forme que prendra l’étau administratif et policier, tu te rappelleras qu’il avait été facile un jour de manger des cerises à même l’arbre, de regarder se former un essaim d’abeilles ou de tremper tes pieds dans la rivière. N’est-ce pas ?

On rentre à pied de Froideville, avec les ombres qui s’allongent, on traîne le pas parce qu’on discute et qu’on discute de la mort. Arthur pense qu’il reste quelque chose après notre disparition, moi aussi, mais on ne sait pas exactement quoi, ni l’un ni l’autre. Je lui rappelle alors une conversation que nous avions eue il y a bien des années déjà. Il semble aujourd’hui comprendre ce que je voulais dire, je lui parle alors du texte de Cendrars lu ce matin. J’éprouve un certain bonheur à marcher ainsi en parlant de la mort. En revanche le gaillard est un peu moqueur avec les croyants, moi pas. Je le lui dis, je trouve même qu’ils ont une certaine chance, une telle confiance donne un sacré courage, quand bien même ils ne sont à l’abri de rien. Sans compter que ce dont ils sont dépositaires en arrière de ce qu’ils disent, avec les mécréants, les athées ou les agnostiques qui se taisent n’est rien d’autre que le peu dont nous disposons pour penser notre condition et le monde qui nous entoure.
Des circonstances divines ont voulu que nous interrompions soudain cette sainte conversation.





Jean Prod’hom
38

Pas de livre
ce matin
branle-bas devant la maison
les enfants mangent
des cerises à pleines mains

Jean Prod’hom
Dimanche 19 juin 2011

Perdu la béquille de ma mémoire et un peu de ma raison, gorge serrée de par les circonstances, oubliée à mes pieds, que sais-je.
Au milieu du passage du Puisoir j’entends des voix d’outre-tombe, celle d’un jeune loup débordant de fatuité, clinquante, acide, qui assène une enfilade de vérités pleines de sincérités. Il aurait tellement mieux valu qu’il garde tout cela pour lui et qu’il consomme ses petites sottises en aparté, là surtout. Il entend à peine les mots étouffés du vieux et de sa vieille qui ne demandent rien, bougent à peine leur tête qu’ils tiennent surbaissée dans l’obscurité d’un laboratoire. Ils ont serviles et sages perdu la partie. Il croit les consoler le diable. Je ne les vois pas, j’ai beau me pencher, leurs voix seulement, incapables de faire taire le coq, leurs voix dans cette boutique à l’abandon, nature morte creusée dans le néant de l’espérance. Faites le taire, réveillez-vous, plumez-le, faites le taire.

Et ce soir un hérisson aux piques luisantes attend immobile que je m’en aille. Sa patience viendra sans effort à bout de la mienne. Après vous. Je pars demain pour Vienne, inquiet de ce que je laisse derrière moi, ils feront bien sans moi, et mon éloignement fait croître l’étendue de ma peine. Je n’ose imaginer qu’un jour je n’entendrai plus ces voix.
Jean Prod’hom
Dimanche 12 juin 2011

Lorsque je remonte ce matin de la laiterie pour rejoindre le chemin des Tailles, le ciel est large et le bleu est libre, et je pourrais comme si souvent m’en réjouir : le soleil le zèbre d’or en tous sens et essore les prés, le vent baigne les corps et les flaques dans lesquelles les moineaux font leur toilette lancent des feux.
Mais sans que je n’en connaisse les raisons, tout cela ne m’atteint pas et je fais la moue, la nuit ne m’a pas lâché et je reste à côté de ce dans quoi on s’abreuve pour surmonter les imperfections de notre condition : le premier est vide, le second chauffe à blanc et le troisième souffle sur des restes moribonds. Je suis condamné à attendre, et à croire, à espérer que quelqu’un ou quelque chose m’invite à entrer dans la danse, m’y oblige en douceur, sachant pourtant que, quoi qu’il advienne, il nous est interdit de nous y livrer entièrement sous peine de perdre la raison.
Et c’est un livre que j’avais pris la précaution de glisser dans une poche de mon gilet qui me tire hors du désert où je suis retenu par des forces noires et me dépose sur le chemin des Tailles. Un texte sombre, sans appel, d’un homme condamné qui écrit jusqu’à la fin les pas qui l’y conduisent, dans des souffrances dont il ne cache pas les effets mais dont il ne tire aucune gloire, dans une écriture qui chatoie encore un peu et offre une jouissance paisible à celui qui veut bien le suivre, à défaut d’autre chose, en des voies imprévues et souterraines qu’une syntaxe au rasoir endigue, jusqu’aux prochains remous ou au large delta qui ne manquent pas de se présenter à celui qui a choisi de poursuivre son chemin sans se laisser arrêter par rien jusqu’au terme du parcours sur terre qu’on appelle une existence.

C’est à peine s’il se considère comme un habitant de cette terre, quoique, en raison de son inépuisable beauté, nullement impatient de la quitter, mais torturé par le désir impossible à satisfaire de s’y rendre invisible, d’en être un spectateur clandestin, tour à tour émerveillé et horrifié, jamais indifférent en tout cas, sinon autant se vouloir atteint de cécité – la faculté de percevoir étant pour ainsi dire la seule à le maintenir en vie, une vie qui, à force d’avoir à la défendre sur tous les fronts est devenue bien plus rarement source de jouissance paisible que de tension nerveuse, en dépit de quoi elle n’a rien perdu de son pouvoir d’attrait, et même il s’en est accru avec l’affaiblissement général de l’être, les infirmités de la vieillesse.
Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu’au dernier

Réussi à quitter la nuit, mais à demi, car pas tout seul. Mais pourrait-il en être autrement? Je songe à tous ces vieux qui se satisfont de presque rien depuis qu’ils savent qu’ils ont perdu la partie, à la vieille de Pra Massin. Et soudain les oiseaux qui piaillaient se mettent à chanter.















Jean Prod’hom
Dimanche 29 mai 2011

On a failli l’écraser ce matin dans une longe courbe entre Mézières et Corcelles, où il est soudain apparu, caché jusque-là par les herbes hautes et les rames de colza. On roulait au pas, c'était un homme que personne n'avait vu encore dans le coin, il semblait traqué, pieds nus et torse tatoué, pressé, les traits tirés, inquiet d’avance de ne pas trouver là de quoi s’arrêter, incapable de mettre à respectable distance l’enfer vers lequel il se hâte. On ne le reverra plus.
Est-il seulement possible aujourd’hui de vivre vagabond, de rien et à découvert? Les chemins vicinaux trop coûteux à exploiter disparaissent, l’inconnu est d’entrée le malvenu, les inspecteurs du travail ont mis le holà aux coups de main des employeurs de fortune, les églises ferment leurs portes avant la tombée de la nuit, on cadenasse les refuges. Les vagabonds sont condamnés à accélérer leur marche, plus nus que jamais, répondre d’une misère dont beaucoup réussissaient autrefois à tirer parti. Il ne fait pas bon être vagabond aujourd'hui, les chiens errants ont une vie bien meilleure.




Ce soir la nuit monte des corps du bois, en continu, souffle sur les longues herbes inclinées de l’étang, le vert et le bleu sombrent, le renard revient sur ses pas avant de s’enfuir, j’ai beau me croire chez moi, il se sait chez lui. L’obscurité lisse les jointures des choses, ça tient ensemble, la terre et le bois, le ciel et mes doigts.
Jean Prod’hom
Dimanche 22 mai 2011

C’était aujourd’hui la fête à la ferme des Mélèzes, le club Passepartout de Moudon organisait la seconde manche de la Swiss Cup Trial.
Les coureurs se sont mêlés tout au long du jour aux spectateurs, c’était bon enfant, et moi dedans jusqu’au cou. Les applaudissements se sont mêlés aux odeurs de cuisine, les rires des enfants aux plaisanteries des piliers de la buvette et de la cantine. On a cherché à isoler les mauvais signes du ciel pour les conjurer et se donner les moyens de passer en équilibre à côté de l’orage. C’est fait, on l’a détourné au-dessus de Savigny et, en écho à ce miracle, le budget a basculé du bon côté.
En fin d’après-midi les spectateurs se dispersent, les juges boivent une bière tandis que les organisateurs démontent en une paire d’heures l’infrastructure d’une fête à laquelle plus de soixante bénévoles ont participé depuis plusieurs semaines. On a remis les prix, rentré les cochons et le poulain, les chèvres, le lapin et les moutons. Les tracteurs avec leur lourde remorque s’éloignent. Les tables, les tonneaux, les bancs et les palettes sont empilés, les collecteurs de béton s’emboîtent comme des poupées russes, on aligne les traverses de chemin de fer. Demeurent sur le pré les restes d’un mikado géant.
En remontant au Riau j’aperçois les oubliés du jour qui respirent à nouveau. Ce n’est plus le règne du tous, de l’aucun ou de l’un, mais celui du quelques-uns, quelques sifflements, quelques gouttes, quelques pas.



Jean Prod’hom
Jean-Daniel, Javier ou Elisabeth

C’est aujourd’hui une affaire heureuse et sérieuse, heureuse parce que ça marche, sérieuse parce que Louise a rencontré quelqu’un à sa taille, d’accord et capable de l’accompagner sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. On s’est rendu lundi soir en famille à Maracon pour une audition. Lui c’est Javier, elle c’est Louise, il lui accorde sa guitare avant de l’accompagner, c’est son professeur et elle l’admire. Il lui laisse ensuite la place et elle joue seule. Elle voudrait des leçons plus longues, une demi-heure c’est court. Il est d’accord. Il lui parle, elle le regarde. Il parle peu et elle joue beaucoup, ils jouent ensemble parfois, elle joue seule le matin au réveil, à midi, à 4 heures, le soir avant de se coucher. A la fin, c’est une affaire entre elle et sa guitare qui lui fait aujourd’hui des promesses.
Nos enfants auront grandi d’avoir été avec des autres là où nous ne sommes pas, chacun son tour, hier c’était Arthur, aujourd’hui c’est Louise, demain ce sera Lili. Et si on laisse nos enfants entre les mains de ces gens-là, c’est pour qu’ils puissent mener à bien ce qu’on est bien incapables de faire, les conduire plus loin que nous ne le pouvons, ou ailleurs, ou ici, mais moyennant ce détour qui les libérera de notre emprise. La société serait bien mal prise sans ces passeurs, Jean-Daniel, Javier ou Elisabeth, qui dénouent avec soin les fils qui ont lié nos enfants à notre amour immense, aveugle et nécessaire.









Jean Prod’hom
Dimanche 15 mai 2011

C’était le dimanche 12 septembre de l’année passée, nous avions pique-niqué la veille au bord du Doubs, avec le soleil, mangé une truite et dormi à l’hôtel de l’Union de Tramelan. Mais je suis seul ce matin, Sandra et les filles sont restées au Riau et Arthur est allé rejoindre Jean-Daniel pour la reconnaissance du parcours de la course à laquelle il va participer aujourd’hui.
Celle qui assurait le service du petit déjeuner dans cet hôtel fermé le dimanche est à nouveau là. J’aurais bien voulu savoir ce que cette native de Tirana et son mari devenaient, ses enfants aussi. Il y a huit mois, elle s’était assise à notre table et avait raconté un bout de sa vie.
Rien à faire cette année pour connaître la suite, je n’ose pas la déranger, elle semble triste et fatiguée, les yeux enfoncés dans le sommeil. Elle a servi les quelques clients de l’hôtel, parmi ceux-ci deux malcommodes que je me suis empressé de détester. Puis elle s’est assise, deux morceaux de pain et un café serré, pas tout à fait là, les yeux dans le vide, bien au-delà la petite place déserte. Pourtant il m’a semblé que son rire était au bord de ses lèvres, je n’ai pas insisté, me suis rappelé sa voix rugueuse avant de me pencher sur un livre qui m’a paru bien idiot.
Jean-Daniel est arrivé sur le site de la première manche de la Swiss Cup, petit carnet à la main : il passe en revue avec les coureurs les difficultés des différentes zones. Arthur est le seul coureur du club à rouler dans la catégorie des Benjamins, il dispose ainsi pour lui seul des conseils avisés de l’entraîneur. Ils s’éloignent en tête à tête, je les aperçois de loin, me fais discret. Je ne saurai rien en définitive de ce qu’ils se sont dit, je n’y comprends d’ailleurs pas grand chose, m’efforce même de me maintenir dans cette docte ignorance. N’est-ce pas une des façons de laisser aller de leur côté, sans les encombrer, ceux qu’on a faits? quitter son rôle de père dans un monde qui n’est plus seulement aux yeux du fils le monde de la famille.










Je les laisse à leur plan et vais faire un tour. La gravière qu’exploitent les Huguelet n’a guère changé, les coureurs, les parents et leurs accompagnants errent. On se croirait un matin de fête foraine, quelques courageux sortent de leur caravane et baguenaudent les mains dans les poches, les responsables de la course apparaissent au compte-gouttes et se réchauffent les mains autour d’un verre de café, quelques voitures arrivent, les langues se mélangent, italien, suisse-allemand, français, les enfants sautent comme des cabris sur les obstacles. On regarde inquiet le ciel qui ne donne pas toutes les assurances, les buvettes s’ouvrent, la journée prendra longtemps avant de démarrer.
La mienne n’aura pas commencé, j’aurai vécu dans le sillage et l’ombre de mon fils, porteur d’eau et oreille bienveillante, fournisseur de sandwichs et consolateur, content de voir à la fin de la journée cet enfant grandir d’un coup, prendre conscience qu’il peut vivre dans la peau d’un vainqueur, soulagé, mais aussi un peu seul, là-haut, sur le podium.









Jean Prod’hom
Dimanche 8 mai 2011

Je ne l’entends pas s’approcher, il est à vélo, me dépasse au bout du plat avant que je le rejoigne au milieu du raidillon qui mène à la Mussilly. Il est descendu de sa bécane, avec un peu de bave au bas du menton, bonjour. Il essaie de parler mais n’y arrive pas, il hoche la tête, sourit, je lui parle, ne me répond pas, essaie encore, essaie, hoche la tête, oui il a eu une attaque, il y a quelques années, oh oui. Il vient de là-bas, au bout de son doigt, non, pas de Corcelles, Pully peut-être. Il sourit encore, moi ausi je crois. C’est bon de pédaler, de marcher, oui c’est bon. Il essaie encore une fois, à peine trois mots au total, inachevés, avant de parvenir au chemin qui entre dans le bois. Il me salue, monte sur sa bécane, se lance, s’il tombe. Je l’aperçois au bout du chemin près du refuge, il pédale encore, c’est le vent qui le soutient. On dit du sourire de Bouddha qu’il est impénétrable, le sien aussi, il tient ensemble son bonheur d’en être et l’impuissance qui l’habite, l’irrévocable qui nous précède et l’irrémédiable qui nous attend.

Les choses on bien changé depuis ce dimanche de janvier où je passais par-là. Les abeilles ont lancé les grands travaux, s’affairent autour du colza et butinent les derniers pissenlits. Encore quelques jours avant l’effacement des jaunes et l’établissement sans limite des verts. Je lis en marchant la seconde moitié de Kosaburo, 1845 (Nicole Roland), avec le sentiment idiot – qui ne me quittera pas – qu’il recèle une clef. Je la trouve à la fin, la serrure aussi, mais elles ne sont pas appariées.

Je connais au moins une issue, une réponse à l’amoncèlement des soucis dont s’alourdissent chaque jour nos vie : sortir, sortir là où il n’y a rien, ou presque rien, ici, là, là où l’interrogation n’appelle aucune réponse, mais se mêle à la rumeur qui la porte. pour devenir la soeur des eaux dormantes. Assis sur une souche, je regarde passer ce qui ne passait pas, l’enfer que je m’étais construit, qui se défait comme parfois les nuages et rejoint en morceaux le dérisoire. Dans la pente des talus, les fraisiers sauvages ont fleuri.

Le paysage tourne autour du réservoir de Goumens-la-Ville. Je bifurque avant Malapalud dans le lit du Talent pour le remonter rive droite jusqu’au Moulin, rive gauche jusqu’au chemin qui conduit à Assens par les étangs artificiels des Bois aux Allemands, il y a foule. Il y a eu foule aussi à l’Espace culturel où je babille un instant avec Catherine. Il est 18 heures 30 lorsque je m’assieds sur les escaliers devant l’église : le retable aux couleurs d’Arlequin, sculpté en fanfare dans les ateliers de Jean-François Reyff autour de 1680 est inaccessible, une porte fermée à clé en barre l’accès, elle est cachée derrière une fenêtre à double vitrage qu’une artiste, Renate Buser, a installée là. Pour qu’on réfléchisse peut-être. Alors je réfléchis.

Jean Prod’hom
Dimanche 1 mai 2011

La vertu de la prière, c’est d’énumérer les choses de la création et de les appeler par leur nom dans une effusion. C’est une action de grâces. (Blaise Cendrars)
Je remonte plein soleil sur Vuibroye en longeant le Grenet bientôt sec, en écoutant Miriam Cendrars évoquer la participation de son père au J’accuse d’Abel Gance. Nous sommes en 1919, le cinéaste français à besoin de gueules cassées pour dénoncer les horreurs de la guerre. Elles ne manquent pas dans la capitale. Blaise Cendrars fera l’affaire, une trentaine d’années, le bras droit laissé dans les tranchées et du temps à revendre.
André Dhôtel n’apparaît pas dans le film d’Abel Gance, pourtant l’Ardennais en avait une belle de gueule cassée, surtout à la fin. Né en 1900, il a 14 ans lorsque la guerre commence, fait de la philosophie à Paris alors que la guerre s’éternise dans le nord. Il retourne à Attigny en 1919 quand la paix est signée. Il n’y bougera presque plus.
J’ai toujours associé les deux écrivains que pourtant rien ne semble rapprocher. L’un bourlingue et écrit au fer, l’autre paresse le long de la Meuse et file des textes improbables. Tout les oppose quoi que...
En 1957, Dhôtel publie en effet un récit qu’il intitule Saint Benoît Joseph Labre dans lequel il raconte l’histoire d’un vagabond du XIXème siècle que Léon XIII canonisera et qui deviendra le saint patron des mendiants et des sans domicile fixe, un oeil bienveillant sur les inadaptés, les rêveurs, les pèlerins, les naufragés, les malheureux, les mécontents. les hommes libres, les insoumis. Ceux qui ont eu des revers de fortune; ceux qui ont tout risqué sur une seule carte; ceux qu’une passion romantique a bouleversés...
Saint Benoit Labre était un jeune homme extrêmement pieux, tellement voué à la religion que son entourage lui reprochait d’être un peu trop confit en religion. Il désirait aller dans un couvent. Or il a fait trois essais et chaque fois ce fut un échec complet. Ce n’est pas que la vie du couvent ne lui plaisait pas, c’est qu’il n’en obtenait qu’une angoisse épouvantable. C’est donc un échec. Après le troisième couvent, il part sur la route... Que s’est-il passé? Je crois d’abord qu’il avait voulu saisir le bonheur dans l’amour de Dieu et le fait même de vouloir saisir ce bonheur l’a mené à une catastrophe. Vous vous souvenez de cette parole de Rimbaud : le bonheur a été mon remords, mon ver... Benoit s’est trouvé très indigne, au dernier degré de l’indignité, mais l’aventure est celle-ci: cette indignité n’a pas entamé sa foi, elle n’a fait que la rendre plus vive car il a compris qu’il était en présence de l’inacessible et il s’est aperçu que si on ne peut pas atteindre l’inaccessible, on peut aller vers... Alors où va-t-il? N’ayant pu rester dans un couvent, il va visiter tous les couvents possibles et imaginables. Quelquefois il entre, quelquefois il se présente à la porte, espérant être appelé un jour... eh bien on peu dire qu’un poète se présente à la porte et attend, non qu’il y ait un appel, mais une sorte de parole qu’il n’attendait pas. Benoit, ne pouvant rien faire d’autre, marchait. Le poète, ne pouvant rien faire d’autre, cause. Il se met à causer un peu à tort et à travers. (André Dhôtel)


J’apprends aujourd’hui que Blaise Cendrars, dans le creux de Montpreveyres, entre Servion et la Goille, peu avant sa mort, manifestant jusqu’au bout le besoin d’écrire la sainte alliance de l’horreur et de la beauté, écrivait les pages d’un livre qu’il aurait intitulé Les Lépreux et dans lequel il aurait raconté la vie de saint Benoit Joseph Labre. Nous sommes en 1961, André Dhôtel avait fait paraître son Saint Benoit 4 ans auparavant. Moi j’avais 6 ans et je ne savais pas lire.
Jean Prod’hom
Dimanche 17 avril 2011

La haute pression mélangée à l'inertie des dimanches soulève le ciel. Le soleil chasse les locataires des maisons encore froides et nous voilà, fenêtres ouvertes, la bride sur le cou. Balade du côté de l'étang dont j'aurai vu le cycle tout au long de l'année. Son étendue – son identité – perceptible pendant l'hiver ne l'est plus. Les aulnes et les bouleaux ont colonisé la tourbe et la bruyère ne s'y retrouve pas. Il y a quelques années, quel que soit le temps, on pouvait en faire le tour, je crains qu'il ne disparaisse et redevienne un refuge pour les lièvres et les chevreuils repoussant plus loin les canards et les grenouilles. Mais où?

Hans Steiner
Lorsque je rentre, Louise joue de la guitare, Lili se raconte des histoires, Arthur lit. Sandra dort, victime d’un virus qui a profité de sa fatigue. On la laisse tranquille et on descend au Musée de l'Elysée qui présente un ensemble de photographies réalisées par Hans Steiner.
Des photos de l'ancien temps? demande Lili. C'est exactement cela Lili, des photos de l'ancien temps. Hans Steiner est en effet né tandis que le XXème siècle venait de commencer et il est décédé alors que je n'avais que sept ans. C'est en cela que ces photographies fascinent, elles font voir ce que je n'ai pas pu voir, ou à peine, parce qu’elles nous font voir les choses comme on n'avait pas l'habitude de les voir, entre reportage et mise en scène, publicité et engagement, des images qui sont encore d'aujourd'hui mais réalisées avec les moyens d’hier, ou l’inverse, sur la crête, à bonne distance de ce qui est sous nos yeux et de ce qui a basculé dans les fosses inodores de l’histoire.
Je sens encore une fois combien le passé, qu'il soit proche ou lointain, demeure vivant à deux pas de nos existences et ne constitue en définitive qu'un des modes un peu passés du présent. Me demande au passage si Hans Steiner n'a pas été l'auteur d'une photographie que j'ai retrouvée dans un carton et qui m'a ramené bien loin en arrière, un peu avant que je cesse d’être un enfant.


Hans Steiner
Arthur, Louise et Lili se sont comportés comme des grands et, pour fêter ça, on mange la première glace de l'année. Ils s'y sont retrouvés même, je crois, parce que ces photographies de Hans Steiner constituent un bon relais, susceptible de les conduire sans heurts d'ici à là-bas, à cet ancien temps que l'on distingue sans peine et qui fait sourire, parce que ce sont d’abord des images capables de faire voir ce qu'elles ne contiennent pas en propre, ou mieux, ce qu'elles ne contiennent pas du tout mais indiquent seulement, comme ces maisons éclairées, aperçues depuis le train, qui nous rappellent au crépuscule la possibilité d’un autre pays où nous aurions pu vivre.




Jean Prod’hom
30

On a appris que ça ne se faisait pas, que le vert des saules jurait avec celui des mélèzes, c’est tout de même très joli, parce que les saules et les mélèzes ne sont tout au plus que des riverains sans intention sur les bords d’un chemin désert qui leur apporte un peu de lumière. Je le vois bien, ils ne prêtent aucune attention à ce qui les entoure, ne font que durer, chacun pour soi, mais j’ai remarqué qu’ils le font sans en rajouter, et c’est pour cela qu’ils n’éprouvent ni le besoin de se rapprocher ni celui de se quitter.
A l’arrière des grappes de samares tiennent solidement aux branches des frênes, à la traîne de l’an passé. C’est ici comme partout ailleurs, toujours la même chose, mais on sait que ça ne se répète pas, on sait que ça dure, ça dure si bien qu’on on ne se plaint pas, qu’on soit en avance d’un pas ou en retard d’un an.
Jean Prod’hom
Dimanche 3 avril 2011

Sous les draps les reins, l’ombre des grasses matinées, les fenêtres ouvertes avec les moineaux qui battent l'air. Du robinet de l'évier, en-bas, gouttent les mesures d'un temps long, à côté de deux pichets d'eau, vides. Dehors les vernis s'écaillent, l'esprit d'escalier sommeille avec les pioches dans les remises.
Pas un chat sur la route qui mène aux Chardouilles mais une litière au bout du pré. Je m'étends hors les mots dans la solide durée, sous l'empire d'un rien qui étend son empire jusqu'à la lisière des pensées, me dissimule derrière des vagues qui ondulent, se chevauchent, maintenues ensemble – ne veux pas savoir comment.
Un groupe d'enfants attend la venue de ceux qui les ont tant attendus, rivés les uns aux autres, à l'attente et aux promesses. Tout à l'heure les petits joueront l'air de l'apocalypse joyeuse, un canon, dix-sept langues.
Il est si simple lorsqu'on voit clair, trop clair, trop simple de lever les forces noires de ceux qui vivent dans la suie des rêves. La violence est dans la bascule. Reviendront alors les jours pleins jusqu'à la gueule de canons et de sang noir, les fers rouillés, volets fermés dès le saut du lit. On ne verra plus dans le ciel le ciel et la ouate des nuages, mais les traces d'un chat noir sur le capot de nos véhicules en ruines. Ma foi il n'était pas désagréable le temps d'avant, lorsqu'on ne feintait pas trop avec la mort.
Jean Prod’hom
Dimanche 27 mars 2011



























Que pense
le papillon
de l’éphémère
et la pierre
du possible

Jean Prod’hom
Dimanche 20 mars 2011

Matinée à l’hôpital ophtalmique pour une poussière que j’ai ramenée la veille de Forel-sur-Lucens à l’occasion des gros travaux de nettoyage du local du club de trial. Ce ne serait pas un hôpital si on m’y avait attendu, je m’y présente avant 9 heures, c’est après 10 heures seulement qu’un médecin – qui ne colle pas à l’image que je me fais des médecins – plonge son oeil dans le mien: pas de poussière, pas de bris de verre, bris de bois ou bris de fer, il repère pourtant un petit vaisseau qui a sauté. Il en profite pour visiter les coins et recoins de mon oeil gauche dont un collyre a dilaté la pupille et paralysé le muscle ciliaire. De mon oeil gauche je ne vois rien de particulier, sinon des éclairs multicolores; de mon oeil droit, j’aperçois l’oreille de l’inconnu, proche, trop proche, percée d’un anneau d’or.
Et puis tout s’enchaîne comme chez Lucrèce: tiens mais c’est une uvéite,... l’inflammation de l’uvée, cher Monsieur! c’est souvent le signe d’autre chose, de ceci ou de cela. Mais ne craignez rien, ce n’est peut-être qu’une poussée orpheline. Elle peut être aussi le signe d’une maladie générale, style maladie de Bechterew... Je ne bouge pas, laisse passer l’orage qui dépose, seconde après seconde, de drôles de dépôts sur les choses qui m’environnent. Puis retire la tête de l’intérieur d’un dispositif complexe en forme de cloche, constitué de divers appuis, vis et barres d’acier... qui me fait immanquablement penser aux dispositifs de la trépanation d’antan.
Une infirmière me retire ensuite 9 millilitres de sang pour qu’on en ait le coeur net. Le médecin signe une ordonnance pour des gouttes de cortisone que je devrai appliquer toutes les heures au cours des deux prochains jours; il me faudra, ajoute-t-il, trouver un conducteur pour me ramener à la maison; enfin, et c’est le bouquet, il place sous mon nez un papier m’autorisant à un arrêt de travail d’une semaine. C’en est trop, me vois grabataire et aveugle. Décide de négocier le tout: j’appliquerai les gouttes, mais j’irai travailler; quant à mon retour, j’y vois suffisamment clair; c’est entendu, on se retrouve dans 48 heures pour un bilan. L’entrevue aura été courte, je saurai mardi dans quelle mesure ma vie a changé.
Je sors de l’asile des aveugles – c’est ainsi qu’on appelait autrefois l’hôpital ophtalmique de Lausanne – un peu sonné et oublie même de faire quelques photos de ce beau bâtiment qui date d’un siècle et demi.

Intérieur d’un épicéa, avec la naissance des branches
C’est peut-être ainsi que vont les choses. Un jour, un pépin de santé vous tombe dessus qui bouleverse votre vie. On croyait que ça n’arriverait jamais, en tous les cas pas un dimanche, et disons beaucoup plus tard.
Si tout cela n’est que bricole, il faudra pourtant que je prenne garde de ne pas faire le crâne. Il aurait pu en aller autrement. Me restent deux jours à vivre dans une espèce de sursis au statut ontologique incertain. En attendant je rentre au Riau, vais faire un tour avec une drôle d’impression, entre appréhension et appréhension.
Jean Prod’hom
Derborence

M’enthousiasme à cause de Derborence, évoque Si le soleil ne revenait pas et La Grande Peur dans la montagne. Ne le dis pas, mais c’est Derborence que je préfère. M’emporte un peu lorsque j’entends les élèves se réjouir du visionnement, la semaine prochaine, du film réalisé par Reusser. Leur promets les plus hautes déceptions auxquelles conduisent immanquablement tous les cinéastes qui ont voulu exploiter les trouvailles stylistiques d’un écrivain. M’emporte pour ça jusqu’à l’épuisement. Me demande même si je vais rester debout, mais tiens bon. Il fait beau lorsque les élèves s’en vont, fais un crochet par l’étang pour essayer de relever la tête. Vomis discrètement derrière un gros frêne.






Toute la partie orientale de l’étang est transfigurée, on entend ici puis là des coassements sourds et profonds. Les gelées des grenouilles se substituent lentement aux gelées de l’hiver, si fines désormais qu’on croirait des osties. J’aperçois deux grenouilles qui traversent le chemin leur donne un coup de main. J’ai hâte que la nuit vienne, rentre et l’attends. Faut-il encore que je puisse en disposer. Je diffère la rédaction d’une note sur Le Génie subtil du roman d’Olivier Rolin, renonce à mettre de l’ordre sur mon bureau, brûle d’en finir. C’est fait, je suis resté debout et vais me coucher.
Jean Prod’hom
Dimanche 5 mars 2011

On sort pour la première fois, même si c’est pour la seconde ou la troisième fois qu’on sort pour la première fois cette année. Mais on le dit aujpurd’hui plus fort au-dedans parce qu’on y croit plus fort au-dehors, oh les beaux jours. Et si l’on renvoie à plus tard le ramassage des branches mortes du tilleul, des foyards et des chênes, c’est parce qu’on se sait soudain un peu immortel. Le soleil veut ça, on dirait même qu’il y prend un certain plaisir. J’imagine des feux, les feuilles mortes de la veille et les tailles des roses, j’en sens l’âcreté, aperçois quelques cheminées, les fumées bleues qui se mélangent au ciel vide.
On s’y est préparé en s’allégeant, trop peut-être, il ne faudra pas lambiner. Les échelles laissées à l’automne dans les vergers servent à nouveau. Les vieux, cauteleux et imprudents, mêlent leurs bras à ceux des pommier et des cerisiers. On aperçoit qui dépasse leur main grise l’extrémité de la poignée rouge ou jaune d’un secateur. Fleur et Edelweiss guettent le retour des taupes et des mulots dans le pré dur d’à côté. C’est chacun pour soi et nous du nôtre. On ira à l’étang, Arthur devant. On a des manières si différentes d’essorer nos esprits.

L’enfant, confiant, laisse à ceux qui l’accompagnent le souci du lieu, où il est et où il va. Malheur à ceux qui l’abandonneraient dans l’effroi des bois, malheur aussi à ceux qui ne l’y conduiraient pas. Le Petit Poucet avait-il lu le récit qui conte ses exploits? Suffirait-il donc de donner des noms aux lieux de son égarement pour en écarter le souffle noir?

Il faudra attendre encore un peu avant de voir le merle revenir aux Censières, d’où il s’était enfui il y a dix-huit mois et où il reviendra comme une flèche qui ne se serait fiche nulle part, lorsque le sous-bois aura bourgeonné et se sera remplumé. L’eau qui s’écoule au goulot de la fontaine donne une idée assez exacte de l’immobilité qui passe.
On rentre, le jardin donne au sud, il est comme une grande cage sans barreaux que les oiseaux quittent parfois. On entend les premiers tracteurs qui sonnent la charge, les bruits se rapprochent, c’est une bande de moineaux qui piaillent dans la haie vive, ils ont levé un pan du printemps, c’était autrefois un temps à mettre le linge sécher dehors.
Jean Prod’hom
LXXXV

Lili rentre de l’école.
- Qu’as-tu donc fait ce matin? demande sa mère.
- De l’histoire biblique.
- De quoi avez-vous parlé?
- De Yakari.
- De Yakari?
- Oui.
- Et puis?
- De Jean le bassiste et d’Elisabeth.
Jean Prod’hom
LXXXIV

C’est la Saint-Valentin, Arthur est allé samedi matin faire ses emplettes au marché. Il a mis 9.90 pour un collier.
- Et toi, papa, combien tu mettais?
Jean Prod’hom
Dimanche 30 janvier 2011

Elles se promènent, retraitées bientôt, sur les quais entre Paudex et Lutry, voix rauque des demi-distinguées et mises en plis sous chapeaux d'apparat. Il semble que leur belle amitié file sur des rails. De loin en tous cas, car je comprends vite qu’il s’agit en réalité d’une petite association de malfaiteurs.
Elles s'arrêtent à deux pas d'un portail ouvrant sur le lac mais fermé à double tour. Leur foie torturé a repeint leur visage en jaune, l'acidité de leur estomac les oblige à tordre les lèvres, de la vapeur sort de leurs bouches sèches, c'est de l'aigreur. Leurs jambes sont des fers cassants, leurs mains s'agrippent au vide. Enfermées dans une bulle de haine, elles semblent respirer encore. Je tends l'oreille pour fouiller leurs secrets.
Elles organisent aujourd'hui le lynchage de leur ancienne meilleure amie. Le rituel est fixe: chacune à son tour lance une flèche qu'elle justifie par le récit bref d'un événement dont elle tire elle-même une condamnation définitive. L’autre ricane, confirme la sentence en ajoutant quelque chose comme une preuve, inarticulée, avant de reformuler le jugement. C'est sans appel. A l'autre de lancer sa pierre: récit bref, justification, condamnation, ricanement, confirmation, petit ajout et reformulation. Et ainsi de suite.
Elles ont tant de raisons d’en vouloir à leurs meilleures amies que l’opération se prolonge, emprunte des chicanes, faisant voir parfois d'étranges détours au cours desquels elles ne peuvent s'empêcher de condamner les pauvres (qui pourraient quand même travailler), les malchanceux (qui l'ont bien voulu), les malheureux (qui rampent au lieu de redresser la tête). Elles s'arrêtent enfin. Le lynchage est en effet si bien engagé qu'il peut continuer et se terminer sans elles. Leurs victimes agoniseront seules.
Elles s'éloignent en silence, deux silhouettes au long cou dressé comme celui des cormorans, elles suçotent leur triomphe. Direction tea-room où je les aperçois plus tard, épuisées par la bataille qu’elles viennent de livrer. C'est la faim, elles plissent leurs lèvres de plaisir en pinçant un bricelet qui craque sous les dents. A leurs pieds un chien broie les restes d'une carcasse de poulet que l'une d'elle a conservé dans un papier d'aluminium. Leurs mains lourdes des bijoux de l'avarice s'agrippent à une tasse de thé noir qui ne s'en formalise pas. Moi j'hésite, pèse le pour et le contre. Faut-il que je dénonce à la Cour internationale de justice ces femmes qui se privent de tout pour faire la peau des absents avec des cure-dents? Je crains qu'elles ne passent encore une fois entre les gouttes, mais qu'elles prennent garde, une lutte acharnée contre ces associations de malfaiteurs se prépare, des avocats ont flairé le bon coup et préparent des dossiers.
En sortant du café, j'aperçois sur le toit plat d’un immeuble résidentiel une douzaine de hérons immobiles qui guettent de là-haut le gros poisson, fiers, hautains. Eux ne parlent pas, ils conchient les balcons de gros industriels que l’on aperçoit derrière des baies vitrées. Ils regardent la télévision le dos tourné au lac. Un rouge-gorge s'éloigne en sautillant sur le brise-lames gorgé de fer. Il s'en fout.

Je continue les yeux baissés. Peu de déchets, peu de tessons, je le craignais. Faudra-t-il que je remette à l’eau ceux que je ramasse depuis 20 ans? Suis-je le seul à avoir fait main basse sur la polychromie des rives du lac Léman? Lugrin Tourronde, Meillerie, Epesses, Nyon,... Je découvre enfin le tesson que j’étais venu chercher. Mon après-midi est sauvée, vais pouvoir terminer ma lecture de Quignard et préparer ma visite chez Juliette Mézenc.
Un petit saut dans le temple de Lutry. Sur le lutrin le Psaume 82.
Rendez justice au pauvre, à l’orphelin,
déclarez juste l’humble et le pauvre.
renvoyez libre le pauvre,
arrachez le faible aux prises de l’impie.
Dieu lève-toi! juge la terre,
car tu es l’héritier de toutes les nations.
Je ne peux m’empêcher de penser aux deux paroissiennes qui ont rendu justice tout à l'heure au bord du lac. Et continue ma visite; dans une vitrine à l’entrée, des brochures au titre évocateur: Au bout de la nuit / Châle de compassion / N’attendez pas d’être épuisé / Chaque minute dans le monde, un enfant perd la vue! Il fait un peu froid dans cette église. Faut filer, prendre de la hauteur, quitter le lac et sa ceinture noire, l’oeil torve des hérons, les gros industriels, les complots de la haine ordinaire. Je remonte à Mézières par Savigny et Moille-Margot avant de rejoindre le Riau par le château de Ropraz. Le jour est fade et pâle, les verts et les roux refroidis par le givre lissent le paysage que la terre noire au pied des haies vives fait bourronner. Pris dans la ronde du jour blanc les cris sont étouffés, les ravages de la petite propriété sont avalés, on pourrait presque y habiter.

Jean Prod’hom
Dimanche 23 janvier 2011

L’histoire rapatrie des charniers les laissés pour compte qu’elle place délibérément en avant du chantier qu’il a bien fallu ouvrir pour chercher une raison d’être hypothétique à nos existences. L’histoire ressuscite à tour de bras, moule, habille les reliques des éradiqués, guillotinés, chassés, ensevelis, brûlés, dresse dans les cours de nos maisons leurs images pour que nous disposions de repères et puissions aller droit devant à la rencontre de l’étrange rêve du jardin promis. L’histoire pilote nos vies de l’arrière, pieds dans les ronciers, projette à l’avant les roses de l’églantier et mêle les bourreaux de salon au chasseurs de papillons, les belles victimes aux visionnaires déments, le service public aux génocides.

L’homme et le caterpillar qu’il chevauche saignent le réel, l’histoire en est le récit charmeur. Lausanne 1638, plan Buttet et sa traduction qu’en a réalisée quatre maquettistes de la Direction des Travaux de la ville de Lausanne: maisons silencieuses, tours de gala, portes dorées, moulins pour le pain, canaux de dérivation, le Flon et la Louve à ciel ouvert, arbres en fleurs, vendanges tardives, jardinets, paix perpétuelle. Imageries d’un futur à côté duquel on a passé, détenues dans le sous-sol de nos consciences, la campagne nue, des amis, marchands, bourgeois, l’évêque même. On ne voit que ce qui n’est plus et qui est sans avoir été. Un décor pour Alice, avec autour de la cathédrale le cortège des saints en habits d’Arlequin. On y croit à peine, je rêve.

Dehors la ville se dresse, sourit, poursuit sa méditation, imperturbable, avec les hommes à ses pieds, comme des gueux dans l’enceinte du Château Saint-Maire. Rien à craindre pour ces derniers venus, sinon la plus haute des craintes, celle d’être nés là, et hier, et accepter que tout cela ne mène nulle part, passer ce secret au suivant autant que faire se peut pour en être enfin.
Tu seras Elie, le Major ou l’évêque. Et sur les îlots formés des sédiments recueillis par de belles âmes, tu réhabiliteras le monde et son ombre sans leurs ombres, comme s’il t’était toujours loisible de trouver une place, en toutes circonstances. Tu seras meunier, scieur, vicaire ou sculpteur, prêt à l’idylle dans une nuit où le sang ne coule plus, la Louve et le Flon filaient vers la mer. Mais rappelle-toi, nous ne disposions ni de notre vie ni du présent. C’était le 23 janvier, jour de l’Indépendance vaudoise.

J’ai traversé comme une flèche la zone industrielle d’Ussières, déchiré par les lanières du froid, incapable de rêver. L’histoire ne fait pas de détour par l’Ecorcheboeuf, la bise noire en soulève les dessous, ramène les supplices, les terreurs, la sensation qu’on pourrait ne pas en revenir, sans qu’on sache vraiment quelle forme pourrait bien prendre cette fin, sinon celle de l’abandon.

On ne peut s’empêcher de se battre, d’abord se taire, rejoindre les bancs de l’église de Carrouge autour d’un puits d’où se font entendre des voix nues, parenthèses de bienveillance. Et personne pour siffler cette indiscipline, cet hors jeu collectif en marge de ce qui est et de ce qui aurait pu être, en marge du bruit et du silence.

Jean Prod’hom
A.6

On alimentait la flamme tout au long de la nuit. On recueillait à l’aube les braises dans des caissettes portatives de fortune avant de reprendre la route, avec la crainte constante que le feu ne s’éteigne. C’est ainsi qu’on vivait il y a 500 000 ans, à la merci du moindre accident – manque de bois, pluie violente, inattention. J’éprouve à l’instant la même sensation que ces habitants du Caucase d’autrefois, alors que la nuit tombe et que la bise ne mollit pas, isolé du monde, incapable d’allumer un feu par frottement rapide d’un bois dur sur un bois tendre – ou le choc d’un silex sur un bloc de pyrite –, incapable d’enflammer la mousse et l’herbe sèche, le petit bois dans le poêle, incapable de mettre la main sur une boîte d’allumettes. C’était ce soir, dans les montagnes noires du Jorat, la même angoisse devant la même nuit froide.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Dimanche 16 janvier 2011

L’apiculteur a déposé deux ruches bleue et jaune à la lisière du bois Faucan, leurs locataires préparent la saison, s’agitent depuis midi, font des plans. Il faudra certes attendre encore un peu, qu’elles ouvrent les yeux et lessivent la planche d’envol, mais hier soir, en revenant de Ropraz, il faisait déjà jour, on n’y croyait pas Arthur et moi, souriants à l’idée qu’on allait bientôt voir le jour avant d’aller à la mine. Personne n’y croyait tout à fait, mais l’hiver a bel et bien passé, qu’on soit encore au mois de janvier ne change rien à l’affaire, qu’il revienne dans quelques jours non plus.
Ici, au coeur des bois, ce sont les mélèzes qui se chargent de donner l’avant-goût du printemps. Ils recueillent les feux et clairent le plan des bois. Les silhouettes de l’hiver fondent en bordure de chemin. Il vaut mieux désormais ne plus s’asseoir sans précaution sur les billes de sapin qui gouttent comme de vieux tubes de colle percés.

Je dispose de tout l’après-midi pour ne pas revenir en arrière et aller à pas lents par la Corbassière jusqu’à l’orée du bois des Orgires qui vous tire vers l’avant. Les histoires, les livres et tout le saint-fruscin sont restés à la maison. Nous ne sommes que quelques points éloignés sur les chemins vicinaux qui tiennent ensemble Bottens et les Poliez, Froideville et Villars-Tiercelin. Bonjour Monsieur Courbet, bonjour Madame Grognuz. Tenez! on aperçoit le réservoir de Goumoens-la-Ville, blanc comme le melon du Mont-Tendre.

Terre glaise noire remuée, jaune or couleur moisson la bande qu’a épargnée la charrue en bordure des chemins de dévestiture. Tout autour les piquets d’accacia un peu raides se réveillent, s’étirent avant de dérouler les colliers primitifs des clôtures le long des chemins aux courbes idéologiques. Les uns et les autres se croisent par-dessus par-dessous. Sous l’épaisseur du tapis herbeux des bonzes poussent, et on aperçoit les rides de leur nuque épaisse. On se satisfait de la maigreur et de la pâleur des verts, faite au feu de l’ombre qui bourronne au pied des haies. Les vagues viennent se désaltérer dans les creux.

Sur le plateau de Bottens ne reste de la guerre de religions qu’un champ désert dans lequel se font face tête-bêche les églises catholique et protestante que les fidèles peinent à réchauffer. Pour ne pas choir, j’entre dans la seconde pour m’assurer que les six orteils du Polydactile que Louis Rivier a peint en 1943 sont toujours là. Le compte est bon. J’ouvre tout grand la porte, m’étonne que la mère et le fils ne frémissent pas au vent de cette résurrection-là. Je leur en veux même un peu. Réforme et Contre-réforme n’auront servi à rien, au village les deux cafés sont fermés, le ciel est vide. Et c’est tant mieux quand nous n’avons rien à perdre et qu’il fait beau.

Je rôde autour du château disparu avant de plonger sur Malapalud et suivre le Talent, avec en frise l’alternace des molasses gréseuse et marneuse des côtes de Rabataires. L’eau coule froide dans l’ombre. Personne. Mais où sont donc les vivants? les 7 milliards qu’on m’avait annoncés ce matin? En grappes dans des maison privatives? jardin privatif et pensée privative? Nous ne nous priverons pas aujourd’hui du temple immense dont il se sont coupés et qu’ils ont laissé aux bohémiens et aux va-nu-pieds.

Ces balades d’un jour, on s’y lance sans savoir comment on en reviendra, et on en revient sans savoir comment on y est allé. L’éblouissement reste là-bas quand on y retournera.
Jean Prod’hom
Dimanche 9 janvier 2011

S’il y a souvent place pour deux sous les grands parapluies noirs des boulevards, il n’y a aujourd’hui, sous ta capuche, de place que pour toi. A peine. Alors tu la rejettes dans le dos, te racontes des morceaux d’histoire. Un berger sur la colline garde ses brebis, sous un large feutre noir, enveloppé dans une cape plissée comme une girolle, il va et vient sous le crépi du ciel.
- Et toi, que gardes-tu?
- La possibilité de m’abandonner à la pluie qui ne lésine pas, la possibilité de ne rien garder parfois, sans autre auxiliaire qu’un coeur qui bat. Je regarde à mes pieds les ornières qui font le plein, demain les moineaux vont se régaler. La pluie pourrait ne pas cesser de tomber et ça me fait du bien.

J’entends à peine réveillé la pluie et me rappelle les feuilles gaufrées des châtaigniers derrière le grand mas à la terrasse détrempée. Le brouillard lévitait immobile au dessus de la vallée du Vidourle. Je me promène dans le bois, et c’est comme si je m’en allais en direction du jour, l’interminable jour, abrité par la pluie qui en fait voir la trame. Je touche du bout du doigt le bout des cornes de l’escargot qui me ramène à la pluie d’aujourd’hui, un instant, avant de repartir par d’autres passes, une silhouette sur le chemin de Ricken au petit matin tiède, des signes noirs sur la chaussée délavée, sur les tuiles de Vuadens, les ardoises de l’enfance, les lauzes de Sauveterre, t’en souviens-tu, les tôles au-dessus de Feutersoey, le sapin des Charbonnières, enfin là, avec la pluie, celle d’aujourd’hui, avec les odeurs de là-bas lorsque les fumées âcres des feux d’automne réveillent mes souvenirs et rassemblent de proche en proche les tessons de celui que j’ai été, le vase que je suis dans un monde à l’abandon. On a mis les arrosoirs à l’abri sous l’auvent de l’ancenne laiterie.

Le redoux lèche les plaques de neige attardées. Les fontaines tirent la langue, les ruisselets se gargarisaient. Les vieux tonneaux renversés ont le ventre vide, pour un peu on aurait voulu leur faire relever la tête. Personne ce matin n’avait osé prendre les devants, songé à exiger une interruption immédiate de l’averse, on acceptait et personne ne se plaignait. Les portes de l’église de Syens étaient restées fermées à double tour, le coeur au sec. Et moi enfermé dehors, je n’avais à me plaindre de rien. J’ai marché sur l’eau, fait sonné les six sous qui traînaient au fond de mes poches. J’étais dedans, abrité par la pluie, inutile de forcer la porte, pas de raison d’en sortir. J’ai vu une bergeronnette sautiller sur les bords de la Broye.

C’est pas une saison pour remuer, qu’il m’a dit. On garde les bêtes dedans avec ce temps. On transhume seulement deux fois l’an, t’entends. Moi, je suis fier de mes godasses, de mes falsards et de ma gore-tex. Je nage étanche comme un poisson dans l’eau. Je n’ai rencontré personne d’autre cet après-midi. Coupé de tout, rien ne tremble, ni la pluie décidée ni le haut ni le bas. Eblouis par les mousses lessivées, les anges ne craignent pas de mettre les pieds dans la boue. Voici les quelques mots que je voudrais t’offrir dans la double jachère des dimanches de pluie.

Des Jaunins au Torel, du Champ des Dames à Vers chez les Rod, la terre meuble vous fait des pieds de plomb. Du Riau des Méleries aux Chênes et à La Verne, feux de plastique, jaunes, bleus, jeux d’enfants et restes de châteaux en Espagne, bleu, blanc, rouge et tuyaux verts, étincelles de fer des machines agricoles abandonnées dans le pré sur lesquelles, éblouies, les maisons de l’hiver ferment les yeux. Sous le pont de la Bressonne glaise d’eau glisse au pied de la paroi de molasse sur laquelle s’agrippent les mains lisses du froid.

Toute la journée il pleut, me colle à la peau cette idée de retrouver le beau visage effacé de la pluie. Trempé au pied de la vieille ville. A Moudon on m’attendait. Je me suis glissé à l’arrière comme un chien mouillé, la pluie pianotait sur le capot de l’auto. Devant Saint-Etienne, une double hélice de luminaires a éclairé la nuit, qui tombait elle aussi, elle avait ôté tous ses habits. Il eut été insensé de vouloir s’éloigner. Mais je ne regardais plus, comme si le nom qu’il eût fallu donner à la pluie fût plus beau encore. Ah! la belle après-midi.

Jean Prod’hom
Dimanche 2 janvier 2011

C’est décidé, on ira au cinéma à pied, ça ne fait finalement qu’une douzaine de kilomètres du Riau jusqu’au Zinema d’Oron, n’est-ce pas? Et on marche depuis que tu es tout petit. Souviens-toi des Diablerets, de la Vallée de Joux, de Plan Francey,... il t’en reste des morceaux et des photographies dans les albums.
La route de la Moille Messelly est verglacée si bien qu’on renonce à emprunter le chemin du remaniement, on bifurque à la patte d’oie sur Rachigny, fond sur la Goille où F se remet de son opération. On brasse la neige avec insouciance dans le côteau de l’autre côté de l’Echu. Un renard bondit d’un bosquet et plonge dans le lit du Cerjuz. On guigne à tout hasard dans le cabanon des veaux qui surplombe la rivière. Le roux a filé, rejoint par un chat qui disparaît lui aussi. Arthur sautille, grimpe, court.
Près d’un hangar caché dans le bois sous la route de Berne, on entend les chants désordonnés d’oiseaux, c’est une volière en amont du pont de la Bressonne qu’on souhaitait rejoindre par le Moulin du Creux. Aux piaillements se mêle un tube des années 90, les propriétaires s’affairent, on remonte discrètement. Qu’on ne nous prenne pas pour des brigands.
Arthur lance des boules de neige sur tout ce qui bouge. On traverse la zone industrielle de l’Ecorcheboeuf jusqu’au café de la Croix d’Or, fermé malgré les lumières qu’on aperçoit derrière les rideaux. A cause d’Ussières tout près, c’est un lieu qui me fait immanquablement penser à Dhôtel, au Plateau de Mazagran et à l’Ile de la croix d’or.
On fera une halte à Mézières en face d’un caraque, d’un vermicelle et de deux chocolats chauds. Puis, par Chenau, on atteint le pont de la Carrouge. Il nous faut alors remonter la route du Paradis, comme en 2002, entre Tanneires et Roseires, jusqu’au cimetière de Ferlens où S repose fauché par un train. Je raconte cette sale histoire à Arthur tandis qu’il caresse un chaton devant chez les B, la maison est vide, le village est vide, la campagne est vide. On rejoint Fontaine, entre Champ Jaquet et les Planches, longe la lisière du Bois de Fey avant de glisser dans la neige jusqu’au pont du Parimbot. On remonte sur la Possession d’où l’on aperçoit Oron à l’avant de son château, le Niremont et les Alpettes, plus loin les Vanils.

On laisse au nord Auboranges et sa belle maison carrée, traverse le Champ Paccot au-dessus de Vuibroye avant de descendre jusqu’au pont qui franchit le Grenet à deux pas de la Broye. Arthur court devant, onze ans seulement, saute comme un cabri et allonge le pas, se retourne pour s’assurer que je ne le perds pas de vue. Jusqu’à Châtillens où les cloches sonnent, il est 4 heures.

On remonte ensemble en direction du centre de la petite ville qui abrite près de 1500 habitants, s’assoit sur un muret devant l’Etablissement médico-social du Mont où il fait bon vivre, géré par la Fédération des Eglises adventistes du 7e Jour, quelques boules de neige dans le lit du Flon, petit affluent de la Broye, un coup d’oeil chez Denner, les voix de deux loubards, et un chocolat chaud. Un chocolat chaud pour conclure notre balade, au tea room, seul établissement public ouvert de cet ancien chef-lieu de district qui file du mauvais coton.
Une douzaine de kilomètres, le bonheur de marcher avec son fils, et celui peut-être de marcher avec son père, il n’en faut pas plus pour qu’on renonce au cinéma.





Jean Prod’hom
Les livres à la benne

Il y a dix jours exactement, un homme brun, bien mis, break ripolinée et cinquantaine cendrée jetait six sacs de livres dans la benne du vieux papier de la déchèterie locale. C’était un dimanche et l’inconnu n’était pas domicilié dans notre village – on se connaît tous par ici. Il a semblé gêné de ma présence, je l’aurais été aussi. Que cachait-il ? Pourquoi se mettait-il dans un tel état ? J’ai voulu le réconforter en lui soufflant d’un air entendu, ma foi, qu’il le fallait bien de temps à autre. Il a levé les yeux au ciel, sombres et brillants, puis s’est glissé hors la déchèterie comme un serpent. Je n’ai pas voulu en savoir plus, mais il y avait quelque chose de terrible dans ses yeux, et puis d’un peu louche, comme s’il avait voulu se débarrasser d’un mort, ou de son linge sale. Ça ne se fait pas, n’est-ce pas? L’inconnu allait-il revenir le lendemain reprendre ce qui, comme il semblait le croire, aurait pu le trahir? J’ai imaginé un bref instant que cet inconnu était un écrivain et que les livres qu’il avait jetés dans la benne étaient, sans le savoir, ceux qu’il avait écrits et qu’on allait oublier. Le camion de l’entreprise chargée d’emmener le vieux papier sur le brasier a passé hier en fin d’après-midi. L’affaire est close.

Au fond de la benne le visage de Gustave Courbet m’avait pourtant fait signe et j’ai relevé consciencieusement ce dimanche-là les coordonnées sommaires des ouvrages jetés par le brigand. Un jour qui sait? Le livre aura disparu, trop lourd, trop encombrant, trop cher,... Il aura laissé la place à une tablette qui contiendra tous les livres de toutes les bibliothèques pour un prix dérisoire et illusoire. On regrettera peut-être alors les équipées dans les déchèteries et les grands feux dans lesquels on jetait les livres en se mordant les lèvres de honte.

Jean-Pierre Richard, Etudes sur le romantisme, 1970
La Bible du pêcheur, 2001-2003
Michel Viala, Poésie choisie, 2009
Hans-Michael Koetzle, Photo icons, Petite histoire de la photo, 2007
Gérard Genette, Figures III, 1972
Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, 1973
Jean Prod’hom, Etudes de Lettres, La Part des hommes (tiré à part), 1985
Guide du routard, Italie du Sud
Guide du routard, Suisse
Valérie Poirier, Loin du bal et autres pièces, 2008
Henri-Alexis Baatsch, Hokusaï, 2008
Atlas alphabétique, Les Etats du monde
René Benjamin, La Galère des Goncourt, 1948
Stéphane Guégan, Michèle Haddad, L’ABCdaire de Courbet, 1996
Giovanni Boccaccio, Decameron, 1968
Michel Chauvy, Passions et démesures latines, Cicéron, Lucrèce, Catulle, 1999
Robert Aron, Les Grands Dossiers de l’histoire contemporaine, 1964
Michel Puech, La Philosophie en clair, 2004
Anne Cunéo, Les Portes du jour, Portrait de l’auteur en forme ordinaire, 1982
Jean-François Revel, Mémoires, le voleur dans la maison vide, 1997
Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé, 1926
Collectif, Société Vaudoise des Pêcheurs en rivière, 1908-2008
Guides Hachette, Orthographe, 1999
Nayrolles , Profil d’une oeuvre, pour étudier un poème. 1996
E. Giddey, Histoire générale du XIVe au XVIIIe siècle, 1957
Dan Brown, Da Vinci Code, 2003
Maurice Wilmotte, Critique littéraire, 1921
Alain Jouffroy, Manifeste de la poésie vécue, 1994
Winston Churchill, Réflexions et aventures, 1932
Georges Pompidou, Anthologie de la poésie française, 1961
Bescherelle, La Conjugaison, 2004
Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, 2008
Collectif, Guide culturel de la Suisse, 1982
Jim Harrisson, Legends of the fall, 1979
Collectif, De l’ours à la cocarde, 1999
Robert Brasillach, Comme le temps passe, 1937
Eric Massery, Une si belle ignorance, 2009
Emanuelle delle Piane, Pièces, 2010
Michel Vergères, Le Pisteur, L’escroc finit en hiver, 2004
Eschyle, Agamemnon, 2001
Sarcey, le Siège de Paris, 1967
Brasillach, Notre avant guerre, 1941
Stanley, Soumission à l’autorité, 1994
Georges Clémenceau, Grandeurs et misères d’une victoire, 1973
J.-L. Clade et P. Perrin, Au Coeur de la Vallée de la Loue, 2010
Gérard Genette, Figures I, 1965
Michel Butor, La Modification, 1994
Marielle Pinsard, Les pauvres sont tous les mêmes et autres poèmes, 2009
Marcel Schneider, La Littérature fantastique en France, 2007
Gérard Genette, Figures II, 1969
Arnaldur Indridason, Hiver arctique, 2009
Léon Daudet, La vie orageuse de Clémenceau, 1938
André Bellessort, Sainte-Beuve et le XIXe siècle, 1954
Kwong Kuen Shan, le Chat philosophe, 2008
Claude Bron, Orthographe, 1990
Georges Pillement, La Poésie érotique, 1970
Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, 1943
Christine Barras, La sagesse des Romands, 2009
Léo Spitzer, Etudes de style, 1970
Georges Poulet, La Conscience critique. 1986
Collectif, Anniversaire du Gymnase cantonal de la Cité, 1987
Collectif (Corinne Desarzens), Récits sur assiette, Textes inédits d’auteurs romands sur la cuisine. 2009
Collectif (Pierre-Yves Lador) Plumes bigarrées, Inédits suisses, romands sur le livre, 2009
Sylvie Durrer, Le dialogue dans le roman, 1999
Marcel Cohen, Histoire d’une langue le français, 1950
Collectif, Gymnase de la Cité, Annales 1995-1997
PS
J’ai tiré au hasard cinq livres parmi les soixante-cinq dont l’inconnu s’est débarrassé, en me jurant de les garder et de les lire. A moins que je ne change d’avis et que je ne suive son intemporel exemple.
Jean Prod’hom
Dimanche 26 décembre 2010

Ses yeux, que je me représente immenses et brillants, n’auront rien vu du grand monde qu’il désirait tant découvrir. Ils auront eu au moins le don de rester grands ouverts dans le petit qui était le sien...
Robert Walser à propos de Fritz Kocher
Ce n’est pas le vent qui m’a poussé au-delà du domaine de la Solitude entre Montmeillan et les Galites, ni aucun des forfaits qui meublent nos vies et les talonnent dès l’aube, c’est l’autre, un autre, le brigand déguisé en bourgeois chapeauté. Il n’en voulait plus et n’y tenait pas plus que cela, allait de l’avant. Il avait croisé après midi des promeneurs du dimanche, s’en était détourné sous cape, glissant par-dessus le talus dans un pré où la neige s’ammoncèle intacte, lourde. Il n’avait pas craint de troubler sa blancheur inédite. Je l’ai vu s’arrêter là où la neige est moins profonde, où percent des touffes d’engrais vert, mais les traces sont effacées et lui, dos tourné, est bien loin dans le désert. J’ai cru comprendre un peu ce brigand et le pays qu’il habitait. J’ai écouté le double silence du lac acoustique.
Il ne se passe rien, il y a trop de choses – est-ce ironie pour me protéger et aller de l’avant, torturé par la lourdeur du dedans? Entre l’aube et le territoire d’après, il n’y a dans la neige que détours, hésitations et pas de danse, des ans qui passent pour faire bonne figure, traces de bêtes dont on ne veut rien savoir, passants sans visage. On a abattu de vieux arbres hier et le silence s’est réveillé lorsque je me suis arrêté. Nos vies sont d’un seul tenant, un jour et une nuit, on titube aux alentours, là où l’on fut un instant au repos. Parti tôt avec les autres, un moment avec eux avant d’aller où personne ne va, que la neige tombe une fois encore et ce sera fini. Les chiens aboient devant la Grange aux Roud, j’entre dans le bois comme un voleur. Tant de choses font de même, refusent l’affiliation, se croisent, laissent des traces tôt effacées, ne bronchent pas, ne se plaignent pas, la neige fait le reste. Joye a abandonné sa caravane dans le bois de Ban
Je ne suis qu’un locataire d’un meublé dans un décor immobile que seule la nuit surprend, égaré cet après-midi dans le bois sec, pas de bruit, un dédale d’avenues, de sentes et de feux de broussailles où la bête garde les siens au chaud. Comment pourrait-on partager le désert? Comment chevaucher les nuages qui filent vers le sud. Faut-il s’éloigner pour n’être plus seul? Derrière moi les traces s’effacent, il n’y a pas de nuit prochaine, c’est toujours la même, une nuit un jour, et entre elles la neige.
Attester du réel qui passe derrière les vitres de nos fenêtres, on est là, l’autre aussi, plus aimable et correct lorqu’on ne le dérange pas. Quelle histoire tirer de cette petite promenade, quel fil tirer sans déranger la belle ordonnance, pour que rien ne soit changé avec la retenue qui sied ? Ecrire ce qui ne s’écrit pas, mais qui mérite d’être poursuivi avec les égards qui lui sont dus, effacer les traces qui y conduisent comme la neige sur la neige, les lettres sur la page.
Qu’on ne surestime pas cet autre qui est en nous, qui marche et qui s’éloigne. On écrit beaucoup trop, un bon pas suffit parfois, un acte en engendre un autre, et on se débarrasse de tout ce qui n’est pas soi, on se défait pour n’être plus rien, sinon un souvenir, une pensée qui passerait par là ou dans la tête d’un hypothétique lecteur. A force de distraction on parvient à s’éloigner de son but, avec au fond du coeur une belle réserve d’étonnement, c’est que les choses s’en vont, et nous avec. Se coucher dans la neige, par un saut effacer les traces et les tourments. Pas avant d’avoir appris à marcher et à lire, personne pour nous aider.
Aucun souvenir de ce que Robert Walser a vu au-delà du pâturage qu’on appelait Am Ende der Welt, mais le souvenir d’une image, persistante, celle d’un homme dans le soleil, le dos tourné à tout, brassant la neige, un chapeau sur la tête pour qu’on ne le poursuive pas. Les flocons tombent derrière lui et recouvrent les traces qui auraient pu nous faire croire que le chemin est facile et qu’il suffit de prendre la bonne direction, alors qu’il nous faudra recommencer, marcher et puis écrire, qu’il nous faudra recommencer sans rien regarder, ni l’arbre à la lisière du bois ni le nuage qui feint de nous montrer la direction.

J’ai marché et je marche encore, mais pas d’allure égale.
Tantôt j’allais d’un coeur serein,
Tantôt - même le ciel connaît cela -
Je perdais toute envie soudain.
Dans un long jour empli de peine.
Robert Walser
Jean Prod’hom
Dimanche 19 décembre 2010

Tiré en arrière par le poids et la lenteur de ce qu’on emmène malgré soi, il avance cahin-caha, brasse la neige haute et lourde qui tapisse le pré derrière le Chauderonnet, avant de déposer le trop-plein à la lisière du bois et trouver là un milieu qui ne l’oblige à rien, sinon à suivre la cadence, oscillant entre des morceaux de langue qui s’échappent et, enhardi par les empreintes laissées par d’autres solitudes, le chemin qu’il trace. Il décale la gravité vers l’avant, même allure, quelque chose comme une phrase creuse dans la neige un sillon qui se perd au bout du chemin, le souvenir de quelque chose plutôt que rien. Seul, bien seul, mais avec l’autre qu’il héberge, ne serait-ce que pour témoigner un instant de son existence, marcher pour qu’ils ne fassent qu’un à deux pas de l’étang, les mains croisées sur les genoux ou partout ailleurs.
J’entends soudain un bruit de pas qui froissent la neige, ce ne sont pas les miens, viennent de l’intérieur et les cloches qui se prêtent au jeu. Un pan de lumière éclaire tout ensemble, la grande peur qu’il faut surmonter, la tragédie sans laquelle notre âme prise en otage par les ambitions ne se faufilerait pas jusqu’à l’universel avec ses pattes d’oie et ses habits de semaine. Les dieux veillent dans les fourrés.
Mais qui se doute de ce que que l’on est et qui s’en préoccupe ? Je ne suis qu’une simple coïncidence au milieu du jour, avec pour seule assurance les mailles du passé et la promesse de la solitude sans laquelle l’autre ne serait qu’un leurre. Un peu à côté pour me mettre enfin au pas, c’est-à-dire marcher et renouveler l’alliance du lierre et du frêne, avec les cloches qui vont et viennent. Je lève les yeux vers le ciel sans dessus ni dessous, avec un ruisseau en contrebas, un pont et le devisement du monde, le soleil pour faire bonne figure, et tout autour la grandeur, une grandeur qui nous contient, la neige, le ciel et le meilleur.
Il a déposé les preuves passagères de son existence sur le chemin des Censières avant de tourner une page, on ne revient pas sur ses pas. Il a croisé des voix, celle de Ramuz, celles de Starobinski et de Mettra, un peu de nostalgie pourquoi ne pas le dire, nostalgie du simple, du rugueux, du bienveillant. Nostalgie du simple et de l’encore plus simple, jusqu’à ce rien d’où il conviendra de tirer un jour, peu importe, quelque chose ou bien rien.
Jean Prod’hom
Les disparus : été 2008 - décembre 2010
Dimanche 12 décembre 2010

Ils régnaient sans ostentation dans l’embrasure de la fenêtre, en haut un peu à droite. Leur cou maigre et leur tronc dégarni attestaient leur origine modeste, le temps qui passe, les résistances qu’il faut opposer à ce qui advient pour aller de l’avant. Ils allaient sur l’âge, trois devant liés par le silence des grandes décisions suivis avec une confiance aveugle par un grupetto souvent désobéissant. Ce sont les premiers qui montraient la direction, libres au-dessus de la mêlée, la tête dans le ciel, d’eux que s’écoulait la lumière jusque dans la bibliothèque. Leur grandeur, leur raideur parfois, leur dignité s’offraient sans secret. Mais il était difficile de les imaginer les uns sans les autres.
Comme s’ils avaient pris le parti de la sédentariré la veille seulement, par une décision libre. Mais pour un temps seulement, prêts à reprendre une aventure à laquelle ils n’avaient pas renoncé. C’était étrange de les retrouver chaque matin à leur place, parce qu’ils semblaient la veille sur le point de vouloir continuer leur route. Je les dissuadais et le vent les faisait vaciller. Qui donc les aurait accueillis? Ils sont restés là-haut, équilibrant les jours et l’embrasure de ma fenêtre, donnant aux vieux arbres rabougris du verger un air enfantin, s’effaçaient au printemps devant l’exubérance miellée du tilleul. En octobre et novembre considéraient avec bienveillance le chant du cygne des feuillus sur les bords du Riau, leur précarité. Ils gardaient la hauteur, la distinction des sauvages, se réjouissaient en silence de tout, mais est-il bien prudent de dire tout cela ainsi?
Ils avaient dû comme les autres se lever hors la terre maigre, écarter les bras pour régner discrètement sur ce quartier des bois. Je les imaginais pourtant échappés d’une prison bien loin à l’ouest, ripés-là au terme d’une longue épopée et se retournant parfois sur leur histoire. Ils étaient montés de la plaine à la queue leu leu, surgissant un beau matin du creux de l’un des nombreux vallons dont se réjouit le Jorat, surpris par la majesté des lieux, satisfaits de la discrétion de l’accueil. Je me suis raconté tant d’histoires, tout est fini, les bûcherons ont tronçonné la petite tribu. Ça tient de si peu, tout disparaître, n’est-ce pas?
Une fois ce matin, une autre cet après-midi je suis monté à la Mussilly voir où ils se dressaient. Je n’avais jamais éprouvé le désir d’en savoir plus, la terre où ils avaient jeté l’ancre, jamais je n’avais fait le lien entre cette présence du dedans l’embrasure de la fenêtre et cette existence du dehors, juste derrière les ruches qui flamboient à la belle saison au bout du grand pré. Je ne découvre que ruines et coeurs vermoulus, vivants et fumants encore, ils n’avaient jamais fait voir la fatigue et l’usure qui les taraudaient, courageux et dignes comme les chats qui vont mourir dans le sous-bois. Ce ne sont que des histoires, l’horizon s’est aplani, le dessin a déserté le paysage. Sans eux rien n’aurait été comme avant. Je crains que les vieux arbres du verger ne se prennent trop au sérieux. A quoi désormais s’accrocher?
Les disparus 2
Jean Prod’hom
Dimanche 5 décembre 2010

C’est en 1994 que le plan d’affectation du Rôtillon – avec ses quatre îlots homogènes – a été accepté par le Conseil communal de la ville de Lausanne. Ont suivi quinze belles années de controverses, de fouilles et de plans, une espèce de sursis, on pouvait rêver. Il avait été prévu qu’on bâtisse un «miniplex» de salles de cinéma, un centre de vie enfantine et des logements, un bâtiment destiné à l’accueil de jour et à l’hébergement de personnes souffrant de maladies psychiatriques. C’est fait pour le parking mais on a renoncé aux salles de cinéma, en échange on leur a fourni la vidéosurveillance. Il y aussi un salon de coiffure et une boutique de mode, une de ces institutions de réhabilitation psychosociale dont on a tant besoin, une crèche, une régie immobilière, des surfaces commerciales et quelques appartements, tout porte à croire qu’on ne va pas faire la fête tous les soirs au Rôtillon. Ah si, on a ouvert un restaurant, le Double Z sur les bords de l’îlot C, car ce soir le parking tout illuminé est en gloire, un tractopelle à ses côtés, le godet à terre, pas pressé de creuser le dernier îlot sur lesquel la nuit descend, pensez donc, depuis le temps.
On ne reverra pas le Flon couler de sitôt, enterré le passé industriel, oubliés les talus en friche, adieu les grandes tannées, le Café des Artisans, les squats et les prostituées.
Qui place sur les devantures de nos librairies les amers de notre irresponsabilité? Natura maxima, L’Encyclopédie du chocolat, 365 Etincelles, Montagnes sacrées, Switzerland the World, Le Coeur en paix, Drôles de labradors, La Recherche du paradis, L’Herbier essentiel. Qu’on leur fasse la peau.
Aïe, quelque chose m’a piqué le coeur, et une poussière m’est entrée dans l’oeil. Les rosiers poussent de travers et les roses sont laides. C’est comme si le diable avait fabriqué un miroir qui ne montrait que les âmes grises. Un seul établissement public est ouvert, à l’extrémité de la Rue de l’Ale, en face d’une boutique qui brade ses fonds, le restaurant du Cygne. C’en est trop. La nuit serre ses mâchoires sur une ville en liquidation. Je me hâte d’aller récupérer Sandra, Arthur, Louise et Lili à la sortie du Petit Théâtre. La Reine des Neiges les a ravis. A mon tour de les emmener à la maison. Tiens, le soleil est revenu.
Jean Prod’hom
Dimanche 28 novembre 2010

Deux roses rouges ourlées de papier crêpe et coiffées d’un peu de blanc baissent la tête, elles avaient ce matin encore les lèvres bleues. Elles vont aller ainsi jusqu’à la fin de l’hiver, la vieille ne descend plus dans son jardin. Au fond des poches une douzaine de cacahuètes, une poignée de son et quatre mandarines, c’est comme un souvenir, une traînée plutôt, une traînée restée en arrière qui passerait subitement en coup de vent sur le chemin glissant.
Personne entre le Riau et la Goille. Il faut brasser la neige qui remonte jusqu’au ciel, on a beau avoir les yeux grand ouverts, on ne voit rien, ivresse sans vin. Les entailles dans la terre se croisent en tous sens, comme dans le ciel ou dans la neige, mais ne disparaissent pas. A l’Ecorcheboeuf un enfant crie à cause du froid. A quelques pas de lui ses parents pèlent la neige.
Au fond de la combe, le chemin du Creux exécute deux demi-boucles avant de franchir la Bressonnaz et rejoindre le Moulin. Et puis après? Je reviens sur mes pas, dans les parages de Photolabo où tous les jours sont dimanches depuis plusieurs années déjà, l’usine est à vendre : on y développait de la pellicule photos et on y réalisait des tirages papiers. Et puis après après ?
On a chauffé l’église de Mézière la veille déjà, si bien que nous ne sommes pas mécontents d’y entrer lorsqu’elle ouvre ses portes à 16 heures. Elle accueille aujourd’hui les élèves de l’Atelier de Musique, les enseignants, une organiste et les parents, les amis et quelques bénévoles. Le sacré prend un sacré coup de vieux et des allures enfantines : on sourit, on fait les choses à moitié, on saute, parle sans contrition, on se trompe, on recommence, c’est un peu carnaval : des ours jouent du violoncelle, le lait condensé s’écoule des flûtes en do, les flûtes en la font les institutrices, quant à la présidente elle a quelque chose de Jane Birkin. Derrière le coeur le crucifié ne voit rien, il a la tête dans les nuages.
L’organiste qui a ouvert la fête par la Sinfonia de J-S. Bach la clôt par la fugue en do mineur de Mendelssohn. J’aurais bien voulu demeurer un instant encore au chaud dans cette grande pharmacie repeinte aux couleurs des fêtes foraines, auxquelles me font immanquablement penser les trompette héroïques des orgues. Mais la maîtresse de cérémonie en a décidé autrement, elle remercie tout le monde, tout le monde sourit et Lili rit.
Jean Prod’hom
Dimanche 21 novembre 2010

Le brouillard a tiré les rideaux et éteint les lumières bien avant qu’on ne se lève. Les bonnes volontés du dehors mises hors jeu, il a bien fallu faire avec et on a joué le nôtre à l’intérieur, à la lueur des réverbères. Les travaux de peinture allaient bon train mais on n’en menait pas large dans le long couloir repeint aux couleurs de l’hiver. Et lorsque le brouillard a fini par trouver les ouvertures de la vieille maison, s’est faufilé dans ses replis jusqu’à occuper la chambre des enfants, il a bien fallu qu’on songe à une issue.
Sortir donc, retrouver la brouille et se rendre compte que l’âme vit très bien sans corps dans un monde éteint : elle entend distinctement l’eau de la fontaine lorsqu’elle fait le dos rond, les chats s’affairent, dernières emplettes avant l’hiver, on les devine, la terre est noire, les taupes la retournent avant le gel.
Dans le vent on va tous les yeux fermés, je le sais, mais lorsque le visage prend les devants, ils y voient bien plus clair que ce qu’on croit. A tel point que je songeai, assis sur le banc de la Mussilly, qu’il ne serait pas si simple de me lever et continuer. J’hésitai plus d’une fois, le pâturage dépassait de dedans la terre comme une baleine dont on voit l’échine soulever l’océan, à mes pieds une bille de foyard aux flancs d’argent.
Mais le souvenir des sourires des enfants en a décidé autrement. J’ai laissé derrière moi la fraîcheur, deux bandes de vert et poussé devant moi un petit regret, celui de ne pas avoir su prolonger mon séjour dans la fraîcheur. C’est elle pourtant qui a éclairé le chemin du retour, celui qui conduit à d’autres saisons.
Jean Prod’hom
Dimanche 31 octobre 2010

Pour la quatrième fois cette semaine je monte à Pra Massin, quatre fois je m’étends sous les Chênes, à l’abri de la haie, vivace, bouleaux et frênes, un peu d’herbe verte sous la veste et l’orient à l’orient. Les collines font le dos rond et les lignes de fuite caressent le creux de leurs reins. La neige de la semaine passée coule le plomb sur les flancs de Brenleire et de Folliéran, quelques chats se hâtent sous les Tailles, dernières chasses aux mulots avant que la terre roussie ne durcisse. Je cherche les bêtes qui couraient il y a peu dans les taillis, un merle brasse les samares et fait les bonnes affaires. Bien loin dans la mémoire des silhouettes s’effacent, âmes solitaires qui raient le flanc noir des bois, vont et viennent dans les couloirs du purgatoire, raides sur des buttes, aux lisières ou assises sur des bancs. Elles guettent ce qui vient et se gardent de ce qui va, mais il est trop tard, on est de trop et c’est tant mieux, chassé de la bonne saison, à trente pas de tout et de rien, et le reste, avec autour le silence liquide, le léger frémissement du chemin d’erre, pas grand chose, la rouille des saisons, les amarres, un peu de fumée.
J’ai levé ce matin le plan de refuges dressés à l’insu des services de protection qui maintiennent en équilibre au coeur du caduc ce qui ne coûte rien. Quelques solitaires y demeurent à l’écart du cadastre, ils ont laissé quelques traces, nul mot de l’abandon, mais il est écrit dans le pré au milieu duquel ils brillent qu’un jour on sera invité nous aussi au festin, on verra les contours d’une possibilité intacte, être de dedans ce beau désastre. Ici c’est chacun son tour à la condition d’avoir su renoncer à temps, accueillir ce que personne ne veut et dont même l’aveugle se débarrasse. Je laisse filer les choses dans les bords et reste dans le calme du milieu.
Une grande vague soulève la terre, le merle a saisi une sauterelle et quelques promeneurs picorent la vie qui affleure. Pourquoi les seuls témoins de l’amont se sentent-ils coupables ? Une folle tout là-haut sur le banc, noir vêtue, un peu gênée par la vie qui vient en trop. Et à nouveau les cloches sur le chemin, la vie qui avance sur la pointe des pieds emmenant à ses côtés une cohorte de fantômes, le trop plein du purgatoire goutte dans le caniveau, les peurs infernales se sont tues. Il pleut, on aura demain les pieds dans la boue.
Jean Prod’hom
Dimanche 24 octobre 2010

La neige tombée pendant la nuit a sonné le glas des beaux jours, il faut s’y faire ce matin. Mais avant de s’engager plus avant dans la mauvaise saison, les Joratois ont encore à décider de l’allure de celle qui a pris fin. C’est parce que la mémoire n’y suffit pas et qu’aucune position ferme ne s’impose que les paysans, depuis l’aurore, traitent de l’épineuse question avec les premiers levés, quelques-uns du Conseil communal, les vieux et le laitier. Pas un mot ou si peu, les tractations sont secrètes. La décision est politique et relève tout autant du législatif que de l’avis éclairé de ceux qui chaque jour, au saut du lit, scrutent l’orient. Les uns et les autres pèsent les éléments, convoquent les souvenirs, les jours perdus, la grêle, les semailles, le soleil, le retard, les orages, l’humeur de la patronne, les labours, le niveau des sources, la qualité du lait, le fils, la fille,...
Lorsque j’arrive au café, les tractations ont bien avancé déjà, je le vois à la mine entendue de certains. D’autres pourtant s’en vont déçus, tête baissée, avec l’impression désagréable d’avoir dû se plier à ce qui s’est décidé sans eux – et un peu contre eux. Mais c’est la loi ici et aucun ne trahira la décision prise.
Au bar traînent encore les émissaires des villages voisins dans lesquels on a envoyé les nôtres. Ils se croiseront sous peu au giratoire de Sottens, il faut qu’à midi l’affaire soit pliée, d’Oron à Echallens, de Corcelles à Denezy. Quelques mots encore par-ci, quelques mots par-là, un dernier tour de table, silencieux, la sainte équipe se regarde toute proche de l’irrévocable décision. C’est fait ! S’installe alors le silence puissant de ceux qui font le beau temps, le silence du président du Conseil communal, du laitier et du secrétaire de l’Association des déchets carnés qui commande trois décis et trois verres, c’est son tour.
Un peu plus tard le laitier se lève, il me salue, je me risque et me lance.
– La neige est tombée bien bas cette nuit.
– On a eu une belle saison, faut le reconnaître.
Je cherche à me souvenir, je n’ai pas de vue d’ensemble, mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. J’opine avec le sentiment de l’inéluctable, le laitier a raison, certainement raison, il sort du café un bonnet de laine sur la tête.
Jean Prod’hom
Dimanche 26 septembre 2010

Louise et Lili grignotent un petit pain au lait sans prêter la moindre attention à la Venoge qui serpente dans un fouillis de frênes, de peupliers, de saules et d’aulnes entre Vufflens-la-Ville et Cossonay. Le train de 10 heures 45 est presque vide.
Dans le compartiment qui jouxte le nôtre une dame, vieille, écrit dans un petit carnet à anneau. Je la surveille d’un oeil avant qu’elle ne se lève et s’assoie dans le compartiment suivant. Je guigne par-dessus mon épaule, elle se penche à nouveau sur son carnet, écrit soudain quelques mots. Le manège se poursuit une seconde puis une troisième fois, elle se lève, se penche, écrit, récrit, se repenche avant de s’enfoncer à l’arrière du wagon.
La vieille dame réapparaît sur le quai 1 de la gare d’Yverdon, on dirait Alice Rivaz. Elle arrache immobile la feuille de son carnet à anneau qu’elle jette rageusement sur la voie. Je la ramasse discrètement et, tandis que Lili et Louise courent et crient sur la place de jeux, lis les mots suivants :
Se connaît-on vraiment mieux à partir de ce qu'on écrit, puisque en écrivant il arrive qu'on s'invente? J'aurais voulu naître près d'un océan plutôt que dans un pays aux paupières lentes. Un insuccès prolongé fait parfois craindre le succès comme on craint, l'âge venu, un trop grand changement dans ses habitudes. Seuls comptent ces moments de paix intérieure qu'apparemment rien n'explique, ni ne prépare. Pourquoi, Seigneur, permettre, et pire encore, vouloir que soient effacées une à une, inexorablement, toutes vos effigies? Le plus étonnant : nos deux yeux promenant leur regard à partir de leurs petites niches, selon des angles de vue limités, mais uniques.
Au retour Louise et Lili suçotent des bonbons en comptant soigneusement les voitures vertes et les camions jaunes. Elles se désintéressent de l’homme qui soliloque dans une langue qu’elles ne comprennent pas. Quant aux passagers du train de 16 heures 54 à destination de Lausanne, ils feignent de ne pas écouter. A l’inverse je tends l’oreille et entends distinctement : Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Peu après le tunnel d’Entreroches, alors que défilent les bâtiments du tri de la poste, j’entends : Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich ? J’opine. Sur le quai de la gare CFF de Lausanne l’homme aux lunettes cerclées d’écaille, une allure de Max Frisch, disparaît dans la foule.
Jean Prod’hom
Dimanche 5 septembre 2010

Au clocher d’Hermenches l’horloge n’avait qu’une aiguille – qu’une main. Pas de minutes, de belles heures toutes rondes, jamais mordues.
Gustave Roud
![]()
Le vent officiait très haut à l’heure du culte et le ciel était nu. Daniel avait labouré le champ de blé rentré il y a une semaine et l’horizon s’était abaissé d’un bon mètre. Il avait passé la herse la veille si bien que la terre était montée – avec des crêtes de chaume – jusqu’au pied du potager, elle léchait même ceux du banc sur lequel j’étais assis. Une faible bise, orientée est-nord-est, a fait monter soudain le tintement sourd des cloches des villages en contrebas. Un tintement lointain, à peine perceptible, assez toutefois pour réveiller ceux qui ne dorment pas et les débarrasser des petits soucis qui guettent ceux qui n’ont rien à faire.
Des aiguilles, les horloges n’en avaient plus aucune ce matin, et le temps s’est mis à écarter les bras, et tous ceux qui tendaient l’oreille se sont mis à espérer que les cloches, lorsqu’elles faisaient mine de se taire, rajoutent une mesure à Carrouge ou à Mézières, pour creuser un peu plus encore la campagne, jusqu’au silence qui règnerait cet après-midi dans les déserts, les beaux et précieux déserts de nos dimanches.
Jean Prod’hom
Dimanche 29 août 2010

- Dis, toi tu connais vraiment beaucoup de monde étanche ?
- Non ! quelques-uns seulement, et quelques-uns qui le sont qu’un peu. Quant à dire complètement étanches, ça non, je peux pas le dire, c’est rare. Disons deux ou trois, j’entends de vraiment étanches, Michel est étanche.
- Ouais, Michel c’est sûr. Roby est étanche aussi, et toi je crois que t’es aussi étanche.
- Ouais pour Roby, mais son frère, ça jamais. La Raymonde non plus n’est pas étanche. Sur beaucoup j’ai changé d’avis, t’as trop de gens que tu crois étanche, et puis ce que tu as dit un jour, tu l’entends dans la bouche d’un autre, déformé. Ça c’est dur. Pierre-Georges n’est pas étanche, Armand n’est pas étanche, Mais sais-tu ce qu’il m’a dit l’autre jour à Vulliens ? Tu devines ?
- Qu’est-ce qu’il a dit l’Armand ?
- Il a dit que t’étais pas étanche. Tu te rends compte un peu le salaud. Après ce qu’il t’a fait.
- Ah tu le savais?
- Tout le monde le savait.
- Ah bon ?
- C’est là où le bât blesse. Si seulement celui qui n’est pas étanche parlait à un type étanche. Mais c’est jamais le cas. Trop de gens qui sont pas étanches. Bryan n’est pas étanche, Loïc pas étanche. Et ta femme ?
Ma femme est presque étanche. Mais pas assez, je m’en suis rendu compte, pas parce qu’elle redzipète ce que je lui ai dit, mais parce qu’elle transforme ce que je ne lui ai pas dit. Non ma femme n’est pas étanche, je ne lui dis plus tout ce que je sais et ce que je pense, ma femme c’est un peu comme la tienne.
- Exact collègue ! Moi aussi j’aime les gens étanches. Mais disons qu’il faut pas être étanche comme Roger qui ne dit rien.
- Ecoute, ils auraient mieux fait d’éteindre la sono.
Des vrombissements montent de devant leur ventre bedonnant, des grondements de caverne, nocturnes, humides. Ils sont trois côte à côte derrière l'école de Vulliens, chemise blanche, cheveux gris, la rondeur des sages. Ils ont laissé au repos leur bras droit, une main morte au bout; ils tiennent de l’autre, par le collet, un cor des Alpes descendu de Villangeaux, qu’ils vissent et dévissent pour approcher le fragile équilibre des harmoniques. Ils soufflent avec soin, retiennent le tonnerre, tendent l'oreille à gauche et à droite pour tenir ensemble les rênes de voix qui ne veulent en faire qu'à leur tête. Ils y parviennent un peu et c'est encore plus beau ainsi.
A la fin ils demandent un peu d’emploi à leur bras droit pour éponger leur visage. Il s’en vont le cor sur l’épaule, la main gauche dans la poche de leur pantalon, lentement, comme des cow-boys.
Jean Prod’hom
Dimanche 22 août 2010

Aujourd’hui comme il y a quelques jours j’ai maintenu un bref instant, en équilibre et dans la fraîcheur, l’humeur gagnée sur le cortège des contrariétés qui me guettaient dès l’aube. J’ai avancé réconcilié sur le chemin qui monte à la Mussilly en longeant celui qui traverse l’extrémité du bois Vuacoz et celle du bois Faucan jusqu’à la Moille-au-Blanc, avec le sentiment qu’aucun événement n’aurait raison de mes nouvelles dispositions dont je savais pourtant par expérience que le temps était compté. Chacun de notre côté mais faits du même bois. L’aboiement de chiens en semi-captivité et de leurs maîtres aux abois, la menace des petites taches sombres de l’avenir qu’on s’invente, les impolitesses de nouveaux riches présomptueux que suivaient deux demoiselles au sourire servile n’ont pas entamé la tranche de belle insouciance, simple et fragile, dans laquelle je m’étais retrouvé. Tout cela ne tenait à rien, mais tenait, se poursuivait même, en partie peut-être par la résolution prise en cours de route de partager ce qui ne m’appartenait pas en tenant à bonne distance ceux qui n’avaient que l’allure des rois. Equanimité d’un seul instant mais qui laissait quelque part dans le paysage l’assurance qu’il pouvait en être ainsi si je gardais à l’esprit – comme on le fait avec une prière – l’assurance que le règne d’un horizon guéri du prurit de l’avenir, sur lequel le dedans et le dehors avancent en équilibre, n’est pas le règne des fins.
Dans tout cela l’écriture n’y est pour rien. Elle n’est qu’une autre ligne d’horizon, sans importance réelle, dans laquelle l’horizon vrai se mire parfois et trouve une image réconfortante de l’avenir, elle est alors comme l’au-delà réduit de l’horizon vrai nettoyé des scories de l’histoire.
Jean Prod’hom
A quoi bon reprendre le train en marche

à Juliette Zara (Enfantissages)
Se méfier comme de la peste du défilé ordonné de ce qui est à faire et lever la tête. Tant qu’à faire regarder la lune, le train qui passe, les enfants qui jouent, applaudir les fourmis qui ne lâchent rien. Sais-tu que les mêmes nuages reviennent ? Remets à plus tard la tâche pour laquelle le premier venu fera l’affaire et rejoins un instant la réalité suspendue comme un beau jardin. Les gens vont, affairés ou désoeuvrés. Ce soir je ne mettrai rien en avant, personne ne sait demain, supposer l’inverse encanaille nos vies.
J’assure l’immobilité, celle des idiots de la terre ou des pierrots de la lune, je ralentis les rotations et console des vertiges. Rien n’est fait sur terre pour ceux qui n’y sont pour rien.
Jean Prod’hom
Noir et blanc

Une ombre sautille ce matin dans les gravats, entre pré et bitume, avec une bergeronnette attachée à ses basques. Je revois la mariée au loup d’encre sous le soleil de midi, pas troublée le moins du monde par son reflet dans la flaque, enchaînant les génuflexions pour se désaltérer. Plus tard un leurre lancé par un milan noir tissera sa toile dans le trèfle; ne manqueront au crépuscule ni les corneilles ni la pie du pin.
Jean Prod’hom
Se séparer

Assise à l’arrière, elle me confie en rentrant de sa semaine à Orges que loin de nous ça n’a pas toujours été facile, avec cette tristesse qui revenait, surtout le mercredi lorsqu’elle nous a téléphoné. Et le soir.
- Le soir surtout, lorsque la nuit tombait, juste avant de m’endormir. Alors je pleurais, mais je ne pleurais pas comme les autres, je pleurais en silence. Tout au fond de mon sac de couchage, en cachette.
- Moi aussi, sais-tu, rien que d’y penser, à t’entendre à l’instant, ça me fait pleurer. T’imaginer là-bas dans la nuit, étendue sur un lit de paille, avec des inconnues pour voisines. Te savoir seule, pour la première fois loin de nous, huit ans seulement, à peine huit ans et condamnée à grandir, toi si...
- Papa, j’ai jamais mis mes pantoufles.
Jean Prod’hom
Dimanche 1 août 2010

C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de prédire selon les formes consacrées le retour des beaux jours au commencement du mois d’août. Mais la pluie a tout bousculé et rien ne parle plus à l’âme attendrie. La fête nationale hoquette dans le bois noir et les discours s’enlisent dans les vains bruits de la plaine. La liberté est un rêve, importun souvenir, les droits des hommes vaincus. Lorsque les deux jumelles rappellent le serment, personne ne les écoute et la foudre éclate avec bruit, le pasteur a quitté les lieux depuis longtemps sous prétexte d’officier dans le village d’en-bas.
Que des gens bien, de bonne volonté, décidés à défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, mais dépassés par la malice du temps, par des histoires commencées il y a bien longtemps. avec des espoirs à la peine, si bien qu’ils sortent de la route à tout bout de champ. Ce soir pourtant on ne ménagera ni nos vies ni nos biens, mais on le fera aux frais du voisin en dépit des serments pris en toute bonne foi. Levons notre verre, c’est le geste consacré, loyauté envers nos employeurs, honneur à ceux qui ont osé payer leur charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix. La suite, vous voulez la suite, vous n’en saurez rien, plus personne n’écoute les deux enfants chargées de lire le pacte, elles disparaissent derrière la tribune au fond de la boîte à musique. Tout le monde se tait une nouvelle fois, la fanfare fait le reste avec le canon et l’écho de nos montagnes.
A l’ouest les deux Toitoi portatifs pour plus de confort, plus de fonctionnalité boudent, on se serre les coudes à la lisière du bois, les artificiers interdits de séjour se regardent par-dessus la bossette pleine à craquer pour écraser le feu qui rayonne.
Jean Prod’hom
Désencombrement du jour

Je voudrais avoir payé mon dû avant même d’entrer dans le jour, pour entreprendre librement et sans vaine espérance cette traversée à laquelle je suis convié quotidiennement. Je voudrais inverser les habitudes : un mot bref en guise d’écot, – une prière ? – pour affamer d’emblée mes attentes et me livrer libre et bienveillant, mains nues et sans idées derrière la tête, à l’enchaînement de mes tâches quotidiennes. Je voudrais ne pas avoir à traiter avec l’espérance, telle qu’elle se donne lorsque la nuit tombe pour racheter autant que faire se peut l’immanquable déception à laquelle nos vies nous conduisent à la fin. Je voudrais avoir régler le sort de mes journées avant même de les avoir commencées pour en disposer comme de quelque chose qui n’a pas de nom et qui ne figurera dans aucun bilan, un espace sans enjeu au sein duquel je n’aurais qu’à prêter mon oreille, offrir ma main, répondre aux voeux. Je voudrais recommencer ainsi chaque matin de telle manière que mes jours ne comptent pour rien. Je voudrais au fond avoir chaque jour un jour d’avance, pour disposer d’un jour sur lequel je n’avais pas compté, au-delà du temps, un jour imprévu et que je traverserais sans arrière-pensée, en lisière du temps, comme l’envers d’un revenant.
Jean Prod’hom
Juste rapport au temps

Une propension maladive à surévaluer la quantité d’énergie et de temps nécessaires à l’accomplissement des quelques tâches qui assurent la consistance des groupes dans le champ social, la survie des uns et des autres et auxquelles on ne saurait échapper que par lâcheté.
Mais voilà qu’aujourd’hui, frappé – encore? – par le sort, j’éprouve la sensation à bientôt minuit d’avoir accompli des travaux herculéens. Tout simplement parce que ce nouvel imprévu ne m’a pas laissé le temps de trop anticiper, m’a obligé de faire vite et juste avec le temps, de répondre à ras de terre et de me rapprocher pas à pas des gestes qui caractérisent la condition qui est la nôtre, avec pour voisin l’effondrement qui guette et à deux pas la peur qui paralyse le corps jusqu’au petit doigt.
Même qu’il me reste quelques minutes pour écrire ces mots avant minuit, tandis que les enfants dorment, que le tambour de machine à laver le linge turbine et que ma femme épuisée se rétablit en de bonnes mains.
Jean Prod’hom
Ce que les pierres retiennent

Amené à rompre avec la supposée continuité du temps au risque de succomber à un vertige, non plus celui du temps qui fuit, mais celui du temps qui est resté bloqué là-bas.
Si les images, les photographies, les souvenirs vieillissent, c'est parce que, incapables de retenir ce qui demeure, ils laissent filer le temps qui seul compte. On le voit dans les corps passés, on le voit aux visages, aux mains trop lourdes, aux jambes trop cassantes sous le poids des souvenirs qui se défont. Le gros du temps reste en arrière, par-delà les images qui ne retiennent que des ombres.
Rien n'a changé, on voit simplement les choses d'un autre lieu. Mais il aura fallu pour l’atteindre nous extirper de la glaise dont on est fait, faire ce pas de côté, et réaliser quelques voyages de circumnavigation pour retrouver les choses telles qu’elles sont, ce miracle en tiers qui nous est offert lorsqu’on revient bien après. Nous éloigner donc, nous égarer même, souvent, pour considérer enfin les choses en leur lieu, c’est-à-dire de ce lieu que l'on n'a jamais tout à fait quitté, aperçu pourtant comme un phare oublié qui nous fait supporter de manquer ce pourquoi on avait appareillé, sans regret, mais dont il faut bien s’approcher pour être enfin un peu avant de n’être plus.
Jean Prod’hom
Dimanche 6 juin 2010

On s’y trouve engagé à demi, sans qu’on le veuille vraiment, couché et immobile alors que le soleil s’est levé depuis longtemps, mais on renonce à prendre les devants. Dehors la rumeur prend de la consistance, avec par-dessus bientôt du cristal, les moineaux, un rouge-queue, les rires des enfants qui préparent la table du déjeuner, des éblouissements. Tiens, le vent a tourné, pas de cloche ce matin, pas de chant non plus : le coq s’est tu. Le renard qui l’a croqué la veille rodait depuis quelques jours dans le pré fauché, chassant le mulot mais visant du meilleur; il attendait que le blé ait levé assez haut pour vider le poulailler. C’est fait, pas besoin ce soir d’attendre la nuit avant d’aller me coucher.
En retrait donc, retenu d’aller droit devant au plein. Pris à parti pourtant trois fois, par les pleurs d’un enfant, le claquement d’un volet libéré de son arrêt, et le souvenir ce soir d’un vieil homme aperçu la veille dans un café de Lausanne, dégingandé mais d’une belle élégance. J’ai cru le reconnaîte. La foule souffrait au soleil, il était à l’ombre avec une vieille femme à laquelle il souriait. Il semblait venir de très loin et était sur le point d’y retourner. Comme s’il était venu faire un saut parmi les hommes, rassasié mais gourmand encore, lorsque le soleil brûle et qu’un courant d’air traverse de la cour au jardin. Cet homme presque aveugle, rencontré un jour dans une bibliothèque, n’avait pas vieilli.
Et tandis que je suis encore loin de l’autre bout de la journée, je songe au chemin qui me permettra de rejoindre au plus court ce qui est resté en arrière ce matin, l’autre moitié. J’y songe avec un sentiment de plénitude, celle d’avoir traversé sans peine un pays arasé, sur un tapis volant au-dessus d’une belle journée à laquelle je n’aurai pas touché, une de ces journées qui en définitive ne comptent pas, d’autant plus étranges et merveilleuses qu’il n’en reste rien, d’un seul tenant, sans relief, accrochées à deux demi-rêves.
Jean Prod’hom
Dimanche 23 mai 2010

Le frelon s’agite en tous sens, mais il suffit de lever une paupière pour se rendre compte qu’il ne réfléchit pas beaucoup. Visiblement il attend un coup de main, on ouvre tout grand la fenêtre, trop difficile encore, il faudra patienter une bonne demi-heure avant qu’il ne trouve enfin la sortie, il vrombit alors une dernière fois et disparaît en creusant un boyau ouaté dans lequel les pépiements des moineaux profitent de s’engouffrer, en sens inverse, jusqu’à nous. A l’arrière se détachent, lointains, déteints, les neufs coups du battant de la cloche de l’église qui teinte dans le désert. Et puis, venu de plus loin encore, le silence qui rejoint le soleil sous le toit, il adoucit et rafraîchit le drap dans lequel on se vautre comme des rois.
Elle l’observait sûrement depuis un moment; il y a dans les yeux de quelqu’un qui a eu le temps de vous examiner toute une image de vous, retirée, hors de portée, et pourtant bien présente.
Henri Thomas, John Perkins, Gallimard, 1960
![]()
Derrière la maison la bise fait onduler la prairie, lourde et grasse, nourrie au grain. Les années du marais de la Montagne du Château sont comptées, la terre a gagné la partie. Demeure pourtant tout à l’est une large étendue d’eau secrète où vivent et dorment trois colverts. Les petites habitudes auraient-elles laissé la place à l’habitude tout court?
Jean Prod’hom
Dimanche 16 mai 2010

Ce matin le soleil a jeté un paquet de lumière par l’étroit châssis à tabatière des combles dont il a fait fuir, le temps d’un éclair, l’obscurité crue. Puis plus rien. Je veux pourtant, idiot que je suis, me souvenir un peu de cet éclair pour le maintenir brûlant, faire flamber la vieille charpente et éclairer notre dimanche.
Nous sommes à la mi-mai, dehors le jaune du colza et celui orangé des pissenlits étoilent le vert des prés lourds. Le printemps n’a pas tenu ses promesses et ne laisse filer entre ses doigts que des couleurs passées, un peu de rose. celui du liseron au bord du chemin et les fleurs détrempées des Boscop dans le verger du Chauderonnet, les hautes herbes pâles près des haies, les nuages sans forme qui ne désemplissent pas le ciel. A quoi bon s’apitoyer, on patiente en haut de la Mussily main dans la main.
Plus tard dans l’après-midi une flambée de soleil réveillera les abeilles sur le qui vive depuis le début de la semaine, quelques promeneurs souriants et les cris des enfants auront raison de notre humeur. Mais dans le poêle le feu veillera jusqu’au soir.
Jean Prod’hom
Dimanche 25 avril 2010

Au fond, qui ne souhaiterait pas mener la vie d’une locomotive, une belle locomotive au museau froid et rond; filer tête baissée sous le soleil ou dans les éclairs, siffler, souffler, puis aller au pas dans la campagne déserte, parmi le colza ou le blé, recevoir des soins en fin de semaine dans un hangar aux allures de cathédrale, sommeiller les yeux grand ouverts dans un réduit de province ou une immense gare de triage; et pour terminer, disposer d’une retraite utile chez un ferrailleur, ou insensée au bout d’une voie de chemin de fer abandonnée, les pieds dans les herbes hautes, près d’un bois, enlacée par le lierre, loin des regards indiscrets.
Jean Prod’hom
Journée sans

Que dire de ces journées que l'on pousse devant soi avec ceux de son espèce dedans et qui s’achèvent enfin lorsque la grille de l’atelier grince? Rien sinon qu’on est soulagé. On ne dispose pourtant d’aucune poignée d'épluchures à lancer dans la basse-cour, pas même des cris d'un fou qui ricocheraient contre les fûts des bois noirs.
Les nuages de basse altitude déguerpissent. Ceux du haut s’embrasent et les sapins de la crête du bois Vuacoz plient.
Tout au long de la nuit un petit homme famélique surveille l'entrée d’une cathédrale. Il va vomir continûment au pied d'un lampadaire pisseux dressé au centre d'un carrefour désert. Un peu plus loin, deux grosses femmes au dos nu tatoué grimacent à l'entrée d'un bâtiment en ruine, elles fument pour combattre le froid de l'hiver qui a rongé le peu de volonté qui leur reste, elles grimacent, elles ricanent, elles racontent à tour de rôle la même sale histoire. Dans la cour au bitume fissuré, des enfants amaigris, orphelins – cela se voit – crient. Quelques-uns essaient, sans succès, de s'arracher des griffes d’une bête immonde qui ronge leurs mains. D'autres – adolescents plutôt – dansent autour d'un monument aux morts en béton décrépi, ils se passent un objet incandescent qui fait saigner leurs mains et leur arrache la peau. Tout ce joli monde finit par me regarder en souriant.
Jean Prod’hom
Fin de partie

Il suffit parfois de se laisser glisser à l'arrière du cortège et de s'accrocher confiant à sa traîne tandis que la nuit tombe, aller comme un automate en prêtant une oreille étonnée mais bienveillante aux cris de ceux qui en veulent, lèvent le poing, de ceux qui allongent le pas devant. Oublier ainsi un instant les lourdeurs qui collent aux basques et les doutes qui alourdissent les pas. Tourner le dos au choses qui avancent et qui ne vous attendent pas, secoué - bercé - par les cahots de la terre qui a lancé son second demi-tour. Temporiser en songeant, à peine, au tas de mauvaises herbes et aux pétales des roses fanées qui reculent dans la nuit du jardin, aux oiseaux tapis dans les haies, au renard qui erre, aux chatons emmêlés dans la corbeille à linge. Temporiser à la queue du cortège jusqu'à ce que le sommeil vous ravisse et laboure tour ça.
Le matin, les yeux s'ouvrent sur les montagnes à l'orient, tout est rincé et on ne se souvient de rien. On aura beau chercher à s'en rappeler, à vouloir en fixer les étapes, histoire d'en tirer une leçon pour le lendemain. Rien. Rien n'en ressortira lorsque dans deux saisons l'analogue se présentera à nouveau, il ne servira à rien de vouloir se souvenir – de quoi? –, aucune expérience n'y fait, il faudra à nouveau se glisser à la traîne du jour qui file à l'ouest et cet abandon suffira peut-être encore.
Jean Prod’hom
Dimanche 11 avril 2010

Un bout de haie maigre sous le soleil en haut du talus qui borde la route des Chênes, à deux pas de Vers Chez les Porchet: quelques fines tiges de noisetiers sous des frênes, et des ronces, un bouleau aussi, décapité et manchot. Je m'agite, n'ai-je pas d'autres choses à faire? des choses plus sérieuses? La raison pique du nez, je fais demi-tour et grimpe sur le talus. Avec une légère appréhension, faudra-t-il attendre encore?
Je tâte la terre et m'y assieds pour la première fois cette année, j'aperçois de plus près les jeunes ronces que se partagent équitablement les bourgeons neufs et les piquants acérés. Le dispositif est sommaire mais il me protège de la bise. Nulle traîtrise, la terre est sèche, meuble, chaude, des promesses et du bonheur. Tout autour le lierre résistant, vert, luisant, et les reliefs de l'année dernière dont la neige, le froid et la pluie ne sont pas venus à bout: les brindilles se cassent comme des allumettes, les feuilles mortes s'émiettent comme du tabac. Trop de soleil pour accueillir les crocus, les pervenches ou les anémones, la haie est grise.
Je tâte la terre et m'y couche pour la première fois cette année, j'aperçois en haut les branches innombrables d'un chandelier, c'est un long frêne qui ondule sous la bise, mèches encore éteintes. J'entends à côté de moi un froissement ténu, c'est une coccinelle à la tâche, elle a bien six ans d'âge, mais on n'est décidément pas aux mêmes dimensions, j'ai beau m'approcher, lui prêter mon assistance pour franchir les innombrables obstacles, elle m'ignore. Impossible de la comprendre, sa paire de lunettes jaunes semblent lui suffire dans l'obscurité. Je m'acharne, continue mes observations idiotes, elle s'obstine elle aussi avant de s'envoler.
Je somnole, est-il bien raisonnable de rester là couché à ne rien faire? continuer? mais continuer quoi et m'en aller où? Me voici soudain ramené au rang de la bestiole: que faire dans cette obscurité qui semble me satisfaire et dans laquelle je m'endors? Et qui est prêt à me donner un coup de main?
Sans savoir comment, me voilà debout, le long du pré qui descend jusqu'au bois. Je cherche sans y croire les deux ou trois morilles que j'ai vues il y a quelques jours dans les mains du Grignanais près du Lez. Mais n'y crois pas, pas la tête à ça, mais la tête à quoi, la tête à rien. Je continue ma promenade, il n'y a bientôt plus rien, du gui qui colonise les vergers et moi en trop. Et soudain, sans savoir exactement comment ni pourquoi, je rejoins la coccinelle qui avait pris une grosse avance sur moi, je m'envole, pour rien, là-bas, sur les hauts de Mézières et de Ferlens.
Jean Prod’hom
Dimanche 14 mars 2010

On se penche vers ce qui s’entrouvre, on devine, ça tire et ça pousse par en dessous. Avec le soleil qui descend, pour la première fois, tout droit depuis en haut, oui c’est sûr, la besogne sera vite terminée.
La terre – mais est-ce bien le nom qui lui convient en mars? – bombe le ventre et creuse les reins; elle efface les derniers signes de l’hiver que plus personne ne tente de déchiffrer, le grand texte blanc est troué de toutes parts, demeurent quelques grands caractères aux allures de gingembres fantomatiques qui se recroquevillent imperceptiblement, avant de gesticuler comme ces bâtons de guimauve lorsqu’on les approche des flammes : ils moussent et bavent, c’est la débandade.
On aimerait déjà s’asseoir, appuyer le dos contre les mousses et rêver, mais tout est détrempé; sur le chemin, le trop plein d’eau goutte dans de petites vasières que le vent remue; lorsqu’on aura le dos tourné, les moineaux et le merle qui guettent un peu plus loin viendront à tour de rôle y frotter le bec.
Le langage lui aussi monte par en dessous, il vient au bord des lèvres, on voudrait tout dire, vite, trop vite dits, taisez-vous mots mous, laissez la petite débâcle terminer son ouvrage.
Je vais, ma tête s’enfonce dans la terre meuble, un peu d’immobile tout autour, j’y crois dur comme fer, c’est sûr, on a passé bonne espérance. C’était lundi après-midi du côté des Censières, du côté du Bois Vuacoz, à la Mussilly, partout, il n’y avait personne, on n’en parlait pas, ça avait lieu, débâcle aux couleurs pâles, sous le bleu coupant du ciel conquérant.
Jean Prod’hom
La vieille de Pra Massin

L’affaiblissement de ses forces et la perspective de la mort effrayaient moins la vieille depuis qu’elle se rendait avec son chien à Pra Massin sur les hauteurs du village, chaque jour ou presque. Elle s’asseyait sur le banc que la commune avait mis à la disposition des promeneurs et elle se taisait, laissant son regard chercher, puis lentement se fixer sur l’un des villages attachés au flanc des collines qui longent la rive droite de la Broye.
On racontait qu’elle y avait laissé autrefois un amour, auquel elle s’était mise à repenser depuis la mort du père de ses enfants et du mépris que ceux-ci affichaient à son égard. Ce n’était qu’une rumeur sans fondement colportée par ceux qui ont renoncé à comprendre quoi que ce soit du mystère dont nous sommes les hôtes.
En réalité la vieille venait s’asseoir pour s’attendrir et accepter enfin ce qui lui avait été octroyé. Elle disait à qui voulait l’entendre, d’une voix blanche, ferme pourtant, que le paysage là-bas ne se dérobait pas, malgré la danse des saisons, la neige, les coupes dans les bois, les feux d’automne, le brouillard empoisonné. Elle fixait, disait-elle, un point du paysage, toujours le même, en contrebas de l’un des villages, un vallon vers lequel elle sentait converger de proche en proche la terre entière et tous ses habitants comme au milieu d’une grande respiration. Elle ajoutait que ce lieu lui semblait en même temps répandre son secret dans toutes les directions, sans perdre jamais cette singulière étrangeté pour laquelle elle venait à Pra Massin. Elle disait en souriant qu’elle se sentait un peu plus prêt de l’éternité.
Lorsque je regarde aujourd’hui les villages et les clairières sommeillant au dessus de la Broye que survole et caresse son âme libre, je songe aux dernières années de sa vie suspendues à la petite éternité que durait sa halte à Pra Massin et je l’envie.
Jean Prod’hom
En plus, comme n’importe quoi

- Tout de même tu penses à ton avenir ?
- Il n’y a pas d’avenir, tranchait Georges.
Pas d’avenir ? Qu’est-ce que cela signifiait ? Alors ça serait toujours pareil avec rien au bout.
- Jamais pareil, disait Georges. C’est pour ça qu’il n’y a pas d’avenir.
...
- ... Mais j’ai peur que ma vie soit en morceaux. Pas toi ?
- En morceaux si tu veux, dit Georges. Mais tu peux faire encore des morceaux avec des morceaux.
- Ça n’aboutit à rien.
- A rien. C’est pourquoi ça ne finit jamais, jamais.
André Dhôtel
![]()
Il y a le lierre au mur de la bergerie, le château trop étroit, le ciel si haut qu’il ne pèse plus sur rien. Il y a le silence dans le préau, des enfants dans la classe, il y a les tronçonneuses au fond des bois et Jean-Jacques qui y va.
Et toi tu avances d’un pas régulier sans te presser, sans vouloir non plus retenir quoi que ce soit, parfois tu baisses la tête parce que tu crois que ça pourrait te mener quelque part d’avoir l’esprit qui se retourne à l’intérieur, et tu y vas un bout, il y aurait de quoi faire mais faudrait d’abord trier. Tu entends soudain un oiseau, tu l’écoutes, c’est le premier que tu écoutes depuis longtemps, il s’est enfoncé dans la haie et t’a ramené à l’air libre, tu es seul mais tu ris parce que tu n’y crois pas tout à fait. Et tu te rappelles ce qu’une dame a écrit la veille dans son journal, cet oiseau c’était le premier qu’elle écoutait depuis trop longtemps. Etait-ce la même mésange ? La même que celle que tu as écoutée lundi en redescendant de Pra Massin ? T’en souviens-tu ? Et les corneilles tout à l’heure ? Tu les as oubliées n’est-ce pas ? Faudra apprendre à les aimer.
Il y a la ferme en ruines des Chênes, les carreaux cassés, du silence encore, il y a un avion dans le ciel, il y a une pomme dans ta poche et tu la tiens pour que vous soyez deux, il y a le bitume noir, des vapeurs sur l’horizon, un banc, un vieux biscuit dans l’autre poche. Tu ne cherches rien, à quoi bon, les choses passent toujours avec toi, ne t’inquiète pas, avec moi aussi il n’en reste rien. Et puis de toutes façons tout ça mis bout à bout est-ce que ça fait une vie ? Ça fait tout au plus une promenade, et les promenades où est-ce que ça mène ?
Peut-être qu’il faudrait qu’on mette tout ça ensemble toi et moi. Mais c’est pas si simple parce qu’en vrai rien ne va avec rien; tandis que les choses coexistent et les événements se succèdent sans nécessité, toi tu sautes du coq à l’âne. C’est ce disparate que j’aimerais nouer sans brin, ces mots s’ajouteraient aux mots et aux choses, aux souvenirs, au château, au lierre et à l’imprévisible. Tout ça n’est écrit nulle part, subordonné à rien, c’est en plus. Toi tu es en plus, moi je suis en plus comme n’importe quoi. Et à la fin il n’y aurait pas de fin, tu verrais sur le sable lisse l’ombre d’une vague qui s’est retirée, sur la neige l’empreinte d’un oiseau qui s’est envolé.
Jean Prod’hom
Dégel

La douceur de la veille et le soleil de l’après-midi ont transformé le ruisseau porté disparu depuis quelques jours en un filet d’encre noire que la neige n’a pas réussi à effacer. Hier il a dessiné la première lézarde, l’a élargie ce matin. Il retrouve son lit d’avant les nuits blanches et coule désormais la tête hors de l’eau.
Il grignote sur les deux berges la part de neige qui le fait grossir. C’est sûr il écrira ce soir dans son lit sombre quelques belles promesses. Pourtant le ruisseau ne chante pas, c’est pour plus tard, il médite plutôt, tout à son offensive souterraine, il ne prend aucun risque, le bois il connaît, il emprunte le trajet qui a toujours été le sien, il contourne sans ruse les fûts sombres avant de disparaître dans le creux en-dessous des nouvelles plantations.
L’abondance du duvet tout autour ne résiste pas, le manteau pied de poule fait voir sa doublure mitée, détrempée, les brindilles et les feuilles mortes en creusant d’innombrables cupules donnent un coup de main aux grands travaux du renouveau. Tout est noir tout est blanc au bois Vuacoz.
Dans quelques semaines le sol s’amollira, on se couchera dans la mousse et les traits d’encre s’éclairciront, rubans d’argent liquide sur lesquels flotteront les morceaux du ciel suspendu, avec dedans les nuages qui passent.
Jean Prod’hom
Dimanche 3 janvier 2010

On comptait parmi ceux que les dieux avait placés au fin fond de l’un des sept bouts du monde pour garder un oeil sur ce que l’histoire laissait de côté. On habitait le Riau, la maison blanche sur le chemin qui mène au refuge de Ropraz, vous verrez c’est pas compliqué, une maison blanche aux volets verts sur les hauts de Corcelles, à peine un hameau une vingtaine d’habitants.
Tout autour des prairies humides, des flaques, des moilles, des haies. Derrière la Mussilly le bois Vuacoz, plus loin le bois Faucan. Avec nous des chats, le blaireau, des mésanges, des renards, des corneilles, quelques lièvres, des chevreuils, un ou deux chiens, des vaches du Simmental, les taupes et la neige l’hiver.

On y accédait par la Moille Cherry, il fallait bifurquer à droite après le cimetière du village, passer à côté du château puis de l’ancienne école, prendre à gauche du tilleul en direction du refuge de Ropraz et vous étiez chez nous. Ou alors par le plateau de Sainte-Catherine, laisser à gauche l’escargotière, le village des Italiens et la Moille Baudin, la Moille Cucuz, puis à gauche du tilleul. Et vous y étiez à nouveau.
- Et si vous ne trouvez pas demandez!
On ne s’aveuglait pas sur la marche du siècle, mais cette fois la messe est dite, il faut déménager. Les autorités communales nous ont envoyé une vraie lettre dans le style vrai des administrations.
Madame et Monsieur,
Suite à l’attribution de noms de rues et numéros de bâtiments de notre commune, nous avons l’avantage de vous communiquer, ci-après, votre nouvelle adresse officielle:
Chemin de la Moille Messelly 3A
Ce changement d’adresse est considéré au même titre qu’un déménagement.
L’histoire nous a rejoints, il faudra aller plus profondément encore dans les bois.
Jean Prod’hom
Douze sentinelles

La bataille fait rage au couchant tandis que la lune monte avant l’heure au-dessus de Teysachaux. Le ciel se colore d'un rose pâle, violet, ou mauve de cendre, avec en contrepoint les pleurs d’un enfant, je ne sais plus le nom des couleurs, je ne sais plus quoi faire. L’enfant se relève et va confier à sa mère les fantômes qui habitent sa chambre, il remonte avec une frontale, les paysans terminent de labourer le champ, on se retourne et on s'installe à deux pas de la nuit. Un homme n’a plus de bras, quarante-neuf médecins sont à son chevet, je lis. On entend quelques feux d'artifice du côté de Mézières, plus de surveillance, les arbres lèvent la tête, on aperçoit une coulée d'or. J'entre dans les bois par le chemin du Chauderonnet jusqu'à l'étang et reviens par le refuge de Corcelles. Près du réservoir du bois Vuacoz deux chevreuils sautent dans ma direction. Le premier s'arrête, puis plonge dans la combe. Le ciel laisse apparaître d’immenses plages de nuit sur ma tête. Je vais fermer aux poules, le ciel encore et sous lui le jardin noir.

Jean Prod’hom
Le jour le plus court

à Juliette Zara (Enfantissages)
Lili s’est réveillée bien après le lever du jour, elle est assise sur l’édredon et on devine derrière les rideaux le soleil qui est revenu. Elle se saisit d’une petite valise reçue la veille, Secrets de Magicien, qu’elle a placée vers minuit à la tête de son lit, on n’est jamais assez prudent. C’est à ce moment seulement qu’elle ouvre les yeux, puis la valise dont elle vérifie avec soin le contenu, non, rien n’a disparu pendant la nuit.
Elle lance alors au ciel quelques mots secrets, les mots d’une autre langue et tout s’enchaîne comme dans un rêve, elle fait disparaître les doigts de sa main gauche, puis ceux de sa main droite, et tout son corps disparaît sous l’édredon. Demeure une tête d’ange sur un coussin multicolore. Lili dort au milieu d’un jeu de cartes truquées, ses paupières de porcelaine tournées vers une paire de huit et un valet de coeur.
Jean Prod’hom
Enfantissages

Louise n’est pas rassurée, moi non plus: malgré les flonflons, les chants et les luminaires, tout concourt à la faire douter du Père Noël. Qu’il existe soit, mais sur quel mode? Elle est sur le point de trancher le noeud. Quelques promesses pourtant l’encouragent à ne pas engager trop tôt la rupture. Elle s’interroge, comment quitter le bateau la tête haute? le doute l’assaille. Elle demeure silencieuse un long moment au bout de la table, prostrée, elle semble étudier dans le désordre les possibilités qui s’offrent à elle, elle semble vouloir sauver le Réveillon encore une année. Mais les marges sont étroites et le temps presse. Elle relève enfin la tête, sa décision est prise.
- Je mettrai mes chaussettes devant la cheminée.
Pendant ce temps Arthur lit près du poêle un roman qu’Yves lui a offert pour Noël. Je lui demande.
- Ça te plaît?
- Trop bien ce livre ! C’est l’histoire d’un garçon. Un peu plus âgé que moi. Très peu de temps après sa naissance, son père et sa mère meurent dans un accident d’avion...
J’ai compris, je vous donne les coordonnées de ce roman de formation, il plaira sûrement aussi à vos enfants: Anthony Horowitz, Alex Rider, tome 1: Stormbreaker (Poche)
Jean Prod’hom
Procession

lI le projette avec force par-dessus le chemin, par-dessus les aulnes et la viorne, dans les herbes qui bordent la rivière. Il jette un coup d’oeil à gauche puis à droite avant de se faufiler, son corps le suit. Où est tombé le galet? Et l’enfant dans l’herbe folle? Il cherche, s’empare du bel ovale qu’il glisse dans sa poche. Le galet fait le dos rond, il suit l’enfant qui lui serre la main.
Une voix de jadis, buissonnière, accompagne leur course capricieuse sur le dos des talus, le long du ruban liquide qui se déroule dans les mousses et les feuilles mortes. C’est une parabole sur la pente de laquelle l’esprit de l’enfant glisse de clos en clos. Sa main se desserre et le galet luit à nouveau.
Tous trois descendent au village dont on aperçoit le clocher, l’enfant, le galet et la rivière, c’est une foule qui s’en va, sans détour, qui grossit loin de toute demeure et qui sourit gorgée de promesses. Le temps s’enroule autour du petit groupe avant de rouler dans la plaine. Leur insouciance les met à l’abri du pathétique.
Ils n’interrompent pas leur course, filent, rameutent les riverains et vont rejoindre les pluviers et les barges à queue noire du delta.
Resté en arrière, près de la retenue, le silence fait miroiter dans le ciel le souvenir des forces qui vont, les nuages qui viennent.
Jean Prod’hom
Dimanche 6 décembre 2009

Insipide la pluie crépite sur le toit des maisons; ne surnage dans la boue des bas-côtés de la route aucun des souvenirs que la terre a bus avec les derniers tas de la première neige. Sans goût les hommes laissent des traînées, comme sur un tableau noir mal lavé que la chaleur du poêle n’arriverait pas à sécher, ils font les essuie-glace sans rien vouloir savoir du jour.
On ne voit rien dans cette nuit, on a beau fermer les yeux, rien. Pas même le coeur d’un arbre foudroyé qui flamboierait, quelques coings luisants près d’une fontaine, une grappe de raisin dans la pénombre, les ruchers de la terre.
Pourtant qui tend l’oreille entendrait, tout là-haut sur le plancher d’un coin des combles, un enfant assis en tailleur qui chantonne en nommant son frère et sa soeur. Ils surgissent d’entre les pages d’un album de photographies que l’enfant tient comme un accordéon.
Jean Prod’hom
Dimanche 15 novembre 2009

Elle dépose avec gourmandise dans le creux de sa main de minuscules fraises des bois qui ne peuvent plus attendre, mûres, fermes, tendres qu’elle entasse avec un soin prudent, plusieurs dizaines, hésite à rompre le délicat équilibre, en rajoute une, deux, trois avant de jeter la tête en arrière et de les engloutir d’une seule fois. Elles ne disparaissent pas mais enflent ses joues qui rosissent, ses paupières se ferment sous le poids de la gourmandise, c’est le plaisir qui se répand, enfle de l’intérieur, persévère un instant.
Puis elle se remet à la tâche, une à une pour une seconde poignée.
Dans le creux de la main le mariage du vice et de la vertu, de la prudence et de la gourmandise.
Jean Prod’hom
Dimanche 8 novembre 2009

Dehors presque rien, ça siffle, ça souffle et la terre fait le dos rond. Les labours expirent comme de vieux volcans. C’est que le réel hésite ce matin, étouffé par l’air humide qui pèse sur ses reins découverts, il est sur le point de renoncer.
Silence dans le poulailler. Pas de lumière, des ombres, des restes de rêves qui rampent, un volet qui grince, des chimères dans les ornières, à peine quelques fantômes et quelques réverbères, vieilles boules fades sur de vieilles échasses, les pieds dans la boue, qui crachotent un orange de rouille sans goût. Ils ne réclament plus rien depuis longtemps.
A 7 heures 40 un fonctionnaire commande leur extinction dans l’un des sous-sols de la ville déchirés par la lumière des néons. Le jour frémit à ce pâle éclair puis remet la tête entre ses épaules. On ne le reverra pas d’ici demain.
Jean Prod’hom
Dimanche 25 octobre 2009

Je veux avant de m’endormir me saisir de l’un ou de l’autre des innombrables bris égarés du passé que la marée du jour a poussé jusqu’ici, en faire un feu aussi vif que bref en éclairant du bout des lèvres l’un ou l’autre des secrets dont il est l’inconscient messager – bientôt je l’espère avec la même désinvolture que l’ivraie lorsqu’elle écrit en coup de vent dans le ciel ce qui n’est plus.
Les braises tiédissent vite, la nuit s’installe, je me retourne, prends un livre, épais, au feu persistant. Sur le Jadis. Petit Carême. Petit traité. Vie éphémère. Mais c’est encore la nuit tout autour. Je l’éteins et m’endors.
Jean Prod’hom
XLII

Assis sur le banc de la Mussily d’où j’observe depuis une dizaine de minutes la patience d’un chat blanc qui braconne à la lisière du bois, j'entends le bruit lointain d’un moteur. Le chat a levé la tête tandis qu’un homme sort d’un 4x4, c’est Jean-Rémy qui rentre du travail, il ne m’a pas vu. Il appelle l'animal qui a repris son affût, une fois, deux fois, d’une voix mielleuse et aigre, presque bêlante, ce chat lui appartient.
– Minet, minet!
Rien n’y fait, l’animal a les yeux fixés sur une taupinière. Jean-Rémy lève alors le bras et fait le geste sans équivoque du dresseur de fauves à qui on ne la fait pas. Ça ne suffit pas, Jean-Rémy hurle, une fois, deux fois, sans succès, Jean-Rémy crache de dépit.
Sans comprendre, je me lève et m'éclipse discrètement. Le chat non plus ne comprend pas, mais lui il reste.
Jean Prod’hom
Dimanche 18 octobre 2009

Le corps frissonne lorsque l’acier raie la pierre, mais rien n’arrête un Deutz Fahr X730. La coutre fixée au sep tire un trait profond dans le pré, elle fixe la bande verte que le soc décolle par en dessous et que le versoir soulève, retourne et déverse sur le côté. Une fois, deux fois, dix fois, ligne à ligne, le pré avec ses indigestes lampées disparaît sans un bruit, sans la moindre résistance. Ondule une mer nouvelle qui s’étend, noire, tendre, grasse, que le soleil fait moutonner. Aucun nuage dans le ciel.
A 17 heures, le Deutz Fahr X730 vrombit une dernière fois et les trois cents chevaux virent au bout du champ. L’acier de la charrue jette un ultime éclat, le silence se cale entre les choses, dans le ciel, le long des sillons. Ça a pris l’après-midi. Le champ labouré ne bronche pas, il attend, se demande si tout cela est bien terminé. Puis on entend les cris des enfants.
Lorsque la herse aura passé demain on aura enterré l’été.
Jean Prod’hom
Dimanche 6 septembre 2009

La neige a fait son apparition il y a deux nuits sur la Becca d’Audon et l’épaule des Diablerets. C’est tôt, trop tôt pour peindre l’hiver, si tôt que j’en repousse l’idée – elle s’instillerait si je n’y prenais garde, et avec elle celle des feux qu’il faudra allumer avant l’aube, celle de la neige quand elle insiste et qu’elle ne nous lâche plus, celle de la bise qui décide de notre place et de notre rang – ou plutôt je n’en appelle que superficiellement au nom pour tenir l’idée à bonne distance comme une rengaine apprise enfant.
Je reprends la montée vers la Mussily la tête dans les talons. J’aperçois alors comme dans un éclair qui se prolongerait l’île de Sein, son nom d’abord, l’image mobile qui l’accompagne ensuite. Tous deux s’imposent et colonisent quelques secondes mon attention. Je ferme les yeux, les rouvre, je les convoque à nouveau, le mot et l’image ne me font pas défaut, d’autres mots et d’autres images qui se succèdent sans rivalité.
Pas exactement l’île de Sein, mais une suite – indéfinie – d’images de l’île issues d’une même matrice, des images orientées sans que je dispose pourtant d’une place fixe. C’est un autre qui officie et qui, pour répondre à mes souhaits, occupe les points géométriques d’un continuum d’où surgit l’île lointaine, vivante et réelle.
L’île de Sein, celle qu’on ne voit pas lorsqu’on y est, pas plus que lorsqu’on s’en approche depuis Audierne, île, île avec l’océan, bleu, violet et turquoise, lumineux et sombre, le grondement de l’écume, île toute proche et immobile, la lande près du phare, le môle, le quai, la côte à deux pas, les tessons, le tabac du port, le bateau qui fait la navette, le silence des nuits, l’Amérique et le ciel un peu plus haut. Je suis comme dans une bouffée d’idée qui répand ses bienfaits dans toutes les directions. L’idée concrète de l’île me remplit sans entamer les bienfaits du lieu où je suis, le chant des grillons et l’odeur de la sève.
Car je suis bel et bien ici, assis sur le banc de la Mussily, face à la Becca d’Audon et l’épaule des Diablerets. Aller demain à Sein? J’ai pu le croire autrefois, du temps des déceptions, du temps des images qui fauchent les voeux. Je n’ai pas envie d’aller à Sein, d’être submergé par les sensations adventices, les bruits parasites, le voisinage qui oblige.
Mais je n’ai pas envie non plus d’être ici sans l’île de Sein.
Jean Prod’hom
Dimanche 23 août 2009

Les gouttelettes pendues aux oreilles du trèfle, alourdi par la pluie tombée sans discontinuer pendant la nuit, brillaient et prolongeaient l’esprit de fête des jours passés, les foins, les moissons. Mais la rouille qui avait fait son apparition à la lisière du bois sur les feuilles de la première rangée, là-bas au loin, trop loin pour qu’on soit en mesure d’identifier l’essence, annonçait qu’il fallait compter avec la roue des saisons. Peu de mouvement dans ce tableau vivant, sinon celui de quelques nuages attardés, joufflus et souriants, qui avançaient haut dans le ciel en direction de l’ouest pour rattraper le temps perdu. La façade blanche de la maison frappée par le soleil faisait songer aux lumières de l’hiver. Les volets sombres, les fenêtres et la porte fermées, son éloignement aussi lui donnaient l’air buté. Depuis longtemps déjà ni le train ni le bus ne traversait plus cet appendice du monde que seuls deux agriculteurs du village et un vieux gardaient en vie.
La porte s’entrouvrit et le vieux sortit de la maison blanche pour s’approcher d’un pas hésitant du potager clos d’un treillis sans âge, il n’y pénétra pas mais regarda longuement les chétifs légumes qui enfonçaient leur tête dans les épaules. (Les légumes désespèrent à une telle altitude lorsqu’ils sont sans soin.) Il se dirigea ensuite vers le cabanon de la lisière, qu’il regarda avec l’esprit ailleurs, comme un aveugle. Il revint dans le verger les bras dans le dos, il s’immobilisa, appuya sa canne contre un pommier des moissons, croisa les bras sur la poitrine. Il portait une vieille salopette bleu roi et une chemise vert moutarde, des rides matelassaient son visage, il semblait visiblement indifférent au tour que prenait son domaine. Il croqua dans une pomme qu’il abandonna aussitôt dans l’herbe. Il se rendit alors d’un pas hésitant au bout de l’allée, ne se servant qu’à peine de sa canne sur laquelle il s’appuya pourtant pour ouvrir la boîte aux lettres. Il se redressa, les mains vides, reprit sa lente marche en direction de la maison dans laquelle il disparut, sans même avoir jeté un seul coup d’oeil au ciel qui avait retrouvé des airs de printemps.
Jean Prod’hom
14

Au milieu du verger, entouré de tout jeunes arbres, un vieux pommier soutenu par des étais de fortune, chargé et fatigué comme une femme enceinte seule à midi sur la place publique.
Jean Prod’hom
Ce n'est pas l'heure de rentrer

Les émanations lourdes et enivrantes de la sève que dégagent les rondins de sapin couchés dans les épines croisent l'air bleu et l'humidité qui monte de la terre, elles font tourner la tête et mon visage se penche vers la brise. Les sots soucis qui me talonnaient en montant la Mussily s'évanouissent, je respire, m'allège, rien ne peut désormais m'arrêter.
Il faudrait pourtant que je me lève, une résolution idiote traîne dans les parages, issue d'un mauvais calcul, comme si le petit bonheur auquel j'étais parvenu et qui s'élargissait reviendrait plus vite encore si j'y renonçais à l'instant. La maison là-bas est pourtant vide, ce n'est pas l'heure de rentrer et je n'ai de compte à rendre à personne.
Je prolonge l'aventure en me vissant au banc de bois, remettant d'un coup tout à plus tard, tourne la tête, tâtonne à nouveau pour trouver le meilleur angle, me cale dans ce bain d'essence qui bout, m'enveloppe et me délivre de toute attente, tout est décanté, léger dedans et dehors.
Je souris en pensant à mes trois enfants si jeunes encore, le bonheur se mêle aux senteurs et à la tiédeur humide. J'imagine leurs yeux, leurs sourires, leurs pas sur le chemin qui monte jusqu'ici, les voici accompagnés de leur mère qui en tient deux par la main, ils se rapprochent, l'avenir dans la poche, sérieux, pressés, légers, tendres comme du trèfle.
Jean Prod’hom
Sous le jardin d'Eden

Il m'aura fallu plus de dix jours d'une lutte acharnée pour venir à bout de l'ennemi. Un grand-père avait livré autrefois de tels combats, plusieurs oncles aussi, plus près de moi quelques cousins: tous victorieux. C'était mon tour.
J'ai livré bataille du lundi 27 juillet au vendredi 7 août. L'ennemi ravageait le sous-sol du jardin, il levait chaque jour, de nuit comme de jour, trois ou quatre buttes de terre. On dit cette terre fertile, je ne voyais que l'ennemi. J'ai d'abord bataillé avec laideur, sans méthode, en tous sens et sans succès, usant de l'eau, du marteau et du monoxyde de carbone, poursuivi par les insomnies. L'ennemi était-il deux, cinq ou dix, je l'ignorais, mais je pressentais une légion. Pensez donc, plus de trente taupinières! Les ennemis allaient-ils s'attaquer aux fondations de la maison?
Décidé à frapper un grand coup, j'ai placé le jeudi 6 août, à la brune, huit pièges à taupes achetés le matin même, je les ai placés dans les galeries étroites de quatre taupinières fraîchement levées. Je les ai placés suivant les traditions héritées de mon grand-père maternel et de sa lignée qui revenaient à la surface, que de la bonne terre.
J'ai souhaité alors avec force que l'aveuglement réputé de mes ennemis, leur museau au boutoir rosé et cartilagineux, leurs pattes aux griffes puissantes les précipitent dans les pinces d'acier. Celles-ci se refermeraient sur leurs reins et ne les lâcheraient plus jusqu'à leur mort et à mon salut.
Le lendemain à l'aube, avant que le coq ne chante, j'ai jubilé en découvrant les responsables des ravages souterrains et de mes insomnies: une taupe, une seule taupe au doux pelage prise dans la guimbarde de la troisième galerie. J'ai failli hurler ma fierté, je me suis senti de la grande famille des hommes, digne héritier de ceux dont je suis le fils, l'égal de mes aïeux et modèle pour ceux qui viendront après moi si bien que j'ai annoncé urbi et orbi ma victoire sur l'ennemi invisible, à mes enfants d'abord, à ma femme ensuite, et à tous ceux que j'ai rencontrés depuis. Je le fais ici. Car on n'en a pas fini avec cet animal qui, à l'insu du serpent, fouissait déjà le jardin d'Eden.
Ma jeune ennemie qui aurait pu hanter plus de cinq ans encore le sous-sol de mon jardin repose aujourd'hui à l'étage supérieur du compost dans un lit cossu de mauvaises herbes. Je respire et je dors à nouveau beaucoup mieux. Je guette pourtant depuis trois jours, car je crains qu'il ne s'agit que d'une rémission. La partie n'est pas gagnée, je le sais, les taupes reviendront, mais je suis prêt et armé, j'enseignerai la tradition à mon fils.
La fierté ne m'a pas quitté depuis trois jours, l'âme et le corps reposés je descends ce matin en ville, là où le bitume a dispensé les citadins de poursuivre la guerre aux taupes, j'y descends pour commander aux éditions Le Temps qu'il fait l'ouvrage de Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier. Je suis prêt à en savoir plus sur cet animal qui ne voit rien dit-on, mais qui vit quoi qu'on en pense un peu comme nous, dans un réseau de voies de communication complexe, qui comprend des voies profondes, longues et larges, plus permanentes, et un réseau de voies temporaires, superficielles et commerçantes, ainsi que des voies dites de surface utilisées par les mâles à la recherche de femelles.
Jean Prod’hom
On remballe en silence

Le vieil apiculteur qu'on aperçoit depuis le banc de la Mussily se retourne et fait un signe imperceptible de la main. Il s'affaire autour de ses abeilles, c'est la fin, il n'en attend plus rien, il remballe. Jusqu'au printemps prochain le rouge, le vert, le bleu, l'ocre de ses dix-huit ruches ne coloreront plus la lisière.
Un signe de la main encore, discret, silencieux avant qu'il ne s'éloigne au volant de sa vieille jeep derrière laquelle une remorque traîne comme un arc-en-ciel quelques morceaux du tableau de la belle saison.
Rien n'a changé dans le bois et sur l'esplanade du refuge de Corcelles, les bruits se mêlent, celui des pas sur le gravier qui crisse comme du verre pilé, celui du vent à la cime les feuillus qui agitent les bras, le bruissement des feuilles chiffonnées à leurs pieds, le ronflement lointain des voitures sur la Route des Paysans, l'eau abondante qui tombe du goulot de fonte et qui claque dans le bassin, le bourdon d'une invisible armée de guêpes, la colère rentrée des avions qui labourent le ciel, l'appel des quelques oiseaux qui se sont partagé le quartier...
Des bruits bien distincts tissant un filet sans bord, qui agit comme une main sur l'assourdissant silence qui pousse, pousse par en dessous.
Jean Prod’hom
Dimanche 2 août 2009

Un froissement de papier a interrompu la rêverie, mais on a beau chercher, rien ne bouge dans les feuilles mortes. Il attend dedans, il écoute dessous avant de se risquer en terrain découvert. Soudain le voici, l'orange de son bec d'abord, et puis ses plumes d'ardoise, son chant enfin, un chant articulé et indivis du bout des lèvres, à peine un chant, un motif liquide qui roule dans la bouche comme des galets remués par le va-et-vient d'une vague.
Une flexion l'anime comme un ressort avant qu'il ne saute, qu'il ne sautille plutôt, et cinq bonds l'amènent au pied de la fontaine dont il atteint le rebord en battant deux ou trois fois des ailes.
Plus un mot, il longe le bassin à l'extrémité duquel il marque un temps d'arrêt, il se lance, un battement d'ailes, il touche terre, et la tête bien droite il entame une courbe de précaution pour rejoindre le dessous des tables et des bancs massifs du refuge dans l'ombre desquels il disparaît, à peine quelques secondes, quelques miettes peut-être.
Le voici de retour, l'orange, l'ardoise, les galets par le même chemin.
Il sautille cinq fois encore puis s'envole, il n'a pas hésité sur le chemin à prendre, le seul qui lui correspond. Il a percé le sous-bois comme aucune flèche ne sait le faire, car l'oiseau juge en même temps qu'il s'égare.
Il a chassé les derniers nuages du ciel et dans l'ombre du bois le merle va et vient, par ici ou pas loin, par là.
Jean Prod’hom
Fin de saison

On n'échappe pas aux regrets lorsque les foins et les moissons sont rentrés, alors que les corymbes des sureaux, des viornes, des sorbiers livrent aux lisières leurs poignées de fruits rouges et aigres. La poussière des chemins s'est installée sur les feuilles du séneçon et du millepertuis, leurs fleurs jaunes lancent à peine quelques feux, sans parvenir à réveiller les lourds verts qui s'épuisent.
Le sommeil n'efface rien, les beaux jours s'enfuient où qu'on aille. Quelque chose s'appesantit, quelque chose cesse de trembler, ce qui poussait par en dessous s'est tu.
Il pleut, il vente, il faut voir désormais les choses autrement et sauver sa peau, aller à reculons, percevoir les premiers signes de la rouille qui s'attaque au feuillage. Elle l'allège, elle va finalement y bouter le feu.
On verra alors le vent se refaire des amis.
Jean Prod’hom
Dimanche 26 juillet 2009

A la fin des journées du milieu de l'été, le soleil et les trembles déroulent sur la route des Censières filant vers le sud un long ruban passementé d'or et d'ombres aux motifs hésitants qui emballe le corps de la passante lorsqu'elle s'avance sous le ciel bleu, la plastronne, la coiffe comme une Morlaisienne, coule liquide dans son dos avant de s'immobiliser à nouveau sur la route qui fuit à l'arrière.
Et si elle interrompt sa marche pour regarder l'habit, la coiffe, la traîne qu'elle était si fière de porter il y a un instant, la promeneuse est surprise de ne voir sur le bitume, à sa gauche, qu'une ombre d'encre immobile et sans nuance, sans dentelle, la sienne, que seuls quelques cailloux blancs éclaircissent par endroits.
Jean Prod’hom
Un collier de disparates

On y va tous d'un air entendu, mais on y va à cloche-pied, de rien en rien, inspiration expiration, sur une marelle sans clocheton ni pinacle, aux fondations anciennes, incompréhensibles je le crains, une marelle sans toit et aux dimensions de Babel.
Le sachant on avancera chaque jour à reculons et on verra le jour se plier et n'en rien laisser. Ou face à ces riens qui font se dresser ce qui se tait en nous, on retiendra un grain chaque jour, chaque mois, un seul, quel qu'il soit, soutiré avec peine aux bons tours que nous joue la durée pour en tirer un camée ou un collier de disparates.
Les bras du saule s'agitent au milieu de la pelouse, il est 17 heures et c'est l'heure, il faut manger, tourner la clé de la boîte à musique, fermer les volets, ils s'endorment.
C'est l'heure que choisissent les forains pour frapper à la porte du sommeil, avec eux les lumières, les frayeurs, les équilibres précaires, le clown blanc, le vertige, les rires, les fauves, la nuit.
Rêvez enfants! Montez pour un tour sur le carrousel et les chevaux de bois de la nuit. Demain il n'en restera rien, à moins qu'un grain ne vous ouvre la voie du disparate.
Jean Prod’hom
Dimanche 28 juin 2009

Des échelles sans personne, des poignées de cerises qui tachent les mains des enfants, on passe, ils jouent à mourir. Un grand a bien fait les choses et s'est entamé profondément le pouce avec son opinel, d'autres crachent des noyaux.
A l'écart les abeilles vont et viennent en passant sous les avant-toits rouge, bleu et jaune des ruches placées sous un hêtre aux capsules poilues couleur de miel.
On attend, on n'arrête pas d'attendre, ceux qui peinent, ceux qui vont de l'avant, ceux qui nous attendent, ceux qui nous ignorent ou nous ont oubliés. Par l'ouverture on aperçoit la plaine vallonnée qui s'étend jusqu'au Jura, les traces plus jaunes du passage des chars dans les champs moissonnés, les ballots de paille deux par deux, les arabesques vert profond qui cachent les rivières, quelques pièces d'un puzzle qui s'étend jusqu'à l'horizon, et ici et là, d'immenses pylones et quelques clochers reliés par des fils invisibles.
Les casquettes à visière et les lunettes à soleil cachent la liberté qui les habite, des griottes sur leurs oreilles enflamment leur silhouette tandis que quelques papillons se posent sur les polos de couleur, d'autres papillons virevoltent et nous suivent un instant.
Il fait chaud, les champs de maïs aux feuilles d'acanthe ont besoin d'eau, mais les nuages qui s'amoncèlent au nord ne tiendront pas aujourd'hui leurs promesses, et la savante architecture de tuyaux d'acier inoxydable qui recouvre les cultures des maraîchers demeure muette. Peu d'eau dans la Mèbre, peu d'eau dans la Chamberonne, peu d'eau dans la Venoge. Toutes les trois laissent voir leurs gencives de molasse. Du côté de Jotenel, les tournesols ont le visage tourné vers nous.
On a traversé les villages comme on enfile des perles. On y entre on en sort, les tunnels ne sont pas là ou l'on croit. Trois fois dans la journée, on apercevra par une échancrure la surface bleue, immobile, du grand lac.
Jean Prod’hom
XXIV

- Quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a fait si mal au coeur que tu en as pleuré dans le bus?
- Oui.
- Que t'a-t-elle dit?
- Que je pleurais souvent.
- Dis, maman, c'est bientôt l'hiver?
- Non, l'été n'est pas encore arrivé.
- La neige est cachée sous l'herbe?
Jean Prod’hom
Dimanche 7 juin 2009

J'entends de loin la musique de leur pays, je me hâte, je me réjouis de m'asseoir pour me reposer un instant auprès d'eux, à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Ils se sont retrouvés aujourd'hui aux Censières pour fêter une histoire interrompue, comme une page déchirée en son milieu qu'on ne peut pas oublier.
C'est dimanche et ils sont vivants. De grandes flammes dans l'âtre font cuire la soupe, dans la fontaine des bières, sur la table une bouteille de whisky, du vin blanc aussi. On entend les cris des enfants, à peine visibles derrière les feuillus, qui jouent à cliclimouchette sur le chemin qui descend de la Montagne du Château. Sous l'abri recouvert de tôles grises et rouges de rouille, un nuage de fumée peine à trouver une issue.
C'est de la musique de chez eux qui sort d'un appareil de fortune autour duquel les femmes se sont regroupées, elles veulent faire une ronde mais réussissent à peine à constituer un demi-cercle, elles en rient. Elles dansent, elles parlent, elles sourient.
Lui, il fait partie de la minorité musulmane de Banja Luka. En 1992, il a fui avec ses parents et a rejoint un camp de réfugiés en Croatie. Son père a pu choisir alors entre différents pays européens, il débarque à Genève, on le conduit à Aigle, il a dix-sept ans. Il épouse quelques années plus tard une femme de son pays. Non, ses enfants ne retourneront plus à Banja Luka. Il me parle comme dans un rêve des loups et des ours qui rodent dans les montagnes de Bosnie. Il est aujourd'hui chauffeur-livreur et habite le quartier de Boissonnet.
Je dois les quitter, il y a malgré tout du bon dans les communautés. Et lorsque je débouche sur les hauts des Censières, si je n'entends plus la musique de leur pays, je devine, au-delà du battement sourd des pas de danse sur le plancher de l'abri, le vent qui fait faseyer les feuilles des hêtres, identiquement ici dans le Haut-Jorat et là-bas dans les bois de Banja Luka.
Jean Prod’hom
Dimanche 31 mai 2009

Il songe à ce qui pourrait fournir une image approchée de sa condition, le voici à la barre d'un rafiot de moins de dix mètres, ses compagnons d'équipage ivres et épuisés. N'en pouvant plus de regarder fixement dans la nuit la boussole pour maintenir le cap, il s'était étendu sur la banquette arrière, calé contre les reins de l'Ecume de mer tenant l'âme du bateau et les vies des ses amis dans la main droite, il avait navigué dans le ciel, parmi les étoiles, jusqu'à Termoli.
Il se dit réaliste lorsqu'il bêche son coin de jardin, roule sur le plateau de Sainte-Catherine ou prépare de la purée de pomme de terre, idéaliste lorsqu'il pense à ses origines, à sa vie et à sa fin. S'il est convaincu qu'il ne restera rien de son corps malgré les promesses qui lui ont été faites naguère, il juge fort probable qu'un peu de son âme et quelques pensées en exercice veilleront et frémiront lorsque ceux qui resteront essaieront de comprendre dans le miroir leur image surgie de nulle part, lorsqu'ils apercevront par la fenêtre les généreuses traînées de crème dans le ciel et le miel abondant du mois de juin.
Les choses tiennent ensemble par la grâce des âmes invisibles qui les agrègent et des pensées innombrables qui les trament.
Jean Prod’hom
Cathédrale

Les lourds blocs de molasse mis à jour par les pelles lors des travaux de creuse du réservoir d'eau de la Montagne du Château, dégagés, transportés puis stockés depuis plus d'une année derrière le hangar sont pour la plupart en poussière. Qu'aurait-il fallu faire pour que la molasse devienne moins friable?
Rien, me répond N. M. de l'Université de Lausanne. Et les blocs ramenés sont bel et bien constitués de cette molasse grise qui a servi à la construction des anciens édifices lausannois, mais ce grès est très friable. Si elle est extraite à une certaine profondeur dans la masse rocheuse, c'est-à-dire entre cinq et dix mètres, cette roche est même d’assez bonne tenue pour la construction, car elle n'a pas été affectée par les ruissellements d'eau chargée de gaz carbonique qui ont tendance à la rendre friable.
Dans les environs de Lausanne, il n'y a pas actuellement de carrières d'où l'on extrait ce type de grès, sain à l'affleurement. Dans les anciennes carrières, par exemple celle de la grande place de parc au Signal de Sauvabelin, l'exploitation s'est arrêtée il y bien longtemps et la roche est devenue friable suite à son exposition aux agents atmosphériques. Mais il suffirait de décaper le rocher sur quelques mètres et on rencontrerait un matériau de construction en bonne santé.
Pourtant, conclut le spécialiste de l'UNIL, le travail de sape de l'érosion ne manquerait pas de s'attaquer aux édifices construits avec cette molasse. C'est le gros problème à Lausanne – alors qu'à Berne ou Fribourg, la molasse montre une bien meilleure tenue.
Il faudra donc que je m'y fasse, le jeu n'en vaut pas la chandelle, je n'élèverai pas de cathédrale dans le Haut-Jorat.
Jean Prod’hom
Dimanche 24 mai 2009

Les deux filles reviennent du bord du lac avec leur mère chargées de cailloux. elles demandent qu'on leur prépare du ciment-colle pour fixer les différentes parties du corps de leurs personnages. Je me souviens alors du 21 octobre 2007, nous étions de l'autre côté de ce même lac, elle et moi aux Petites-Rives, accroupis tout aux long de la journée dans les cailloux...
– Tu les prendrais si je ne les prendrais pas?
On avait décidé d'un commun accord de rester sage et économe. Avec le ciment-colle acheté à Granges-Veveyse, on avait fixé le caillou rond ramassé sur la grève qui prolonge la terrasse de l'Hôtel des Cygnes: notre premier cyclope. Elle n'avait pas voulu me le céder, elle l'avait offert au retour à sa mère.
On avait attaqué aussi, assis cette fois, le morceau de molasse de la Montagne du Château qui traînait depuis quelques jours avec des outils dans le coffre de la voiture. On avait gratté, limé. Louise s'était emparée d'un fragment qui s'était détaché du bloc trop friable, elle avait esquissé une espèce de tête, la tête d'un hydrocéphale, comme cela arrive souvent avec les amateurs que nous sommes. Louise prêtait des secrets aux pierres, elle pensait avec conviction que des êtres s'y cachaient, les habitaient et qu'il suffisait de les dégager. Cela remontait à la visite que nous avions faite ce même automne du Portail peint de la cathédrale de Lausanne: les statues polychromes, les pierres de l'édifice, la molasse, sa présence dans la région, à deux pas de chez nous, mes explications peut-être, tout cela l'avait conduite à se faire une idée de la sculpture qui m'avait ravi et que j'avais peut-être à mon insu induite. Son frère s'était moqué de cette conception et j'avais essayé sans succès de lui démontrer que sa soeur s'approchait peut-être de ce que cherchent à atteindre les sculpteurs.
Aujourd'hui, près du cognassier en fleurs, à côté du billot de bois qui lui sert d'établi, elle sourit lorsque je lui raconte ce qu'elle disait de l'art de sculpter.
Jean Prod’hom
8

Ils ont fauché l'herbe hier matin, sorti les pirouettes en fin d'après-midi pour tirer des lignes hésitantes et des marges flottantes. Le soir on a pu apercevoir des pages et des pages plus singulières les unes que les autres entre vergers et colza, elles ressemblaient à des morceaux d'océan, les têtes des pissenlits étincelaient sur les andins comme l'écume sur les crêtes des vagues.
Rien n'y sera écrit. Ce soir avant l'orage ils enrouleront dans la précipitation les lignes, et on tournera la page.
Jean Prod’hom
Dimanche 17 mai 2009

Si je m'étends aujourd'hui à midi dans les combles d'une maison déserte, c'est parce que mon corps n'accepte plus, tout à coup, l'idée d'un temps qui avancerait vers le tout autre ou qui reviendrait vers le même. La raison n'y peut rien, Daniel a beau faucher comme il y a douze mois le pré qui s'étend en contrebas du Chauderonnet, Arthur a beau honorer ses engagements en se rendant à l'école, comme nous le lui avons demandé, pour y préparer les années qui lui permettront de continuer sans nous, nous méritons mieux.
La fenêtre est ouverte, la vie est là, le soleil suit une courbe presque immobile. Je ferme les yeux, il fait frais, je distingue pourtant les taches de lumière qui taquinent la vieille charpente. Immobile, éveillé comme jamais, je m'éprends, creuse une niche loin des arènes. Les cris des moineaux, fous du printemps, tiennent à deux mains l'assiette du jour, la vie est un don.
Plus tard je ferai de même sur une terrasse entre Palézieux et Oron, et puis à l'instant en fouillant dans les dépenses du langage.
Je me prends à aimer à nouveau et me réjouis de toutes ces boucles du temps qui ponctuent nos vies, qui nous éloignent des pentes désespérées sur lesquelles on roule inconscient, sans rien espérer d'autre toutefois que leur divin retour.
Jean Prod’hom
Post tenebras lux

Une épaisse crème de plomb tapisse le ciel, maussade jusqu’à l’os. Les grenouilles se frottent les mains, la boue colle aux chaussures, les pissenlits sont éteints. Haies de thuyas, traînée de grisaille, je ne me souviens plus du temps d’avant. Le trèfle a la tête baissée, le chat squatte la niche du chien, l'humidité vient de partout, du ciel mais aussi des champs et des rivières, zigzags de vent, il pleut des misères sur une forêt de parapluies, dans leur imperméable les fonctionnaires partent au travail. Tout est sombre, désespérance en crue, pas l'ombre d'une issue, le ressentiment ronge les visages. Seuls les essuie-glace se réjouissent, ils ont cessé de couiner et rament de bon coeur. J’attends, le soleil reviendra bien.
Je lève les yeux vers les nuages qui filent plus loin annoncer la mauvaise nouvelle. Regardez! ils déroulent dans leur sillage un large et inouï tapis bleu. Le soleil guigne et se frotte contre mon chandail. Je fonds, le corps à l’arrêt. Le bitume d'argent coule à flot sur les routes, c'est l'éclaircie, on voit des choses qu'on n'aurait jamais crues, les malheurs du monde sont effacés, deux draps blancs fasseyent sur l'étendage.
Jean Prod’hom
Dimanche 10 mai 2009

Le soleil s'attarde sur nos laines, le retard nous inquiète peu aujourd'hui, on s'éprend de l'air léger qui fait frissonner les prés. A la station du bus orange qui emmène les enfants du quartier, la conductrice me sourit, je lui souris. Elle me dit alors avec une légère ivresse dans la voix que cette brise, ces couleurs, ce soleil la rendent folle à l'approche de la Pentecôte, chaque année, l'horizon si proche, les Verraux, la Dent de Jaman...
– Tu sais! ajoute-t-elle.
Je sais, mais elle me raconte l'histoire encore une fois: y a cinq ans, sur l'étroit chemin qui conduit le promeneur du col de Jaman au col de Pierra Perchia, son fils a glissé sur les restes de l'hiver, un névé à la traîne oublié au travers de la sente par la comète de mai. Il a perdu pied et il est mort. Quelle terreur avant de le retrouver, c'était le samedi de la Pentecôte. La veille je voulais lui offrir des fleurs roses pour son nouvel appartement. Pourquoi pas des noirs? avait-il plaisanté. Elle en rit encore.
Je ne me suis jamais rendue sur le lieu de l'accident, il n'a plus grandi. Elle, elle vieillit le regard rivé sur le point de ce désastre, une image, non pas qu'elle espère la réapparition de son enfant, mais parce qu'elle ne doute plus de l'innocence de la montagne et reconnaît sa toute puissance.
Il faisait un temps comme aujourd'hui ce samedi-là. L'impensable est si beau et si terrible. Ses yeux s'embuent. Les enfants arriveront avec un peu de retard, un retard qui ne compte pas au regard de ce qui s'est arrêté.
Tous les matins, lorsque le ciel est dégagé et que le soleil claire la vallée de la Broye du Haut-Jorat aux Préalpes, elle et son mari regardent du côté de la Cape au Moine. On ne se dit rien, rien, on n'oublie pas pourtant, mais quoi je l'ignore. Que cherche-t-on dans les plis de ces montagnes? quelque chose qui se décline en-deça des quelques pauvres modes possibles de l'être, quelque chose comme un silence d'avant la respiration, gonflé de promesses nues. Pour peu qu'on n'y prenne pas garde, qu'on se laisse aller, que nos regards s'attardent sur le visage de l'horizon, on fond d'amour pour la montagne qui nous l'a dérobé.
Nous ne sommes pas les seuls, il y en d'autres... conclut-elle. J'aurais voulu lui dire que chacun d'entre nous compte les jours à partir de son hégire. J'ai laissé les montagnes s'éloigner avec leur secret et le bus orange emporter nos enfants.
Jean Prod’hom
Dimanche 26 avril 2009

Le facteur est mort, on l'a appris par le journal, ce journal qu'il glissait chaque jour dans notre boîte aux lettres. La vie pourtant continue, et on avance hébété dans une campagne dépeuplée.
On l'aimait sans le connaître vraiment, on l'aimait de loin, ou comme s'il était né avec le lieu. Il ouvrait les allées de nos jours, Ropraz, Corcelles et ses oasis, le Riau, la Moille-au-Blanc, la Moille-Cherry, la Goille.
On l'appelait par son prénom, il nous appelait par le nôtre, toujours un mot pour réveiller nos enfants.
Stéphane a été le compagnon bienveillant du peu que nous sommes, présent à l'égal du pommier du jardin, du hangar ou du chat. mais mobile comme un furet, jamais très loin, qu'on l'aperçoive ou qu'on le manque, métronome de nos jours, régulateur de nos attentes, mains vides ou mains pleines, témoin de nos riens.
Par la grâce de ses allées et venues, du sillon qu'il traçait dans ce bout du monde, que nous devions quitter quotidiennement pour notre subsistance et celle de nos enfants, il a régné discrètement sur notre biotope, avec la régularité du laboureur, jetant la graine qu'on attendait, ou celle qu'on n'attendait pas. Il assurait le double souhait des forains que nous sommes tous ici, être d’un lieu sans y être forclos. Qui désormais?
C’est un monde qui s’en va. Je crains que les messages ne nous parviennent plus identiquement.
Stéphane parti, nous sommes aux prises avec les mots nus.
Si l’on nous demande
Pourquoi ces vies
Nous montrons nos cicatrices
Elles ont été nos charrues et nos récoltes
Nous les avons engrangées sans relâche
Sous les ciels bleus des belles saisons
Peinant et nous pressant
Sous l’orage des haches
Labourant la plaie énorme, semant dans la chair
Labourés nous-mêmes
Le grain monte
Du fond des fosses nous voyons les fumées sous les nuages
Nous sommes tranquilles
Jacques Chessex
Je lis aux enfants ce poème que la famille de Stéphane a glissé dans le faire-part. On est à table, en famille, Lili ne comprend pas.
- Il reviendra, dit-elle, distribuer le courrier, il reviendra. Ce sera un chien, ce sera un chat...
Je dis alors au dedans: "Comme moi demain et toi mon demi-dieu, ma divine, sans raison, mais avec la discrétion qu'il nous a apprise, toi et moi. Nous sommes ces champs longs et larges, gras au printemps, déserts l'hiver, sur lesquels s'abat un matin, à midi ou à minuit l’orage des haches."
Jean Prod’hom
M2

Des sources du Talent, de celles la Corcelette et de la Bressonne, le M2 nous dépose – à peine le temps de s'assoupir – station Délices sur le Chemin de la Ficelle, coulée verte bordée de magnolias en fleurs. A peine un instant et nous voici dans un autre monde, sur la Riviera. Il n'y a désormais plus qu'un pas des moilles et des bioles de Mauvernay, des foyards et des sapins du bois Vuacoz aux ginkgos et aux forsythias du Léman.
Quitter le Haut-Jorat, monter dans le M2 aux Croisettes et rejoindre par beau temps les rives lumineuses du Léman constitue littéralement un ravissement: on quitte le pays des loups et des brigands pour se retrouver l'instant suivant au coeur de celui des chihuahuas et des commerçants.
Le M2 juxtapose miraculeusement deux mondes, deux époques, deux essences de l'homme, le bûcheron et la marchande de glaces, la paysanne et le vendeur de cigarettes, les souliers militaires et les talons hauts, les geais et les canaris. Le métro est un accélérateur, il vous fait glisser d'un coup et sans peine sur la pente qui tenait autrefois le pays des sources secrètes éloigné de celui des rives tapageuses, il met à portée de main de chacun l'imaginaire de l'autre. Ravis!
Du primaire au tertiaire ou du tertiaire au primaire dans la nuit, sans intermédiaire, de l'économie rurale à l'ère postmoderne d'un coup, sans passer par l'ère industrielle, le M2 franchit plusieurs siècles en tous sens, sans orientation - le M2 est un véhicule sans pilote. D'autres ont fait cette expérience avant nous, Londres ou Paris. Mais de l'avoir fait si tard dans une ville de province n'est pas sans leçon: où qu'on soit, c'en est fini de l'anisotropie du temps, du progrès, des promesses des Lumières.
Demeurent toutefois dans le Haut-Jorat, épargnés par les travaux d'Hercule de notre époque, quelques reliquats des siècles passés, des chemins tendus – vy tendant – qui rapprochent et séparent de proche en proche des singularités géographiques interchangeables dans un monde homogène, villages embourbés à la verticale du clocher de leur église, centripètes et centrifuges.
Sur ces chemins bordés de haies s'avancent aujourd'hui encore les pèlerins d'une seule foi, d'Hermenches à Villars-Mendraz, de Corcelles-le-Jorat à Ropraz, de Peney à Villars-Tiercelin: femmes, bûcherons et paysans qui songent chemin faisant au temps qu'il fera demain.
Jean Prod’hom
Avec le temps

Contraint chaque jour d’avancer, mais libre en tout temps de revenir sur ses pas, d’où l'obligation de s'y être rendu une première fois pour disposer de la liberté d’y retourner plus tard, revisiter les décharges de marbre à Sienne, errer dans les prés de Bonperrier, longer les haies de Vers-chez les-Rod, se baigner dans l'Orcia, se perdre dans les forêts de la Chapelle-des-Bois, et considérer ces lieux inconnus à nouveaux frais, comme s'ils étaient offerts à mon regard pour la première fois.
Si bien que passant le Col de Lys ou le col de Pierra Perchia je ne sais plus s'il s'agit du premier ou du second, si même j'y suis passé un jour.
Qu'importe! A tout prendre, parie sur la liberté. Parie que tu fus l'hôte de ce col une infinité de fois.
Contraint le jour de notre naissance, mais libre ensuite de remonter aux origines du sentier sur lequel nous avons déjà cheminé aux premiers jours et où les choses se sont accomplies. C'est en repassant le col de Lys pour la seconde fois, en ce lieu où j'ai su la première fois que je l'avais déjà franchi, que j'ai cessé de repousser la liberté, la difficile liberté, la liberté d'accomplir l'accompli en acceptant de retourner là où je ne suis jamais allé.
Ceux qui sont venus avant moi m'ont obligé à accomplir, d'abord et à mon insu, ce que j'accomplirai lorsque mon temps sera venu, ils m'ont enseigné le partage accessoire de la liberté et de l'obligation, ils m'ont appris à composer avec ce qui a été et l'accepter, à dire l'identité du passé et de l'avenir, à distinguer l'accompli de l'inaccompli pour mieux les confondre et deviner par après la grande nouvelle qui ne peut pas se dire.
Jean Prod’hom
Aucun bruit du dehors n'arrive plus maintenant jusqu'aux jeunes gens. Il y a tout juste une branche de rosier sans feuilles qui cogne la vitre, du côté de la lande. Comme deux passagers dans un bateau à la dérive, ils sont, dans le grand vent d'hiver, deux amants enfermés avec le bonheur.
«Le feu menace de s'éteindre», dit Mlle de Galais, et elle voulut prendre une bûche dans le coffre.
Mais Meaulnes se précipita et plaça lui-même le bois dans le feu.
Puis il prit la main tendue de la jeune fille et ils restèrent là, debout l'un devant l'autre, étouffés comme par une grande nouvelle qui ne pouvait pas se dire.
Jean Prod’hom
Dimanche 29 mars 2009

Un pré à la teinte indécise tapisse le fond d'une large cuvette à la profondeur réduite, que borde là-bas une bande étroite d'épineux; s'en dégage à mi-hauteur, à peine, un frêne gris et squelettique. On distingue à travers le tricot vieilli de ce petit bois un second pré qui tire sur le jaune lui aussi, ou sur le vert pâle peut-être, et qui monte en pente douce jusqu'à un grand bois sombre, à l'avant-garde duquel s'avancent trois sapins sans chausse, la tête perdue sous de hauts nuages tristes.
Rien à deux pas sinon l'étroit ruban de bitume, et rien au-delà ou presque, un jardin abandonné aux premiers jours de novembre qu'un inutile treillis aux larges mailles entoure. Le clos est adossé à un talus sur le flanc duquel le regard vient buter avant de remonter jusqu'à la lisière et tenter sans succès de s'échapper par-dessus l'épaule des épicéas. Sur la gauche un antique verger, arbres décharnés, lavandes passées, que le propriétaire ne taille plus qu'au hasard des ans qui passent. Manquent les murs en ruine d'un vieux cimetière désaffecté. Pas un bruit, pas un souffle.
Confondus le clos, les bois, les prés, le verger, pièces si peu distinctes qu'elles tendent à désespérer le langage. Les maintient pourtant ensemble et vivantes le voile oublié d'une mariée égarée, une folle tache blanche, tranchante, l'envers d'une clairière, la pièce solitaire du puzzle sans couture de l'hiver.
Le bétail patiente à la Moille-au-Blanc et les quelques ruches de la lisière sommeillent encore un instant avant de mettre le feu à ce papier gris qui traîne à la queue de ce qui n'est déjà plus.
Jean Prod’hom
Dimanche 22 mars 2009

J'avais perçu de l’agitation près du poulailler, c'était un verdier fou, retenu prisonnier dans la cage à lapins. Le chat dansait en prélude à la mise à mort que lui dictait son sang. Ni le chat ni l'oiseau ne semblaient capables de résoudre l'énigme qui les avait réunis là et tenus à distance. Ni l'un ni l'autre ne franchiraient les mailles du treillis.
Le chat s'enfuit, les portes du ciel s'ouvrent, le verdier s'y lance.
Ceux que j’ai aperçus lors de leur première virée l'autre matin dans le mélèze, sur la barrière d’acacia ou dans l’air tiédi ont disparu. L'hiver s'est installé à nouveau, giboulées, l'eau cachée dans la neige, les volets qui grincent, les volets qui claquent. Les hommes, les oiseaux et le cortège des saisons ont fait marche arrière.
Où demeurent-ils? Où passent-ils l'hiver. Je les imagine l’oeil clos dans les troènes, immobiles dans les anfractuosités de granit, au pied meuble des mélèzes. Sang froid dit-on! Sentiment d'abandon plutôt, état de déréliction, étanche aux efforts de la raison – j'ai essayé de comprendre en vain.
Dans le jour et la nuit confondues, cachés dans les inégalités de la roche, tapis dans le désordre les haies, d'invisibles oiseaux sans sommeil tiennent en respect nos arrogances, rappellent nos trahisons et notre condition.
Jean Prod’hom
Dans le Jorat à vélo

Riau Raubon, Le Cugnieux, La Jaccoude, La Moille Baudin, L'Escargotière, La Montagne du Château, Les Censières, La Moille Saugeon, Le Creux Gadin, La Côte de Mauvernay, Les Vuargnes, Le Chalet à Gobert, Pra Roman, Les Tailles, Sainte-Catherine, La Fruitière, La Crogne, Le Collège, La Goille, Moille Margot, La Plumette, La Brûlée, Les Cullayes, Les Fiauges, Le Bressonne, Les Bossons, La Mellette, Le Bois de Ban.
Jean Prod’hom
A la Marjolatte

Feu de bartasses à la Marjolatte, il est midi. Le paysan ramasse ce que l'hiver n'a pas digéré: brindilles légères, morceaux de mémoire, branchettes de lilas, couronnes d’épines. Au coeur du foyer bordé par un ourlet de neige à la couleur indécise, le feu a pris. La formidable odeur se lève et nous enveloppe, les voix oubliées que nous logions dans les blancs de la mémoire esquissent un chant discret, à peine une mélodie tandis que le souffle brûlant des flammes altère les arbres qui sont restés en arrière et l’horizon qui les croise. Le regard se baigne dans le bleu pétrole du ciel qui est descendu dans les ornières où la glace a fondu.
Tout événement n'est qu'un accroît de clarté. L'air froid désemcombre la conscience qui se retire dans quelque recoin, il est vain de résister. Le corps lui-même, poreux, est altéré, il est inutile de se frotter les yeux.
C’est l’heure des grands travaux, le passé et l’avenir sont lavés à grandes eaux, les chemins sont mélangés aux talus, les impasses se lézardent. Où suis-je, ici ou nulle part, je suis ce monde renouvelé lancé sur son erre.
Le feu s'éteint, le soir vient. Et tandis que tu lis pour te réchauffer un roman de gare, ceux qui ne répugnent pas à se pencher sur les papiers calcinés, lisent le texte des braises noires.
Minuit sonne trop tôt, et l'aube déjà.
Jean Prod’hom
Dimanche 8 mars 2009

Lili expérimente dans son bain:
- Oh! maman, j'ai mis un sparadrap qui ne sait pas nager!
Lili bricole pour Pâques:
- Tu découperas le chablon.
- Mais maman, c'est un poussin jaune, pas un chat blond.
Lili invente un jeu pour Louise:
- On dit que que j'ai un autotocollant jaune, et s'il est là ou là, toi tu dois le dire!
- Je comprends pas! répond Louise.
- Tu veux que je dise plus fort? ON DIT QUE J'AI UN AUTOCOLLANT JAUNE...
Jean Prod’hom
Si la nuit ne revenait pas

Combien d'années encore la nuit assurera-t-elle la solidité de nos jours, nous tous tant que nous sommes, saints et assassins, insomniaques, rêveurs et libertins, enfants et vieillards, femmes épuisées, traîtres et musiciens?
La nuit, je le crains, ne résistera pas, les hommes l'ont dédaignée, ils paieront cher leur forfait, nuit peau de chagrin.
Goûte mon fils, poings fermés ou sur le côté, rêveur, amoureux, debout ou pensif, assoupi, attablé, somnolent ou affaibli, goûte ces nuits qui annoncent les derniers printemps.
Les malfaiteurs ont transgressé la trêve qu'elle nous offrait, la guerre va occuper nos jours et nos nuits, je serai sous terre.
Les hiboux se sont enfuis, les hommes tremblent et le réverbère est demeuré allumé au carrefour, nous prendrons demain la mesure de l'événement, le soleil bientôt ne se couchera plus.
Nous comprendrons, ma foi trop tard, que la nuit éradiquée était le salut du jour, il n'y aura plus de trêve, nous rejoindrons à nouveau le souterrain où nous sommes nés.
Demeurera loin au fond des bois la nuit de la nuit, il y fait froid, avec le tombeau et les arbres les yeux grand ouverts.
Jean Prod’hom
Credo

Je crois que je suis et qu'il existe un monde, et que ce monde persévérera dans son être, quand bien même je ne serais pas. Et j'appelle avec d'autres ce monde monde. Et je crois que ce monde recèle quelques beautés qui méritent d'être chantées. Et je sais que tu crois, toi aussi, que ce monde recèle quelques beautés qui méritent d'être chantées.
Tu crois de ton côté que tu es et qu'il existe un monde, et que ce monde persévérera – peut-être – dans son être, quand bien même tu ne serais pas. Quoi qu'il en soit, tu appelles ce monde monde. Tu crois que ce monde recèle quelques beautés qui méritent d'être chantées. Et tu sais que je crois, moi aussi, que ce monde recèle quelques beautés qui méritent d'être chantées.
Nous savons désormais que nous croyons avec force tous les deux que nous sommes et qu'il existe un monde, et que ce monde persévérera – peut-être – dans son être, quand bien même nous n'en serions pas l'un ou l'autre. Nous savons que nous croyons qu'il existe un monde que nous avons appelé monde et nous savons que nous croyons tous les deux qu'il recèle quelques beautés qui méritent d'être chantées.
Tout cela nous le savons, et ce n'est pas rien!
Jean Prod’hom
Tu quoque, mi fili

Le père fait entendre au fils ce qu’il est incapable de lui dire et que le fils est dans l’incapacité de comprendre: tu n'es pas seul, et nous sommes deux. Il lui fait entendre ce que celui-ci ne comprendra que plus tard, lorsque il sera mis en demeure de le faire entendre à celui dont il sera le père.
C'est en donnant naissance lui-même à son propre fils que le père ne devient véritablement le fils de son propre père. C’est dire que le père est toujours un peu le fils de son fils, et le fils toujours un peu, mais à son insu, le père de son père.
En devenant celui qui est venu avant, l'homme comprend enfin ce que c’est que de venir après.
La naissance du fils oblige le père à occuper la place que son propre père n’a jamais cessé de lui faire entendre, la place de celui qui vient après, la place seconde qui est aussi celle du premier venu.
Jean Prod’hom
Dégel

DIMANCHE – Nous descendons Arthur et moi sur la route de la Moille Cherry recouverte d'une épaisse couche de neige à laquelle personne ne touchera plus, c'est le lendemain de la fin du monde. Elle déborde sans compter sur les talus, les champs et remonte bien au-delà de l'horizon. Nous sommes les premiers – les derniers? Il neige encore, pas un bruit sinon le ronronnement du moteur que la réalité – ou ce qui en tient lieu – blanche, indécise, transparente absorbe, et quelques mots qui nous échappent, aucune trace.
Pas d'âme à Corcelles sinon celle du réverbère. A Mézières guère plus, une cabine téléphonique porte ouverte d'où le vide s'échappe goutte à goutte, il n'y a plus personne à atteindre, un abri de bus pâle éclairé par des néons poussifs, il n'y a plus personne à rejoindre. L'église entre chien et loup n'ouvrira pas ses portes aux fidèles. Seul vivant parmi les morts un radar, yeux fermés, qui guette la rectiligne qui mène à Ferlens. Quelques voitures roulent au ralenti dans le paysage, d'autres rescapés, égarés comme nous. Je dois parer au plus pressé, le vertige me guette, un vertige qui fait mine de se retirer un bref instant pour mieux s'installer et me précipiter dans un puits sans fond creusé par une nuée d'éphémères qui viennent fondre sans compter sur le pare-brise.
Devant la salle de gymnastique d'Oron, des enfants gris et leurs parents, gris aussi, SDF ou survivants.
LUNDI – Les jours s'allongent au Riau si bien que la lumière, lorsque je quitte la maison pour conduire les enfants à l'arrêt de bus de la Moille Cherry, a colonisé tout le quartier, de la Montagne du Château à la colline de Vucherens. La neige et le froid n'ont rien cédé pourtant, ils insistent dans les champs, aidés par la bise qui a effacé pendant la nuit les traces des rares chevreuils, des lièvres, du renard qui se sont risqués pendant la nuit aux alentours des habitations.
Le suaire, qui a doublé pendant la nuit, fait oublier ce matin les tentatives que le soleil a lancées mollement la veille pour réconforter les hommes dont les humeurs ont été affectées par les excès de janvier. Tout est à recommencer. Ce matin j'ai retrouvé le silence lourd et assourdissant de ce qui est mort.
MARDI – Pourtant, au pied des haies et aux lisières des bois, là où se réfugie la nuée des moineaux, réside la terre, en surgira bientôt le printemps. Ce n'est pourtant pas encore le dégel, tout au plus sa promesse. La terre rappelle qu'elle n'a pas perdu la partie, elle résiste au pied des hêtres, des sapins blancs des bouleaux, des frênes, des épicéas, elle guigne mêlée aux épines couleur moutarde, elle pousse les racines vers le haut, des mousses fémissent.
J'aime poser le pied sur ces îles, presser la terre qui s'amollit, je sais alors que la fine couche de terre durcie va céder bientôt, que nous n'aurons plus à brasser la neige. C'est dessous que les choses se préparent, la terre chaude et humide s'alanguit, le coeur de la terre ne s'est pas arrêté de battre.
Les moineaux réchauffés piaillaient à tue-tête, je suis rentré par la lisière du Bois Vuacoz.
Jean Prod’hom
Bilan

Sans le trait assuré des ornières, sans les lisières dont je me suis servi comme d’une main courante, sans l’éclat des cloches qui rameutent au loin les fidèles, le cri du coq, sans les tessons qui battent la mesure, sans les morceaux d’herbe et de blé qui habillent la terre, l’odeur du bois qui brûle, sans la grange aux portes entrouvertes, sans les regrets qui exaucent, serais-je demeuré vivant?
Je tremble toutefois de ne jamais parvenir au repos, de ne me satisfaire ni du soleil ni de l’ombre, de ne pouvoir retenir le fugace, je tremble lorsque le chemin disparaît derrière la crête, je tremble de rien, je tremble de tout, je suis sur la bonne voie, sur un chemin qui n’a ni commencement ni fin.
Jean Prod’hom
Dimanche 18 janvier 2009

Le soleil qui se cache depuis une petite éternité se serait-il imposé que je ne l'aurais pas remarqué.
Depuis quelques jours en effet pèse sur ma tête un couvercle dont je suis incapable d'alléger la pression. J'ai beau faire, mais j'ai tant à faire que le tas imaginé des choses à faire ne se réduit pas: j'enchaîne donc les tâches. Mais avant même d'en terminer avec celle qui m'occupe – sans même lever les yeux – j'en aperçois des légions qui viennent de partout, qui attendent et s'impatientent aux quatre coins de mes journées. Je suis à la presse, je ne vois pas le bout, tout reste à faire. Je désespère gouverné par le sentiment que je ne parviendrai pas à prendre l'altitude nécessaire et accéder à la paix qui nous échoit lorsque les choses pour lesquelles on s'est engagé ne sont plus à faire. Incapable de prendre une sage décision, je m'obstine avec la certitude sacrilège que je vais réussir là où Sisyphe a échoué.
Je sais pourtant qu'un rien pourrait réorienter mes efforts et faire revenir le soleil. Je sais également qu'il n'y a qu'une différence minime entre l'homme botté de plomb coiffé d'un couvercle et l'homme à la tête nue qui surfe sur une assiette. Je m'interdis pourtant ce second sacrilège qui consisterait à forcer le passage de l'un à l'autre.
Je travaille donc, mets à jour ce qui encombre mon bureau. Honnête je ne glisse rien sous le tapis. Il me faut simplement patienter, quelques jours encore – jusqu'au printemps? Je profite de tous les moments qui m'éloignent un instant de ce petit calvaire ordinaire pour respirer, faire du feu dans le poêle, remplir la machine à laver la vaisselle, préparer une salade, rouler jusqu'au Mont, écrire ces notes, jouer avec les enfants, regarder les actualités, dormir...
Je soupire et sourit, mine de rien j'ai abattu un gros travail, il est 21 heures 30 et je vais me coucher. Pour être en forme demain matin lorsque je rejoindrai l'atelier de Sisyphe.
Jean Prod’hom
Kezaco

Les notes, celles qui précèdent et celles qui suivent, sont rédigées du côté de Corcelles-le-Jorat. Elles constituent un contrepoint à ce que je crois distinguer, vois, entends, à la maison ou ailleurs, au café, dans les cours d'école, en classe ou sur le blog que les élèves de la classe 11 tiennent quotidiennement. Si j'ai décidé de placer là ces réflexions, des réflexions tièdes, rédigées dans l'immédiat après-coup, c'est avec une triple intention, celle d'abord de fournir quelques images de l'autre scène, toute proche, mais un peu différente de celle dans laquelle les institutions – famille, école,... – plongent nos enfants et que nous avons tous connue un jour. Dans l'intention aussi de rompre une solitude et de proposer à ceux qui s'y intéressent, enseignants, amis ou parents, les traces sans queue ni tête d'une vie et d'un métier, dont nous aurions tort de nous plaindre mais qui sont, comme l'a dit un observateur attentif des transferts, tout simplement impossibles. Avec le secret espoir enfin de tracer quelque chose comme un chemin de crête.
Jean Prod’hom
IV

Nés là un matin de printemps, à côté du café ou derrière le battoir, ils arpentent d’un pas décidé, le dimanche à l’aube, les bois de fayards et de sapins. Les cloches de l’église du village leur rappellent qu’ils sont nés pour rester. Cinquième ou sixième d’une famille de huit ou neuf, ils ont pour seule tâche de laisser le pays comme on le leur a laissé. Ils ramassent alors, sans arrière-pensée, ce que ceux qui ne font que passer ont abandonné le long du chemin. Amateurs de framboises qu’ils tiennent dans leurs mains puissantes, ils passent eux aussi, leurs yeux brillent, ils ont le sourire des anges.
Jean Prod’hom
La sainte famille

Bruits
Arthur est couché, scotché au pied de l'arbre de connaissance, il s'agite. Lili danse et parle en langues. Assis je traduis. Arthur grogne, Lili se tait et je tends l'oreille.
– Que fais-tu?
– Rien!
Silence
– Papa! Lili m'embête!
– Que fait-elle?
– Elle me regarde!
– Et toi, que fais-tu?
– Rien!
Silence
– Arthur, que fais-tu?
– Je regarde Lili qui regarde quelqu'un qui ne fait rien.
– ...
– ...
Bruits
Je les entends alors tous deux se lever délicatement. Ils s'habillent, descendent à l'étage, se saisissent d'un babybel dans le frigidaire, prennent au passage leur bonnet et leurs gants, ils s'en vont faire du bob au Chauderonnet. A quelques pas de là, Sandra berce Louise.
L'histoire du monde a commencé.
Jean Prod’hom
La ville

A Lausanne l'autre matin, une heure de bonheur!
j'y ai vécu les vingt-cinq premières années de mon existence avant de m'en éloigner pendant les vingt-cinq qui ont suivi. Il m'aura fallu ce détour par le Haut-Jorat pour reconnaître ce miracle que constituent la naissance d'une ville, sa croissance, son opulence et le cortège de ses bienfaits.
Je crois bien que je n'étais pas retourné à Lausanne depuis cette époque, l'esprit libre et par beau temps. Je l'ai retrouvée comme elle était alors, Lausanne est coquette, Lausanne est légère, elle a la tête dans les nuages, l'allure d'une fiancée qui s'émancipe. Je n'y décèle aucune trace de la terre et de la boue sur laquelle elle est bâtie, nulle part. Pas de vert non plus, ni celui des prés qui aveugle, ni celui des sapins en deuil.
Tout y est léger, aux dimensions de notre espèce, noble gris qui respire sous le soleil, rehaussé ici et là par les traces laissées par le pied d'Iris. Et puis là-haut le ciel bleu et froid qui efface les noirceurs de l'homme.
Je remonte dans le brouillard qui ne s'est pas dissipé au Riau, mais je reviendrai goûter à Lausanne, l'esprit libre.
Racommoder hier avec aujourd’hui, puis aujourd'hui avec demain, ainsi de suite? Que de romantisme!
L'aujourd'hui a été mis à notre disposition pour abouter – précipitamment et dans l'angoisse – les morceaux du temps. Et nous disposons pour réaliser à chaque instant de notre vie ce noeud papillon de moins de temps qu'Alexandre lorsqu'il a tranché le noeud gordien.
Pour réduire le risque de cette délicate opération, il convient de faire se chevaucher le plus généreusement possible le passé et l'avenir. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que se distinguent les fous des sages!
Jean Prod’hom
3

Au comble de la nécessité, lorsque je prends conscience que nos pas suivent les ornières des chemins d’autrefois et qu’ils ne s’en éloignent pas, j’aperçois, allégé, là tout près, dans les landes mêlées de ronces, la bruyère qui s’incline au souffle de l’imprévu.
Jean Prod’hom
2

J'aurais souhaité ce matin que les reliquats de ma vie, dispersés dans ma mémoire comme les pierres sur un plateau d'un jeu de go, s'organisent et fassent pression pour retenir la machinerie qui terrasse l'avenir, et carillonnent comme les casseroles dans le sillage de la mariée.
Jean Prod’hom
Le lac Clément

Ce matin au réveil, avant de la conduire au village, jour d'exception, sur la place de l'église où elle retrouve Clément et Robin, Louise demande.
- C'est vrai qu'il existe un lac Clément?
Jean Prod’hom
Lacer ses chaussures

Je l'aurais certes souhaité mais je n'en suis pas capable, pas capable de m'aventurer dans le labyrinthe de réflexions dans lequel m'ont plongé quelques mots et quelques gestes de ma fille ce matin. D'abord parce que ces réflexions ne se sont pas présentées à la queue leu leu, ou deux par deux, main dans la main comme dans les cortèges d'écoliers, mais surtout parce que la question me dépasse de beaucoup.
C'est ce matin un peu avant sept heures, le feu ronronne dans le poêle. Nous nous affairons tous les cinq dans un sain désordre, retenus par quelques fils ténus à la nuit dont nous sortons. J'entends alors dans mon dos: – Je fais une vague, puis j'en refais une avec les petites boucles!
Intrigué par ces mots que Louise prononce comme un sésame, je me retourne et la vois penchée sur le modèle-réduit d'une chaussure; elle tient dans ses deux mains les deux extrémités d'un lacet.
Je comprends alors, ma fille s'initie à l'un des rites majeurs du passage de la première à la seconde enfance: nouer les lacets de ses chaussures. Je la laisse à ses exercices persuadé que l'épreuve de ce matin n'est pas la dernière!
Un peu moins de dix minutes après Louise triomphe: – J'ai fait une vague, puis j'en ai refait une avec les petites boucles! Voilà! j'ai réussi.
Je n'en crois rien! Lui aurait-il fallu moins de dix minutes pour franchir le premier obstacle qui se présente dans la vie d'un enfant aujourd'hui pour être autorisé, chaussé, à aller de l'avant? Incrédule je lui demande de me faire une démonstration, le monde s'ouvre alors sous mes pieds. Louise exécute exactement son sésame: – Je fais une vague, puis j'en refais une avec les petites boucles.
J'avais avec d'autres Cassandres annoncé la disparition tragique du lacet; les enfants de la génération Velcro allaient manquer une aventure inoubliable qui les aurait conduits à la maîtrise d'un savoir-faire emblématique et à la résolution, pour la première fois sans trancher, d'un noeud de vipères.
Je me souviens de cette première aventure de la connaissance dont j'ai été le héros, le désespoir devant cet objet trop complexe, les innombrables obstacles qu'il m'a fallu franchir, mais aussi l'objet qui devient jour après jour plus clair, l'éveil peut-être même à l'idée de modèle, les phrases dont je ne me souviens plus et qui devaient m'aider, les grimaces de ceux qui ont vécu cette aventure avec moi. Le succès enfin! Le sentiment d'avoir réussi un exploit démesuré, inespéré.
Voici que je m'aperçois que les enfants apprennent aujourd'hui non seulement à exécuter ce geste, mais disposent encore d'une technique belle et simple qu'on m'avait cachée. Je me sens grugé...
Un instant seulement, car si je suis convaincu que l'exécution de la vague ou de la tresse comme je l'appelais, renvoie à une opération et à des gestes identiques, je devine par contre une irréductible différence dans la suite: Louise répète strictement l'opération initiale si bien que la fleur est là avant son épanouissement: elle papillonne selon un modèle.
Il n'en va pas de même pour moi, en 1960 à Riant-Mont 4. Assis dans le corridor, j'avance comme un chasseur, je prépare un collet à arrêtoir, l'étrangle avant de glisser la pointe dans un fouillis obscur avant de saisir une boucle naissante, lui donner de l'ampleur. Mon papillon est né de l'obscurité.
Je dois le dire, mon aventure vaut la sienne. Mais les rites, les mots et les méthodes qui m'ont permis et lui permettent d'aborder la terre, de l'entamer pour en faire partie, ne relèvent pas de la même épistémologie, et si ma fille et moi avons commencé et terminerons identiquement notre vie intellectuelle, vague, tresse et papillons, nous n'irons pas par les mêmes chemins.
Jean Prod’hom
Football

Je regarde parfois les matches de foot de la Ligue des Champions. Avec un double sentiment, celui certes de prendre du bon temps en me retirant, une heure et demie durant, des affaires qui occupent mon esprit - mes inquiétudes, mes projets, mes passions, mes peines,... -, mais aussi avec l'étrange impression de m'écarter de quelque chose d'essentiel, ce qui précisément me constitue. Je me retrouve alors encalminé sur les bas-côtés de la "vraie" vie, prisonnier d'une sotte conviction, celle de croire qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, et qu'il me faut rester là, médusé, jusqu'à la fin.
Les rideaux se baissent, je me lève alors du fauteuil dans le ventre duquel j'ai vécu, amiotique, amnésique, j'éteins les projecteurs, traverse l'obscurité. Je me réjouis alors du silence dont les plis enveloppent ceux que j'aime, un silence qui tressaille, un silence qui tremble, inentamé, "le silence de quelqu'un qui est sur le point de parler".
Jean Prod’hom







































































