(Pers) Sur les berges du Styx

Pour Claire, Denise, et Martine
Arcangelo Corelli
22 janvier 2009
Sans le trait assuré des ornières, sans les lisières dont je me suis servi comme d’une main courante, sans l’éclat des cloches qui rameutent au loin les fidèles, le cri du coq, sans les tessons qui battent la mesure, sans les brins d’herbe et les épis de blé qui habillent la terre, l’odeur du bois qui brûle, sans la grange aux portes entrouvertes, sans les regrets qui exaucent, serais-je demeuré vivant?
Je tremble toutefois de ne jamais parvenir au repos, de ne me satisfaire ni du soleil ni de l’ombre, de ne pouvoir retenir le fugace, je tremble lorsque le chemin disparaît derrière la crête, je tremble de rien, je tremble de tout, je suis sur la bonne voie, errant sur un chemin qui n’a ni commencement ni fin.

8 avril 2009
« Ce qui ne meurt pas est redoutable. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre! » écrit le psalmiste.
Mais ne te détourne pas de l'éphémère, murmure la vieille sur son banc: la flaque d'eau, Sauveterre, le vent d'ouest qui couche les herbes folles, la crête de la Montagne de Lure, les portes closes, les granges, ceux qui fuient, le chemin poussiéreux, les noms qui disparaissent, les malandrins, l'étang de Gruère, les clochers des églises qui piquent le ciel.
Ne te détourne pas de l’éphémère: la grève de Palerme, le courage des malades, le tracteur dans la remise, les repas sans fin, la sieste de l'ouvrier, les terres incultes, un livre ouvert dans une salle d’attente vide, les méandres du Doubs, les tessons, la dignité de l'orphelin, Ferpècle, les côtes de Bretagne, la pie qui s'envole, les jachères.
Sois bienveillant avec l'éphémère, l'éphémère qui revient, avec le retour des saisons, le sac et le ressac des souvenirs.

Ce petit livre, qui tient dans la main comme un galet, donne à voir les visages d’une cinquantaine de morceaux de terre cuite, ramassés depuis un peu plus de 25 ans sur les grèves, au bord des rivières, des mers, au bord de l’océan; des morceaux de terre cuite qui ont su mener une vie discrète, du lieu de leur abandon à celui de leur rédemption.
Et qui ne craignent pas de disparaître.

Une cinquantaine de textes donc, qui ont autant à faire les uns avec les autres que les morceaux de verre d’un collier qu’on tarderait à boucler. C’est d’ailleurs parce qu’ils supportent sans broncher l’arrivée de nouveaux venus que j’ai décidé, alors que le livre était déjà sous presse et ainsi sur le point de se refermer, d’écrire ces lignes, avec le secret espoir qu’elles le maintiendraient ouvert un instant encore.
Je voudrais aussi faire entendre, chemin faisant, un peu du ravissement qui m’a saisi lorsque les travaux appelés par ces minuscules paradis portatifs m’ont fait comprendre que ceux-ci n’avaient plus besoin de moi.

La mythologie que ces lignes revisitent, je n’en ai, avouons-le d’emblée, qu’une connaissance sommaire, déformée même, je le crains. Elles m’auront cependant conduit à reconsidérer mon commerce avec ces morceaux de terre cuite, une fois encore, depuis le commencement.

Avant d’accepter qu’ils ne montent dans sa barque, Charon, le fils des ténèbres et de la nuit, exigeait que soit placée dans la bouche de ses clients une obole, c’est-à-dire une piécette de peu de valeur – pas même une drachme – à l’avers de laquelle le roi d’Argos avait fait frapper dans ses ateliers d’Égine, en son temps, une tortue de mer.
C’est à cette condition seulement que le vieux nocher acceptait, en grimaçant, de faire passer ses clients sur l'autre rive. Sans quoi ceux-ci avaient à errer cent ans durant sur les berges du fleuve, avant de rejoindre le royaume des morts.
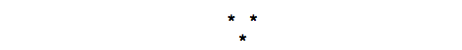
Cette histoire, on me l’a racontée à l’école, j’en ai lu des bribes ailleurs, en ai vu des images ici ou là, avec le sentiment rétrospectif de n’avoir jamais saisi exactement ce qui était en jeu et méritait mon attention. Avec, plus tard, la nette impression qu’il ne s’agissait en réalité que d’une fiction agonisante, tout juste bonne à alimenter le quant à soi de la classe des gens cultivés.
Il m’apparaissait en effet que, dans ce récit, la rive des morts ressemblait par trop à celle des vivants pour nous dire quelque chose d’inédit sur la question, qu’il ne nous éclairait guère sur l’autre royaume.
Et que l’homme couché au fond de la barque n’était vraisemblablement qu’à demi-mort, un ivrogne peut-être, l’oeil entrouvert, bref un vivant qui avait, comme il se doit, à payer son voyage.
Quant à la mauvaise humeur du patron de l’embarcation, les fatigues engendrées par sa tâche et la misère de son salaire l’expliquaient aisément.

Somme tout, ce mythe ne faisait que frôler la trivialité en répétant l’habituelle loi des échanges et l’adage bien connu selon lequel tout travail mérite salaire: chaque passager, quel que soit son état, vivant ou mort, doit, aujourd’hui ou hier, payer son titre de transport, que ce soit au guichet de l’embarcadère ou au péage de l’autoroute. La loi ne souffre aucune exception.
Cette histoire, colportée à l’école dans des langues mortes, ne dirait donc que ce que tout le monde sait déjà, mais en nous laissant supposer qu’elle contiendrait un secret touchant le royaume des morts et ses rampes d’accès, un secret creux à l’examen, dont les bien-pensants seraient persuadés de détenir la clé, qu’ils feraient passer de main en main, comme le furet, de génération en génération.

A moins que, à moins que cette histoire ne nous invite à regarder dans l’autre direction, non pas du côté du royaume des morts, mais du côté de celui des vivants, de ce que nous y faisons, jour après jour jusqu’en son point le plus extrême.
Nous naissons un jour de mars, d’août ou de septembre, sans l’avoir souhaité ni même demandé, nus. Nous ne disposons d’abord de rien, devons année après année répondre à tout et de tout, trouver une place qui ne nous préexistait pas.
Assurés de rien, sinon du fait que notre temps est fini et qu’il nous faudra un jour passer la main.

De ce que nous faisons de ce temps, et pendant tout ce temps, le mythe ne nous dit rien. Il indique simplement qu’il ne faudra pas, au moment voulu, oublier ce modeste viatique, si l’on veut rejoindre le royaume des morts. Pour le reste silence, faites comme bon vous semble.
Le prix du passage, est quasi nul, une obole, à peine une drachme. Mais le mythologue insiste: ce viatique, il convient de ne pas l’oublier, sinon... sinon gare, tout serait à refaire. Vous errerez sur les berges du Styx pendant cent ans.
Sanction exorbitante! Pensez donc, cent ans pour une omission de rien du tout, à peine deux sous! Comme on est loin du principe de proportionnalité.
Mais Charon donne ainsi aux oublieux une seconde chance pour mettre la main sur ce qui leur était sorti de la tête dans la première. Et cette fois, passer.

Je ne parierai pourtant pas un kopeck sur l’existence de Charon, je crains en effet que personne ne nous laisse demain une seconde vie si nous manquons l’essentiel aujourd’hui. Le mythe ment, comme toujours. Ce sursis ne nous sera pas octroyé.

Mais en décrivant nos vies au plus près, le mythe dit vrai, comme toujours. Car les années d’errance que vaut aux défunts cette omission se confondent avec les années mises à notre disposition pour mettre la main sur ce presque rien qui nous manque tout au long de notre vie, cette piécette qui nous échappe, ce nom qu’on répète, cette image ou ce reflet : clé, perle de verre, formule, prière, poème.
Le mythe dit vrai en ceci que la sanction de Charon est ce à quoi la vie nous oblige, sans que nous n’ayons fait quoi que ce soit de répréhensible. Condamnés, errant, à aller à l’essentiel pour passer, à saisir ce rien qui est à notre porte, ce passe qui l’ouvrirait. A notre porte ou sur les interminables berges, sans bruit et désarmé, où j’aperçois un visage de sable qui se défait et se refait, et qui me dit : laisse-moi être oublié.
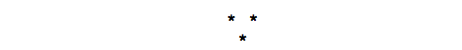
Je vais et viens sur la grève, remue les laisses de la mer, cherche l’éclat avec lequel j’ai rendez-vous, brisé, rejeté, roulé, raboté, poli. Eclatant enfin. Brimborion délaissé que je serre dans la main, avant de goûter du bout de la langue à son sel et le glisser dans ma poche.

Ces tessons, je n’y ai pas touché, ils sont devenus, chemin faisant, le gué que j’emprunte pour franchir le fleuve, lever la tête, me réjouir de la lumière et accepter l’obscurité: Kérity et Tourronde, la Bressonne et la Corcelette, le Tibre et le Tage, les rives du lac de Bracciano et le Léman, le cap Ténare et le Finistère.
À défaut de prier, je ramasse des pierres, en ai plein les poches, plein la bouche et je bégaie les petites proses qui les accompagnent: haltes dressées sur le chemin que je fraie, pour accepter mon égarement, retourner d’où je viens et aller où je vais.

Il aura fallu que quelqu’un s’intéresse à ces morceaux de terre cuite, s’en approche, montre son intérêt pour que j’accepte d’entrouvrir le meuble d’imprimerie qui les contient. En joignant son regard au mien, Pascal m’a encouragé à aller plus loin, c’est fait et je l’en remercie.

Ce livre n’est pas un roman, pas même un récit, pas tout à fait un recueil d’images.
Ce livre n’est pas un traité même s’il en a parfois l’allure: il a en effet renoncé à vouloir faire le tour de ce qui le déborde, les hypothèses y pullulent mais iront fleurir ailleurs. L’idée de classement ne le rebute pas, mais il ne s’y attarde pas et semble dire : « Va, il y a mieux à faire. »

Un livre d’heures peut-être, un livre de pierres en tous les cas, un livre qui tient dans la main.
Car je n’ai pas oublié qu’écrire n’est pas l’essentiel, écrire ne remplace pas les jeux d’ombres et de lumière sur le chemin qui longe la Broye, la passe des Islandais près de Paimpol, les échassiers d’Alcochete, les pêcheurs de Lugrin, le vieux fou de Tourronde, le delta du Tage à marée basse, la mer la nuit du haut du Stromboli. Mais écrire permet de nous désencombrer et de laisser aux mots le soin de dire ce qui nous manque, en tirant du fatras de nos journées ce dont la pointe est si fine qu’elle finit parfois par se confondre avec l’étendue.

On naît, on croît, on diminue, mais c’est de notre vivant qu’on meurt.
Que nous reste-il donc, le soir, lorsque nous rejoignons cette petite mort qu'est le sommeil ? Ici, dans le Jorat, les bords des rivières sont pingres, impossible de ramener un tesson avant la nuit. Alors j’écris chaque jour, je frappe dans mon atelier l’obole qui me permettra de passer, par quoi quelque chose s’ouvre de l’intérieur et offre une allure et un chiffre à mes heures.
(Pers) Chaque jour je ramasse, là où je suis, une pierre que je taille: un texte, trois lignes, que le ciel soit verrouillé, la tête à la mine ou dans les étoiles, pour faire naître ce que je pressens et dont je devine le contour, tandis que s’élève dans le ciel un chant simple, que l’oiseau s’empresse de suivre.

Et passant, passer.

Je vous laisse avec ce livre, il fait état d’une errance et de la découverte d’un passage que je veux maintenir vivant, la beauté ne cicatrise pas.

Les uns y verront un livre sur la construction des gués, les autres une revisitation du Petit Poucet ou la structure de la tortue d’Egine sur laquelle Aphrodite aurait posé le pied. Ils n’ont pas tort. Les plus généreux entendront, inaudible, invisible, la mélodie qui accompagne l’imprévu lorsqu’il montre son nez.

Je voudrais tant que vous ne soyez pas montés ici pour rien, je n’ai pas grand chose à vous offrir, ni pierres d'angle, ni clés de voûte, des souvenirs peut-être, comparables à ceux qu’évoque Ramuz dans Découverte du monde, des souvenirs dont, je cite, je m'aperçois qu'ils ne surnagent dans ma mémoire que sous forme de moments épars, comme dans un naufrage les agrès qu'on voit flotter encore à la surface de la mer, quand le bâtiment lui-même a coulé. Quelques souvenirs seulement, ça et là, que je n'ai pas choisis, qui ont émergé d'eux-mêmes, séparés les uns des autres par de grands intervalles ; mais pourquoi brillent-ils ainsi, et d'un éclat d'autant plus vif qu'une plus grande nuit les entoure?

Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, parfois sans le savoir, à cette étrange aventure. On a tout loisir en écrivant, et ce n’est pas le moindre de ses bienfaits, de nous entretenir avec ceux qui nous accompagnent et de reconnaître, avant de le refermer, ce que le livre leur doit. On n'écrit jamais seul, même s’il faut être seul pour entendre leur voix.

Il y a ceux qui se sont tus, Henri le père et Marie la mère, Daniel Christoff le maître. Il est fort probable, au fond, qu’on écrive des livres d’abord pour ceux qui ne les liront pas.
Il y a ceux que je n’ai pas revus depuis des années, certains me font le plaisir d’être là, je les salue chaleureusement.
Il y a ceux que je vois chaque jour au Mont-sur-Lausanne, adolescents vifs, exigeants, qui obligent celui qui veut durer dans cet impossible métier, de se détourner des recettes toutes faites et de considérer les choses du lieu de son ignorance.

Il y a ceux du Riau, de Corcelles et des villages alentours avec lesquels j’échange quelques mots lorsqu’on se croise, une main qui se lève derrière le pare-brise ou le treillis du jardin.

il y a ceux que je rencontre ici pour la première fois, que j’ai croisés sur les réseaux sociaux et que j’ai eu l’occasion de lire sur le net.
Ceux qui sont à mille milles d’ici, Michèle, François, Franck, Justine, Mathilde, Virgine, Christine, Brigitte, Christophe. Ils font vivre le net. Leur lecture, nos échanges, leur soutien auront été essentiels. Car le numérique n’est pas qu’un instrument de domination, le net et les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel, ils offrent ici et là des poches d’indépendance et de résistance, vivantes, aussi importants aujourd’hui que les cafés autrefois. Ils sont nos ateliers, nos laboratoires, des lieux de discussions et d’expérimentation.

Il y a ceux de la première heure, Frédérique d’abord, elle qui la première a vu débarquer à Hermenches ces objets, alors qu’elle partageait ma vie, elle n’a jamais moqué cette entreprise sans queue ni tête.
Il y a Olivier que j’ai beaucoup rencontré cette année, si généreux, qui n’a jamais refusé de m’écouter et avec lequel nous avons eu de belles conversations au bord du lac.
Il y a Yves qui n'a pas une seconde douté, je crois, de ce que j’entreprenais, et qui n'a pas hésité à m’encourager et à me soutenir lorsqu’il le fallait.

Il y a ceux qui ont facilité ma tâche, Thierry, Arturo et Raul, qui on fait en sorte que je dispose d'une journée de congé, cette année, pour mener à bien ce projet.

Et puis il y a celui qui a tenu bon, alors que d'autres auraient laissé tomber avant même d'avoir commencé. Il y a de belles histoires, celle de Tessons en est une.
Disons qu’une lettre, reçue l’hiver passé, est pour beaucoup dans la naissance de ce livre.
Cher Jean, m’écrivait Pascal Rebetez,
Je vous découvre aujourd’hui sur la toile. Par hasard, je crois.
Suivent deux ou trois gentils compliments qui donnent un peu de courage à ceux qui n'ont cessé de pratiquer le doute et qui, écrivant, espèrent secrètement, mais en vain, le lever un jour.
Je ne sais si vous désirez publier un livre, j’en réalise de petits, le plus soigneusement possible.
Non, Monsieur Rebetez, je ne désirais pas publier de livre. Oui, Pascal, l’allure de ta lettre m’a convaincu, le ton, son pas.
J'aimerais te proposer qu'on les partage ces tessons, qu'on les offre à voir, dans un livre, c'est ça que je sais faire, en y prenant le temps, mais qu'il soit beau comme un cadeau, on le sortirait tout visible dans les librairies en octobre 2014.
Fallait-il encore l’écrire, et dans les délais. Mais ta proposition était convaincante, n’habites-tu pas rue de la Poterie? Ça ne s’invente pas, je devais te suivre.
On prendra le temps, écrivais-tu. Là je souris : il m'avait fallu 26 ans pour que je me décide à faire quelque chose de ces brimborions, tu ne me laisseras pas 6 mois pour réaliser ce quelque chose. Nous sommes le 31 octobre, cher Pascal, c'était moins une.

Et si ce livre est sans contestation possible un livre, c’est d’abord à cause du savoir-faire d’artisans exigeants, Chatty la graphiste et les imprimeurs du Locle. Ils ont su mettre en page les textes et les photographies que Geoffrey et Romain ont réalisées.
Ne pas oublier Jasmine, l’indispensable, qui a toujours gardé la distance nécessaire, regardant de très haut lorsqu’il fallait embrasser l’ensemble du projet, de tout près lorsqu’il nous a fallu descendre dans le détail du texte.
Merci pour ce cadeau.

Je veux encore remercier Alain, notre hôte, qui fait vivre cette Fondation avec Claire-Lise, Michaël et les amis de l’Estrée. Alain qui m’a convaincu de montrer quelques-uns des restes de cette vaisselle du monde, regardez, il a pris soin d’eux et leur a offert un beau milieu, un peu écrasés par les grandes toiles de Logovarda. Pas grave, ils ont l’habitude.

Merci à Laurent Flutsch. Avec le concours de David Cuendet, responsable de laboratoire du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Laurent Flutsch va offrir une vie parallèle à ces objets et à ce livre. Ils seront en effet présents au Musée romain de Lausanne-Vidy, depuis le 4 décembre, jour du vernissage de la nouvelle exposition temporaire.

Merci à Christine Macé que Françoise et Edouard m’ont fait connaître. Elle anime dans la Drôme, depuis de nombreuses années, un espace de rencontre autour de la céramique et de la calligraphie: Terres d’Ecritures. Elle accueillera, elle-aussi, ces tessons et ce livre, dans sa galerie de Grignan, au printemps prochain. ils auront l’honneur de côtoyer les calligraphies de Kitty Sabatier et de Denise Lach. Peut-être.

Il y a ceux enfin que je n’ai pas oubliés une seconde, si proches.
Sandra ma femme, qui a suivi avec sollicitude toute cette aventure, elle a supporté le désordre que ne cessent de causer ces merdouilles, comme le dit si poétiquement David, qui ont la fâcheuse tendance à s’éparpiller, alors qu'elle a tant à faire avec la rédaction des manuels de physique sur lesquels s'échineront les adolescents de demain.
Nous savons désormais tous les deux ce qu'écrire veut dire.
Arthur qui rêve de faire quelque chose avec presque rien. Oui Arthur, c’est un très bon plan. Les restes tiennent toujours leurs promesses: petits objets, petites vies, petits bonheurs.
Louise, ma Louise, avec qui il m’aura fallu lutter ferme pour ne pas céder à ta proposition de monter une petite entreprise et tirer de ces objets une fortune. Oui, Louise, tu n’as pas tort, il y aurait de quoi faire, j’y ai songé, mais je les aurais trahis.
Lili enfin. J’aurais tant voulu suivre les conseils que tu m’as fait parvenir l’autre jour à Château-d’Oex. Voilà ce que tu m’écrivais:
Salut papa, je suis rentré de mon super camp d’équitation, j’ai monté Katlaya. Sinon nous sommes allés manger des crêpes, à Rue, elles sont trop bonnes. Je te raconterai la suite quand tu rentreras.
Pour le reste, prépare bien ton discours. Petit conseil, utilise des mots majestueux, je sais que ça ne veut rien dire, mais je fais de mon mieux.
Bonne soirée, ne bois pas trop, car ça ne va pas pour les discours. Bref, fais une belle nuit avec de beaux rêves.
Lili, ma Lili, je ne sais pas si tu es contente de mon discours, tu me le diras tout à l’heure, mais je peux te l’assurer, j’ai fait de mon mieux.

Merci à vous tous d’être montés jusque-là, dans la nuit de ce pays de loups.
Jean Prod’hom
Photo : François Corthésy et Romain Rousset






