Si les moyens m’en étaient donnés

Si les moyens m’en étaient donnés, je ferais en sorte que les mécanismes qui conduisent à la résilience (au sens où je l’entends) soient enrayés dans le cerveau des élèves qui deviendront des enseignants. Autant dire qu’on trouverait vite des réponses adéquates à la question des devoirs, au régime des peines, à l’organisation du rythme scolaire. Et reviendrait un peu de paix dans les maisons qui en ont tant besoin.

Jean Prod’hom
Rien ne nous distingue d’eux

Rien ne nous distingue d’eux, sinon un divorce, un divorce consommé, sans lequel il eût été impossible de nous concilier les bonnes grâces des fantômes et d’en faire nos alliés, de monter sur la lune, de survivre au tonnerre, à la foudre, de réduire nos approximations et d’aménager nos maisons.
Mais aussi – c’est le paradoxe et c’est l’histoire – de concevoir les remèdes qui tout à la fois nous permettent de différer la réconciliation et de recoller quelques-uns des morceaux nés de cette silencieuse déflagration. Pour nous faire patienter.

Enfants très à la fois,
hantés dedans, hantés dehors,
enfants presqu’entiers.
Jean Prod’hom
L'acharnement des élites

L'acharnement des élites à vouloir aligner tous les enfants sur les meilleurs, – au sens où elles l'entendent, c'est-à-dire les leurs –, a permis de reconduire avec l'aide des enseignants leur autorité sur cette institution et de transmettre à leurs propres rejetons – ainsi qu’à ceux de leurs valets – leurs rêves et leurs privilèges.

Quelque chose s'est pourtant grippé depuis quelques décennies ; les élites d'autrefois ont perdu de leur autorité en laissant filer leur pouvoir, les élites économiques ont repris le flambeau et, comme on le dit à tout bout de champ, le niveau baisse.
Pour faire taire cette rengaine, il suffirait d’aligner nos cohortes de gamins sur les plus faibles, c’est-à-dire de les affamer plutôt que de les goinfrer ; le niveau ne cesserait de monter, même chez les bien nés.
Ce renversement est pourtant inconcevable aujourd’hui, utopie c’est sûr, il nécessiterait une solide révolution des mentalités : passer d’une pédagogie du couvercle à une pédagogie de l'assiette. Qui impliquerait de tels bouleversements dans l'organisation de nos institutions qu'il est préférable de ne rien espérer, ou de désespérer aussi longtemps que le couvercle de la marmite n’aura pas étouffé, écrasé, asphyxié, mis en purée notre marmaille, et qu’il n'en sortira plus rien.
Jean Prod’hom
Abandonner l’ombre pour la proie

Abandonner l’ombre pour la proie, le nom pour le visage et reconnaître dans les tâtonnements de l’élève, sa lassitude, ses joies, ses tourments, ses égarements, un monde qui se lève. En tenant résolument à distance l’empathie nue, si mauvaise conseillère, qui conduit le maître à parasiter le territoire de son élève en lui faisant croire qu’il lui est un peu redevable de ce qui lui arrive.
Si le maître est indispensable, ce n’est pas en ce sens, pas non plus parce qu’il en saurait plus sur le monde, c’est parce que l’élève a besoin que quelqu’un demeure inaccessible en occupant la place de l’autre ; et pour qu’il parvienne à y rester sans faillir, le maître doit prendre conscience, enfin, qu'il est le principal obstacle à l’apprentissage de son protégé, et le rester aussi longtemps que celui-ci n’a pas jeté son dévolu sur d’autres horizons.
L’école n’est pas, d’abord, une machine à transmettre des connaissances, ni un laboratoire à produire des grimaces, des rires et des pleurs, ou une fabrique à mauvais souvenirs dans laquelle l'enfant apprendrait, comme c’est si souvent le cas, à s'endurcir et à faire bande à part, mais un abri où il s’essaie à devenir un parmi les autres dans un monde en partage. La connaissance suit.

Jean Prod’hom
Les enfants rêvent

Les enfants rêvent lorsque les lumières de leurs parents projettent des ombres géantes. Ils s’en éloignent alors, non pas que ceux-ci n’aient pas été à la hauteur de leur tâche, bien au contraire, mais parce qu’ils se sont montrés incapables de revenir sur terre et de les entretenir de ce qu’ils ont dû passer sous silence pour en arriver là.
Au enfants de prendre au sérieux les ombres que leurs parents leur ont laissées, de déchiffrer leur danse ; de leur donner un visage, un nom, et un peu de cette lumière qui projette sur le rivage l’ombre de nos constructions de sable.

Jean Prod’hom
Deux jeunes institutrices

Deux jeunes institutrices boivent un thé sur la terrasse ensoleillée d’un tea-room du nord-vaudois ; elles évoquent la rentrée – c’était lundi – , se plaignent du peu de maturité de leurs élèves, de l’inefficacité des transports scolaires, de la responsabilité défaillante des parents, de l’aide de la direction qui ne vient pas.

Elles insistent pourtant sur la beauté d’un métier qu’elles ont choisi, elles ne se sont jamais vues ailleurs. Elles évoquent leurs joies, leurs satisfactions et l’arrivée du nouveau prof de gymnastique. Elles confessent pourtant certaines de leurs difficultés et de leurs craintes, puis se moquent, gentiment, de l’une de leurs collègues qui, disent-elles, n’a vraisemblablement pas changé ses manières de faire depuis qu’elle enseigne. Elles racontent leurs projets, discutent pédagogie, avant d’échanger quelques-unes des idées qu’elles ont décidé de mettre en oeuvre.
- Je vais installer un coin-lecture, comme l’année dernière, au fond de la classe. Il suffit de dérouler un morceau de moquette, pas trop salissante, de placer contre le mur deux mini-matelas, à angle droit, et trois ou quatre coussins, jolis, de couleur, pour le confort. Quelques livres et le tour est joué.
- Tes élèves s’y rendaient souvent ?
- Non, jamais ! Tu sais, avec moi, ils ont toujours quelque chose à faire.
Jean Prod’hom
Heure blanche ce matin

Heure blanche ce matin, Cossonay par la fenêtre de la classe 210. En contrebas l’entaille de la Venoge, au-dessus Mont-la-Ville, d’où sort un fil qui se tend à flanc de coteau jusqu’à la Praz ; plus haut la ligne verte du Jura, plus haut encore le ciel bleu. On devine le moulin de Lussery et la Sarraz, et le canal d’Entreroches, creusé dans le calcaire du Mormont par un Fitzcarraldo du XVIIe siècle, Elie du Plessis-Gouret, Breton établi à Delft. Regret. Ce rêve de grandeur, abandonné en 1648, aurait permis enfin de mêler les eaux du Nozon avec celles de la Venoge, et fait de Pompaples le centre de l’Europe, plaçant les ronges-pattes à mi-chemin de Marseille et de Rotterdam.

Nous avons, du second étage des nouveaux bâtiments scolaires de la commune, une vue qu’aucun collège n’a jamais eue, baies vitrées si larges qu’elles permettent d’embrasser le monde de Genève à Bullet. Pourtant, il n’est pas si simple de détourner de leur tâche les enfants qui nous ont été confiés. Pas étonnant puisqu’on n’a cessé de leur répéter qu’il sont là pour travailler, qu’il est préférable qu’ils ne se laissent pas distraire et qu’ils persévèrent, malgré la peine, qu’ils avancent, avancent encore, Dieu seul sait où. Comment ces gamins pourraient-ils entendre dès lors l’invitation qu’il leur est faite d’aller rêver, nez contre la vitre, aux innombrables villages qui sommeillent ce matin, de répéter leurs noms : Sévery, Grancy, Vullierens et Senarclens, Apples et Ballens ; de buissonner le long du Veyron, et du Toleure, de l’Aubonne et de la Morges ; d’évaluer leur pente et les distances qui séparent les villages, de compter leurs habitants et d’écouter les histoires de leurs ancêtres, de suivre le tracé des deux tortillards et s’étonner.
Il semble que la fenêtre ne soit pas une ouverture, n’autorise pas le passage ; un courageux pourtant, parfois, suit d’un oeil distrait l’agitation d’une mouche qui cherche une issue, s’agitant contre les vitres, sur lesquelles on a collé, il y a quelques jours, des oiseaux noirs, leurres, ombres immobiles chargées d’avertir leurs frères de lumière, de ne pas venir s’écraser contre ces invisibles obstacles et les conchier, perturbant ainsi l’étude de nos gamins.
Rien décidément n’entrera dans cette salle ni n’en sortira, si bien que le château de Vufflens, la Dôle, Pampigny et Montricher, qu’on aperçoit au loin, n’auront pas plus de réalité que des rêves oubliés, et bien moins que les images de ces mêmes villages, de ces mêmes rivières, ces mêmes trains, ces mêmes hommes dans un livre de géographie ou d’histoire.
Pas sûr que l’école soit le meilleur moyen donné à ceux qui y entrent d’en sortir, ce n’est pas nouveau. Mais qui ira au chevet, depuis dedans, de ce qui se voit dehors ?
Jean Prod’hom
Il n’est peut-être pas si idiot de penser

Il n’est peut-être pas si idiot de penser que le découpage disciplinaire auquel sont soumis les institutions scolaires constitue une lointaine conséquence de la division du travail, elle-même issue de la sédentarisation de notre espèce. Cette division a permis à certains de faire main basse sur les champs d’activités et, parmi eux, sur les régions de l’encyclopédie, en contrôlant les entrées et les sorties, en traçant des limites et en ménageant des passages, en établissant des langages et en cryptant des sésames. C’est vrai, cette conception a fait ses preuves ; plusieurs fois millénaires, elle ne compte pas ses réussites.

Pourtant, les frontières entre les domaines de la connaissance (comme celles entre les états) tendent à redevenir poreuses ; et les succès dans la recherche dépendent toujours davantage de collaborations, d’échanges, d’emprunts, de mélanges, de greffes, de métissages, de traductions,... amenant l’ensemble des connaissances à redéfinir sans cesse les limites de leur territoire.
On pourrait souhaiter que la formation de nos enfants profite également de cette tendance et ne demeure pas aux mains d’enseignants issus d’une conception révolue de l’encyclopédie : géographie, allemand, histoire, mathématiques, physique..., une conception qui perdure certainement par inertie, mais aussi, et comment ne pas les comprendre, parce que ses dépositaires en tirent aujourd’hui leur gagne-pain.
Imaginons un instant que l’école se mette au diapason et renonce au découpage disciplinaire ; la voici qui serait amenée à réorganiser le temps scolaire, à reformuler le rôle des enseignants et à mobiliser l’enfant dès son entrée en classe, à mille lieues de cette vie de cul-de-plomb assisté qui caractérise l’écolier européen, enfermé dans une double grille, horaire et disciplinaire.
Celui-ci pourrait goûter un instant encore au plein air et aux joies des chasseurs-cueilleurs dans le jardin cadastré et protégé du néolithique dont nous ne sommes pas sortis, en songeant aux gains qu’il pourrait tirer personnellement de l’ensemencement du tout avec le tout, tout en rejoignant la fête mystérieuse à laquelle, qu’il le veuille ou non, il participera activement jusqu’à la fin.
Je rêve naturellement, mais j’ai entendu dire l’autre jour que les Finlandais – dont l’école, je crois, a fait ses preuves depuis plusieurs décennies – avaient pris le parti de se débarrasser des disciplines. Il faut que je vérifie.
Jean Prod’hom
C’est le 21 août 1989

C’est le 21 août 1989, il est 7 heures 30. La salle de classe est encore vide, mais des piles de livres et de cahiers trônent sur le bureau ; avec des agendas, un horaire, un programme, des chartes, des tableaux, des listes, une chaîne téléphonique, les dates des devoirs surveillés, du petit matériel, l’inventaire des tâches, des règlements et l’échelle des sanctions.
Tout devait aller droit lorsque les gamins entreraient ; c’était à moi de plier, si nécessaire, l’imprévisible aux impératifs, de le marier au dispositif, de le courber aux objectifs. Et si, malgré toutes les précautions, un peu de vie trouvait une ouverture, il suffirait de lui faire une petite place, ou de le feindre. L’imprévu s’épuise vite si on prend les mesures nécessaires, surtout qu’il ne fasse pas tache d’huile : fermer les portes et les fenêtres, et lui aménager une niche aux dimensions de la page A4. L’embarcation aurait tôt fait de rejoindre l’invisible chenal que chacun emprunte depuis 1803, de génération en génération.
J’ai voulu très modestement, à mon échelle, remettre sur ses pieds une école qui allait sur la tête, empoisonnée par des idées et des partis pris, une institution constamment sur le qui-vive, devenue timorée, méfiante, frileuse.

Dernière rentrée scolaire demain matin. Sur un post-it, le rappel de quelques rendez-vous pris l’année dernière, et quelques fragiles convictions : les gamins ne sont pas des idiots et l’occasion fait le larron ; l’imprévisible fait partie de notre condition et certains biens sont souvent mal acquis ; la connaissance ne se construit pas brique à brique ; les programmes ne viennent qu’à posteriori souligner l’importance qu’une génération donne à certaines choses et à certains événements ; les nouveautés apparaissent à ceux qui acceptent d’avancer désarmés et parfois déboussolés...
Bien dormir surtout et m’y rendre sur un tapis volant, prendre les vents ascendants et ne pas les détourner de l’essentiel : lire, se repérer, écrire, observer, dire, balayer, raconter, calculer, s’égarer, écouter, rêver passer... Autant de verbes consubstantiels à nos vies. C’est déjà ça.
Jean Prod’hom
Dans les lourds sacs à dos de nos gamins

Dans les lourds sacs à dos de nos gamins, des livres, des cahiers, des brochures, des dossiers qui voyagent de l’école à la maison, de la maison à l’école, à l’image des bûches de foyard que leurs grands-parents apportaient autrefois pour nourrir en hiver le poêle qui les réchauffait. Les temps ont changé, un simple parpaing règlerait désormais l’affaire.

Jean Prod’hom
Le maître se doit de maintenir

Le maître se doit de maintenir
ses élèves à distance,
aussi longtemps qu’ils en sont affectés.
(Le maître n’a qu’une seule tâche,
celle de maintenir ses élèves à distance, en jouant petit,
aussi longtemps qu’ils n’ont pas pris la main.)

Jean Prod’hom
"Écrire est évidemment sans importance"

Écrire est évidemment sans importance, il n’importe pas d’écrire. C’est à partir de là que le rapport à l’écriture se décide. (Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre)
Ceux qui en appellent à la professionnalisation – dans des domaines qui demeuraient jusque-là en marge de l’économie et qui avaient pour vocation d’offrir un lieu tiers d’où interroger le monde, librement et dans toutes ses dimensions – doivent prendre garde.
En exigeant pour chacun de leurs actes une contrepartie et en cherchant à asseoir des activités qui supposent précisément qu’on vive debout, ils émettent un mauvais signal, disent leur dépendance et invitent les comptables à affiner le tableau des gains et des pertes. Le recours au concept de professionnalisation constitue le premier moment, idéologique, d’un consentement et d’une mise au pas, avant que le marché fasse le reste et la loi. On aura le temps alors de s’attrister et de mesurer la réduction accélérée de ce qui aura pris l’allure d’une peau de chagrin.
On en a fait la cruelle expérience dans le domaine de l’enseignement, elle pourrait être reconduite dans le domaine de l’art.

Jean Prod’hom
Elle est grande

Elle est grande, brune, étanche, c’est une force de la nature. Elle a un faible pour les longs couloirs des administrations, tient depuis toujours, dans la main droite, un trousseau de clés auxquelles elle fait sonner périodiquement le tocsin. Elle aime s'entendre venir de loin, au pas, s'aligne avec elle-même, à gauche et à droite des portes vitrées, roule ses lourdes hanches. Elle a servi depuis le temps plusieurs institutions : police, école, institution religieuse, prison, colonie de vacances.

Dedans, la méchanceté et la suffisance macèrent, ça ne se voit pas, la donzelle sait où mettre les pieds. Si le vent tourne, elle se replace, demi-tour ou culbute. Toujours prête à donner à celui qui peine le coup de main qui l'achèvera, ça ne coûte rien : un mot tordu, une savonnette, une encouble, une grimace, un peu d'acide. Elle écoute, collecte les rumeurs qu'elle jette dans son alambic, il en sort du vinaigre qu'elle verse sur les plaies.
Ne vous méprenez pas, la dame aux yeux gris-vert est sensible ; elle s'est décidée pour un second tatouage, un joli tatouage, un papillon peut-être, sur le mollet ou sur l'épaule, elle hésite encore.
Les plus lucides se taisent, craignent qu'elle se dégonfle et qu'ils l’aient sur les bras. Ils la laissent faire, alors elle continue.
Jean Prod’hom
Personne n’a jamais entendu la gamine élever la voix

Personne n’a jamais entendu la gamine élever la voix, tout le monde pourtant s’en souvient, elle avait l’art délicat de faire précéder chacune de ses réponses par deux ou trois hochements de tête, lents, de consentement, qu’un sourire de tout le visage accompagnait et qu’elle répétait tandis qu’elle parlait. C’était comme une mise à terre qui nous assurait qu’elle avait bien compris notre intention, mais qui nous prévenait également qu’elle ne nous en en dirait pas plus et qu’il serait inutile d’insister, quelle que soit la teneur de sa réponse.

Lorsque je l’ai connue il y a quelques années, elle étudiait en secret le japonais ; de ne rien dire de cette passion, trois ans durant, de ne pas songer à la partager, de la maintenir ainsi intacte, l’avait conduite à faire circuler, à son insu, le charme en partie imaginaire qu’elle prêtait à cette langue et à cette culture qui l’envoûtaient. Cette différence indicible, légère en direction de laquelle son esprit tendait et dont elle ne savait trop quoi dire, l’avait rendue différente des autres.
Par ces hochements de tête, elle indiquait à qui voulait l’entendre que la conversation pouvait avantageusement remplacer l’interrogatoire, le consentement la panique, la mise à terre la mise à mort. Elle soufflait à ses maîtres et maîtresses que des baguettes pouvaient se substituer aux couteaux et aux fourchettes pour observer, pincer, approfondir, être au monde.
Jean Prod’hom
C’était un gamin attachant

C’était un gamin attachant ; lorsqu’une balle s’échappait de sa raquette, à la verticale, il attendait de longues minutes la tête dans les nuages, assuré que le ciel la lui rendrait bientôt.

Jean Prod’hom
Si les récalcitrants sont envoyés derrière la porte

Si les récalcitrants sont envoyés derrière la porte
– ou font l’école buissonnière –, c’est parce qu’on en a besoin.
Ce sont eux les héros de demain, des romans mis au programme.

Jean Prod’hom
Les réponses sont éphémères

Les réponses vont de l'avant.
Les questions veillent,
en retrait.

Jean Prod’hom
Vous voulez en finir avec les questions

Vous voulez en finir avec les questions de vos gamins,
exigez des réponses.
Jusqu'à épuisement.

Jean Prod’hom
C’est une impression

C’est une impression, j’entends des voix, je n’y puis rien ; nos établissements de formation ressemblent toujours davantage à des associations de malfaiteurs chargés de faire tenir la baraque, qu’importe le prix et les sacrifices. Insaisissables comme les pieuvres, comme la bêtise, je le dis, c’est mon devoir, mes réserves. J’avertis de dedans, depuis 30 ans, colère, argumente, invente, propose, vitupère.

Les chiens aboient, mordent, rabattent le sens dans le caniveau des eaux usées, tandis que nos enfants allument les langues de bois. Vous comprenez ? Nos gamins ne sont ni brebis ni porte-greffe.
Je ne peux m’empêcher de penser au jour où un inconnu déposera plainte, au prétexte que nos institutions de formation mettent en danger certains de ceux qu’elle prétend émanciper. J’irai en prison, vous m’apporterez des oranges.
Aucun refuge, inutile de pousser nos enfants vers le grec, la cuisine ou le latin, la théologie ou la photo argentique, aucun n’est plus à l’abri.
Ce soir, je pleure ; j’entends pourtant, dans la débâcle, la voix de nos gamins qui disent, se taisent, pensent, vont, jouent, crient, lisent. A tort et à travers. Ceci n’est que littérature.
Jean Prod’hom
Un jour les hirondelles

Un jour les hirondelles,
une nuit les chauves-souris
ne reviendront plus.

Jean Prod’hom
Génie helvétique (Chalet des Enfants)

Coup double.
D’abord ceci : Madame la Municipale m'a remis le cahier des charges pour la rédaction de la brochure communale à l’attention des candidats à la naturalisation. Je m'étais montré intéressé lors de l'apéritif servi à l’occasion de l'inauguration des nouveaux bâtiments scolaires. Elle m’a relancé l’autre jour, j'ai accepté tout à l’heure : les élèves de 10P concevront et réaliseront la brochure qui sera donnée aux candidats à la naturalisation : institutions (démocratie, fédéralisme, Etat de droit, la Suisse dans son environnement international), histoire (fondation et extension, domination bernoise, grandes dates) géographie (Suisse, cantons, canton de Vaud, démographie, régions naturelles, bassins fluviaux, lacs, langues), commune (autorités, population, alentours, sociétés locales) et actualité.
Qu'une commune fasse confiance en ses propres enfants pour un tel travail me ravit. Ce sont eux en effet les plus aptes à faire entendre ce qu'ils sont en train de découvrir : le milieu dans lequel ils sont nés et vivent, objet complexe s’il en est, en usant d’outils que l'école sépare artificiellement. Avec pour objectif, celui de réduire le génie helvétique en une trentaine de pages.

Second miracle ensuite : une dizaine d'élèves, après plusieurs semaines de palabres et d'errances, ont rédigé entre deux et trois la première version d'une initiative fédérale qu'ils vont déposer et défendre en novembre prochain à Berne.
Elle vise à donner une réponse à la peur qu’ils éprouvent devant l’étranger, et plus largement face celui qu’ils ne connaissent pas. Selon deux directions : la première, finalement abandonnée, visait à multiplier les contrôles aux carrefours et à surveiller les allées et venues de chacun pour mettre dans la foulée la main sur l’assassin ou le pédophile, et lui infliger la peine qu’il mérite. Avec la conviction que les sanctions encourues feraient hésiter puis renoncer ceux qui sont sur le point de désobéir.
La seconde direction, finalement retenue, remonte aux sources ; elle vise à combattre la peur en offrant à chacun l’occasion de s’approcher de celui qu’il ne connaît pas, en aménageant des lieux pour accueillir l’un et l’autre, en imaginant des activités qui favoriseraient les échanges. Mouvement d’intégration donc. Mais les élèves se sont rendu compte que si la mise à disposition de ces lieux, l'organisation de ces fêtes, l'encadrement de ces manifestations, entraînaient des coûts, ils pouvaient être en même temps à l’origine d’économies importantes dans le domaine social – qu’ils sont bien en peine de chiffrer. Ils ont compris également qu'il serait contrindiqué d'obliger quiconque à entreprendre de telles actions, qu’il serait au contraire préférable d'encourager et d'aider ceux qui voudraient s’y engager ; c’est le rôle de la Confédération. Aux cantons, aux communes, aux institutions le soin de prendre des initiatives et de mettre en oeuvre leurs projets.
Voici en primeur la première version du texte de cet article 42, que les élèves proposent d’ajouter à la Constitution fédérale de la Confédération suisse :
Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté
et buts sociaux
Chapitre 3 Buts sociaux
Art 42
La Confédération encourage et subventionne les projets des cantons et des communes favorisant l’intégration sociale de tous.
Des semaines de travail, de discussions, de tensions, d’engueulades, d’incompréhension. Au bout une seule phrase qui danse, aussi belle et profonde que le plus beau des poèmes. Je crois bien que ces chenapans ont touché cet après-midi, par je ne sais quelle grâce, au génie helvétique.
Jean Prod’hom
Mottier D (Mont-sur-Lausanne)

On ne répétera jamais assez, les architectes qui ont réalisé nos bâtiments scolaires ont fait du beau travail. Leurs constructions résistent aux intempéries, fournissent à nos gamins un abri sûr qui aura permis aux officiers de l’instruction publique d’agir par n’importe quel temps, au diable les saisons. C’est la première de leurs vertus.

Pas que ! Les gamins ainsi mis en quarantaine ont tiré d’autres bénéfices de cette opération, immenses, notamment celui de leur permettre de s’écarter du flux qui les emportait, de décoller leurs yeux de l’immédiat, de faire quelques observations, guidés par les maîtres qui les avaient circonscrites puis neutralisées, de refaire les analyses en vogue, d’objectiver les caractéristiques qui ont fait leurs preuves, de toucher enfin, du bout des doigts, l’universalité.
Cette mise en quarantaine – personne ne compte plus les heures – n’aura pourtant pas été sans danger. Certains de nos gamins se sont en effet mis à penser que le réel – que l’on croyait leur donner à voir – n’était en réalité qu’une extension approximative du laboratoire dans lequel ils avaient été formés, une extension aux bord flous, un fantôme qui n’avait pas su se plier à l’étanchéité et à la docilité de la pièce chauffée dans laquelle ils avaient grandi et pensé.
Certains parmi nous se sont inquiétés : en isolant le savoir de son bourbier, en déconnectant la connaissance de son énonciation et de la communication qui président à son élaboration, on risquait de séparer pour toujours la fleur du terreau qui la nourrit, d’ignorer les greffes et les mauvaises récoltes, les sécheresses et les années d’abondance.
Nous nous sommes alors avisés qu’il devenait toujours plus difficile de maintenir le pont qui tient ensemble l’ordre de la connaissance et celui du réel, que les savoirs aseptisés dans lesquels nous baignions nos gamins constituaient toujours davantage un piège qui les amenait à faire toujours moins de crédit à l’ordre premier qui les avait vu naître et dans lequel ils étaient appelés à retourner. Si bien que le laboratoire dans lequel nous les avons nourris pour qu’ils ne restent pas dépendants de leur immédiate ignorance, pour qu’ils s’en affranchissent même et goûtent à cette double vue sans laquelle on ne voit rien, s’est refermé sur eux comme une nasse, les menaçant d’une double nuit : celle d’une connaissance détachée des objets de l’expérience, celle d’un réel livré à la passion.
Jean Prod’hom
Salle 107 (Mont-sur-Lausanne)

D’être aujourd’hui ici, avec eux, seuls ou par deux, est le produit d’un concours de circonstances qui n’en finit pas, mais aussi de l’obstination des plus convaincus. C’est grâce à leurs dons de voyance que nous usons, presque tous, de l’écriture et de la lecture, sans lesquelles nous serions encore enchaînés à l’immédiat, inaptes à goûter de la liberté seconde, éclairée, éclairante, qui nous a rendus aptes à suspendre, à différer nos actes et nos jugements à l’emporte-pièce.

Beaucoup d’entre nous ont oublié cette genèse, ou ne l’imaginent qu’à peine, s’assoient chaque matin en traînant les pieds, avançant pour leur défense qu’il en sera ainsi aussi longtemps que l’obligation institutionnelle bâillonnera leur liberté première.
Un retour à l’immédiateté de seconde génération menace, susceptible de ramener l’espèce au rang des bêtes que nous avons été, analphabètes, livrés à la violence dont nous croyions nous être écartés pour toujours et qu’on voit poindre à nouveau. Il conviendrait donc, à côté des contenus colportés par les livres et par ceux qui sont supposés savoir, de faire voir et entendre ce qui les a rendus possibles, ce mystérieux retrait et ce sursis que nous ont apportés l’écriture solitaire et la lecture silencieuse.
Jean Prod’hom
Des gamins peu enclins à mettre le feu

Cher Pierre,
Les quatre bibliothèques sont en place depuis hier ; Guillaume revient ce matin, avec son frère, poser à l'étage les meubles de rangement. Ils dégagent ensemble le recto et le verso d’une belle assurance, heureux à l’idée de rencontrer, quels qu’ils soient, les problèmes qu'ils sauront résoudre. Ils se parlent comme deux frères qui ne se seraient pas revus depuis des années ; ils s'appellent, eh frérot, s’encouragent et se conseillent, plaisantent. On boit un café à 10 heures.

J’ouvre de mon côté le portail d'accès sécurisé aux ressources de l'Etat de Vaud avec le doigté d’Edward Snowden : nom d’utilisateur, mot de passe et authentification forte, façon matrics ; j’y dépose – l’école décidément exagère – les derniers résultats des élèves. Puis range quelques livres.
Le brouillard que j'ai laissé, hier soir, à l'entrée de Corcelles s’y trouve encore. Je monte avec Oscar à la Moille-aux-Blanc assister au spectacle. Le brouillard stagne dans les vallées de la Veveyse et de la Broye, cache le Mont-Pèlerin. Je salue par-dessus l’immense édredon mes frères des Pléiades et des Paccots.
Les filles rentrent à midi, je glisse au four le gratin que Sandra a préparé hier, lave une salade et coupe quelques fruits en quartiers. Il faut faire vite, une demi-heure pour manger et respirer c’est peu : je suis opposé à l’horaire continu. Lili a plus de chance, elle a congé et reste à la maison ; je dépose Elsa et Louise devant le cimetière de Mézières.
Dix des vingt-six élèves de 9P sont capables désormais de mettre en page sur rapidweaver leur billet et ceux de leurs camarades. En me libérant de cette tâche, les élèves font de moi un meilleur lecteur. En retour leurs billets s'améliorent au fil des semaines, avec pour conséquence de donner des exemples à ceux qui cherchent en vain l’idée qui les sauvera de leur petit néant. Un élève lance un débat sur le site – le premier de l’année – autour de la COP21; il glisse au passage qu’il a signé la pétition dont parle Nicolas Hulot.
Une maman d'élève a souhaité me voir, on a rendez-vous à 17 heures ; son mari, elle et ses deux enfants ont quitté la vallée de la Chevreuse et le cours de l’Yvette au début de l’année. Tout va bien, mais s'intégrer ne se fait pas d'un coup.
David qui travaille dans la classe parallèle évoque l'inertie du groupe d'élèves dont il est le référent. Des gamins à l'image du temps qui les a vu naître, peu enclins à mettre le feu, à s’interroger sur l'équilibre miraculeux des choses, à s’en informer et s’en étonner.
Nous sommes entourés de mules doctrinaires, précautionneuses à l'excès, présomptueuses par nécessité ; piégées dans leur box par le confort, les compléments alimentaires et les mesures de sécurité, un cadenas toujours en réserve. C'est l'autre dans l’aventure qui se dérobe et s'éloigne. Où donc poser désormais le pied et marcher lorsque le jour se lève ? Où placer le levier ? Je crois mieux deviner ce vers quoi tend le regard du saint Augustin de Carpaccio à Venise, l’oeil rivé sur ce qui lui manque et qu’il maintient, ainsi, aussi éloigné qu’il le peut, et qui fonde en retour la singularité de son existence. D'avoir voulu combler cette distance en multipliant les dispositifs optiques aura certes livré quelques secrets, mais cette aventure aura également conduits beaucoup d’entre nous, par une espèce de passage à la limite, à croire que l'autre avait été définitivement rapatrié dans le même. Aux non-dupes de faire entendre à nouveau l’irréductible altérité du monde.
Bernard Stiegler dit des mômes qu’ils ont besoin de s’identifier à leur père, puis à une figure de rupture avec le père qu’ils accusent alors de ne pas incarner correctement et sincèrement la loi. Ils cherchent alors d’autres figures identificatoires. Mais s’ils ne trouvent plus de possibilité d’identification dans la société, et s’ils vivent dans une société qui est en train de s’effondrer, ils sont prêts pour s’engager dans ce que j’ai appelé une sublimation négative – qui peut conduire au pire. Ce sont là encore des symptômes. Pour répondre à cette impossibilité d’identification, Bernard Stiegler en appelle à la société qui se doit de produire au plus vite des capacités nouvelles d’identification positive sur des idées républicaines, constructives et vraiment porteuses d’avenir. Je crains que de telles figures identificatoires, lorsqu’on attend que la société les produise, ne fassent pas long feu. Ces figures identificatoires sont peut-être là, lointaines et sous nos yeux.
Le café de l’Union a des airs de fête, la patronne a sorti des guirlandes rouges et d’argent, collé sur la porte des étoiles poudrées de blanc, des flocons, des bougies et des fausses barbes, une crèche à droite de l'entrée, je vois mal ce qu'on pourrait y ajouter. J'embarque à la fin de l’entraînement Lili et ses deux amies que je dépose à Mézières. Guillaume est parvenu à poser cet après-midi le meuble de l'entrée, les travaux sont cette fois bel et bien terminés. Ah! non, il reste deux plinthes.
Jean Prod’hom
Je fais le rabat-joie

Cher Pierre,
Les excellents résultats des élèves de 9ème année devraient me réjouir ; il serait en effet inhumain de résister aux larges sourires que ces réussites ont dessinés sur leur visage et au soulagement que leur annonce provoquera dans le giron familial – ils le savent lorsqu’on se quitte – sitôt le seuil de la maison franchi.

Mais leurs succès ne me réjouissent au fond qu’à moitié. L’objectivité en effet à laquelle prétendent ou font croire ces travaux, et les malentendus nombreux auxquels cette naïve croyance conduit, font beaucoup de mal ; un mal qui compterait pour bien peu si les questions auxquelles les élèves avaient donné exacte réponse ne constituaient pas quelque chose comme la fermeture des horizons dont ils sont curieux et vers lesquels on voudrait les voir aller.
On pourrait joyeusement consentir à ces épreuves, mais à la condition que chacun en voie les limites, aussi bien ceux qui les pensent que ceux qui les subissent, en observant ou en étudiant les raisons pour lesquelles elles sont toujours mal conçues, et pourquoi quelques-uns les réussissent, d’autres échouent ou peinent.
Le bonheur qu’éprouve l’enfant qui fait ses premiers pas n’appelle aucune évaluation chiffrée, la découverte qu’il marche soudain un jour le comble, lui et ses parents. Le voici prêt à aller de l’avant par ses propres moyens, à franchir les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter, sans l’aide de ceux qui devraient se réjouir de le voir tourner les talons.
Je fais le rabat-joie, je n’y puis rien ; je ne vois que trop dans ces épreuves rituelles et les jugements qui leur sont attachés la ruse de l’institution de maintenir captifs ceux qu’elle feint de laisser libres, dans un espace étroit, circonscrit en réalité, entravé par les innombrables signes d’une sujétion objective.
À une heure de l’après-midi, le lendemain, la classe du Cours supérieur est claire, au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l’Océan. On n’y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche, mais les harengs grillés sur le poêle et la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés de trop près.
On a distribué, car la fin de l’année approche, les cahiers de compositions. Et, pendant que M. Seurel écrit au tableau l’énoncé des problèmes, un silence imparfait s’établit, mêlé de conversations à voix basse, coupé de petits cris étouffés et de phrases dont on ne dit que les premiers mots pour effrayer son voisin :
— Monsieur ! Un tel me…
M. Seurel, en copiant ses problèmes, pense à autre chose. Il se retourne de temps à autre, en regardant tout le monde d’un air à la fois sévère et absent. Et ce remue-ménage sournois cesse complètement, une seconde, pour reprendre ensuite, tout doucement d’abord, comme un ronronnement.
Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d’une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n’ai qu’à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs.
De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle-Étoile.
Je lis aux élèves de 10ème le huitième chapitre du Grand Meaulnes (Le Gilet de soie), puis fais voir à ceux de 9ème les images de la première partie du Peuple légendaire que Jean Malaurie a ramenées de ses expéditions chez le Inuits.
Un peu de soleil est resté, il éclaire comme une bougie le rêve d’une classe vide de maître et d’élèves, il y a tant à faire sur la banquise, à apprendre dans les livres, à regarder dans le ciel et les bois, il y a tant de domaines mystérieux.
Le pied de Louise va mieux, la pluie a cessé, je fais des croûtes au fromage et une salade. Arthur a raté le bus, il prendra celui de 21 heures 30. Enregistrement de la troisième partie de l’introduction du Gustave Roud de Philippe Jaccottet.
Jean Prod’hom

Renouer avec l'allégresse que la scolastique assèche

Cher Pierre,
Huit heures ! le feu brûle dans le poêle, la maison est vide, Oscar peu décidé à sortir. Je lis pour la seconde fois cette semaine la très belle introduction du Seghers que Philippe Jaccottet a consacré à Gustave Roud ; à haute voix, lentement, soigneusement, hésitant même un instant à en faire un enregistrement ; mais il me faut filer à Oron, acheter une ou deux choses à la COOP et revenir pour 11 heures 30.

Jean-Claude Sonney me fait visiter, malgré le travail qui le presse, l’ancien séchoir qui occupe le sous-sol de sa boucherie ; la bielle de l’antique compresseur, qui claquait des dents lorsque son père a repris le commerce en 1969, les claque encore. Le boucher se montre inquiet, parce que Noël arrive et parce que le beau temps va inciter les clients à différer leurs commandes jusqu’à la dernière minute. Les fêtes de fin d’année le mettent dans tous ses états ; heureusement, me dit-il, que je n’ai plus à abattre, j’aime mon métier mais j’ai tué bien trop de bêtes.
Je rentre au Riau avec dans les mains un bouquet de roses blanches pour Sandra ; deux bouquets de roses jaunes et de roses rouges pour Lili et Louise qui vont arriver ; je prépare le repas. Nous écoutons tout en mangeant la très belle chronique consacrée par Karim Karkeni sur Radio Vostok à Tessons, à Marges et à la rencontre au Café littéraire de Vevey la semaine dernière. Le temps passe trop vite, Lili et Louise repartent à l’école, je descends au Mont. Des couleurs de l’automne il ne reste rien, mis à part le vert tendre des épines des mélèzes virant à l’orange.
Les élèves de 9ème font encore beaucoup de théâtre, et cela va durer aussi longtemps qu’ils n’auront pas repris pied dans ce qu’ils rencontrent chaque jour et qu’ils traînent sous leurs souliers ; il faudra un mois avec certains, six mois ou une année avec d’autres, quelques-uns n’y parviendront jamais et continueront à jouer à l’école, avec le plus grand des sérieux, cherchant dans un désert d’images pauvres ce qu’on attend d’eux, une idée comme ils disent, ou imitant servilement ce qu’on leur propose en guise d'exemple, incapables de se réorienter vers une voie moins asséchante.
Je voudrais que les élèves se méfient des idées qui viennent toujours trop tôt, parasitant ce qu’ils aperçoivent étonnés, interdisant à ce qui leur échappe la possibilité d’aller de l'avant, de flotter, de dériver hors de la portée des idéologues que l’école a tendance à faire d’eux en les incitant à réduire tout ce qui tombe sous leurs mains aux dimensions des tiroirs qu’elle met à leur disposition. Il serait bon que les élèves renouent avec l'allégresse que la scolastique leur a dérobée et la confiance qui les habitaient avant d’y être admis.
Je crois que le dieu de l'enfance nous abandonne aujourd’hui aussitôt que nous nous installons sur les bancs de l’école, un dieu remplacé par celui qu'on connaît, mais qui dit à voix basse : « N’oubliez pas le dieu de votre enfance! »
On frappe à la porte, ce sont Catherine, Guillaume et leurs deux enfants qui viennent manger ; ce n’est pas encore ce soir que je récupérerai le sommeil qui me manque.
Jean Prod’hom
On appelle ça une révolution copernicienne

Cher Pierre,
La longue balade de ce matin a eu ceci de réconfortant qu’elle m’a rappelé que la terre pouvait aisément se passer des hommes et qu’en dehors de quelques lieux denses, elle demeure inhabitée.

Trente ans suffiraient pour qu’elle redevienne – nos déchets nucléaires mis à part – celle d’avant. Les hommes et leurs guerres comptent si peu à l’échelle de la terre que les premiers devraient raisonnablement se passer des secondes. Au cas où, les liquidateurs, s’il en reste, doivent savoir que, lorsque les hommes se seront entredétruits, le Léman suffira amplement à contenir dix fois les sept millards de victimes.
C’est pourtant un peu triste – n’est-ce pas ? – d’imaginer le filet d’eau du Riau de Corcelles, les fruits des fusains et les bras nus, levés ou pendants, des frênes et des saules en hiver, sans personne pour en témoigner. Je fais une halte chez Marinette qui m’offre une verveine ; elle me parle de la nécessité d’agir, moi des pages que Mankell consacre aux prochaines grandes glaciations. On s’étonne de n’avoir vu aucun chardonneret cette année, ni l’un ni l’autre.
Louise et Lili ont congé cette après-midi, je les laisse à la maison et m’en vais, un peu à contre coeur : ce qui me pèse dans ce métier, en définitive et toujours davantage, c’est la manière dont les portes se referment au moment même où on feint de les ouvrir pour préparer nos enfants à découvrir le monde, comme si ce qu’on leur demandait d’apprendre était arrêté et scellé dans des coffres, depuis longtemps déjà, bien avant même qu’ils en connaissent l’existence, qu’ils éprouvent le besoin de les ouvrir et de se saisir de leur contenu, chargeant ceux qui sont réputés savoir de leur préparer une pâtée indigeste qu’ils leur glisseront dans le gosier, comme on le fait avec des oies, cuillère après cuillère, selon un ordre et un rythme définis par des idéologues en manque de confiance. Ces pédagogies ont montré leur inefficacité et nos enfants hésitent à goûter à ces produits inertes et à tremper leurs lèvres dans ces eaux stagnantes.
Il ne sied pas d’anticiper ce que désireront ou ce dont auront besoin demain nos enfants, mais d’anticiper, approfondir, élargir et multiplier leurs besoins et leurs désirs, de leur fournir une assiette et de leur laisser à portée de main les outils dont ils auront immanquablement besoin. Lire, écrire, dire, écouter, calculer, se repérer, se souvenir n'ont nul besoin d'être encadrés par un programme pour faire la preuve de leur rôle essentiel, hormis pour les adultes oublieux. Tout le monde le sait, tout monde le dit, chacun l'ignore.
Disons le haut et fort, la refonte de l'école ne coûte rien, elle nécessite de remettre l’apprentissage à l’endroit, l’école sur ses pieds et de marcher avec la confiance dans le dos. On appelle ça une révolution copernicienne, elle prendra plusieurs décennies.
Sans vouloir généraliser, il conviendrait d’octroyer localement des moyens et un peu plus de liberté à ceux qui souhaitent faire la preuve de l’efficacité de pédagogies alternatives, au sein même de la maison, sans jamais fermer les portes. On sait depuis le naufrage du Titanic que les caissons étanches ne préservent pas du naufrage.
Je termine aujourd’hui la lecture des fragments (Sable mouvant) qu’Henning Mankell a rédigés en hiver 2014, instants de grâce sans lesquels la vie n’aurait pas de sens.
Jean Prod’hom



Aller à contre-sens, du côté de l’accompli (4)

Cher Pierre,
Au-delà des pâturages qui prolongent la terrasse du Chalet des Enfants, le soleil allonge sa courbe à deux doigts de l’horizon. Deux femmes chuchotent les petites misères du monde à la table voisine ; deux hommes se font plus loin les hérauts de leurs exploits d’écoliers ; flatus vocis mourant aux flancs de la barque que la fatigue aujourd’hui m’alloue, clapotis témoins de notre condition et du manque qui nous habite, rumeur qui entoure l’esseulé comme une île nos embarcations : beauté.

Marc-André a terminé ce matin les travaux de terrassement, je lui téléphone pour le remercier et lui demander s’il a une solution pour parer au danger que constituent par temps de pluie les traverses de chemin de fer détrempées ; Arthur qui n’a fait qu’un passage éclair,redescend en ville, dont il découvre, depuis qu’il est au gymnase, les mystères et les attraits. Je vais faire le petit tour avec Oscar, réduis son rayon avant la Mussilly pour ne perdre aucune miette du soleil. Le pâturage de Jean-Paul a été retourné par les sangliers, je traîne les pieds dans les feuilles mortes.
Je monte à la bibliothèque, conscient de l’urgence de rassembler ce que j’ai éparpillé depuis quelques jours et sur lequel je fais souffler deux fois le Stabat Mater de Pergolèse. Louise me demande de lui lire les chapitres 6 et 7 des Dix Petits Nègres, je m’y colle avec plaisir ; ne comprends rien au 6, me régale du 7. Je reviens à jeudi, qui manque encore singulièrement d’une colonne vertébrale, et à Pergolèse, qui n’a besoin de rien.
Je n’ai pas vu grand chose jusqu’à mes 16 ans, embarqué sans jamais avoir à écoper, faisant d’abord un avec ma mère, avec le monde ensuite.
J’ai commencé à voir double à l’adolescence, s’est mis à exister ce qui était et ce qui aurait pu être. Et j’ai pensé que notre bonne volonté, celle de mes amis et la mienne, serait en mesure de transformer tout naturellement les conditions réelles de nos existences ; nous nous sommes mis à vivre de peu, de pain et de vin, beaucoup de vin, sans nous occuper de ceux qui avaient plus que nous.
J’ai fermement pensé à vingt ans que la philosophie convaincrait les plus réticents qu’il suffisait d’inventer le futur ; nous nous sommes mis à parler par métaphores et nous avons commencé à nous méfier des concepts à l’emporte-pièce.
J’ai payé mon passage 30 ans durant, sur les bancs de l’école que je n’ai pas quittée, l’école vaudoise que j’ai voulu changer, là où j’ai été, ou ailleurs, en concevant du matériel scolaire, ou en formant des adultes.
Il m’a semblé que nous avions, Sandra et moi, touché au Graal en 1998 et 1999, dans un petit collège au nord de Lausanne. Nous étions sur le point de changer le monde. L’enfant qui est né de ces noces a changé la donne.
Je n’ai renoncé pourtant à rien de tout cela : rien ne vaut en effet une volonté bonne, lire un peu, une balade souvent suffit. Pour aller à contre-sens, du côté de l’accompli. Et donner vie et donner sens à ce qui ne l’est pas encore, au passé et à l’avenir, dans le présent de l’écriture. Chaque jour.
Jean Prod’hom
Nous préférons goûter à la mousse aux fraises

Cher Pierre,
Nous avons lu la semaine passée, les élèves de 10ème et moi, les premières pages du Grand Meaulnes ; j’ai risqué quelques observations. Je leur ai lu le second chapitre aujourd’hui, lento, bien décidé à poursuivre ces prochains jours, aussi longtemps qu’ils le voudront. A eux de continuer à voix silencieuse la lecture de cette merveille lorsqu’ils en émettront le souhait.

Je passe ensuite dix fois dix minutes en tête à tête avec dix d’entre eux, autour de l’abstract qu’ils auront à distribuer avant de lancer leur présentation orale. Pendant ce temps, les autres font vivre Cocktail, animé cette année par une soixantaine d’élèves qui lisent, écrivent, éditent et publient. Une dizaine sont désormais capables d’utiliser Rapidweaver et d’assurer, techniquement, la vie de ce site.
C’est encore difficile de diversifier, dans le même lieu, les activités avec les petits de 9ème, mais ils sont sur le bon chemin, et la manière dont ils s’adressent à leurs camarades est déjà remarquable. Je vérifie encore et toujours l’idée, somme tout évidente, que le principal obstacle aux apprentissages sérieux, c’est le maître. Dont la tâche la plus haute, vraisemblablement, est d’être aussi absent que possible et donc, d’abord, de se taire, d’entendre là où ils sont, ceux qui s’essaient à parler, en leur faisant voir sans rien leur montrer que tout est déjà là, à portée de leurs mains.
Je fais quelques courses à Mézières avant de rentrer : des fruits, de la pâte brisée, des épinards congelés et un gâteau de chez Ronny. Lili a fait son test d’histoire sur la fondation de Rome, elle espère que son prof n’y verra que du feu, car enfin, le Tigre et le Tibre c’est du pareil au même. Quant à la question de ce qui distingue l’histoire et la légende, je dois confesser à ma Lili que je serais bien emprunté de répondre à une telle question, les légendes ne sont-elles pas toujours des histoires ? Et au lieu de la renvoyer, elle qui a 11 ans, au legenda qui en dit tant, nous préférons goûter à la mousse aux fraises. On fête par la même occasion Louise qui a fait zéro faute à sa dictée, et Arthur qui a eu l’honneur de s’entraîner avec le roi du parkour à Lausanne, sous les feux de Couleur locale : Jesse Perveril.
Je lis, avant de reprendre Mankell, le 92ème chapitre que Jean-Louis Kuffer publie ce soir dans ses Riches Heures de lecture et d’écriture. Ses mots, où se croisent les deux enfants que nous avons été, réjouissent naturellement l’adulte que je suis devenu.
Jean Prod’hom
René Girard est mort : petit exercice d'admiration

Cher Pierre,
René Girard est mort en début de semaine, mais sa pensée demeurera vivante, c’est sûr, longtemps encore. Lorsque j’entre dans la classe 101, les élèves montent au milieu de chacune de leur table des murs de classeurs, à défaut de parpaings, qui les isolent, prévenant ainsi tout au long de l’épreuve leur désir d’aller brouter l’herbe du voisin.

Et ces contrôles de connaissances, aux formes très ritualisées, que l’institution nous enjoint d’organiser et qui, je le sais d’expérience, font plus de mal que de bien, engendrent davantage d’opacité que de clarté. Ils ont en réalité pour seule vertu celle de repérer ceux des élèves qui sont le plus à l’aise avec les langages de l’institution – ceux qui précisément pourraient se passer de ces contrôles – et à stigmatiser ceux qui ne saisissent pas les attentes de l’école, parce qu’ils ne parlent pas son jargon, se méfiant de ces épreuves qui leur rappellent, rituellement, qu’ils ne seront pas invités au grand raout.
J’interdis aux élèves de monter ces murs de la honte, leur autorise tout leur matériel, leurs notes, leur travail. En encourageant ainsi les échanges, quels qu’ils soient, l’enfant apprend vite qu’il est parfois mieux servi par lui-même que par autrui, et qu’il est souvent préférable de ne pas suivre aveuglément son voisin. Il sied que cette expérience soit faite par chacun. La mise en quarantaine régulière que mettent en place ceux qui croient bien faire, pour s’assurer que la connaissance est piégée dans la tête de l’enfant, la stérilise en la coupant de la circulation qui la nourrit.
Et, tandis que des enfants élèvent des forteresses pour prévenir le partage et jeter le discrédit sur le mimétisme qui donne vie à soi, à l’autre et à la connaissance, une moraliste fait un très beau prêchi-prêcha dans la classe voisine, rappelant mythes à l’appui la traditionnelle hospitalité des Européens. Elle évoque aussi le gâchis du mur grec, puis raconte l’apartheid sud-africain et les combats de Mandela, montre enfin un morceau du mur de Berlin acheté aux puces. On ne peut demander à nos enfants à la fois d’aimer leurs voisins et de garder pour eux-mêmes ce qui est à tout le monde. Partager s’apprend, en premier lieu sortir du double bind.
Ce matin, les employés communaux ont posé les pare-neige au-dessus de la Mellette. Je trouve en rentrant, dans la boîte à lait, Sable mouvant de Henning Mankell, Lettrines, Lettrines 2 et Liberté Grande de Julien Gracq. Me rends à 19 heures au comptoir d’Echallens pour signer quelques livres.
Jean Prod’hom

Quelque chose s’est refroidi

Cher Pierre,
Il reste sur pied, ici au Riau, un peu de maïs et des betteraves. Ce matin, Jean-David en déchintre un champ à la Moille-aux-Blanc, pour ne pas avoir à rouler avec son tracteur sur le pré voisin, en bordure duquel il entasse les fanes. Il en décollette deux rangées, qu’il viendra charger ce soir dans une vieille bennette.


Les sangliers ont sérieusement labouré le pré, ils sont partout, me dit Jean-David ; Jean-Paul a vu une mère et ses petits traverser la route en-dessous de la déchèterie, d’autres ont été aperçus du côté du chalet d’Orsoud. Les gens avisés de la commune estiment qu’ils sont plus de trente à écumer la région, il va falloir les tirer. On parle, on parle, mais Jean-David veut terminer ses deux rangées de betteraves avant de descendre à la laiterie ; la société de fromagerie dont il est le président se réunit en effet tout à l’heure pour une réunion extraordinaire. Il y a eu un pépin, la chaudière de 6600 litres, étamée de cuivre, est fendue. Les sociétaires devront décider s’ils la rapetassent ou s’il en achètent une neuve. La seconde solution serait préférable mais coûterait à la société 160’000 francs.
A l’autre bout de la journée, une conférence des maîtres ; ce sont d’autres soucis qui sont évoqués par le directeur, pendant plus d’une heure : la population qui croît, les règlements qui se multiplient, les budgets qui explosent, le ton qui se durcit ; les procéduriers en appellent au cahier des charges, les plus confiants bâillent. On dirait que le bon sens a pris la clé des champs, nous laissant avec un chaudron fendu ; on tente d’allumer ici et là des foyers, d’en étouffer ailleurs ; mais quelque chose s’est refroidi, quelque chose ronge l’intérieur du chaudron. On rapetasse en continu, avec du neuf ; on ajoute des couches supplémentaires qui ont pour seul effet d’alourdir l’édifice. Il ne restera bientôt, à l’intérieur, plus rien qu’un feuilletage d’enduits qui s’écaillent.
Jean Prod’hom
Il y a du Jan Vermeer dans ces fins d’après-midi

Cher Pierre,
En échange des heures passées à Grignan, je surveille cet après-midi les arrêts, dans le silence : les têtes de linotte liquident leurs arriérés ; les droits communs ont déposé les armes et se reposent : tenir le haut du pavé à journée faite les oblige à puiser dans leurs réserves, pas mécontents de vivre un instant loin des feux de la rampe, le temps de se refaire une santé. Ils rament léger, un stylo et une feuille, des listes et des trous qu’ils remplissent du bout du doigt, sans réfléchir. Ils vont bientôt aux toilettes, à tour de rôle, en traînant les pieds, s’étonnant d’une tranquillité dont ils ne sont pas familiers. Ils ont déposé en entrant leur fierté sur une chaise vide, nichent leur tête dans leurs bras, pas loin de s’endormir ; se redressent bientôt, inquiets à l’idée que ce bien-être ne les amène à changer quelque chose dans leur vie ; ils ne sont pas prêts, restent sur le qui-vive, personne n’est là pour les accompagner dans cette transition ; ceux qui leur ont promis un soutien ont une vie ailleurs. Alors ils se reprennent, l’état de grâce s’effrite, l’un d’eux couine, un autre grogne ; ils n’ont plus une minute à perdre, plient leurs rêveries, se réinstallent dans leur égo défaillant, si bien qu’ils sont prêts en sortant à rependre la galère, là où ils l’ont amarrée en entrant.

Aujourd'hui ressemble à hier, même hauteur du ciel, même pression atmosphérique, même régime de vent. Je parque derrière le garage, les filles sont dans le jardin, Nicole et Sandra assises sur le granit rose de la fontaine ; je dépose mon barda ; Arthur, qui héberge comme nous tous un être de raison et un indéfectible rêveur, hésite au coin de son lit.
Je monte jusqu'au triage, Oscar rayonne, nous longeons le repaire des bouvreuils, barré par les ronces, traversons la sapinaie jusqu'au refuge de Ropraz, empruntons le sentier qui rejoint le chemin aux copeaux, redescendons sur la route de terre qui mène à Froideville. Oscar me colle aux basques lorsque le sentier se fait sente, prend les devants lorsqu’il s’élargit.
Le grand marais sous la Montagne du Château a perdu la partie, les bouleaux et les aulnes, les saules et les peupliers ont jeté l'ancre. On ne reverra plus ni les canards ni le ciel ; je crains pour la bruyère et les myrtilliers.
Nous n'avons pas de fleuve au Riau, ce fleuve qui nous aurait permis d’organiser le monde en un en-deçà et un au-delà. Cet étang était notre Greenwich, on le voyait où qu’on soit et on dessinait tout autour, les yeux bandés, des cercles concentriques toujours plus larges qui nous donnaient une exacte représentation du monde. Il nous reste la clairière de la Moille Baudin.
Il y a du Jan Vermeer dans ces fins d’après-midis ensoleillés d'automne, dedans comme dehors, lumière froide et or blanc derrière les carreaux des fenêtres entrouvertes, dentelles d’ombre et coulées de lumière dans les sous-bois.
Jean Prod’hom
Vous êtes bien mignon Jean

Cher Pierre,
Romain, à qui le responsable de l’inauguration des nouveaux bâtiments de l’école où je travaille, a prié de réaliser le programme des manifestations, m’a demandé de rédiger le texte introductif. Je m’y colle ce matin en essayant de faire voir, au passage, le visage de Janus de cette noble institution qui, simultanément, abrite des activités qui n’ont guère changé depuis Jules Ferry et digère tant bien que mal des mutations profondes que tous les acteurs de l’école sont invités à honorer aujourd’hui, qu’ils le veuillent ou non, et qui les obligent à réorienter leurs efforts en usant des outil si nouveaux qu’ils les laissent souvent pantois.

Je tais l’autre idée, iconoclaste, selon laquelle les embarcations construites par nos architectes pour apprendre à nos enfants à naviguer sur terre, sont obsolètes avant d’être mises à l’eau. Les moyens de communication, mais aussi de stockage de l’information dont nous disposons ne nécessitent plus de grands locaux fixes, pouvant accueillir 20 ou 30 élèves – et le matériel supposé nécessaire –, mais au contraire des espaces réduits, modulables, capables d’accueillir jusqu’à cinq ou six personnes – pas plus – ; un local permettant à une centaine de personnes de travailler individuellement et en silence ; un autre enfin, de même dimension, à l’acoustique irréprochable, qui permettrait à un orateur de se faire entendre de tous, ou à un film d’être projeté dans de bonnes conditions. Inutile de parler de cela, personne n’est prêt à le concéder, pas même à entrer en matière.
A la suite de sa lecture de mon billet de hier, un lecteur écrit ceci : Vous êtes bien mignon Jean, mais les réfugiés politiques qui déferlent sur l'Europe n'effleurent même pas votre village ? S'il vous plait, revenez un peu parmi nous. L'homme, qui se déclare humble disciple de Montaigne, de Spinoza, de Rousseau et de quelques autres s'étonne que ma prose élégante rebondisse sur l'orbe du monde réel comme si elle ne l'effleurait même pas.
Dois-je rester dans le village que j'habite et m'en excuser, ou rejoindre ce disciple de Montaigne et aller à la rencontre des réfugiés politiques qui déferlent ? Que cet homme prenne en otages des auteurs qui ne lui appartiennent pas et qu'il m'arrive de lire parfois, en se proclamant leur disciple, ajoute un peu de colère à mon désarroi. Ce monsieur veut-il étendre la guerre partout, même dans mon village ? Il doit comprendre que je défendrai mes enfants où que nous soyons, dans sa ville ou ici au cul du monde.
L’intervention de cet homme, quoi qu'il en soit, laisse entrevoir l'incurie des épargnés. À moins qu’il ne soit en danger et que derrière ses allures de révolté, il soit un réfugié qui fuit et demande un asile ? J’aurais aimé qu’il me demande comment va le monde, je lui aurais répondu : Pas bien ! Mais faut-il mal tourner pour en être solidaire ? C'est un miracle que nous soyons encore vivants.
Belle soirée dans l’ancien cinéma du Bourg en hommage d’Hessel, avec ses amis, mais je ne prolonge pas la fête. Sale journée ! Une amie de Montreuil m’envoie un gentil mot ; ce que j’écris, dit-elle, l’apaise. Elle ajoute pour mon bonheur qu’elle a trouvé dans ses rêves un petit tesson avec une main dessinée dessus.
Jean Prod’hom
Eclats de Méditerranée

Cher Pierre,
Le vaste mouvement de laïcisation des institutions scolaires aurait pu ouvrir les yeux de nos enfants, les ouvrir à d’autres ciels que celui qu’indiquent, urbi et orbi, l’index de l’église romaine et, mystérieusement, le petit doigt des consciences réformées.
Mais les précautions prises par les hommes chargés de cette sécularisation les ont conduits à se taire et se faire tout petits jusqu’à disparaître sous terre, pour éviter le soupçon de privilégier tel ou tel ciel. Avec pour conséquence le rejet de l’idée essentielle que les signes pourraient venir d’ailleurs, laissant nos enfants seuls avec eux-mêmes. Nouvelle traque, nouvelle ère du soupçon, autrement plus dangereuse que celle dont certains philosophes avaient rendu responsables, au milieu du siècle passé, Marx, Freud et Nietzsche. Voici nos enfants plongés dans une nuit où le ciel est par prudence banni.

Voilà ce que j’ai pensé au terme de cette première longue journée à la mine, longue traversée à quai, grandes baies vitrées à travers lesquelles il est interdit de regarder, tableau étrange qui éloigne nos enfants du saint Augustin de Vittore Carpaccio et les rapproche de la taupe. D’une taupe qui s’ignore, disposant de barres à mine, de lanternes, de cliquets et de roues dentées, tunnels étroits et galeries d’aération qui permettent à l’espèce de ne plus avoir besoin de sortir la tête de l’eau et de se détourner du ciel.
Cette obscurité dans laquelle m’ont plongé ces réflexions s’est dissipée en écoutant Vassilis Alexakis et Nicolas Verdan, visages au vent, parler à Sonia Zoran de la Grèce – au-delà du roman de ses turpitudes –, de la mer qui l’a découpée, qui l’a préservée, et de ses rives sur lesquelles vient s’échouer les échos d’un ailleurs qui demeure entier.
Jean Prod’hom
Corcelles-le-Jorat | 22 août 2015

Cher Pierre,
Au risque d’en étonner plus d’un, moi-même en premier lieu, je suis étrangement calme avant cette rentrée scolaire, bien décidé à mener les élèves à l’essentiel, à ne pas les noyer dans une cascade de distinctions ou à les égarer dans les labyrinthes de la scolastique.

Les jours rétrécissent, certes, mais le soleil, radieux, nous rappelle que l’été n’a pas renoncé. Et si le temps des cerises est bel et bien passé, celui des pommes du verger nous promet de belles récoltes. Sandra et les enfants sont descendus en ville, c’est là-bas que se trouve leur avenir ; je monte au triage avec Oscar, – le sien est plutôt dans les bois.
Avec dans la poche La Vallée de la Jeunesse d’Eugène ; c’est un livre publié en 2007, qu’une collègue nous a proposé de lire avec nos élèves, dans l’idée qu’ils puissent, au moment voulu, rencontrer son auteur et s’entretenir avec lui du métier d’écrivain ou, s’il ne s’agit pas d’un métier, de l’écriture lorsqu’elle n’est pas exercice scolaire.
J’ai lu le récit d’Eugène il y a quelques années. Des vingt (ou vingt-deux objets ?) qui ont marqué sa vie, à Bucarest et à Lausanne surtout, je me souvenais assez précisément de l’aiguille à ponction et du Rubik’s Cube 4 x 4. L’idée de lire ce livre avec des élèves m’emballe, le principe est efficace. Et puis, à travers le rappel des dix objets qui lui ont fait du bien et des dix qui lui ont fait du mal, il sera aisé d’évoquer plusieurs aspects du monde dans lequel nous vivons ; on abordera en outre la belle et épineuse question de l’écriture des souvenirs.
Et même si tout est faux, quelle importance ? Je me souviens de la réponse de Blaise Cendrars quand on l’a sommé d’avouer s’il avait réellement pris le Transsibérien, pour écrire un de ses plus fameux textes : « Qu’importe si je l’ai pris, puisque je vous l’ai fait pendre ». (La Vallée de la Jeunesse, page 178)
J’ai lu, Pierre, votre mot à mon retour du triage, là où j’ai suivi ce printemps les amours de deux bouvreuils et la naissance de leurs petits ; là où je lis aussi, parfois, loin de tout, et somnole.
Vos envois me réjouissent tout autant parce qu’ils m’obligent à demeurer attentif aux mésaventures et aux petites misères des autres, si semblables aux miennes, mais aussi aux beautés qui persistent et qui permettent à l’inquiet que je suis de trouver des arrangements avec le monde, ne serait-ce que pour en sortir vivant lorsque le jour tombe.
Sandra s’est rendue à Servion, la table et les chaises sont prêtes ; on en disposera la semaine prochaine. Promenade encore avec Sandra et Oscar, avant que le soleil disparaisse derrière le bois Vuacoz. J’ai entendu à nouveau, au-dessus du poulailler, les petits coups secs et francs du pic épeiche que j’ai aperçu ce matin.
Jean Prod’hom
Travaille, creuse, orpaille

Cher Pierre,
L’engagement des élèves et l’écureuil qui sommeille en chacun d’eux auront eu raison de mes prévisions ; on ramène le pactole de Naples. J’écris un mot aux parents, y joins des photos de classe et la somme qui leur revient. A eux la répartition de celle-ci selon leur conception de la justice distributive.

Il y a le feu dans l’aula et aucun air ne s’invite par les portes grand ouvertes, chacun agite son éventail ou le programme ; belle cérémonie cependant, avec deux points d’orgue : la lecture faite par le directeur de Tu es plus belle que le ciel et la mer. Je ne suis pas loin de penser avec Cendrars qu’il faut parfois dégager. Et c’est en souriant que je remets à chacun de ceux que j’ai accompagnés depuis trois ans le viatique qui les rend à la liberté. Va-t’en ! Regarde mais surtout dégage !
II y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre
Travaille, creuse, orpaille ; fais ton pain, mais surtout fais ton lit et dégage ! Quitte ce maître dont tu ne tireras rien ! File ! Il y a tant de choses en-dehors des murs de cette prison, regarde, descends dans le puis, monte sur les cimes.
Et puis, second point d’orgue de cette cérémonie, le coup double de Samuel qui reçoit son certificat, mais aussi le prix que le conseil de classe a décidé de lui remettre pour l’ensemble de son parcours.
Les civilités ne sont pas mon fort, je n’y coupe pourtant pas. On se retrouve tous, enseignants, élèves et parents dans la cour devant le réfectoire, on parle de certaines choses, on en tait d’autres, on sourit parfois.

Madeline a essayé de m’atteindre depuis quelques jours par téléphone, sans succès ; elle décide de faire un saut au Riau. On passe un délicieux moment sous le foyard et le chêne qui mélangent leurs branches au fond du jardin. On parle de maman, de leur cercle de lecture, de quelques livres. On prend rendez vous pour le 24 septembre ; je rejoindrai leur groupe à Peney, dans la fermette que Madeleine occupe en été depuis 1969, seule depuis que son mari est décédé. Je me réjouis.
Jean Prod’hom
Tout se sera passé au mieux

Cher Pierre,
La ville se réveille à peine lorsque nous rejoignons, à 6 heures, la place Garibaldi ; l’Alibus nous emmène à Capodichino. L’embarquement se fait sans douleur, je traverse le ciel avec les élèves à tribord et la mer à babord, les gamins s’endorment, tout se sera passé au mieux.

Avant de quitter François et Sylviane qui m’ont fait l’amitié de nous accompagner, – et combien le métier du premier m’aura été précieux –, six élèves chantent des remerciements improvisés entre Genève et Morges. Comment ne pas fondre ?

Je remonte au Riau, Sandra et les enfants ont le sourire, la journée balade-galop a ravi les filles. Sandra a dû montrer à l’architecte qui était le maître-d’oeuvre ; quant à Arthur, il me raconte qu’il est rentré l’autre jour d’Ogens au petit matin, avec son copain de Ropraz, à pied ; il leur aura fallu près de quatre heures. Comment ne pas fondre une seconde fois
Je vais faire une sieste au milieu des gravats, avant de mettre à jour les maigres notes que j’ai prises lors de ce séjour à Naples. Attachées à un mail que m’envoie Claude, la couverture et la quatrième, tout est prêt, l'impression va démarrer sous peu, les exemplaires seront prêts pour Grignan.
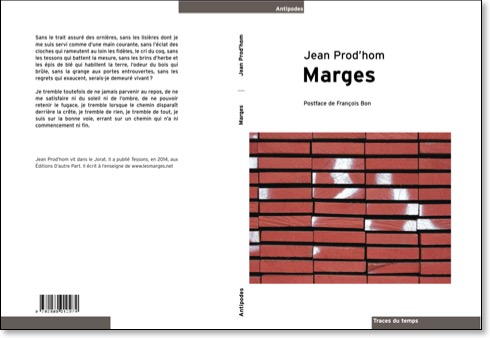
Jean Prod’hom
Largo Banchi Nuovi

Cher Pierre,
Le métro sort de terre après avoir passé le Pausilippe, la mer apparaît alors entre les HLM, parfois le cap Misène et le vieux bourg de Procida, le sommet des collines d’Ischia. Toujours le bleu du ciel. Pouzzoles ne ressemble à rien, on monte jusqu'à la Solfatare ; la Grande Bocca expire des exhalaisons qui indisposent les plus délicats, le grand bourbier est vide de fange ; des portes des étuves du purgatoire et de l'enfer s'échappe le souffle du diable. Un guide de Pouzzoles, croisé au guichet du site, ne croit guère au plan d’évacuation, mais il ajoute qu’il ne vivrait pour rien au monde dans nos montagnes.

L'épicière qui fournit la buvette me propose un pannino à la carte, un bello pannino, bello ma non a balla, ajoute-t-elle. Il a en effet belle allure mais pas que, j’en témoigne. On rentre en ville par le même chemin.
Le musée archéologique est fidèle à lui-même, comme les Napolitains : les fenêtres sont restées ouvertes, les gardiens n’ont pas quitté le fauteuil dans lequel ils somnolaient il y a une année; seuls les deux athlètes de la maison des papyrus ont fait faux bond, ils sont à Milan ou à Vancouver. Les gamins traversent les salles au pas de charge, s’étonnent au passage de la taille des abacules ; les peintures de Pompéi laissent ce sentiment étrange que, si les hommes du 1er siècle représentaient et se représentaient les choses un peu comme nous, ils le faisaient avec une profondeur un peu différente, moins technique, moins raisonnable, moins systématique, donnant aux choses et aux êtres un corps, une peau, une vie que nos calculs et nos chambres obscures ont raboté.
Les gamins vont faire quelques achats, je retrouve un peu de liberté. Piazza Bellini, une trentaine de personnes tournent une scène d’une comédie intitulée Vita cuore battito. Une heure de cris, de regards noirs, de discussions, de reproches, pour la mise en boîte d’une quinzaine de secondes ; pas de place pour le hasard et les circonstances dans ce cinéma-là ; on se réjouit de son autre orientation, car au fond le cinéma c'est ça, disait Godard, il suffit de filmer des gens libres.
A Santa Chiara, Michèle épouse Francesco ; j’assiste à la cérémonie avec, à mes côtés, Ludovico da Casoria, mathématicien et physicien, préoccupé par la pauvreté, créateur de revues, de congrégations, béatifié en 1993, sanctifié l'année dernière ; à bien regarder son visage, je comprends pourquoi certains ont tout donné pour le suivre.
Sur la place Bellini, ça s’agite encore, mais l’équipe n’a pas avancé d'un pouce ; je les quitte fatigué, fatigué à l’idée de ce qu’il leur reste à faire, sans même oser imaginer quoi et pourquoi. L'écriture a ceci de particulier qu'elle n'use de rien ; tout est si lourd en dehors d'elle, hormis marcher. L’atelier des deux frères Lebro est fermé, leurs voisins de palier me confient qu’ils ont bien vieilli.
Des élèves ont réservé des tables au sud de Santa Chiara, pour un repas qui conclut leurs onze ans d’école obligatoire. En remontant à l’hôtel, nous nous arrêtons sur le Largo Banchi Nuovi pour une fête imprévue, rythmée par des voix, une guitare, des castagnettes et des tambourins. On regroupe les sacs à dos dans un coin de la place, les gamins se lancent à l’eau, accueillis à bras ouvert par les Napolitains ; danser la tarentelle, ils ne pouvaient espérer meilleure fin.
Jean Prod’hom














Procida

Cher Pierre,
Diane à 6 heures 30, déjeuner, métro ; embarquement à Beverello ; on longe le golfe de Naples jusqu’au cap Misène avant de lâcher le continent et mettre le pied, à deux pas seulement, sur l’île de Procida.


On monte par petits groupes au sommet du bourg médiéval ; visite de l’abbaye de Saint-Michel l’Archange, lequel a sauvé l’île des Sarrasins : une dizaine d’ex-votos sont accrochés dans le couloir qui mène à la salle de la confrérie ; on s’installe dans les stalles de bois vernis, embellies par les ans ; de vieux cercueils ont échoué dans la pièce ; on aperçoit d’autres barques par la fenêtre ouverte, avec le bleu de la mer qui se confond avec celui du ciel, une rumeur. Les Bénédictins avaient décidément bon goût.


C’est dans le petit port de pêche de Corricella, blanchi par le soleil, retouché par les couleurs pastel des barques qu’on mange. Baignade ensuite sur la plage qui jouxte le port, la Chiaia, ambiance bon enfant, je ramasse quelques tessons, les gamins m’en amènent, Samuel m’en offre une poignée.
On retrouve en soirée au Gambrinus notre guide pour une visite extraordinaire des citernes et des cuniculi creusés sous les quartiers espagnols, aqueduc assurant la distribution de l’eau jusqu’à l’extrémité de la baie, aux locataires des palais du centre comme à la soldatesque rangée à Misène.
Ces galeries remplies d’eau, dont le tuf récupéré a permis d’ajouter de étages aux immeubles et aux palais, cloaques dès la fin du XIXème siècle, ont été réaffectées pendant la seconde guerre mondiale. Abris anti-aériens où se réfugiaient les Napolitains, que les Américains ont arrosés de bombes jusqu’en automne 1943.
Il est plus de minuit lorsqu’on sort du souterrain, les Napolitains n’ont pas sommeil, ils sont nombreux à prolonger la journée.
Sur le Corso Umberto I, ce ne sont pas des érables qui rythment la longue avenue, mais des grappes de jeunes filles en fleurs qui tentent de boucler leur fin de mois ; elles se retirent au passage des gamins qu’on ; ce n’est pas, semblent-elles dire, misère de misère, un travail à faire. Je crains que leur corps et leur visage ne vieillissent trop vite.
Jean Prod’hom


San Gennaro

Cher Pierre,
Une dame passe une serpillère dans la chapelle de San Gennaro ; plus tard, dit-elle, revenez plus tard. Mais nous ne verrons pas les ampoules du sang du saint, l’ostensoir qui les contient est bien caché à l’arrière de l’autel, il faudra revenir le 19 septembre, ou à Noël, ou à la mi-mai.

C’est à un autre miracle que nous sommes conviés, un prêtre se glisse en effet dans la crypte de San Gennaro ; je m’empresse de le suivre avec les 8 gamins qui m’accompagnent ce matin.
Une dizaine de fidèles sont là, dix grosses minutes vont suffire, tout y est : pénitence et absolution, lectures de l’ancien et du nouveau testament, alléluia ; assis, debout, assis, à genoux, debout ; les quelques mots d’explication du prêtre n’entament pourtant pas le mystère ; prière pour les affligés, les Napolitains, les hommes du monde entier ; sanctus sanctus, consécration du pain et du vin, voici mon corps, voici mon sang, tempête et transsubstantiation. Souvenez-vous du jeudi saint, des morts et des vivants, intercédez pour les âmes du purgatoire, offrez-nous vos grâces, vous qui avez associé à la passion de votre fils l’évêque et martyr de Bénévent. Le prêtre rompt alors le pain, communion et bénédiction, avant de nous envoyer paître : allez en mission. Personne n’a rien vu venir, le miracle a eu lieu, bien plus difficile certainement à réaliser que la liquéfaction du sang de San Gennaro.
On a pris un peu de retard, nul ne saurait dire sur quoi ; longue halte pourtant à la chapelle de Sansevero, le Christ de Sammartino respire sous son suaire de marbre ; alternance des perceptions, hallucinations : est-ce le suaire qui frémit ou le corps dessous qui respire, ce ne saurait être les deux ensemble.

On se retrouve tous au marché de la Pignasecca, sous Montesanto, avant de prendre le métro linea 1 pour la gare centrale ; la Vesuviana nous conduit jusqu’à Sorrente où l’on passe l’après-midi dans la mer, dans un petit pré carré que les privés ont bien voulu laisser à ceux qui pensent que la terre, le ciel et la mer appartiennent à tout le monde. Avec de l’eau jusqu’à la taille, sans bouger, laissant à la mer le temps de faire passer un peu de sa fraîcheur au-delà de notre peau, dans ce qui pourrait bien être notre coeur.
Jean Prod’hom
Le Vésuve mousse du jaune des genêts

Cher Pierre,
Les Napolitains se satisfont d’une informatique de la première heure ; ainsi les 112 billets que je commande ce matin au guichet de la gare Giuseppe Garibaldi sortent un à un du capot d’une imprimante, que l'employé soulève de temps en temps pour souffler sur le ruban ; il me faudra une bonne heure pour les obtenir. Ces manières de faire ne rebutent pas ce peuple d’artisans, de maçons, d’épiciers, ce peuple de marchands de tripes et de fripes ; ça leur réussit même assez bien, à preuve le train de 10 heures 11 pour Sorrente, bourré jusqu’à la gueule.

On descend de la Vesuviana à Ercolano scavi. Ici, ce n'est pas comme dans le centre historique de Naples, les morceaux d'histoire ne s'empilent pas, ni ne se plissent, ils ne se chevauchent pas non plus ; à Herculanum, les ruines anciennes côtoient les ruines du jour, bord à bord ; impossible de concevoir les unes sans les autres. On s’étonne alors de la passion excessive des hommes pour les premières et de leur désintérêt inexpliqué pour les secondes.
Le Vésuve mousse du jaune des genêts et du rose de fleurs cousines des adénostyles ; quelques bourses de silène rampent à la hauteur du trèfle ; au bord du chemin, des cirses et des papillons. Lorsque le Vésuve s’est mis en colère en 79, les habitants d’Herculanum ont voulu fuir, on en voit aujourd’hui quelques-uns à la devanture de leurs magasins qui donnaient autrefois sur le front de mer, squelettes figés, dégagés par une mission archéologique américaine à la fin du siècle passé de la vague de lave qui les avait submergés. C’est subitement le passé qui côtoie le présent bord à bord, et qui devient tout entier la veille.
On remonte à pied jusqu’à la gare d’Ercolano ; la Vesuviana offre quelques places assises aux plus habiles d’entre nous, soulagés de nous retrouver, après une grosse journée livrés aux ardeurs du soleil, dans le hall climatisé de notre hôtel.


Jean Prod’hom
Ecrire c’est encore marcher

Cher Pierre,
Même si écrire c’est encore marcher, j’ai bien trop battu le pavé pour avoir la force de jouer du clavier ; l’énergie dépensée à garder un oeil sur les vingt-quatre adolescents que j’accompagne cette semaine à Naples n’y est pas pour rien.

Nous avons suivi l’itinéraire proposé par trois d’entre eux, du Corso Umberto I jusqu’à Spaccanapoli, enchaîné les zigzags sur le damier du Decumanus inférieur jusqu’à la rue de Tolède, traversé les quartiers espagnols avant de prendre le funiculaire central pour le Vomero, jusqu’à la place Fuga où l’on a mangé, au Trianon la pizza simplissime des premiers temps : tomate, mozzarelle et origan.
Les plus courageux sont redescendus dans la nuit, de l’esplanade de la Chartreuse jusqu’à la rue de Tolède, dans la nuit, bris de verre et basalte de piperne. Retour à minuit, tout va trop vite, les gamins sont pressés, sans jamais lever les yeux du côté des balcons, ou les plonger dans les arrière-cours qui abritent d’extraordinaires palais antiques.
Ecrire c’est encore marcher, je m’arrête avant l’épuisement ; chacun reçoit au réveil son quota d’énergie qu’il est tenu de ménager en certaines circonstances ; il est plus d’une heure et le réveil réglé sur 6 heures ; j’aurai ainsi demain les mains libres, avant le réveil des gamins, j’achèterai les billets pour Herculanum et Sorrente, boirai un café sur une terrasse tandis que le jour se mettra en place.Toujours la même leçon, compter sur ces propres forces.
J’apprends qu’un incendie s’est déclaré dans la gare de de Lausanne en début d’après-midi, immobilisant tous les trains, peu après que le nôtre nous emmène à l’aéroport de Cointrin. On a passé à côté du situation fâcheuse, très fâcheuse, mais du bon côté.
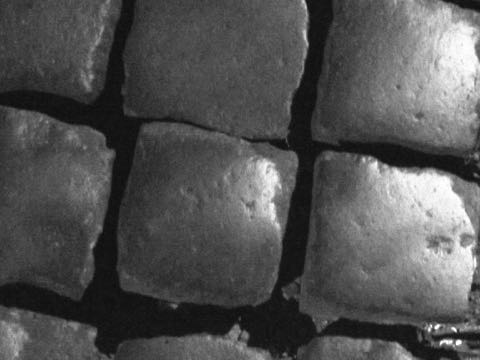


Jean Prod’hom
Seule la loi affranchit de la loi

Cher Pierre,
Dans les institutions qui vacillent en temps de paix, les employés les plus solides restent au rez, les bras au-dessus de la tête, chargés de soutenir le plafond qui se lézarde ; les moins courageux sont à l’étage, plaisantent, discrets et légers ; les plus lâches se calfeutrent benoîtement dans les caves, les rêveurs vivent incognito dans les combles.

Quelques gardiens font tout autour des rondes, interdisant à quiconque d’entrer et de sortir ; quand aux responsables – mais en existe-t-il encore ? –, ils sont à mille lieues de la bâtisse, se congratulent à l’abri, inventent des matériaux inédits, conçoivent des contreforts, lambourdent de faux plafonds, imaginent des colles qu’ils tendent sans y entrer à ceux qui sont dedans, placent des fusibles, coordonnent ce qui ne communique plus, invoquent des mots sacrés qu’ils soulignent pour faire sésame. C’est écrit noir sur blanc, disent-ils, peu importent les raisons.
Chacun demande à l’autre de bien noter ceci ou cela, et de le faire dans les plus brefs délais, sans prendre de dispositions si la mesure demeure sans effet. Ceux du rez, du premier, des caves et des combles deviennent comptables de potions inutiles, répétées à satiété. Alors chacun en appelle aux lois, en redemande pour parer au plus pressé ; les règlements d’application grossissent et de vieilles habitudes se transsubstancient en lois, le système se durcit, personne n’ose plus imaginer une gestion différente des problèmes ou un renversement des ordres et des priorités (assiette plutôt que couvercle).

Si donc la bâtisse continue à vaciller, ce n’est pas tant en raison d’un manque législatif, mais en raison de l’indigence des interprétations de la loi. Et par un curieux paradoxe, je me suis mis à entendre cet après-midi, au coeur même de celle-ci, non seulement une musique que je ne soupçonnais pas, mais le lieu même de l’invention et la promesse de grandes manoeuvres. Seule la loi affranchit de la loi.
Jean Prod’hom
L’homme est une usine à pathétique

L’homme est une usine à pathétique, c’est ainsi, difficile de faire autrement. Mais le rituel qui met un terme à la scolarité obligatoire, là où il demeure, inquiète, son prix est exorbitant. Pour maintenir la bastringue hors de l’eau, ses exécutants sont amenés à prendre des mesures toujours plus onéreuses et cocasses, on bricole ; tout le monde collabore, mais le bénéfice maigrit, à peine suffisant pour sauver la face, et refaire un tour. L’opération semble obéir à la loi des rendements décroissants, il serait temps de passer à autre chose. Certains s’y attellent depuis longtemps déjà, sans grand succès, ils se consolent à l’idée que la réponse viendra d’ailleurs, de là où on l’on ne s’attendait pas, comme toujours. Et c’est tant mieux. En attendant, ils font de leur mieux avec les moyens du bord : frontières, saisie des téléphones, murs, contrôle des sacs, séparatifs, logiciels anti-plagiats, encouragements à la concurrence, espionnage sur les réseaux sociaux. Bonne chance les enfants !

Trop de zones grises, disent les plus hardis, il faut légiférer au plus vite, obtenir un soutien, de l’argent. Alors les hommes de loi légifèrent pour mettre sous contrôle ces zones, systématiquement, rationnellement. D’accord. Paradoxalement, leur nombre et leur étendue croissent lorsqu’une règle ou une loi est mise sous toit, avec pour corollaire la mise en miettes du champ de leur application.
On invoque les nuances tandis que le gris s’étend, grisaille, on multiplie les coutures sans couleur. Mais, et comment faire autrement, on faufile si lâche que les filous parviennent à glisser dans l’ouverture une pince-monseigneur, à se saisir de l'infime pour en faire un précédent. Les procéduriers font de rien une affaire d'état, c'est l'envers de la peau de chagrin.
L’espace et nos vies sont pavés de bonnes intentions, de poèmes abscons et de lois magnanimes ; alors le quelque chose qui résiste recule, se tient à l’abri des peurs et des profits qui accablent nos vies. Rien n’a pourtant changé, mais toute ouverture est devenue un danger que les gardiens de l’ordre s'empressent de colmater ou de contrôler.
On a réduit simultanément d’autres zones grises, les bonnes, celles qui nous permettent de respirer, les jachères et les granges vides, les bouzigues, les chantiers et les haies. Où donc nos gamins iront-ils demain s’embrasser ?
Je crains aujourd’hui le coup de grisou, le respect de la loi suppose une confiance aveugle, analogue à celle qui permet la circulation de l’argent, tout est si fragile. Et si je suis amené à l’écrire, c'est parce que ce quelque chose qui était consubstantiel à nos vies est devenu si miraculeux qu’il est nécessaire de renouveler son bail à chaque instant, sachant que sa rupture nous contraindrait à tout reprendre depuis le début, bellum omnium contra omnes.
Jean Prod’hom
L'école manque à sa tâche

Cher Pierre,
L'école manque à sa tâche en cherchant à séduire ceux qu’elle accueille, en mettant tout en oeuvre pour qu’ils ne lui échappent pas ; alors qu’elle a pour tâche, précisément, de leur donner les moyens d’en sortir au plus vite ; elle échoue en voulant les amuser, en espérant leur plaire ; en les captivant, elle ne parvient qu’à les rendre captifs.

Elle contrôle entrées et sorties, a mis en place un monde second par la mise en place d’un système de communications perverses : jeux de pseudo-questions et de pseudo-réponses, trompe-l’oeil, cache-cache, bienveillance de ceux qui sont supposés savoir, confusion des rôles, devinettes, pseudo-équité, travail au mètre, exercices venus de nulle part, figures de papier, attentes, dés pipés, terrain miné, malentendus, fabrication d’énoncés factices, allocutaires fantômes, rituels scolastiques.
Alors qu'il serait prioritaire d’apprendre à sortir de son giron, quitter les chemins battus, prendre ses distances avec le convenu, de la hauteur, prêter l'oreille aux besoins ; apprendre à poser des problèmes, dégager des problématiques, se familiariser avec les langages, trouver la personne qui pourrait nous informer, nous aider, celle avec laquelle on pourrait collaborer, celle qu'on ne connaît pas.
L’école vous dira que c’est exactement ce qu’elle fait. Pas vrai. L’école est en réalité faite par et pour les enseignants, ceux qui ont refusé d’en sortir et qui recommencent. L’école a fait ses preuves, disent-ils. Quelles preuves ? On ne tourne pas aisément la page.
Jean Prod’hom
Que je n’aie au fond jamais quitté l’école

Cher Pierre,
Que je n’aie au fond jamais quitté l’école m’amène à penser aujourd’hui, rétrospectivement, que ce que j’y ai acquis ne m’a permis, à aucun moment, d’aller faire fortune ailleurs. Les apprentissages fondamentaux me sont toujours restés si mystérieux que je ne me suis jamais senti capable d’en user dans d’autres domaines.

Je suis donc resté à l’école après l’école pour y voir clair, chercher à déterminer pourquoi ce qui allait de soi demeurait à mes yeux énigmatique, sans assise, non pas que je sois plus idiot qu’un autre, quoique, mais parce que ce sur quoi les autres semblaient s’accorder et dont l’existence paraissait si assurée me manquait cruellement, incapable de concevoir les apprentissages comme un préalable à la réalisation de telle ou telle chose dont j’aurais pu devenir le maître.
Il me restait, en y restant, à chercher ce qui m’échappait, me manquait, c’est-à-dire à me pencher sur mes premiers apprentissages et les troubles qu’ils avaient engendrés, pour les reconnaître d’abord, en poursuivre l’exploration ensuite et, chemin faisant, m’aviser que ces troubles avaient été et continuaient à être l’occasion de découvertes imprévisibles.
Avec pour seule ambition – plutôt que d’occuper la place de celui qui est supposé savoir –, continuer mes apprentissages avec d’autres, hésitant, essayant, doutant, mais en connaissance de cause.
C’est à cela que je songeais en lisant Jean-Christophe Bailly :
La recherche n’est que la prolongation de l’apprentissage... Si l’apprentissage peut être assimilé à l’exploration d’un continent, la recherche correspondrait quant à elle à ce qui transforme ou relève cette exploration en découverte... Le paradoxe est même que la recherche vienne augmenter la dimension d’inconnu qui est la clé ouvrant l’apprentissage... Chercher, rechercher, c’est remettre tout le savoir en balance, c’est un métier qui fait de l’apprentissage son principe. (« Rechercher » in L’Elargissement du poème)
A moins que, à l’école, je n’y suis au fond jamais allé.
Jean Prod’hom
La fenêtre restera ouverte toute la nuit

Cher Pierre,
Passe plus d'une heure et demie avec des parents, ils souhaiteraient que je leur procure une de ces recettes qui ont fait leurs preuves. Je leur peins un tableau qui n'a pas grand intérêt, mais qui est sensiblement le même que celui qu'ils me peignent : nos mondes sont compatibles.

D'avoir enseigné, c'est-à-dire fait découvrir à ceux qui n'en disposent pas, les différents langages qui structurent nos vies, et d'avoir signalé, aussi souvent que je l'ai pu, à ceux qui ne s'en satisfont pas, certains de leurs rouages et quelques-unes de leurs roueries ne m'a jamais permis de pronostiquer quoi que ce soit de ce que peut ou ne peut pas l'enfant qui aurait marqué son enthousiasme ou qui s'y serait opposé. On attend trop les uns des autres. Ce qui infléchit la trajectoire d'un enfant - comme celle d'un adulte - relève d'un ensemble de circonstances dont le concours est si improbable qu'il vaudrait mieux compter sur l'imprévu. On ne peut donc pas réconforter les parents qui doutent ou qui souhaiteraient qu'il en soit autrement. On peut au mieux faire voir notre étonnement et notre ignorance ; il m'aura fallu 30 ans de compagnonnage avec des gamins pour dire tout haut que j'ignore ce qui dans leur formation et la mienne est cause de quoi. Et dans ce repli, ou ce retrait, non pas succomber à la lâcheté, mais consentir et, par là, signifier les vertus de l'acquiescement.
Passe à Ropraz récupérer le mousse. Souriant, content. Deux fois content, et pour la deuxième fois cette semaine. De son travail d'abord, mais aussi de ce que celui-ci doit à d'autres travaux et à d'autres personnes. Comme s'il découvrait les joies de l'orchestration et, je l'espère, ses pouvoirs.
On mange à la véranda, Sandra est fatiguée, je regarde avec les enfants la première partie du match de football qui oppose le Bayern de Munich et le Barcelone, seul la seconde. La fenêtre restera ouverte toute la nuit.
Jean Prod’hom
J'ai le plaisir d'apprendre

Cher Pierre,
J'ai le plaisir d'apprendre, en fin de soirée, que les Editions Samizdat, Faim de siècles et D’autre part parleront, mercredi et jeudi prochain au Théâtre des Osses à Fribourg (Focus sur les éditeurs romands), de leurs choix, de leur travail et de leurs combats pour publier les auteurs de notre pays. Roger Jendly, Anne Jenny, Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier liront les extraits des oeuvres proposées par les éditeurs tandis que la pianiste fribourgeoise Véronique Piller les accompagnera au piano. Tessons sera de la partie ; entendre Roger Jendly en lire des extraits, ce serait extra...

Bus numéro 8 jusqu'à Bel-Air, puis numéro 17 jusqu'au Galicien. Il nous faudra ensuite une dizaine de minutes pour atteindre, par Kleber Meleau, le Centre intercommunal de gestion des déchets.
Un animateur – le même qu'à Tridel – raconte aux élèves les grandes étapes de l'épuration des eaux à Lausanne, de l'évacuation des déchets directement dans la Louve et le Flon, du voûtage de la première en 1812 et du second en 1873, de la pose de plongeurs pour évacuer le tout loin des rives du Léman, de la mise en place de la station d'épuration en 1964, de la dérivation des eaux claires du Flon dans la Vuachère en 1996, de la restitution de celles de La Louve directement dans le lac.
Ne roulent aujourd'hui dans les anciens lits de la Louve et du Flon que les eaux usées. Coup d'oeil encore, en-bas la vallée de la Jeunesse, au déversoir du Capelard.





Si on peut considérer que le processus de la séparation des eaux claires et des eaux usées trouve son origine en 1812 dans le voûtage de la Louve, c'est en 1812 également que le Petit Conseil du Canton de Vaud arrête qu'aucun cimetière ne peut être établi dans l’enceinte d’une ville ou d’un village, que les cimetières seront clos et fermés et qu'ils ne serviront pas à d’autres usages qu’à enterrer les morts. Séparer les eaux claires et les eaux usées, les vivants et les morts, c'est tout un.
Je lâche donc les élèves dans le cimetière du Boix-de-Vaux, conçu par Alphonse Laverrière en 1912 en raison de la forte croissance démographique. Pour justifier une telle invitation qui leur semble tout à fait saugrenue, je précise que ce cimetière bien vivant, avec de vrais morts, est inscrit à l' Inventaire cantonal des monuments historiques et fait partie de la liste des Jardins historiques recensés par l'UNESCO. Ils s'égaient ensuite dans les allées, repèrent la tombe de Coco Chanel, de Pierre de Coubertin et d'un adolescent dont on a beaucoup parlé l'été passé. Je fais de mon côté quelques photos d'arrosoirs.
Le bus scolaire nous ramasse devant le siège du CIO, je reprends la Yaris derrière l'église du Mont. Me simplifie la vie pour le repas du soir, rédige l'article sur la course de trial de la veille pour les journaux locaux. Arthur est à Stockholm, il nous a laissé son absence.
Jean Prod’hom
Les prévisions sont inquiétantes

Cher Pierre,
Les prévisions sont inquiétantes, 6 heures, il fait cru, je fais du feu dans le poêle ; il pleut, il pleuvra cette nuit, il pleuvra demain, il pleuvra dimanche : pas bon pour la course de Ropraz.
Impossible de remuer Oscar, vautré toute la matinée dans un fauteuil ; vautré moi aussi, dans le mien, je poursuis la lecture du récit de Pierre-Laurent Ellenberger ; qu'il me faut suspendre pour faire des emplettes à Oron : fruits et légumes surtout, l'engagement végétarien de Louise ne nous facilite pas la tâche. Je prépare du riz et de la salade, pèle deux carottes et une pomme, prépare une tarte pour ce soir.

Louise rentre seule à midi, sans Lili qui pique-nique avec ses copines à Mézières ; elle rentre de petite humeur, peu satisfaite de ses travaux ; ils sont pourtant très bons et elle comprend vite les quelques erreurs qu'elle a commises. Des erreurs pleines d'enseignements, j'ai beau le lui dire, ça ne change rien, elle n'est pas contente et je la comprends ; rien ne sera repris de tout cela, il y a le programme, on n'a pas le temps.
Cette école fait des ravages chez tous nos enfants, les bons et les moins bons. Les notes, la langue de bois, les impératifs, les pièges et les fourches caudines réparties tout au long de leur parcours, l'absence de suivi réel, font des dégâts dont on n'a pas encore mesuré le coût réel, l'effet sur le capital de confiance ; nous sommes peu à penser qu'il pourrait en aller autrement, alors les choses continuent ainsi. Et les gamins se soumettent aux épreuves de ceux qui sont supposés savoir. L'évaluation à laquelle les gamins sont assignés est une réelle catastrophe, elle ne rend compte d'aucune compétence, n'atteste à la fin que de leur aptitude à se conformer aux normes et à supporter le dressage. Le concept de résilience, qui a bon dos, fait le reste.
Pour toi la guerre est finie, c'est le livre que m'a offert Karim la semaine passée. Il s'agit d'un récit posthume de Pierre-Laurent Ellenberger, né en 1942 et mort en 2004, qui raconte – plusieurs années après ? – ses journées à Lausanne, de 1966 (projection de La guerre est finie d'Alain Resnais) à 1972 (Tueries aux JO de Munich) ; qui raconte aussi les événements dont il a été le spectateur éloigné.
J'avais tout juste 17 ans lorsque le récit se termine, j'avais fait mes premiers pas dans les bistrots où Ellenberger a passé une partie de ses soirées, comme moi : Le Major Davet, Le Jour et Nuit, le café du Marché, le café des Philosophes...
En lisant ces pages, j'ai eu le curieux sentiment de n'être jamais vraiment entré dans ces cafés, ou seulement lorsque la fête était finie, d'avoir été un tard venu ou d'avoir passé à côté, de n'avoir été qu'un figurant : nous l'avons tous été. Cette impression est un effet de l'écriture, qui a le don de donner une seconde vie – la seule – à ce qui a été englouti, une consistance rétrospective – la seule – à ce qui a passé comme l'eau sous les ponts.
Il en va de même, mais à l'inverse, pour les romanciers, qui ne se sont dégagés qu'imparfaitement des motifs de leur maigre vie, si maigre qu'ils s'abreuvent à ce qu'ils ont lu. Rien de plus conservateurs donc, mis à part ceux qui ont fait basculer ou bifurquer les habitudes, en raison d'une expérience qui les a obligés à renouveler les caves et les combles du récit. Quant à la kyrielle de romans qui paraissent aujourd'hui, on voudrait parfois qu'ils touchent terre, apportent, comme les démonstrations mathématiques, quelque chose d'essentiel, de bref, quelque chose de simple et d'élégant, quelque chose de beau et de ramassé.
Je réchauffe du riz et fais sauter un émincé, on mange. Renonce ensuite à accompagner Sandra et les enfants au cinéma de Carrouge, monte à la bibliothèque et rédige ces notes; dehors le brouillard a plongé la nuit dans un noir épais, qui ne laisse passer que la pluie.
Jean Prod’hom
Voici ce que j'ai tiré de quelques mots décousus

Cher Pierre,
Voici ce que j'ai tiré de quelques mots décousus, tapotés à la va-vite sur mon natel ce matin, derrière l'Ecole hôtelière du Chalet-à-Gobet :
Les récits usent les plus résistants, le fil sur lequel on a pris l'habitude de pincer les événements dépérit, le présent ne remorque plus le passé, l'avenir est sur nos talons, voilà que les événements se mettent à tournoyer sur eux-mêmes comme des samares, et donnent naissance à autant d'îles que d'érables. Difficile d'y consentir sans inquiétude, mais on a tant besoin d'un peu d'éternité.
L'idée de destin a depuis toujours offert ses lettres de noblesse à la liberté, en rétrocédant le mince filet de l'histoire à l'étendue qui la borde, en rabattant la fin sur le commencement, en établissant ainsi la possibilité de la durée.

Pour le reste peu de choses à signaler, sinon ce mail que les enseignants de l'établissement dans lequel je travaille ont reçu ; qui les invite, avec les gamins dont ils ont la charge, à réfléchir à ce qu'ils pourraient bien mettre dans la capsule temporelle (50 x 50 x 72) qui sera mise en terre lors de l'inauguration du complexe scolaire dans quelques mois ; et qui sera réouverte dans 25 ans.
On ne peut que se réjouir, se réjouir que l'on pense à ceux qui viendront après nous, mais il convient qu'on s'interroge aussi sur la valeur de ces réjouissances. Car c'est vouloir encore garder la main sur l'avenir que d'exiger le jour et l'heure, que d'imaginer qu'il nous revient de choisir ce qui mérite de demeurer. Le demander aux enfants qui n'ont jamais participé aux processus de décision dans l'école est une manière de se débarrasser de ses responsabilités. On n'a jamais demandé aux mineurs de témoigner de leurs conditions pour les générations futures, mais on a pu souhaiter que les patrons des mines s'engagent à améliorer la vie difficile de leurs ouvriers, et qu'ils honorent leurs promesses. De quelque façon que ce soit, les dés sont pipés. Cette capsule temporelle me fait davantage penser à une bouteille de naufragés qu'à une pierre de fondation.
On pourrait, j'y songe, donner une autre dimension à cette capsule temporelle, l'agrandir au point qu'elle puisse contenir le complexe scolaire lui-même. Une conférence internationale réunie à Londres a levé mercredi les 180 millions d'euros manquants pour démarrer la construction du sarcophage de béton qui recouvrira le réacteur accidenté de Tchernobyl.
Nous descendons, Arthur et moi, à 18 heures 30. J'aménage avec J-P le bureau de la course et on bricole la tente des samaritains, qui donnera à la course de dimanche un petit air de Solférino.
Jean Prod’hom
Une belle âme a fait du petit bois

Cher Pierre,
Une belle âme a fait du petit bois, Arthur vraisemblablement ; j'en saisis une poignée que je pose en équilibre sur une demi-page froissée du 24heures, ajoute par dessus deux morceaux de tilleul, minces, secs et boute le feu à l'ensemble. Une allumette a suffi, je ne peux m'empêcher de penser que la journée a commencé sous de bons auspices.

Edelweiss et Fleur attendent je ne sais quoi à la cuisine, leur écuelle est pleine ; je vide la machine à laver la vaisselle, remplis un tupperware d'un mélange de fruits et d'avoine, et hop ! à la mine. Le trafic sur la route de Berne se densifie chaque jour davantage, et si cette tendance se confirme, il me faudra partir plus tôt de la maison.
Je reprends avec les grands la réflexion commencée la semaine dernière sur la ponctuation, l'utilisation de la virgule et le destin singulier du point-virgule. L'extraordinaire quatrième paragraphe du premier chapitre de la première partie du Grand Meaulnes est à cet égard exemplaire. Du point de vue rythmique, mais aussi du point de vue de l'organisation des contenus, on imagine mal comment Alain-Fournier aurait pu faire sans ce mal aimé de la ponctuation. J'aimerais en convaincre les élèves.
Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail ; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, à trois kilomètres ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs... tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie — demeure d'où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures.
J'ai commencé depuis quelques années à retirer mes billes de l'école, ou plutôt à cesser d'y replacer tous les bénéfices qu'elle me procurait, d'en réinvestir ailleurs sans succomber au divertissement, dans une autre région, centrale. C'est bien compréhensible si on admet qu'il existe une vie en dehors du travail. Mais nous pourrions ne pas y prendre garde et courir le risque, à l'instant même où notre employeur prendra congé de nous, de manquer d'un coup de cette moitié de réalité sans laquelle l'autre n'est pas. La retraite des retraités est aussi exigeante, somme tout, que celle des ermites et des Chartreux.
Une assistante sociale s'entretient, à la table voisine du café où je fais halte, avec une femme prise dans un filet aux mailles si lâches qu'elle ne semble pas près de s'en défaire. Elle oublie tout, ne retrouve rien, elle dit je n'ai plus rien, plus de chien et je pose des lapins ; les hommes, je ne veux pas avoir à faire avec, ils m'exaspèrent, je voudrais les frapper. Elle dit encore je n'arrive pas me l'expliquer, mais j'ai peur qu'on me prenne pour une folle, j'avance comme si le chemin était déjà tracé et que je ne devais pas m'en écarter, et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu tout ce que je vis, mes perceptions sont décuplées. J'ai des maux de tête, je ne peux plus rien faire, ni lire ni écrire, ni faire le ménage, ni promener mon chien ; mon chien, je l'ai ramené à la SPA, deux grandes promenades, c'était trop ; je ne vois plus mes enfants, on me les a retirés : sa voix s'éteint, je ne l'entends plus, celle de l'assistante claironne.
Arthur est devant Chez les Burdet lorsque je l'embarque ; au Riau le feu s'est éteint et il pleut, il n'y aura pas de seconde allumette ; sitôt rentré Arthur va promener le chien, les filles rentrent d'Oron, Sandra a fait des courses. On se retrouve tous devant une soupe et un morceau de pain, une salade et un oeuf au plat.
Les filles au lit, on prend une ou deux décisions concernant les travaux qui vont démarrer dans moins d'un mois. Arthur qui vient nous souhaiter une bonne nuit m'apprend que les belles âmes du petit bois, ce sont ses soeurs, Louise et Lili.
Jean Prod’hom
Les ornières des chemins sont remplies d'eau

Cher Pierre,
Les ornières des chemins sont remplies d'eau et les clairières détrempées, mais le soleil troue les nuages de temps en temps, il aura tôt fait d'éponger la pluie de cette nuit. Je monte au triage jeter un coup d'oeil à mes protégés : la femelle couve, je fais quelques photos ; le mâle passe en coup de vent et, caché dans la sapinière, lance des avertissements. J'essaie de m'approcher encore un peu, trop, la future mère s'éclipse et laisse cinq oeufs au fond du nid. Attends à quelques pas que l'un ou l'autre reviennent ; ils semblent bien organisés, la femelle réapparaît après un long détour, s'allonge discrètement sur ses oeufs et reprend sa couvaison là où elle l'a laissée.

Pouillot véloce
Louise me demande de l'aider à travailler sur la naissance du christianisme ; on passe une bonne demi-heure à traverser l'un des quatre chapitres qu'elle doit réviser ; pause ensuite. J'en profite pour terminer le compte-rendu de la course de trial de Savièse, en ajoutant quelques mots sur l'église de Saint-Germain et les noces, en fin de journée, de la pluie et du soleil. Sûr que le journaliste sportif de la Broye s'empressera de les supprimer ; je rouvre enfin le dossier de la Campanie et m'en vais d'Alphonse d'Aragon aux Quatre journées de Naples.
Je retrouve Louise après les quatre-heures, je n'ose dire ici ce que l'école attend d'une gamine de treize ans, c'est tout simplement une vilaine farce ; on décide donc d'aller terminer notre chemin de croix sur le plan de travail de la cuisine ; et pendant que je pèle des pommes de terre, émince des poireaux, des carottes, des tomates et les reste d'une courge, coupe des pommes, des poires, des oranges et des bananes, elle lit les dizaines de pages photocopiées d'un manuel d'histoire dont l'enseignant a fait souligner de longs extraits. Au terme de cette étude, précise l'habituelle page d'objectifs, l'élève sera capable de
- donner les raisons internes et externes qui plongent l'empire dans l'insécurité durant le IIIème siècle,
- citer l'essentiel de l'oeuvre de Constantin,
- énumérer les raisons du partage de l'Empire romain,
- citer quelques apports que la civilisation romaine nous a légués.
Mais aussi
- comprendre et utiliser le vocabulaire religieux (abbaye, abbé, baptême, cathédrale, clerc, clergé, diocèse, ecclésiastique, clergé, laïc, moine, monastère, pape),
- rendre compte de l'organisation ecclésiastique du haut Moyen âge ainsi que la distinction entre clergé et les laïcs.
- expliquer le développement du mouvement monastique,
- expliquer la toute puissance de l'Eglise sur la société au Moyen Age,
- mentionner quelques règles et principes de vie que l'Eglise imposait à ses fidèles,
- différencier l'architecture romane de l'architecture gothique,
- fournir les raisons qui ont poussé les chrétiens de l'époque à exclure certaines catégories d'individus de la société.
Ce n'est pas tout, mais je ne prendrai pas la peine de transcrire la seconde série d'objectifs, ce serait indécent. Pauvres enfants ! pauvre histoire ! pauvre école !
La lecture de deux textes qu'Eric a écrits et dont il m'a parlé l'autre jour à l'occasion de notre balade au bord du lac de Neuchâtel m'apaisent : lire ce qu'un ami a pris la peine d'écrire, pour dire au plus près ce qu'il pense, m'a toujours fait du bien.
Jean Prod’hom
Comment y voir clair dans le brouillard

Cher Pierre,
Comment y voir clair dans le brouillard ? et les bêtes sauvages, s'en réjouissent-elles ? Les changements climatiques, secondaires, infléchissent-ils leurs habitudes ? Connaissent-elles l'hésitation ? Et leur semaine est-elle rythmée par ce qui correspond à nos weekends ? lèvent-elles la tête le dimanche quand sonnent les cloches de l'église ? Leur arrive-t-il de prolonger, comme les hommes, leur sommeil, ou leurs rêveries ? Vivons-nous dans le même monde ? ou chaque espèce a-t-elle son ciel et des manières toutes à elle de s'interroger au coeur d'une énigme qu'incontestablement nous partageons. Elles sont à coup sûr notre chance et notre avenir, en ce sens qu'elles ont choisi de ne rien nous dire.

On finit par se lever et je dresse la liste des courses du weekend. Sandra et les filles se rendent elles aussi à Oron, pour acheter des cartons utiles au stockage de nos affaires pendant les travaux et des fleurs que Louise veut placer dans la plate-bande.
C'est un constat sur lequel tous les observateurs avisés s'accordent, l'agressivité des automobilistes, insupportable au premier étage des parkings, se réduit à mesure que l'on descend dans les étages inférieurs pour totalement disparaître au dernier. Par un paradoxe que les sciences de l'homme connaissent bien, ce constat ne peut être fait que par ceux du dernier étage, qui ont compris que s'éloigner de leur but les en approchait parfois considérablement. Alors que ceux qui auraient tant besoin d'un peu de paix et de recul s'agitent, tournent, vitupèrent à deux pas du leur.
C'est ce à quoi je pensais assis dans la Yaris au parking de la COOP d'Oron, ce matin, rempli de véhicules jusqu'à la gueule, en raison du comptoir qui a ouvert ses portes, mais qui offrait en périphérie d'innombrables places, avec le vent qui agitait l'herbe déjà haute, le ciel et le piaillement des moineaux. Je m'y suis trouvé si bien que je me suis demandé pourquoi je ne resterais pas jusqu'à la nuit, comme cela m'arrive parfois lorsque je m'étends sur les herbes sèches en-dessus du triage. Et c'est dans ces instants, je crois, que l'envie d'écrire ou de ne pas écrire est la plus forte, parce qu'il n'y a presque rien tout autour.
Et si je suis malgré tout de retour à la maison, c'est bien parce qu'il a bien fallu que je me décide à glisser dans un caddie des cornflakes, du lait entier de Gruyère, des fruits, des légumes et du riz. Mais je l'ai fait de très loin, avec dans les yeux les herbes hautes et le ciel, à distance des états d'âme des gens, et en même temps très près de leur cœur. Cette aventure m'a fait penser à l'écriture de Walser, à cette ligne mélodique qui fait entendre l'harmonie des mondes disjoints, qui concourent soudain, miraculeusement, à ce qui pourrait être et qui est. Oui, la vie est très belle, pleine de surprises et de noirceur, d'agitation et de sourires.
Au parking, les oiseaux se sont réjouis de mon retour, heureux, je crois, que je leur demande comment ça allait pour eux, et les herbes hautes ont applaudi.

Mésange nonette
Olivier entreprend de nouveaux travaux à Ferlens, un peu obligé par les circonstances ; le jardinet au sud des écuries est charmant. On ne s'était pas revus depuis plusieurs années, si bien qu'on a beaucoup parlé ; les moineaux se sont succédé au goulot de la fontaine, visible de la table de la cuisine autour de laquelle on était assis.
Le brouillard s'est levé, les pommes-de-terre sont pelées et coupées, la courge et les poireaux lavés et émincés, la tarte au four, les pointes d'asperge blanchies. Je confie le tout à Sandra et vais rejoindre au-dessus du triage le couple le bouvreuils et leur nid. Invisibles! Ai-je été trop présent ces derniers jours ou les motards qui vont et viennent sur leurs engins trafiqués les dissuadent de se montrer ?
Sandra et les enfants jouent aux dés lorsque je suis de retour, je fais cuire du riz et râpe du fromage. La rentrée c'est pour après-demain, Lili nous confie pendant le repas sa position sur la question : elle n'en veut pas à Charlemagne qui a inventé l'école, mais elle en veut sérieusement à celui qui l'a rendue obligatoire. Je ne suis pas loin de penser comme elle.
Jean Prod’hom
C'était donc ça

Cher Pierre
C'était donc ça : si la femelle que j'ai aperçue hier, et deux fois ce matin, se cache dans les branches du sapin nain, c'est pour y construire un nid, tandis que le mâle, bien visible, fait le guet. J'aurais pu le deviner le premier jour ; mais c'est tout autre chose d'avancer dans l'ignorance et de se réjouir de ses découvertes.

Cette histoire est d'autant plus curieuse que Sandra me fait voir le premier exercice de la première partie du manuel de physique dont elle est responsable, rédigé il y plusieurs mois déjà.
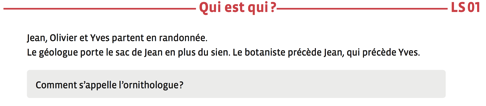
J'ai rendez-vous à 15 heures au Musée de Vidy où je salue Laurent qui travaille dans son bureau à sa prochaine exposition ; je récupère le carton contenant les tessons. Le lac, qui est à son niveau le plus bas, m'invite à aller jeter un coup d'oeil, jusqu'au pont de la Chamberonne au pied duquel je trouve une fleur bleue.
L'autoroute est bien dégagée si bien que j'arrive à l'heure à Baulmes ; l'hôtel de ville ressemble à un château, sa construction a été financée par les ventes de bois, m'explique Joël, le garde-forestier, des bois qui occupent la grande partie de la commune. La baisse des prix et le gui dont les graines sont rejetées et dispersées à la cime des sapins par les grives sont les principaux responsables de la baisse des revenus de cette petite ville de 1000 habitants, située au pied du col de l'Aiguillon.
Ce n'est pas loin de ce col que Joël m'emmène, à Grangeneuve où la classe des petits passera trois jours. Il se propose de nous accompagner un peu plus haut, dans la forêt de Limasses, et de nous raconter l'histoire de sapins trois fois centenaires, dont les deux plus imposants portent les noms de président et de vice-président ; de pique-niquer avec nous – ce Joël mérite d'être connu.
De nous retrouver également le lendemain dans un petit refuge, à deux pas de la carrière des Rochettes dont l'exploitation du calcaire marneux, souterraine d'abord, transformé dans l'usine de Chaux et ciments à Baulmes, a connu ses heures de gloire dans la première moitié du XXème siècle. Elle s'est poursuivie à ciel ouvert après la seconde guerre, jusqu'en 1962. Il faut noter encore que le dénommé Joseph Bon a établi en 1953 une champignonnière dans les galeries inférieures désaffectées ; le Joseph en question n'a visiblement pas fait fortune puisque l'Office des poursuites d'Orbe a procédé en 1957 à la vente aux enchères d'un aérochauffeur, de plusieurs centaines de m3 de fumier et des grillages.

J'espérais que Pierre-Alain R pourrait nous faire voir les oiseaux de sa région et tout particulièrement ceux qui ont élu domicile dans la carrière, il m'apprend au téléphone qu'il sera en voyage.
Je rentre en m'arrêtant en vitesse à Epalinges où j'achète du pain, à Corcelles où j'achète du fromage. On appelle fondue le mélange de ces deux produits.
Jean Prod’hom
Rendez-vous de chantier

Cher Pierre,
Rendez-vous de chantier ce matin avec l'architecte, l'électricien, le cuisiniste et le chauffagiste ; manquaient le charpentier, le maçon et le menuisier. Ce qui étonne chez ces gens-là, c'est d'abord leur confiance ; non pas celle de l'infatué qui croit savoir, mais celle qui se nourrit de l'assurance que les choses ne se passent jamais exactement comme on le veut, mais qu'elles n'ont jamais eu l'intention de mettre en défaut qui que ce soit et qu'il y a toujours une solution pour contourner ou même prendre appui sur l'obstacle qu'elles représentent tôt ou tard.
C'est ensuite la faculté que chacun d'entre eux a de collaborer sans déborder sur les compétences des représentants des autres corps de métier, sans en douter non plus, en maintenant la distance qu'il convient, sachant que leur actes ne sont pas indépendants, qu'ils concourent aux mêmes fins : ensemble et chacun séparément. Tout cela paraît évident,
Lorsque je compare leur travail, la façon dont ils l'abordent et les principes qui les animent, je me plais à imaginer que quelque chose de pareil pourrait animer le corps des enseignants, qui pâliraient de jalousie s'ils se penchaient sur l'efficacité des échanges de ces gens qu'ils disqualifient si souvent, sur leur bon sens aussi, non pas tant celui auquel on recourt idéologiquement pour recouvrir d'un voile nos ignorances, mais celui qui donne assez de jeu pour que la logique de nos actions puisse s'ouvrir à l'imprévisible.
Il faudrait exiger des candidats à l'enseignement qu'ils fassent un stage d'une année au moins dans le secteur de la construction, ne serait-ce que pour les garder de l'idée simpliste qu'ils se font de la connaissance comme empilement de briques, colportée depuis des lustres par les responsables de l'école obligatoire.
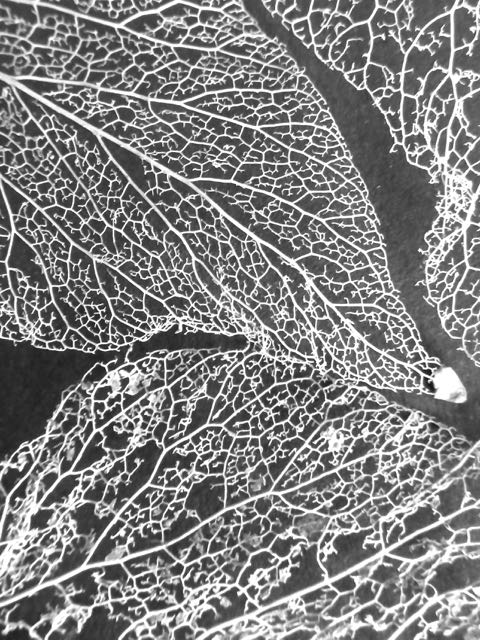
Je retrouve pour la première fois cette année le sol des sous-bois, assez sec pour s'y asseoir, Oscar les explore. Et le calme revenant, je m'avise du rôle de l'appétit, de la soif, de la digestion, de l'oxygénation, de la marche, des saisons dans le fonctionnement de l'intellect, de tout ce que celui-ci aurait bien voulu se passer.
Reviens en pensant à cette phrase du prologue qui ouvre Les Neiges de Damas d'Aude Seigne que j'aurais la chance de rencontrer le mercredi 22 avril à Yverdon (Libraire l'étage) :
C'est un livre contre la dictature du sens et de la cohérence, contre l'obligation de conclure.
Propos décidé, qui semble répondre à une fringale et à un insatiable désir de totalité, provocation aussi à laquelle les plus solides d'entre nous pourraient souscrire, mais aussi les plus faibles ; mot d'ordre en forme de paradoxe, écrit par une jeune femme dans les premières années du XXIème siècle, mais qui aurait pu l'être également par un jeune Nietzschéen du troisième quart du XXème. Car enfin, cet énoncé, en vertu même du principe de réflexivité, ne permet pas de conclure, ni sur son sens ni sur sa cohérence.
En réalité, ce paradoxe est une épreuve. Faut-il tenir jusqu'au bout à cette logique qui n'en est pas une en s'y accrochant par souci de loyauté et renvoyer l'explication finale, la clé de voûte et la conclusion à plus tard ? Ou y renoncer séance tenante ?
La littérature, comme la philosophie, est tout à la fois un poison et un remède : poison pour les êtres faibles qui inventent des fables pour se convaincre eux-mêmes de l'impensable et obliger ceux sans lesquels ils seraient seuls à les suivre ; remède pour ceux qui sont en pleine santé, assez forts pour expérimenter une voie singulière au risque d'aller de ce pas vers l'insensé et l'incohérent. Sans conclure.
Dictature du sens soit, mais en quel sens, en sacrifiant les principes d'identité et de non-contradiction ? Ne pas conclure pourquoi pas, mais en différant le dernier mot de telle manière qu'on pourrait croire s'être débarrassé des fins une fois pour tout ? Voilà où j'en suis. Pas sûr que tout cela soit très sensé et cohérent.

Je monte à la bibliothèque et réunis les éléments qui devraient constituer ce qu'on appelle pompeusement un dossier de presse en vue de l'événement qui aura lieu à Grignan en septembre. Là encore, je suis tenaillé par la crainte de faire faux.
Jardin en fin d'après-midi, je déplace les trois dernières lavandes, taille un lilas. Arthur rentre de ses deux jours de camping, Louise et Lili reviennent de chez Marinette. Ils ont faim, je fais bouillir des pâtes, râpe des carottes rouges et réchauffe les restes du gigot de dimanche. On parle des chamboulements que les prochains travaux vont amener dans la maison ; Sandra sourit, elle est un ange.
Jean Prod’hom
Marcher dès le saut du lit fait du bien

Cher Pierre,
Marcher dès le saut du lit fait du bien, surtout lorsque la part de soi chargée de faire le point – qui suis-je? où suis-je? qu'ai-je à faire? – annonce au réveil, à celui qui attend les instructions, que ce qui devait être fait a bel et bien été fait la veille. Et lui indique, pour le combler, qu'il serait préférable de remettre à plus tard la tâche prévue, laquelle attend, comme le pain, son levain.

En effet, j'ai fini hier soir de rédiger les réponses aux questions qu'Amandine Gleralec m'a adressées, et les cinq poèmes que V. M-A. m'a invité à écrire demeurent dans les limbes. J'ai donc marché une grosse demi-heure en équilibre, sans appréhension, sans ombre : Mussily, Moille aux Blanc et retour.
Mais il est temps de descendre à la mine ; pas sûr que les gamins soient aussi enclins qu'Oscar à renifler les pistes qu'ils croiseront ; en voilà un qui est toujours content lorsqu'on se saisit d'une laisse.
J'aperçois en sortant de la maison les traces de deux paradis : devant la porte-fenêtre du salon et en bas des traverses de chemin de fer. Ce sont les filles qui ont sorti, hier après-midi, les craies ; elles ont indiqué, en couleur, les étapes pour y accéder ; la pluie de la nuit n'a pas réussi à les effacer et dans le jardin, l'hiver a buté contre les fragiles obstacles qu'elles ont dressés pour jouer avec leurs chevaux imaginaires, enfermés tout l'hiver dedans leur tête.
Si mes premiers pas ont baigné dans une douceur printanière, il n'en ira pas de même pour l'élève dont la maman est morte hier matin des suites d'une longue maladie. Je me raisonne, il ne faut préjuger de rien, les hommes ne manquent pas de ressources ; on leur prête trop souvent nos faiblesses, sans considération des réserves dans lesquelles ils puisent lorsque l'irréparable se produit.
Pas tous! La situation en effet dans laquelle l'organisation de la société plonge certains de nos enfants, fragiles déjà, ne les aide pas à recourir instinctivement aux forces dont ils disposent, sans le savoir ; à en user pour trouver une place qui leur ferait défaut ou à laquelle ils n'auraient jamais eu accès. Au contraire, leurs forces tendent à s'échapper, à se diluer, à se perdre dans les mailles du tissu social.
L'impératif de croissance est mortifère. Sans que l'on sache précisément si la multiplication des aides, des médiations, des marabouts, des psychiatres, des coachs, des psychologues, chaque fois qu'ils interviennent, est à l'origine de la réduction de substance des personnes dont ils s'occupent, ou si cette substance est entamée avant même qu'intervienne le filet social. Répondre à cette question ne change rien à l'affaire, puisque celui-ci ne parvient pas à endiguer la montée des pauvretés, à refaire du lien et donner un peu de confiance à ceux qui en manque. A moins que je ne me trompe, les plus optimistes n'hésitant pas à affirmer que tout va encore assez bien, qu' il ne faut pas se plaindre, que ça pourrait être pire, reconnaissant par là qu'on ne perd rien pour attendre.
L'architecte est venu en fin d'après-midi nous présenter les grandes lignes des différents travaux d'isolation sur la maison ; on risque bien de faire la totale. Je laisse Sandra à l'architecte, parce qu'il est temps de conduire Arthur à Ropraz Le temps s'est refroidi et je retrouve les filles, Lili frigorifiée, sortant du manège à Thierrens, la voltige ne les aura pas réchauffées. Le feu brûle dans le poêle.
Les derniers chapitres des Chroniques de l'Occident nomade m'occupent jusqu'à 8 heures. Aude Seigne raconte sa fâcheuse habitude de compter les marches d'escalier ; elle se souvient notamment du nombre de celles qui lui ont permis d'atteindre le sommet du minaret le plus septentrional d'Europe (XV). J'aurais pu succomber à cette tentation, si et seulement si j'avais été capable de déterminer avec certitude où commencent et où se terminent les première et dernière marches de n'importe quel escalier.
Elle évoque les malentendus qu'engendrent la collision des temporalités (XXII), la honte qui saisit le voyageur (XXVI), l'agitation qui l'amène à considérer un si grand nombre de choses en même temps qu'elles est lui se vident de leur substance (XIX).
Quelque chose doit changer, cette fuite s'interrompre, inexplicablement (XXI), en devenant effacement de soi (XXII). Le départ prend alors le pas sur le voyage (XXIII), l'écriture sur les notes. Deux ans pour donner une expression à ce besoin de voir les choses s'éloigner, dos au mur, le port d'Ancône dans les lumières d'hiver (XXV). Dire ce mouvement pour tenir les deux bouts, voyager et demeurer sur le pont d'un rafiot.
Jean Prod’hom
Evaluer la santé et la vitalité d’une institution

Cher Pierre,
S’il est correct d’évaluer la santé et la vitalité d’une institution à ses capacités de ne pas exclure les plus faibles de ses éléments, l’établissement dans lequel je travaille est sur la bonne voie.

C’est ce que je me suis dit cet après-midi en voyant dans une salle de dégagement, la porte vitrée grand ouverte, ensemble le doyen accaparé par ses tâches et un gamin de quatorze ans dormant profondément à la table voisine, son manuel de français en guise d’oreiller et le soleil pour le réchauffer.
J’ai cru distinguer dans les sourires échangés par certains d’entre nous une espèce de satisfaction, celle d’avoir été capable de laisser la priorité au bon sens, d’avoir eu le courage d’ignorer la logique institutionnelle et d’accepter nos limites, faisant voir à qui ouvre les yeux que l’école constitue, dans une société spécialisée dans l’aménagement des aires de repos et de dépose, le dernier des refuges.
Il me faut boucler avant 16 heures la journée et la semaine, je repars en effet lundi prochain pour Crans-Montana, cherche l’efficacité à outrance. C’est d’ailleurs ce qu’on devrait enseigner dès le premier âge, apprendre à mettre en oeuvre un minimum d’efforts pour un maximum de résultats, ne recourir qu’à des bouts de chandelle pour donner à voir l’essentiel, bref retrouver l'idéal des Lumières et des poètes.
Me lance à 16 heures 30 dans la valse du jeudi : Riau, Ropraz, Thierrens, Ropraz Riau. La musique s’arrête à 20 heures devant un vacherin et des pommes de terre en robe des champs. Chacun remonte ensuite dans sa chambre ; Louise m’appelle pour lui lire le trentième et dernier chapitre du livre qu’elle a commencé en début de semaine :
Devant moi, sur le chemin, gît une petite plume blanche, aussi douce et pure que si elle était tombée des ailes d’un ange. je la ramasse en souriant, puis je rentre dans la maison. (Aux Délices des anges)
Je fais un saut au jardin, cherche la lune ; elle était au-dessus des Gibloux à 7 heures, de la Dent de Lys à 8 ; la voilà à 10 au sommet de l’un des deux chênes du jardin. Elle demeurera, décidément, l’être le plus imprévisible que je connaisse.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 5) L'Aar

Cher Pierre,
Les oiseaux chantent le long de l'Aar, ils prennent garde de ne toucher à rien. L’Aar lisse et glisse sous les ponts, mutité large et mate gorgée de soleil, avec au fond une partie du ciel et l’or qui entoure la ville. Deux cygnes noirs, un verdier sur la berge, des corneilles qui prennent un bain. Ici, c’est tous les jours dimanche, et c’est pour cela que j’aime les dimanches.

Si on entend, lointaines, les cloches du Münster, ici en-bas on ne se sent pas concernés, on passe. D’ailleurs les bancs publics sont rares ; j’en trouve finalement un devant le Stürlerspital des Diakonissenhauses, là où l’Aar termine sa boucle, c'est-à-dire son travail, et se lance en direction du lac de Bienne. Je reste pour la voir passer, sans regret, le soleil nous a manqué au début de la semaine. Bien sûr, c'est difficile de dire ce que la ville doit à l'Aar, plus facile de dire ce que l'Aar doit à la ville, pas grand chose, l'impression d’avoir été utile en la bordant. Il faudrait rester ou revenir, refaire, reprendre à la même place pour mieux comprendre la confiance qui habite les cours d’eau et reconnaître tout ce qu’on leur doit. L’Aar n’appartient pas à la ville, elle est l’envers de sa légende. Qu’on lui laisse son lit.
Porte fermée au centre Rober Walser où sont exposés quelques-uns de ses microgrammes, me rabats sur Nakis Panayotidis au Kunst Museum. Du monde dans les rues de Berne, c'est carnaval avec la nouvelle question qui l'accompagne, celle du seuil. Les déguisements ne se distinguent guère de nos habillement quotidiens. Il y a un continuum, et cette absence de coupure inquiète au même titre que toutes les manifestations qui ont voulu ou dû s’en passer.
Passe en rentrant par le CHUV. F cherche quelque chose de plus solide que la barrière du lit à laquelle elle s’accroche. Je discute à la cafète avec Valérie.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 4) Samuel

Cher Pierre,
Les moments passés entre nous lorsqu’on en a fini avec nos adolescents, qui se prolongent sans qu’on s’en aperçoive, pèsent sur ma volonté ce matin à 6 heures 30. Prendre un peu l’air en haut du tunnel de la Zivilschutzanlage ne suffit pas, une lourde fatigue colonise mon corps qui se raidit et raccourcit ma respiration. Si bien que j’ai tôt fait de rentrer.
Le hasard a voulu que je dispose d’une heure, je l’emploie sur une paillasse militaire à lire une nouvelle de Bernard Comment avant de céder au sommeil.

Le soleil s’est installé sur Berne et chacun a le sourire quand on monte dans le tram. Il y a du monde sur la Place fédérale, les nôtres portent leurs habits de gala. C’est pas pas tous les jours qu’on a quinze ans, qu’on parle à la tribune de la salle du Conseil national, devant plus de deux cents personnes. Première fois que ces gamins vivent en démocratie en y participant vraiment, en réalisant ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ils ont accepté les règles dont l’établissement les précède, et c’est de ce consentement-là, initial, qu’il exercent leur liberté. Ils ont accepté le principe, avant d’agir pour changer ce qui peut l’être, de se ranger à l’avis de la majorité. A moi de leur rappeler qu’il convient parfois de désobéir aux règles, on ne le dit pas assez, si la folie s’empare des hommes.
De ces cinq heures de délibérations, votations, recommandations, il faudrait évidemment tout dire. Mais si tout m’était enlevé à l’exception d’une seule chose, c’est de l’histoire de Samuel tout au long de cette semaine que je me souviendrais, et d’un moment très singulier, lorsque ce gamin, traversé par le syndrome d’Asperger, a décidé de se lancer et de lire à la tribune ce qu’il avait rédigé la veille.
Ce qu’il voulait dire est resté bloqué un long moment dans sa poitrine, il a respiré profondément, à plusieurs reprises, avant de se lancer enfin. Ça a duré 2 minutes 50, il s’est arrêté une ou deux fois, là où il avait placé des points à ligne, avant de rejoindre le dernier mot. Il lui a fallu réitérer le même effort, respirer profondément, allumer sa voix, avec les mots loin dans la poitrine, en crue, qu’il lui a fallu remettre en file indienne.
On en avait parlé la veille, je lui avais raconté l’écriture boustrophédon, il savait que s’il ne parvenait pas à enchainer les parties de son texte sur un seul sillon, il aurait à engager toutes ses forces pour redémarrer. Il a préféré honorer les différentes parties de son discours sans lesquelles celui-ci aurait été comme un ensemble de membres disjoints. Il a choisi le sens contre son handicap, les autres en lieu et place de son confort. Cet enfant a une force extraordinaire, il est allé jusqu’au bout.
Pour le reste, cette session à Berne m’aura confirmé dans l’idée que les adolescents sont très conservateurs, et que s’ils veulent que les règles en usage perdurent, c’est pour prolonger la possibilité de leur désobéir, les transgresser et, ce faisant, différer l’âge des responsabilités.
On se couche encore une fois trop tard. Mais ces rencontres entre personnes régies par les mêmes règles, sans rien avoir d’autre de commun que la proximité ou le voisinage, ont quelque chose de miraculeux. Nous ne parlons pas la même langue, vivons dans des régions géographiquement très différentes, partageons quelques-unes de nos infrastructures. La Suisse? Ni une patrie ni une nation, mais une société en acte.
Cérémonie de clôture d’Ecoles à Berne. Quelques élèves improvisent une chanson qu’ils chanteront tout au long du trajet du retour :

Discours de Samuel
Tram numéro 9
jeux électroniques
discours de Samuel
la nourriture chers cuisiniers c’était très bon
Ambassade de Colombie
sucettes à la pomme et au coca-cola
on s’est éclatés durant cette semaine
en participant à Ecoles à Berne
Tram numéro 9
jeux électroniques
discours de Samuel
la nourriture chers cuisiniers c’était très bon
La chancellerie fédérale
nous a fait attendre trop longtemps dans le froid
il fallait récolter cent signatures
on a même fait du sport le lundi soir
Tram numéro 9
jeux électroniques
discours de Samuel
la nourriture chers cuisiniers c’était très bon
On voulait jouer une dernière fois au jeu des fondations, Schwytz, Berne, Grisons et Vaud, au bar du Novotel. Fermé. On s’est rabattus sur le bar voisin, bondé. Les supporters d’Everton fêtaient la victoire de leur club contre l’équipe bernoise. Impossible de s’entendre, c’était le moment de se quitter.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 3) Il y a un chasseur parmi nous

Cher Pierre,
Le groupe se retrouve dans la salle 3, travaille entre 7 heures 30 et 9 heures 15. Visite ensuite du Palais fédéral ; la guide, italophone et pleine d’entrain, pleine aussi d'idées préconçues sur les adolescents, ce qu’ils sont, font, et pensent, les rend muets ; elle s’en étonne. L’enthousiasme et la passion tuent, c’est bien connu, ses interlocuteurs ont baissé les bras, baissent les yeux, elle se plaint, le malentendu est installé, chacun se méfie. Tout ça donne envie de fuir.

Cher Pierre,
Jacques Neyrinck nous a fait faux bond, personne dans la salle 287. Les 24 adolescents s'étaient intéressés à la vie et à la carrière de cet imprévisible ludion du landerneau politique vaudois, démocrate et catholique, ingénieur et romancier, vieil homme de plus de 80 ans. Ils avaient préparé cette rencontre, les voilà déçus, déçus d’une absence dont ils ne s’attendaient pas. Je lui téléphone, il a effectivement oublié. S’est ajoutée, dit-il, une urgence. A moi de l’excuser. On ne peut s’empêcher de repenser au film de Bron, à certains mots à son propos : Neyrinck? Personne ne sait ce qu’il va dire, faire ou voter. S’il va changer de position au dernier moment.
En rentrant en tram à l’Arena, je suis frappé du nombre d’anneaux que filles et garçons se sont fixés sur le visage, anneaux qu'on ne voyait autrefois qu'au museau des bovins et qui ornent aujourd’hui d’innombrables visages : nez, lèvre, joue, front, paupière, sourcil. Cette ferraille inquiète, comme si leurs porteurs, attachés à rien, cherchaient quelque chose à quoi s’accrocher. On aimerait qu’ils en prennent conscience et s’en débarrassent, comme on se débarrasse discrètement d’une miette de pain restée sur la lèvre ou une coulée de rimmel au coin de l’oeil. Mais on n’ose leur en parler de peur de les gêner.
Le ministre de l'ambassade de Colombie a séduit l'auditoire dans ses bureaux du deuxième étage de la rue Dufour. Un immeuble locatif des années 70 que l’ambassadeur partage avec ceux de Slovénie et des Philippines. Le ministre offre à l’un participant qui lui en demandait les références un exemplaire en français de Cent ans de ans de solitude. D’autres auraient sans doute eux aussi aimé recevoir un cadeau, mais tant qu’à faire, ils auraient préféré le dernier disque de Shakira. On rentre avec la nuit, les premiers masques du carnaval guignent au coin des rues. On se hâte, souper à 18 heures. Les orateurs de demain préparent jusqu’à plus de 22 heures, sous les néons de la Zivilschutzanlage, leurs interventions de demain.
On se retrouve une nouvelle fois dans le bar du Novitel : Bernois de Bienne et de Berne, Schwytzois de Pfäffikon, Grisons de Cazis, Vaudois de Corcelles et de Baulmes. Il y a un chasseur parmi nous, grison. Il nous raconte la chasse haute dans ses montagnes, le profusion des cerfs, la rareté des chamois, l’arrivée des loups, ses rencontres avec les bêtes, ses trophées. Il nous fait part de cette paradoxale conviction selon laquelle une bête que le chasseur tire a donné préalablement son consentement. Lorsque je lui oppose qu’en tuant l’animal, le chasseur s’interdit tout accès non seulement à ce qu’il n’est pas mais encore à ce qu’il est lui-même, il me rétorque que l’animal mort emporte non seulement son secret mais aussi celui du chasseur. Pourquoi dès lors ne pas les laisser fuir tous les deux?
Lis très tard les dernières lignes de l’Abrégé du monde. Pour la première fois. Reprendrai une seconde fois la semaine prochaine, pour y voir clair.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 2) Bars de l'Eleven et du Novitel

Cher Pierre,
Nuit courte. Je me retrouve au déjeuner, bancal, face au Grison que les hurlement de sa fille ont ramené à la vie. L'impression qu'il m'a faite hier se confirme ; tout en lui rappelle les caprinés qui habitent les montagnes au-dessus de Cazis : yeux tombants, longs cils, nuque osseuse, pattes arrière résistantes, jarrets fins, jusqu'à sa voix de fumeur, rauque : entre le brame du cerf et le bêlement de la chèvre. Son insouciance aussi.

À la table siègent encore un hibou, un phasme, un paresseux, une musaraigne, un moineau, une perruche, un renard, une autruche, non deux autruches, une oie, un mustang, un fourmilier. Tous semi-domestiqués, ou croisés avec un humain, demi-dieux.
Il fait un froid de canard, les trois ours de la fosse hibernent ; j’en aperçois un respirer sur l'écran de télévision placé sur le chemin du bord de l'Aar. Froid polaire devant Erlacherhof, devant le Münster, la Banque nationale et le Palais fédéral. La chancellerie nous fait poireauter un bon quart d’heure avant qu’un de ses employés montre son nez du bout des doigts, à peine deux mots, il a froid. Se retire aussitôt avec la liste des signatures de tous ceux qui qui veulent un Mariage et famille pour tous.
Les commissions de l’après-midi réchauffent les esprits et l’atmosphère. Les adolescents n'ont plus besoin de moi, je vais m'étendre sur une paillasse militaire, lis quelques lignes de l’Abrégé du monde. Elles me suffisent.
Longue séance de discussions le soir au sein du groupe parlementaire, jusqu'à dix heures. Les adultes sortent ensuite : bar de l’Eleven au Wankdorf, celui du Novitel ensuite, on ne compte plus les heures, la nuit sera une seconde fois courte, très courte.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 1) Lausanne-Berne

Cher Pierre,
Purée de pois au Riau, la batterie de la Yaris ne répond pas ; la lance sur le chemin, elle consent à démarrer avant le tilleul. Je respire enfin lorsque le soleil fait son apparition à la Marjolatte.

Bois un chocolat chaud au buffet de la gare, croise une foule de gens décidés, trop. La ville, le matin, m’inquiète ; elle réveille quelques mauvais souvenirs, Bruxelles, Rome, Paris. Et je retrouve cette peur sourde qui me raidissait, la sensation d’être enveloppé par quelque chose qui est plus que la ville, la déborde et en fait un bateau ivre, agité, sans capitaine sur le pont ; monstre ravitaillé par de fragiles embarcations sur un océan sans continent.
Les 24 adolescents que je vais accompagner à Berne tout au long de cette semaine sont à pied d'œuvre dans le hall central de la gare. Le candidat, que le groupe parlementaire a choisi pour la présidence du Conseil national, traduit en allemand le discours qui devrait convaincre les conseillers des cantons de Berne, de Schwyz et des Grisons ; la présidente du groupe traduit de son côté la présentation qu'elle fera, cet après-midi, de son parti : leur combat pour le droit au mariage de chacun avec chacun, quel que soit son sexe, et des droits que cette institution induit ; leur volonté d’accroître le contrôle de l'expérimentation animale et d’abaisser les prix des transports publics, leur désir d’améliorer la situation des demandeurs d'asile et de responsabiliser les jeunes au volant.
La train rentre à nouveau dans la brouille sitôt qu'on a tourné le dos au Léman, Fribourg remue dans le coton, Berne ne fait pas mieux. Tram jusqu'à l'Arena ; une étudiante, charmante, accueille notre groupe et nous fait découvrir les locaux ; le béton triple couche des abris PC n'a pas bougé depuis l’année dernière : couleurs fades et glacées, odeurs visqueuses.
Impossible d’éviter la litanie qui assure la bonne marche de la session : information, concertation ; bientôt élection, commission ; puis discussion et votation. Jusqu'à 21 heures 30.
Termine la journée dans une halle de curling, puis la soirée au bar du Novotel avec deux enseignants des Grisons. L’un d’eux raconte l'avalanche qu’il a déclenchée, il y a quelques semaines. Il était avec son jeune fils et sa fille qui les a sauvés en hurlant, au dernier moment, alors que l’avalanche fondait sur eux. Sans quoi ils auraient été perdus. La fille a pu rester au-dessus de la coulée, le père et le fils fuir sur les côtés. Le père se félicite aujourd’hui, – que peut-il dire d’autre de son inconscience ? – qu’ils sont vraiment de bons skieurs. Je pense en m’endormant au père d’Arthur qui a eu bien moins de chance.
Jean Prod’hom
Ce rien qui distingue leurre et lyre

Cher Pierre,
Cinq heures, ciel bleu, et blanc sans limite. Je me suis tourné toute la journée, à intervalles réguliers, en direction du treizième étage de d’hôpital ; je l’imagine cherchant à offrir à sa raison un point d’appui et un lieu où se reposer. Il se dérobe, et l’infatigable reprend l’inventaire de son semainier, dont les tiroirs ne semblent s’ouvrir que du dedans. Me suis senti hier incapable ni d’y entrer ni de l’en faire sortir.

La raison qui fait tenir ensemble le langage et le monde est un lien fragile, miraculeux. Il laisse entrevoir, lorsqu’il cède chez celui dont on a été si proche, l’étendue de notre ignorance. Et on se réjouit que ce lien qui s’est défait puisse se refaire.
Cette fragilité, je crois l’avoir évoquée ce matin à la mine, en parlant de la figure de Nicolaï Troubetzkoy, ou plutôt en faisant voir sa découverte à de très jeunes élèves, le ce à quoi peut se réduire notre langue, à ce rien qui distingue père et mère, mort et sort, leurre et lyre, et du monde qui s’en suit.
Je récupère Arthur à l’arrêt de bus, mets une bûche dans le poêle, fais de l’ordre dans la paperasse concernant la course de Ropraz : ce soir il y a séance de comité. Le jour poussé par la nuit s’en est allé voir ailleurs.
Jean Prod’hom
Réunion syndicale

Cher Pierre,
On courbe l’échine de Corcelles à Peney. Pierrot et Jean-Jacques font ce qu’ils peuvent pour contenir la neige ramenée sans cesse par la bise sur les routes communales. Ils se lèvent avant l’aube; on aperçoit loin dans la nuit les phares de l’attelage, le bruit du moteur qui grossit, la lame blanche qui écarte les congères ; je fais un signe, Pierrot ou Jean-Jacques, lui seul le sait.

Non, j’ai appris qu’un homme au coeur plein d’angles avait barré l’accès de sa cour libre de neige, interdisant ainsi aux conducteurs qui auraient souhaité rebrousser chemin de manoeuvrer sur ses terres. La bise, par bonheur, a renversé son dispositif. S’il y a beaucoup de Charlies, il y a aussi quelques Charlots qu’il est préférable de garder à distance. Je m’inquiète et ris jaune : il y a tant de caméras sur les façades des maisons.
Réunion syndicale en fin de journée : les conditions de vie de certains enseignants sont devenues tout à fait impossibles, des conditions dues en partie à l'intégration, dans les groupes, d'enfants difficiles, très difficiles, voire impossibles. Les aides sont insuffisantes. Notre établissement n'y coupe pas. J’imagine les années qui viennent, il n'y a pas besoin d'être voyant pour se faire du mauvais sang.
L'être, voyant, conduirait à ne voir que du noir, ne percevoir que des craintes et des tremblements, chacun s’essayant à sauver sa peau et à réparer héroïquement l'irréparable, alors qu’il conviendrait de tout recommencer depuis le commencement, là où nous sommes, avec ceux qui sont là, en désobéissant, en inventant, avec élégance, discrètement.
Jean Prod’hom
Le préau

Cher Pierre,
La gamine n’est pas allée à l’école, elle est restée cachée dans sa chambre ; elle se promènera tout l’après-midi dans la neige autour de chez elle. A ses parents qui lui demandent le soir, fâchés, ce qu’elle a fait, elle ne pipe mot. Elle leur confie pourtant, à la fin, qu’elle a aperçu trois chevreuils. Son père lui rappelle ses obligations ; sa mère lui sourit.

Position haute, debout derrière le cadre d’une fenêtre au deuxième étage du collège : dehors le froid, la neige et le noir du bitume, l’immobilité des enfants, les arbres et la forme du préau, les bonnets rouges, verts, les bonnets jaunes et le ciel bleu, les bâtiments qui bordent le haut de la scène, tout ça mis ensemble me rappelle un tableau qu’aurait pu réaliser un Flamand du XVIème siècle ; regard en pente descendants, plongée comparable à celle qui fait voir les paysages hivernaux qu’a peints Pieter Brueghel l'Ancien (ou l’un de ses admirateurs) : L'Adoration des mages, Le Dénombrement de Bethléem ou Le Massacre des Innocents, Les Chasseurs dans la neige ou Les patineurs et la trappe aux oiseaux.
Pourtant, c’est à une autre représentation signée du maître flamand que j’ai songé de là-haut, celle dont l’impression au format mondial orne les classes des tout petits avant qu’on ne la retire de chez les grands, au prétexte que les choses sont désormais sérieuses : Les Jeux d'enfants.
Mais dans le tableau que j’ai sous les yeux, aucun signe du monde joyeux qui agite la place d’Anvers, pas trace des corps dansants et gesticulants, des jeux d’équilibre. Mais des corps disciplinés plus tout à fait innocents, les enfants y sont rares, une vingtaine seulement contre plus de deux cents chez le Flamand.
On ne joue pas, on ne joue plus ; pas trace de cerceau, de bille ou de poupée, de dés ; pas d’échasses, pas de saute-mouton ou de culbute : bien sûr c’est l’hiver ; mais pas d’igloo non plus, de glissades, de bonhommes de neige, de pierres qui curlent ou de palets. Ici, il est interdit de jeter des boules de neige, c’était écrit mais on a corrigé, il est interdit d’en lancer. Il sera bientôt interdit de toucher à la neige.
Le préau ressemble à la cour d’un hospice sans vice ni vertu. Mais on devine derrière le calme apparent de ces statues frigorifiées – derrière les obligations qui vertèbrent leur vie – une eau qui frémit, un pays d’où tout adulte est banni, une folie printanière.
Jean Prod’hom
Des gamins qui lèvent la main pour en être

Cher Pierre,
La neige et le froid auraient eu raison de moi si Arthur ne m’avait donné un coup de main pour sortir la Yaris du chemin des ruches. Il y avait du verglas ce matin. J’ai roulé prudemment jusqu’au Mont, traînant derrière moi un cortège de plusieurs dizaines de véhicules qui ont eu la sagesse de ne pas me dépasser. J’ai vu juste, nous avons en effet rejoint, puis dépassé un peu avant la bifurcation du Chalet-des-Enfants, deux imprudents dans le fossé, ils attendaient des renforts.

Nous vivons au Mont la semaine des conseils de classe, à l’occasion desquels je constate, chaque année davantage, que l’administration scolaire a progressé dans son effort de gestion et de centralisation, avec ses effets collatéraux.
Les obstacles qu’elle a placés sur notre chemin, un peu à son insu, pour baliser et assurer son contrôle, m'auront fait grogner une bonne partie de la matinée, en me laissant l’impression que chacun d'entre nous collabore désormais au verrouillage de nos généreuses entreprises, participe d’un formalisme frileux, prend des précautions excessives générées par la peur ; on se méfie, avec derrière nous les priorités que les notables évoquent dans les dîners mais auxquelles on ne croit plus guère : elles sont devenues secondaires.
Nos élèves ont pris le sillage et nous avons intégré, les uns et les autres, l’idée qu’il est impossible de revenir en arrière ou d’infléchir les trajectoires, interdit de prendre un peu de temps, de nous tromper ou de nous égarer. C'est bien à une voix venue de nulle part que nous obéissons, sourde à ce qui est en jeu, prête à nous laisser en paix pour autant qu’on respecte les procédures, les délais, les habitudes. L’esprit a quitté la partie ; il se réfugie, j’ose l’espérer, dans les préaux.
Un ami m’a montré hier une photographie sur laquelle on pouvait apercevoir des notables de l’Etat islamiste, très affairés, souriants, occupés à soulever à Racca une armée de petits soldats. Des gamins de 10 ou 12 ans, enthousiastes, qui lèvent tous la main pour en être. Je me suis dit aujourd’hui que si les nôtres maintiennent la leur baissée, il ne faut pas nous en plaindre mais nous en réjouir. Nos gamins résistent.
Pour autant qu’ils soient amenés, de l’autre côté, loin des mirages relationnels, à creuser une galerie dont on ne voit rien en surface, leur chemin de taupe, et dont ils ressortiront plus tard éblouis. La pédagogie n’a pas pour tâche de réunir les collectifs autour de réponses communes, mais à faire en sorte que chacun s’essaie à un questionnement sans réponse immédiate.
Tout faire donc pour qu’en certaines circonstances – elles sont nombreuses – personne ne lève la main.
Jean Prod’hom
Arrêts du mercredi après-midi

Cher Pierre,
Du mouvement il n'y en a presque pas derrière les baies vitrées : les fumées avalées sitôt échappées du conduit des cheminées, trois drapeaux qui sèchent ; passent entre deux villas un bus et sa remorque, un scooter, plus haut dans le ciel une corneille en coup de vent.
Au premier étage du Mottier quelques soupirs, l'aiguille des secondes, une main qui se soulève, le froissement d'une feuille ; par la porte entrouverte le bruit tranchant d’un massicot, le ronflement d’une machine à café, un concierge qui chantonne. On se regarde en souriant, aucun d’entre nous n’a choisi d’être là.

Huit élèves ont été convoqués aujourd’hui, 13 ou 14 ans, pour des devoirs non faits, des violences, des oublis, des impolitesses, des indisciplines, pour une boule de neige.
Ils sont là, dit-on, pour remettre les compteurs à zéro ; mais je soupçonne, à les voir souriants et dociles, qu’ils sont là pour goûter au calme de ces mercredis après-midi d’hiver. Certains rêvassent, le collège est vide ; d’autres se lancent à corps perdu dans le travail qui leur a été imposé.
Les traits détendus, ils n’ont plus besoin de répondre de leur rang, des actes héroïques ou désespérés qui les ont conduits jusqu’ici. La désobéissance est derrière eux, plus besoin de faire la preuve de quoi que ce soit, réjouis seulement qu'on leur foute la paix. Certains ont à rester trois quarts-d’heure, d'autres une heure et demie.
La qualité de ce moment me pousse à demander à ceux qui en ont terminé, s'ils veulent rester une période supplémentaire, arguant qu'il fait bon être ainsi ensemble, chacun pour soi, à sa tâche, sans que personne ne vienne nous déranger. Ma proposition les fait sourire, pensez donc, l'un d'eux a 36 heures d’arrêt en suspens. On se salue.
Les deux élèves qui n’ont pas fini de purger leur peine reprennent leur tâche. Mais l’un d'eux s'endort, il en est à son vingtième devoir non fait, je ne le réveillerai pas. L'autre bute sur le poème que l’institution lui a commandé de rédiger : un poème sur la vie. Il me demande de l’aider, c’est quoi les rimes, à quoi ça sert, on discute. Nous sommes bientôt interrompus par le retour d’un de ceux qui viennent de nous quitter, il voudrait rester avec nous, et faire ses devoirs d'anglais.
L’après-midi se termine comme elle a commencé, sans bruit, avec à la fin un poème que l’auteur me fait lire.
La vie n'est pas toujours facile
Il y a parfois des choses difficiles
Des malheureux qui n'ont plus de famille
Plus de fils ni de fille
Comme en Syrie
Il a accepté que je le publie ici ; ces gamins qui n’aiment pas l’école sont décidément tout à fait fréquentables, ils méritent mieux. D’un peu d’attention, et peut-être, d’un lieu où on leur foutrait la paix.
Jean Prod’hom
Célestin Freinet veillait sur nous

Cher Pierre,
La neige est tombée cette nuit sans compter ; mais Pierrot a passé la lame bien avant que les habitants du quartier ne s’en rendent compte, si bien que nous avons tous pu nous rendre à notre travail. J’ai rêvé toutefois, un bref instant, comme un enfant, que la neige et son allié le vent avaient formé des congères si imposantes qu’elles nous avaient, Sandra, les enfants et moi, empêchés de quitter la maison. Nous avions dû évidemment avertir les autorités scolaires de ce contretemps, feignant que c’était à contre coeur, tout heureux en réalité de rester près du poêle, à jouer, lire, Louise à la guitare, Lili au piano.

C’est en cherchant la route dans le brouillard, entre le Riau et la Marjolatte, que le souvenir d’un livre m’est revenu, titre et auteur m’échappent ; un livre lu au temps où le débat pédagogique avait sa place à l’école ; Célestin Freinet et la pédagogie institutionnelle veillaient sur nous et nous invitaient à concevoir une école vivante et efficace.
C’est à cet homme – dont je possède une photographie – et à ce livre que je songe ce soir, en relisant les trois courts paragraphes que j’avais écrits alors pour résumer sa vie, sur un carnet de moleskine noire, et qui disent mieux que je ne saurais le faire aujourd’hui ce que j’aurais voulu dire du métier que j’exerce depuis plus de 25 ans.
L’auteur raconte en substance que, au début de sa carrière, il ne quittait pas des yeux l’objet qu’il avait à faire passer de l’autre côté, du côté de ses élèves. Mais il avait beau s’agiter, parler, imaginer des dispositifs, exemplifier, schématiser, rien n’y faisait, l’objet ne transitait pas, il ne parvenait pas à s’en défaire, l’objet demeurait en carafe dans ses mains, loin de ses destinataires.
Le maître d’école prend conscience, beaucoup plus tard, que le langage est, en ce domaine, de trop, la simplification un obstacle, les explications un voile. Il se donne désormais pour unique tâche, celle de trouver où poser l’objet, à bonne distance de l’élève, de s’éloigner et de les laisser à leur mystère.
Le maître passera le reste de sa vie à se débarrasser de ce qui faisait de lui une singularité, deviendra à la fin assez vide pour recueillir les eaux de pluie et le jeu des ombres, si lisse que les rugosités ne s’attarderont plus sur son front, si transparent que les attaques seront sans effet. Lointain comme sur une photographie, détenteur de la confiance qui manquait à l’enfant, débordant de tranquillité, déporté dans les nuages.
Jean Prod’hom
Tirer du jour

Tirer du jour
quelque chose
à quoi l’accrocher
un épi
une gerbe
un baiser
une fleur
un dessin
Jean Prod’hom
Laisser aux mains de nos enfants

Laisser aux mains de nos enfants
du temps à perdre
et le temps de s’égarer
des friches
des casse-tête
des minutes creuses
les petites rivières
des chansonnettes
et la pâte à mots
avant qu’ils n’étouffent
et ne nourrissent la croissance
la croissance des hommes dangereux
Jean Prod’hom
En s’en remettant à l’idée de vocation

En s’en remettant à l’idée de vocation
les hommes donnent un air de noblesse
au maton qui patrouille leur visage et verrouille l’avenir
Jean Prod’hom
La relation pédagogique prend fin

La relation pédagogique prend fin
lorsque l’élève découvre que l’ignorance de celui qui est supposé savoir
est de même puissance que la sienne
Jean Prod’hom
Loi du moindre effort

Pour Stéphane
La loi du moindre effort oblige celui qui veut bien l'honorer
d'engager des travaux sans commune mesure avec le gain
Ainsi marchent de concert le progrès et l’exploitation de l’homme par l’homme
Jean Prod’hom
Au cours de sciences

Ecartez le bruit et retroussez les manches,
ajoutez à l’eau versée dans les douves du château de sable un peu de sel,
vous ferez lever la mer.
Jean Prod’hom
Au milieu des années 30 du siècle passé

Au milieu des années 30 du siècle passé, Louis Rossier démissionna de l’Ecole d’agriculture de Marcelin qui l’obligeait, en fin d'année, à dépenser sournoisement l'argent qui demeurait dans les tiroirs de ses services, afin d'en obtenir autant l’année suivante, lorsque la nécessité s’en ferait peut-être sentir.
Je n’ai pas mis la main sur le papier qui atteste de cette démission; et si l’espoir de sa validation s'éloigne chaque jour davantage, ce qui s’avèrerait alors n’être qu’une légende aura fait naître en moi, d’un modeste chef de culture, un héros.
Jean Prod’hom
Ils s’en prennent

Ils s’en prennent comme d’hab à ceux qui ont pris acte de la nouvelle donne
au prétexte d’assurer la sécurité de ceux qui viendront après eux
leur refilant en sous-main les représentations antiques qui les paralysent
Jean Prod’hom
Silence et déni

Silence et déni
pour conjurer l’échec
dont se réjouit celui qui a gardé confiance
Jean Prod’hom
Rien à signaler sur le front scolaire

Rien à signaler cette année sur le front scolaire mis à part
de nouveaux caporaux et des améliorations dans l’étanchéité des bâtiments
la mise à jour du jeu des injonctions et des soumissions
Jean Prod’hom
J’ai essayé

J’ai essayé d’imaginer les Australiens comme l’école nous y obligeait
à chaque coup un vertige me saisissait et je m’accrochais à la cime des arbres
le ciel à mes pieds et la tête en-bas jurant qu’on ne m’y reprendrait pas
Jean Prod’hom
Ecoles à Berne

Ecoles à Berne, c’est le nom d’une aventure à laquelle j’ai participé et qui m’a enthousiasmé. Trois classes dont j’ai eu la responsabilité au Mont-sur-Lausanne, en 2010, 2013 et 2014, ont eu en effet la chance de se rendre dans la capitale toute une semaine, une semaine organisée au piccolo par une équipe très décidée et consciente de l’importance d’un tel événement pour des adolescents.
J’y participerai une quatrième fois en 2015, c’est sûr. Mais on me dit aujourd’hui que le financement de cette belle affaire n’est pas assuré à long terme. C’est dire que si je veux y retourner une dernière fois avant ma retraite et faire profiter une dernière volée en 2017, il faut que je me décarcasse et convainque ceux qui pourraient hésiter.

Disons d’abord que c’est un jeu qui a le mérite de remettre en perspective la question du politique en la reprenant depuis le début, c’est-à-dire dans l’espace réduit d’une classe réunissant des personnes qui ne sont ni de la même famille, ni ne se sont choisis. Que fait-on là, ensemble, pendant ces années d’école? Qu’a-t-on en commun? Si nous sommes en désaccord avec le monde dans lequel nous vivons, peut-on le changer. Peut-on trouver un terrain d’entente? Faire des alliances? A quel prix et avec quelles conséquences? Veut-on obtenir quelque chose immédiatement ou changer les choses en profondeur et à long terme? Comment déplacer les mentalités? Accepterons-nous de perdre? Que ferons-nous de nos victoires?

Le jeu démocratique dans lequel une société s’engage en acceptant ses règles est un jeu en tout point analogue à celui qui est proposé par Ecoles à Berne – mise à part la modification effective de la Constitution fédérale. C’est dire que le second jeu est aussi sérieux que le premier. Il est en outre, du point de vue de l’enseignant que je suis, hautement formateur. Je voudrais mentionner brièvement deux ou trois choses que les élèves ont été amenés à rencontrer et qui leur ont permis d’aller plus avant dans des problématiques que l’école se doit d’aborder.

Les programmes scolaires ont longtemps insisté sur le pacte de 1291, ils se sont tournés il n’y a que peu en direction de 1848. Il convient aujourd’hui de mettre l’accent sur cette période non seulement parce que la Constitution régit aujourd’hui encore notre vie politique mais parce que l’histoire du fédéralisme a encore beaucoup à nous apprendre.

Le jeu proposé par Ecoles à Berne, centré sur le dépôt d’une initiative fédérale, oblige les participants à comprendre du dedans nos institutions, à en éprouver les contraintes, à en interroger les faiblesses et les points forts.

La vie à Berne, pour un enfant de ce côté-ci de la Sarine, est une découverte. Non seulement celle d’une autre langue, mais aussi celle d’une autre ville. Les organisateurs ont bien fait les choses ; ils proposent en effet aux participants, à côté de leurs travaux parlementaires, une visite de Berne, celle du XIXème siècle, des ambassades et de la vie politique actuelle.

Faire manger dans le même réfectoire des ressortissants des cantons de Thurgovie, Argovie et Vaud n’est pas sans conséquences. En les obligeant à se mettre d’accord ou, pour le moins, à trouver une solution qui satisfasse chacun, les participants prennent conscience en commission ou en plénière que les différences culturelles et linguistiques ne sont pas toujours à la source de conflits mais, paradoxalement, l’occasion d’être ensemble pour trouver des solutions satisfaisantes.

Pas d’action sans anticipation et stratégie, pas d’argumentation sans préparatifs, collecte et organisation d’informations, utilisation fine de la langue, mots choisis, un à un.

De ce point de vue, le jeu permet à chacun de comprendre que pour convaincre celui qui n’est pas convaincu, il ne suffit pas de l’être, qu’il s’agit d’abord de mieux comprendre ce que croit l’autre, de déterminer les objets sur lesquels il ne cédera pas, de lui concéder ce à quoi on peut renoncer. Du point de vue de l’utilisation de la langue dans son versant argumentatif, Ecoles à Berne est une mine aux dimensions du réel qui ne saurait être remplacée.

Travail de longue haleine donc, bien avant la semaine qui se déroule à Berne. Autour d’un objet qui se révèle toujours complexe. L’étude de texte ne suffit pas, il faut en appeler à la genèse de la problématique, aux différentes réponses qui en ont été données, celles des cantons, des états, des spécialistes… L’élève est invité à aller à la rencontre d’objets de connaissance qu’aucun domaine disciplinaire n’a pris en otage. Au contraire, l’élève doit saisir cet objet dans ses différentes dimensions et, pour cela, s’en référer à ses dimensions historique, géographique, linguistique, sociologique…

Obligation donc pour les enseignants de se soumettre à une logique de l’objet plutôt qu’à une logique des programmes et des disciplines. Disons que de ce point de vue, l’affaire n’est pas gagnée.

Tout va très vite à Berne, rien ne serait possible sans une organisation dont tous les participants sont les maîtres d’oeuvre. Accepter que l’un d’entre eux prennent la tête du groupe, choisir un vice-président, prendre des initiatives, ne pas jeter le discrédit sur celui qui n’en prend pas, respecter l’ordre du jour, être à l’heure, déléguer.

(Voici le stratège du groupe, il s’ignorait jusque-là, il imagine un scénario pour obtenir la vice-présidence du Conseil national, impossible de viser la présidence, les Suisses allemands sont trop nombreux. Voici une conseillère nationale qui en veut, ne lâchera pas ses adversaires avant de les convaincre, gagner quelques voix ici en allemand, là en anglais, mais aussi avec les mains. Un membre veut faire bande à part, l’exclura-t-on du groupe?)

Il n’est pas inutile de rappeler que les parents des élèves que j’ai accompagnés m’ont souvent encouragé à remettre l’ouvrage sur le métier avec les cadets de leurs enfants. Rappeler aussi que les autorités communales n’ont pas hésité à aider substantiellement les familles dans la réalisation de ce projet. J’en suis persuadé, cet investissement professionnel et financier n’est pas vain. Mais je crains que les autorités scolaires cantonales n’ont pas assez prêté l’oreille à ce qui se déroule à Berne depuis quelques années, pas assez prêté leur concours pour convaincre et aider les enseignants à y participer.

Le jeu se termine le jeudi, dans la salle du Conseil national, par une plénière à l’occasion de laquelle les différentes initiatives populaires sont présentées et discutées, avant que la majorité ne recommande au peuple de les accepter ou de les refuser. Tous les participants, en principe, montent à la tribune.

Quelque chose m’a toujours sidéré à cette occasion. Le soin que les jeunes orateurs apportaient à leur intervention rédigée la veille, répétée au réveil, la manière dont ils montaient dans le tram numéro 9, se préparaient pour cet instant guère plus long qu’un éclair, la manière dont ils se levaient pour se rendre à la tribune, ajustaient le micro, posaient leurs notes et leur voix, s’adressaient à leurs collègues. Pour quelques mots, quelques mots qui venaient de loin puisqu’ils étaient le fruit d’une année de travail, de lectures souvent ardues, de discussions longues. Oui, aurait certainement dit Socrate, dire quelque chose est chose difficile.
Jean Prod’hom
Inconscience ou grandeur d'âme (c)

Traiter avec la même bienveillance ceux qui se serviront demain
des outils enseignés pour asseoir leur domination
inconscience ou grandeur d’âme
Jean Prod’hom
Demain l'école

Nous sommes sans réponse de nos commanditaires
on commencera donc l'année scolaire sans chaises ni tables ni papier
une chance pour notre école qui volera de branche en branche
Jean Prod’hom
Ecoles à Berne

Nous avons participé, début mai, au jeu « Ecoles à Berne », qui nous a permis de nous sensibiliser à la vie politique suisse. Avec cinq classes de la Suisse allemande, nous avons troqué l’habit d’écolier pour celui de conseiller national durant une semaine. Chaque classe a déposé une initiative sur un sujet qui lui tenait à cœur.
(la suite, c’est ici : ECOLES A BERNE-2014
Mantra

Professionnel mot mantra mis à la disposition des enseignants
pour que les amateurs qu’ils resteront n’aient à répondre
ni de leurs actions ni de celles de l’institution à laquelle ils obéissent
Jean Prod’hom
Passage de la mer Rouge

Deux douzaines de baronnets annoncent continument ce qui est juste et bon
écartent d’un trait les eaux de la mer Rouge
corps glorieux à la poupe de leur vaurien monté sur des roulettes
Jean Prod’hom
Lemme 13

Au prétexte que la pilule est amère,
on les voit user de séductions auprès de ceux à qui il conviendrait précisément de faire voir qu'il est possible de ne pas y succomber sans cesse.
En réalité les maîtres n'en savent rien et sont victimes de leurs propres pièges, exilés, comme ceux dont ils ont la charge, de la connaissance qui leur manque.
Ils sourient, copinent ou cabotinent, bien décidés à protéger le château de sable, dont ils sont devenus les barons replets, de l'extraordinaire profusion du monde.
Jean Prod’hom
Rappel

La connaissance est le seul vrai obstacle
rencontré par le maître dans sa volonté
de mettre ses élèves sous tutelle
Jean Prod’hom
En souvenir d’André
Salle du Conseil national
Jeudi 1 mai
Un groupe d’élèves défendent devant des classes de Suisse allemande une initiative populaire intitulée
Pour une mort digne et une assistance au suicide
Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
2bis Tout être humain a le droit de mourir dans la dignité. 3bis Tout être humain peut bénéficier d'une assistance au suicide
A cette occasion, une élève cite un extrait d’En souvenir d’André de Martin Winkler

Jean Prod’hom
Il y a mieux à faire

Les salariés de l’enseignement obligatoire
colportent on le savait les vérités d’avant-hier
avec l'assurance des scientologues c’est nouveau
Jean Prod’hom
Jouer petit

Jouer petit
forcer ainsi l'enfant à prendre la main
l’obliger à se retrouver devant
Jean Prod’hom
Bulletin scolaire

Six points sur douze
la gamine huit ans ne dit rien
terre d’asile
Pleure à la récré
pas de points de suture
crime contre l’humanité
Jean Prod’hom
Ce qui en tout lieu n'a pas de fin

Le milan là-haut n’était pas dans notre temps. Il savait ménager son vol pour mesurer la beauté de l’air. La libellule, qui n’avait pas sa force vive, se risquait à suspendre son élan et quand la buse criait, elle criait deux fois, une fois pour sa vie une fois pour autre chose que sa vie. (André Dhôtel, Le Mont Damion)
Toujours davantage, toujours plus clairement et distinctement l’appréhension qu’il va me falloir une fois encore, pour rejoindre l’espace que je partage avec mes semblables, – aligner mes pas et faire tourner la noria –, descendre du ciel aux larges anses. Sans que je n’y puisse rien. Et lorsque j’entends les pas résonner dans les couloirs, le bruit des souliers et des bottes monter du fond de la cage d'escaliers, je songe une fois encore à l’apaisement auquel le désoeuvrement m’a conduit pendant les quelques jours fériés du bout de l’an, et que cette vague humaine est sur le point de recouvrir.
Il est bien trop tard pour m'éclipser. Me reste un court instant pour consentir à payer mon dû et quitter avec le moins de regret ce que je laisse, en le dissimulant dans un pli de la mémoire, et reconnaître en guise de consolation que les principes, les artifices et les obligations sécrétés par le collectif ont permis à l’espèce de survivre en glissant de main à main ce qui non seulement assure la prolongation ou la reconduction de nos espérances mais encore, quoiqu’on en dise ou comment on le pense, ce qu'on appelle le progrès.
Et cette tension entre ce qui est au-delà de ce que je sais et de ce que je vois, qui me divise, que je l’envisage comme l’irréconciliable, que je tente de la réduire ou que je tienne la clé du passage secret qui conduit de l'un à l'autre, m’oblige aujourd'hui encore à ouvrir la porte et à accueillir ceux qui viennent après moi, non seulement pour leur remettre l’indispensable, lire, écrire, compter, mais encore pour leur rendre plus familier ce qui en tout lieu n'a pas de fin.
Qu'ils puissent un jour, sans effroi, ne pas se détourner du chant liquide du rossignol entendu tout à l’heure près du cimetière, il faisait nuit. Je me suis souvenu alors de cet autre matin, de la gare de Pully près de laquelle j’avais cru pouvoir me réfugier à l’aube, au-delà de tout. Personne ne m'avait rien dit de cet autre monde dans lequel je me trouvais soudain enfermé, avec pour seuls compagnons le chant d'un rossignol et les herbes du talus, sans savoir comment revenir au lieu qui m’avait vu naître. C’était pourtant le printemps, j’étais allé trop loin, forclos et naufragé, il m'a fallu des années pour retrouver près de chez moi les innombrables traces de l’existence de cet autre monde dont je suis enfin revenu. Un monde qu’on n’habite pas mais qui nous entoure.
Jean Prod’hom
Un collège à défaut d’une maison

En être à n'importe quel prix, peut-être ; c’est si difficile d'être né la veille. Inutile de te demander de renoncer et de venir du côté du pardon ; et recommencer. C'est seul, je crois, qu'on avance, incrédule comme au premier jour ; en espérant encore, les mauvais matins, qu'on pourrait en être.
Collège, racines coulées dans le béton, gaines techniques à défaut de maison. Les têtes sous cloche ne perçoivent pas les voix du dehors, il n'y a pourtant qu'un pas, sortir et entrer librement. Pourvu que ces voix ne nous abandonnent pas. Il en faut de l'innocence pour demeurer du côté des pierres.
Être divisé l’un dans l’autre. Quelqu’un – ou était-ce un autre ? – m'a fait entendre le rire dans le rire. Surtout bien dormir pour l'entendre encore demain.
Jean Prod’hom
Garder le livre ouvert

On manque d’air au réveil, chacun s’affaire pourtant et tout le monde se tait. On pourrait s’y faire. Mais l’un d’eux sort la tête du tunnel. Il demande quelque chose, à défaut d’étincelle de quoi reprendre des forces, n’importe quoi, mais quelque chose à emporter et y retourner. Le retenir, ne pas suivre son plan. Je lui offre une image qui ressemble à celle d’un tombeau ouvert, puis on parle de choses et d’autres. La salle de classe surplombe le cimetière, il fait beau dans les allées et les contre-allées, fleurs ensoleillées au-dessus du silence des morts.
Ne pas baisser les yeux. Aller se perdre ailleurs que dans ses copeaux, du côté de l’étendue, du vide auquel s’abreuve la diversité des choses qui passent d’une jambe sur l’autre, font des signes. La profusion n’est pas un labyrinthe.
Garder le livre ouvert sur la table pour ne pas se perdre. Mais garder les mains libres et lever les yeux sur le bouquet qui s’offre. Et s’égarer.
Jean Prod’hom
Ne pas broncher

Sa mère n'a jamais voulu savoir où il était, lui non plus. Alors elle l'a mis ailleurs et le voilà nulle part. Il lui raconte que tout va bien, elle se paie de mots, propos sucrés et sourires de satisfaction. Le gamin, yeux de fouine, lance des pierres et tire des lignes avec un cheveu sur la langue.
Défaire les empilements, tailler des marches. Ni forceps ni ruse. Aller, aller jusqu'à ce qu'on y soit, tout au bout. Le gamin s'abandonne à son nouvel état, il suffoque, large sourire dans une déferlante qui le fait aller en tous sens, mais en un autre sens cette fois. Le voilà quelque part et personne à qui parler. La moitié du chemin est faite.
Surtout ne pas broncher, ne rien ajouter.
Jean Prod'hom
Lemmes 12

Peu de différences en somme de l'école aux vacances : On y fait l’Afrique, l’Océanie. Le tourisme, les régimes alimentaires, la lutte des classes. Les transports maritimes et les récits de voyage, la restauration et la digestion, Cuba, les Maldives, la Bretagne et le change. À quand l'amour et le mur ?
Les sacs à dos font de nos élèves des mules dociles. Besoin ni de fouet ni d’oeillères.
Maître et fonctionnaire, la quadrature du cercle.
Jean Prod’hom
Lorsque la mine ne laisse rien voir du jour

Lorsque la mine ne laisse rien voir du jour, lorsque le ciel menace de se refermer sur elle, lorsqu’elle se sent alourdie par les petites misères qui s’accumulent et gonflent comme l’avoine dans la panse de ceux qui ruminent, défaite par ses manques et les incompétences des gens qui l’entourent, atterrée par l’état de tant d’enfants en déroute pour lesquels elle ne peut que peu et qui ne veulent rien, lorsqu’elle a courbé l’échine devant les mirages que brandissent les maîtres chanteurs, il lui suffit de sortir, de monter dans sa voiture, de rouler en écoutant la litanie des autres misères sur le chemin de la Bérallaz qui plonge dans la nuit, le bouchon qui ne se résorbe pas entre Morges et la Maladière, l’accident près d’Yverdon, les promesses des fieffés menteurs de Genève, la suffisance des journalistes, il lui suffit, dit-elle, de s’éloigner de ce tohu-bohu pour que la malédiction se détourne et qu’il ne lui reste rien d’autre qu’un immense et bel abandon. La vie redevient une douce énigme, elle se remet à sourire près de Montheron, vivante, sans ramasser le bois noir qui nourrit les enfers. Elle désespère sans personne à ses côtés, légère, la neige tombe, elle roule. Personne n’en saura rien. A part toi qu’elle me dit, et elle revit.
Jean Prod’hom
Lemmes 11

Elle se plaint en salle des maîtres de la faiblesse de ceux dont elle a la charge, de leur incapacité à faire tenir ensemble ce qu’elle leur enseigne avant de lancer ceci : «Les connaissances de nos élèves ressemblent chaque jour davantage à des pans incomplets de briques dont il manquerait le premier rang.»
S’obstiner à leur demander d’empiler des parpaings est en effet un non-sens ; la connaissance n’a rien à voir avec un bunker, elle est un objet qui vit précisément de ne pas avoir de toit ; elle perd la boule lorsqu’on le lui impose et s’abîme par le bas, c’est sa manière à elle de dire non, de ne pas se laisser enfermer dans un sujet lui-même captif.
Jean Prod’hom
Dans un quatrain de Follain

Conférence de fin d’année ce matin, tout l’établissement babille dans le hall des pas perdus, c’est la foule des grands jours. Règne un brouhaha qui faiblira mais ne cessera pas, il y a tant à dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Les lunettes à soleil dressées sur le front de quelques-unes nous rappellent qu’il fait beau dehors. On se penche un bref instant sur les incivilités des tout petits, on convient des cadres à fixer autour de leur irrépressible agitation. On les voudrait au fond immobiles, en rang d’oignons à côté d’un citron, d’une poire et d’un pot de fleurs, nature morte, nappe verte et lumière profonde au temps du cinéma muet.

Il y a le réseau, le réseau-réseau, le réseau-ressources, les remises au pas, les appuis, la dynamique négative, le redoublement, le soutien institutionnel, belle grappe de langue, on se grise. On passe en revue les classes : la 201, la 303, la 402, la 403, pas de 807 cette année. On salue les enseignants à la retraite, on évoque les situations qui en appellent d’autres, et puis il y a les refus, les accords, les validations. On a installé de tout nouveaux filets de sécurité, on accorde encore des faveurs mais les privilèges ne seront pas rétablis. La dyslexie, le dyscalculie, les dyspraxies, les dysphasies, la liste s’allonge, demain tout mal aura son mot. J’apprends que le multi-âge est banni.
On ouvre l’enveloppe, la boîte des horaires, celle des généralités et des compléments, formellement ou concrètement, celle des mises à niveau, des réorientations, des effectifs réduits, et des options spécifiques. La vendange est belle, je m’étonne pourtant de nos certitudes collectives et je devine derrière le ronflement du lexique une assurance qui vacille.
On nous rappelle que les mamans ne seront plus obligées de fourrer les cahiers de leurs enfants fabriqués par des prisonniers. Je l’ignorais mais le journal de la fonction publique de l’Etat de Vaud nous l’apprend, les cahiers utilisés en classe sortent des ateliers des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. Dix détenus travaillent huit mois durant à la confection du million de cahiers (15 types en 4 formats différents) distribués dans les classes à la fin de l’été. Le journaliste de La Gazette de 2004 note que le pécule qu’ils reçoivent en échange permet d’améliorer l’ordinaire des prisonniers et d’acheter des cigarettes. Echange de bons procédés, je souris, un cahier de géo contre une clope.
Plus délicat, je crois entendre soudain les échos d’une vieille querelle sur le rôle de l’école dans le redressement moral des enfants. Une parabole. Voici. De deux frères jumeaux en tout point pareils, le premier avait fait tout ce qui lui avait été demandé au cours de sa scolarité, il avait été poli, était venu aux appuis, jamais en retard, avait fait des efforts considérables, volontaire, besogneux même. Malheureusement le bon bougre à bout de souffle avait raté d'un demi-point l’obtention de son diplôme. Ne fallait-il pas aider cet être désarmé ? L’institution veille, elle sait reconnaître ce qui doit l’être, le gamin le méritait, elle lui a octroyé ce qui lui manquait. Son frère jumeau n'avait quant à lui rien fait de bon depuis le début, avait été désobéissant, moqueur, jamais coiffé, crâne, devoirs non faits, menteur, buissonnier, au diable les efforts, soldeur, m’enfouteur et j’en passe. Comme on peut s’y attendre le garnement avait raté l’obtention de son diplôme, d’un demi-point, le conseil des sages ne lui a pas octroyé ce qui lui manquait. En vérité je vous le demande, lequel des deux avait un avenir, l’enfant à bout de souffle qui avait été sans faillir à l’image de ce que commande l’institution ou celui qui était plein de force de n’avoir rien fait et qui rappelait à l’enseignant celui qu’il aurait aimé être : courageux, indiscipliné, naïf, confiant. L’institution a tranché, petit vaurien, tu partiras les mains vides, sans papier, sans diplôme, héros si tu le veux dans les Ardennes, dans un récit de Dhôtel ou dans un quatrain de Follain.
L'année s'est bien passée je crois. Les vacances feront du bien à tout le monde. Mais j’ai au fond un peu peur, j’aimerais qu'on me réconforte, qu’on me persuade que tout cela est encore solide. J’entends une voix qui me souhaite de très loin le meilleur en m’avertissant du pire.




Jean Prod’hom
Mon nouveau collège

Oeuvres vives et oeuvres mortes, des caissons étanches, écubier et guindeau escamotés, mais ni gaillard d’avant ni gaillard d’arrière, ni proue ni poupe, ni gouvernail.
- Parés à appareiller ?
- Parés.
- Conditions météorologiques ?
- Temps calme.
- Voiles ?
- Affalées.
- Filets ?
- Relevés.
- Ecoutilles ?
- Fermées.
- Corps morts ?
- En place.
- Bouées ?
- Prêtes
- Ancre ?
- Jetée.
- En route !
- Où ?
- A quai !
Jean Prod’hom
Une doctrine à double foyer

Hier, on a démarré la journée avec les batteries à plat, sans disposer de chargeurs ou d’une voiture de service, on a dégotté finalement une pente, mais tard, très tard si bien qu’il nous a fallu mettre les bouchées doubles. C’est que, la veille, on était rentrés tard de la fête organisée par la commune du Mont-sur-Lausanne dans la grande salle du Petit-Mont. Belle soirée, silence entendu sur le job, on a voulu croire avant l’été que tout allait bien, que l'école de septembre ressemblerait à celle de juin, qu’il suffisait de prolonger les lignes vers un hypothétique point de fuite et de ne pas se demander s’il pourrait en aller autrement. On a montré dans ce domaine comme toujours de la bonne volonté et plein d’idées.

Tous, les architectes comme les politiques, les fabricants de tables, de chaises, de pupitres, de cahiers, de livres, tous, les enseignants et les élèves, les secrétaires et les concierges se tiennent la main pour parer à l’injonction qui leur est faite de prendre acte des nouvelles conditions objectives de nos vies. Sourires chez les professionnels, comme on dit, prêts à payer le prix pour ne pas avoir à se coltiner les effets de la mutation à laquelle nous convient nos vies réelles. On n’a pas évoqué vendredi soir les établissements des Pays-bas qui ouvriront l’année prochaine leurs portes de 7 heures 30 à 18 heures 30 avec pour seule obligation que les élèves soient présent de 10 heures 30 à 15 heures. L’enfant gère son planning comme il l’entend. Il y a par contre beaucoup moins de vacances imposées. L’établissement est fermé uniquement pendant les fêtes de fin d’année. En ce qui concerne les vacances, rien n’est imposé. Ce sont les parents et les enfants qui décident. Que les responsables des onze écoles de ce type les appellent des écoles Steeve Jobs n’est pas pour nous rassurer, mais l’idée que des gens répondent sur le fond à cette déclaration du même Steve Jobs selon laquelle il est absurde que le système éducatif américain repose encore sur le modèle suranné de professeurs debout devant leur tableau noir avec à la main leurs manuels scolaires n’est pas pour nous déplaire. On en est ici très loin encore, sachant que la clé de cette affaire ne relève pas essentiellement des moyens financiers et des outils mis à notre disposition, mais du courage de chacun de tout reprendre à zéro, de fixer les élémentaires priorités et d’agir bien plus comme des gamins pleins de bon sens que comme des professionnels imbus de leurs compétences et de leurs droits.






La cérémonie commence à 13 heures 30, on sera les derniers sur les lieux, la Yaris en bout de file avec les cloches qui sonnent dans le court campanile carré qui chevauche le petit faîte de l’église elliptique de Chêne-Paquier. Est-ce un choix délibéré des deux amoureux que d’avoir choisi cette église de 1667 pour se jurer fidélité, une église des origines secondes du protestantisme dans le pays de Vaud, sortie des mains de l’architecte Abraham Dünz ? Une église ovale avec une disposition en large dès l’origine, seul exemplaire de ce type si on excepte l’église d’Oron en ovale aplati construite elle aussi par Abraham Dünz peu après avoir terminé celle de Chêne-Pâquier (mais qui trouvera une utilisation en long au moins au début du XIXème siècle), ovale donc, ovale ovale, tout nu, sans contrefort ou porche avancé.
Toujours est-il que, samedi en début d’après-midi, la cérémonie s’est déroulée elle aussi sur un plan elliptique, on a en effet tourné autour de deux foyers, le premier qui maintenait dans son orbite un peu lâchement le nom des oeuvres vives de Dieu et les paroles de l’Ecclésiaste, le second qui tenait en laisse le pasteur amoureux de cette rhétorique de la persuasion et du divertissement utilisée en d’autres lieux, pour maintenir les brebis dans leur enclos. Un vitalisme donc conjuguant un contenu doctrinaire secondaire, relativement pauvre, obéissant aux lois du discours publicitaire, avec de l’énergie brute, positive, prioritaire, que transmettent avec doigté les animateurs d’aujourd’hui, chargés à bloc, qui ne se départissent jamais d’une certaine bonne humeur et d’un sourire confiant, presque carnassier, quand bien même le ciel leur tomberait sur la tête. Pasteur donc, habillant ses dires non pas d’images au sens classique, les protestants demeurent iconophobes, mais de figures rhétoriques colorées, images encore qui, de connexion en déconnexion, admission, explosion compression, décompression, promettent que la fête sera vraiment belle.
Mais ce que j’ai appris hier au retour de Chêne-Pâquier, c’est que malgré Dünz Ier, les prédications, les promesses, les agapes, les mousses au chocolat, les sucreries et le soleil, on oublie souvent l’essentiel. Avant que le cortège des voitures coiffées d’un plumet blanc ne parviennent en effet à Donneloye, là où un chemin vicinal conduit à une ferme foraine, un petit groupe d’enfants se tenait là, au carrefour. Cinquante voitures avaient déjà passé et personne n’avait jeté de bonbons aux riverains comme le veut la tradition. Les enfants se tenaient immobiles, oubliés, aussi stupéfaits que s’ils avaient été les témoins d’une catastrophe dont nous aurions été les victimes et, tandis que nous nous éloignions de ces spectateurs ébahis, ils nous offraient dans une autre langue le sourire qui nous manquait, comme s’ils voulaient compatir avec notre souffrance silencieuse et nous libérer d’une dette. Ils disaient merci de n’avoir rien reçu, oubliant même ce qu’ils étaient venus faire à ce carrefour et dans l’ignorance de ce qu’on leur devrait désormais.
Jean Prod’hom
Basta

Il a tellement plu hier matin sur le Jorat qu'il a fallu renvoyer les joutes sportives de Thierrens au Mont. Lorsque le ciel s'est calmé, on a perçu une sourde déception. En écho cette balade, fraîche consolation le long de la Valleyre. Les pensées des petits ont tôt fait d'aller au-delà, on évoque le Flon, la molasse et les cathédrales, le Rhône, plus loin Marseille, bientôt les vacances. De minuscules fraises des bois roulent au pied d'un parterre d'oeillets, fines paupières au teint rose jambon, découpées comme des cils : dianthus superbus. Le Jura réapparaît derrière les vapeurs d'eau.
Si, nous explique un tout malin, on l'appelle foyard, c’est parce qu'il finit en bois de chauffage dans les foyers de nos cheminées. Le nichoir fixé sous ses lourdes charpentières semble inhabité. Qui sont donc ses locataires ? Je prends contact sur le champ avec l’universitaire qui a laissé son numéro de téléphone là-haut sur la maisonnette : on l’a installée pour les chouettes hulottes, mais il n’y en a pas eu beaucoup ce printemps, à cause du mauvais temps, du froid et du manque de nourriture, inutile d'insister, et si des petits avaient éclos, ils voleraient à cet instant de leurs propres ailes.
On refait dans la tête la balade, mais à l'envers, en dégringolant pédagogiquement le chemin des Neuf-Fontaines. Je raconte à ces gamins comment, par un infime recul et l'application de l'une ou l'autre des techniques rappelées par l'historienne britannique Frances A. Yates dans son Art de la mémoire, chacun d'entre nous est capable de garder en soi ce qui tend à s'en échapper.
On termine avec les élèves de la 11 la projection du film de Daniel Vigne sur les aventures de Martin Guerre qui a défrayé la chronique au milieu du XVIème siècle, une affaire déroutante qui aurait pu conduire Martin à la folie si Martin avait été Martin. Mais, Martin, tu n'es pas Martin, tu es Arnaud du Tilh, si ressemblant que tu nous a trompés, tu en sais autant que Martin sur sa propre vie, plus même peut-être. Martin Guerre, tu n’es pas Martin Guerre, tu es Arnaud le diable, Arnaud l'usurpateur. Arnaud du Thil est pendu le 16 septembre 1560 à Artigat pour fraude et adultère.
Cette affaire me rappelle une psychiatre qui m'avait averti, la veille d'une sortie, que sa fille ne participerait pas à la course d'orientation que mes collègues et moi avions soigneusement organisée, parce que, disait-elle, en remettant à chaque groupe un téléphone portable, on disait très clairement mais à notre insu que les élèves couraient de réels dangers. En conséquence sa fille resterait à la maison.

Il fait nuit lorsque je sors du collège, il n’est pourtant que 16 heures 30, le ciel est à nouveau très chargé. Je descends en ville, parque la Yaris près du Musée de l'Art Brut, vais et viens sous la pluie, le long de la rue du Maupas et la rue de l'Ale avant de rejoindre sous un parapluie et des trombes d'eau la librairie Basta où les éditions Antipodes vernissent ce soir quatre nouveaux livres.
Nous ne sommes pas très nombreux mais je reconnais plusieurs visages, Murielle descendue de la médiathèque du Mont rend les lieux plus familiers.
Un comédien lit des extraits de trois ouvrages universitaires qui traitent respectivement de la naissance socio-historique de l'assurance chômage en Suisse entre 1924 et 1982, du débat autour du génie génétique entre 1990 et 2005 et des rapport de la Suisse avec l'Algérie entre 1954 et 1962. Il est curieux de percevoir dans la bouche ronde d'un comédien les ressorts rhétoriques du genre, leur sous-couverture, l'étanchéité des caissons, les ligatures qui se referment en bout de respiration, les connecteurs qui paradent, les suffixes à discrétion, l'invisible pâte dont la raison enrobe ses motifs aux armatures d’airain. Un alexandrin parfois, égaré, puis une assonance qui relance le propos de gouttière en gouttière, de cheneau en cheneau jusqu’à ce que l’essence s'écoule de l’alambic, goutte à goutte, dans les nappes profondes de la conscience.
Je lirai le quatrième ouvrage, celui de Nicole Gaillard, Couples peints, Esthétique de la réception et peinture figurative.
La librairie est minuscule, les gens polis, on se croirait sortis d'un film de Rivette, d'Eustache ou de Rohmer. Jean-Pierre Léaud est là, les mains dans les poches, il fait chaud, Michel Legrand fredonne l’air des Parapluies de Cherbourg et Godard grommèle. Michel Sautet a fait un saut pour dire bonjour, bonjour sourire, on parle tennis et football, Dziga Vertov, masculin féminin. Tout le monde est un peu saoul à la fin, ce sont des choses qui arrivent, des choses de la vie avec Michel, Diane, Claude et les autres. Les années 70.
Jean Prod’hom
A l'étuve

Une ribambelle de moineaux est née ce matin, en noir et blanc, personne ne les a vus mais je les ai entendus, ce sont eux qui ont donné le signal en soulevant les quatre coins du drap noir. Sur le toit un rouge-queue a agité sa crécelle, j’ai remisé sous l’oreiller les franges grises de la nuit. Je me suis levé, une nichée de canetons a plongé dans l’étang, ils ont pris un peu d’avance, premier air, première risée.
C’est la seconde fois cette année que je sors avant six heures en bras de chemise, la fraîcheur a pris les devants et hydrate mon visage. Partirais volontiers sur les berges de la Broye ou sur les rives du Léman, sur la terrasse du café du village ou plus haut, du côté des Vanils, ou plus loin, là où la marrée monte. Avant qu'il ne fasse trop chaud.
Curieuse scène, une fouine que je prends d’abord pour un écureuil, plastron blanc, vient à notre rencontre sur le chemin de la Moille-au-Blanc. Oscar ne la voit pas. Elle, elle l'entend et prend une voie de garage. Lorsqu’on passe à côté du roncier où elle a disparu, le chien s'agite, aboie mais il n'est pas dans le coup. Je me retourne un peu plus loin pour lui faire un signe au cas où elle aussi voudrait m’en faire un. Je ne vois que les cytises, ils sont en fleurs, grappes lourdes, grosses larmes, jaunes sur le vert pâle des merisiers.
Descends au Mont écouter des élèves qui feront tout au long de la journée la démonstration qu'ils sont à même de construire une intervention d’une dizaine de minutes adressée à un public réel sur un sujet de leur choix, mais qui feront également la preuve qu’il ne sont pas prêts à quitter le giron dans lequel ils ont été nourris parfois trop chichement, pour aller écouter ceux qui pourraient les informer ou se plonger dans des livres trop longs à leur goût. Ils ont pour la plupart picoré sur internet, sans se méfier de ce dont on les avait avertis et prendre les précautions qui conviennent. On aura mâché toute la journée une bouillie souvent informe dont au fond ils ne se satisfont pas eux-mêmes, puis on les quitte en espérant qu'ils comprendront bientôt en-dehors de l’école ce qu'ils n'ont pas voulu ou pu comprendre au-dedans.
Mais on aura été à la même enseigne tout le jour, tous, à l’étuve d’abord, écrasés ensuite dans un immense brasier irrespirable. Personne n’a demandé son reste lorsqu’on a tiré le rideau, chacun s’est éclipsé pour plonger dans l’une ou l’autre de ces fontaines que chacun abrite secrètement.
Jean Prod’hom
Surveiller mais quoi ?

L’isolement dans lequel les institutions de formation plongent nos enfants dans l'intention de s'assurer qu’à la fin ils détiennent et gèrent chacun pour soi ce qu'ils ont projeté de faire entrer dans leur tête, les a conduites à élaborer des moyens toujours plus sophistiqués et coûteux de contrôle et de coercition, avec pour corollaire la fragmentation des objets susceptibles d’être identifiés, la normalisation des réflexions et des méthodes sur lesquelles ces établissements sont capables d'exercer leur contrôle. Rien n’entrera dans la tête d’un enfant qui ne puisse en sortir de manière décidable, tel aura été le mot d’ordre de la formation.

Cette manie d’isoler chaque enfant, de circonscrire l’objet de connaissance en énumérant chacune de ses propriétés, d’en contrôler le traçage de son input à son output, de l'écriture des programmes à la certification de sa présence en fin de scolarité, tourne à la farce lorsqu’on en évalue les résultats et si l’on sait que personne n’a jamais été assuré que ce qui entre, loge et sort de la boîte noire est bien ce qu’on souhaitait y mettre. Cette manie est le résultat d'un vieil atavisme qui nous ramène aux temps obscurs où l'homme allait crédule au confessionnal, tremblant d'être mis à jour par celui qui détenait la vertu qui lui faisait défaut. Le pêcheur allait tremblant, seul, se faufilant comme un vers de terre, persuadé qu’il était un bon à rien, désireux par-dessus tout d’être moins seul et d’une seule chose, d’avoir près de lui un compagnon de son espèce.
Les aptitudes de nos enfants au travestissement – pour ne pas parler de falsification ou de déni –, leurs stratégies d’évitement, le soin qu’ils mettent à éviter l'inconnu qui les entoure et à contourner les obstacles qui leur font craindre le pire trouvent leur terreau dans la solitude à laquelle l’institution les condamne. Il est temps d'ouvrir les portes et les fenêtres, que chacun retrouve le bon larron, les vertus de la copie, de l’imitation et du compagnonnage.
C'est en effet lorsqu’on dégagera l’enfant de l’idée qu’il est seul avec lui même que les objets de connaissance retrouveront une consistance égale à ce qu'il est, en lui, hors de lui, avec les autres et qu'il parviendra à accepter à la fois ce qu'il a en commun avec ceux de son espèce et ce qu'il a en propre, bien moins que ce qu’on lui fait croire, un grain de voix, un rire, un tournis, une occasion d’occuper un lieu avec devant lui d’autres paysages. Il apprendra alors que la solitude qui l'habite, unique en son site, peut être douce s’il n’a pas à y répondre autrement qu'en y persévérant, petite mélodie, naïve expression.
Jean Prod’hom
Impossible métier

Une quinzaine d'années pour offrir à nos enfants la possibilité de rattraper l’inimaginable retard pris à leur naissance et les familiariser avec les outils sophistiqués que les générations précédentes ont conçus en un peu plus de 4000 ans ans et déposés à leurs pieds : cadeaux obligés.
Mais quinze ans également – moins certainement – pour montrer à nos enfants comment ralentir leur course et ramasser, étonnés, les trésors qu'ont oubliés leurs aînés dans leurs course effrénée : le lys et la mélancolie.
Jean Prod’hom
Les Mystères de l'UNIL
Deux grosses dizaines de chefs, quatre colonies de post-docs et une soixantaine de doctorants, une quarantaine d’administrateurs et de techniciens constituent le Département d’écologie et évolution, mais l’ombre des anciens planent aussi, dinosaures de leur vivant, on aperçoit quelques traces des deux cents chercheurs qui ont collaboré à cette aventure collective. Pas simple de distinguer les techniciens des docs ou des post-docs, à moins de le leur demander.

Lui c’est Richard Benton, du Centre intégratif de génomique, le chef d’un petit groupe de 17 personnes qui se penchent sur le système sensoriel de la drosophile, son odorat et ses goûts. Il est accompagné d’une technicienne formée à l’Ecole Cantonale Vaudoise de Laborantins et Laborantines Médicaux et d’une post-doc formée à Oviedo.
S’ils nous apprennent que ces mouches ont un faible pour le sucré et le vinaigre, pour la lumière et l’altitude, ils nous font voir aussi que les recherches, si elles répondent évidemment à des impératifs méthodologique et à des outils toujours plus sophistiqués, ressemblent bien plus à des épisodes d’un roman écrit à plusieurs et à l’allure de l’escargot, avec des rebondissements imprévus, des ellipses, des accélérations et des ralentissements bienvenus, qu’au dressage pseudo-scientifique que l’école inflige rituellement à nos élèves.
On notera encore chez Richard Benton, né à Edimbourg, une timide ironie qui pourrait passer pour un manque de savoir-vivre si elle n’avait fait la preuve qu’elle était avec le travail obstiné, la désobéissance, l’humour et l’indépendance d’esprit la seule voie attestée de l’invention et de la nouveauté. Les peintres qui peignent, les écrivains qui écrivent, les chercheurs qui cherchent sont de la même famille, ils ont le même sourire et le même regard habité, ils font ce qu’ils ont décidé de faire avec un sérieux sans faille, sans jamais se prendre exagérément au sérieux.
Poète, romancier, chercheur ? Ce profil, je l’ai rencontré en fin de matinée dans les sous-sols du Biophore. Pierre Million fait partie de l’équipe de Tadeusz J. Kawecki qui se penche, elle aussi, sur la drosophile. Ce doctorant escamote modestement l’histoire de formation trop complexe qui l’a amené dans ce laboratoire, mais raconte celle que les chercheurs du groupe écrivent autour de la mouche, collectivement : passionnant !
Il y a bien sûr la teneur de cette aventure, les leurres que ces Ulysse de la connaissance placent sur la route de leurs drosophiles issues d’une lignée de plus de 100 générations, les pièges qu’ils leur ménagent pour savoir si elles seront capables d’apprendre à leurs congénères ce qu’elles ont appris sous la contrainte et à force d’essais et d’erreurs, des subterfuges que le chercheur utilise lui-même pour ne pas perdre son temps en travaux fastidieux.
Mais il y a aussi le regard attentif de ce jeune chercheur étonné par ce qui l’entoure, le dénuement de son visage, un peu poète, un peu égaré, ses mains vides, la langue qu’il utilise, précise, avec les parfums du pays du Gard, pour dire au plus près des choses somme tout assez simples. Tout autour des boîtes et des cartons vides.
Avant de conclure, tous ces chercheurs savent-ils qu'ils doivent une fière chandelle à l’un des miens, aventurier et paysan d’Ecublens qui a vendu autrefois une partie de son domaine au canton et à la Confédération ? C’est en effet sur les terres de l’oncle Gaston que se dresse aujourd’hui le Biophore.
Et la drosophile à qui on aura par ruse fait goûter à la pomme de la connaissance sera-t-elle capable d’avertir ses congénères qu’il existe pas loin de leur lieu de résidence des fruits qui pourrissent au pied d’un vieux pommier que mon oncle Gaston avait planté il y a plus de 50 ans dans un immense verger aujourd’hui disparu ?
Jean Prod’hom
Etat des lieux

- Et tes loisirs ?
- Je vais trois fois par semaine chez une répétitrice.
- D’autres occupations ?
- Je vais à l’école les autres jours !
- Comment ça ?
- Ouais, à l’école extra-scolaire !
Difficile de choisir mon sujet d’examen, j’ai beaucoup hésité entre la maltraitance des personnes âgées et la maltraitance des animaux. Disons que les personnes âgées ça ne me plaisait pas trop, alors j’ai pris les animaux.
Bien sûr que j’aimerais travailler, mais rien que d'y penser ça me démotive.
Jean Prod’hom
88

Tout autour de la ville des propriétés privées, à perte de vue, des propriétés privées de tout.
Il n’est pas raisonnable de vouloir conduire l’enfant du je dois au je veux dans une école obligatoire.
- Dis maman ! tu trouves pas que le riz tout seul c’est meilleur avec quelque chose ?
Jean Prod’hom
Hagiographies d'Albert Einstein

Une découverte récente dans la vie d’Albert Einstein a conduit ses hagiographes à revoir leur copie. Jusque-là, ils avaient fait apparaître au coeur du bonhomme un cancre bon-enfant s’ennuyant sur les bancs de la maternelle, incompris, collectionnant les 1, mais habité par des forces vives prêtes à éclore. On s’avise aujourd’hui que l’échelle de notation était inversée dans son école et que les 1 qui avaient parsemé ses agendas scolaires étaient, comme nos 6, les signes de l’excellence. Les hagiographes ont retroussé leurs manches mais n’ont guère eu de peine à démontrer que le génie était compatible avec le chemin de croix que la société place sur le curriculum de ses ouailles.
La nullité ou la perfection ça joue, mais la médiocrité n’a jamais ouvert à personne les portes de la Légende dorée si bien que je me réjouis de voir comment l’hagiographie s’y prendra pour sauver son entreprise lorsqu’on rendra public ce que la succession d’Einstein a toujours voulu escamoter, la présence d’un 3,5 et d’un 4,5 dans le curriculum d’Albert, alors qu’il était élève au Luitpold gymnasium de Munich en 1889.
Jean Prod’hom
Aux voyants la jachère

Eradiquer le bruit, exclure le faux, baisser les yeux, fermer les fenêtres virgule, isoler, encadrer, trancher virgule, distinguer le haut du bas, élever le ton, sonner les cloches virgule, brûler l’incorrect, chasser l’étrange, écrire au lance-flammes, faire rédiger des poèmes point. On s’étonnera demain de l’improductivité de nos sols virgule, passez donc virgule, il n’y a plus rien à voir point à la ligne.
Les mauvaises graines poussaient aux flancs des talus, le bleuet et le coquelicot autour des crapules, l’école buissonnière derrière l’horizon. Aux voyants la jachère et les chemins de halage, la chienlit et le carillon, les refuges et les portes cochères, la forêt, l’eau trouble et la mauvaise herbe.
Jean Prod’hom
Insurrection

On allait vers le printemps, l'aube se faisait chaque jour plus matinale, les merles avaient épuisé leurs réserves et croquaient les derniers fruits des aubépines et des sorbiers, les bergeronnettes marchaient à petits pas pressés sur la molasse de la rivière en hochant la tête et la queue, la glace de la fontaine avait molli, le givre ne résistait pas au premier coup d’essuie-glace, pas de bouchons sur l’A1.
Mais tout semblait pourtant revenir en boucle dans la ronde des saisons. Nous roulions en bon ordre sur le plateau de Sainte-Catherine, incognito, pas un mot pas un signe lorsqu’on se croisait. Il y a avait dans l’allure de chacun, dans le sérieux qui animait nos visages, l’odeur de discipline que chaque conducteur répandait tout autour de lui ce quelque chose qui garantit, pour notre malheur, la pérennité des langues de bois et des poignes de fer.
Je ne pouvais imaginer qu’au-dedans de nous les choses se passent ainsi et que nous ne nous arrachions pas de la mainmise de cette misère par quelque battement de coeur. Je devinais forclos en chacun de nous un chaos équipotent à l’ordre que nous suivions servilement.
J’ai soudain entendu un chant, et j’ai aperçu sortir du cortège un magicien qui s’est mis à danser, il occupait la seconde face d’une bande de Möbius sur laquelle il esquissait un décor dans lequel il égrenait le chaos, brassant les pièces d’un puzzle géant à grands coups de pinceaux.
Ce chant était une berceuse et une ribambelle d’enfants marchaient sur les bas-côtés de la route que le magicien avait crayonnée et sur laquelle nous roulions tête en bas, les enfants allaient à contre-sens, il étaient en pyjamas disgracieux.
J’ai très vite compris, ceux qu’on avait arrachés tout l’hiver au sommeil et à la nuit pour les mettre en rangs, comme aucune bête ne l’avait fait jusque-là, rentraient chez eux pour se glisser sans bruit dans leur lit. On entendait dans le lointain les parents qui applaudissaient la résolution de leurs petits. Lorsque plus tard les enfants se sont réveillés. le soleil avait réchauffé la terre, l’eau coulait dans la fontaine, l’aubépine bourgeonnait, les merles barbeyaient les haies. Les enfants ont cueilli les premières perce-neige, les premières primevères, c’était le printemps. Le mastodonte avait bel et bien été déplacé, les gamins l’avait décalé de deux heures en direction de l’avenir. Une lueur est alors apparue au-dessus de Mauvernay.
Jean Prod’hom
Lemmes (10)

Dire aux élèves à journée faite que le temps manque, qu’il y a le programme, que d’autres tâches l’attendent, c’est les endoctriner en les faisant participer sans nécessité autre que celle du dressage à la chaîne industrielle de l’éducation.
Qui dit à ses élèves qu’il y a du pain sur la planche et qu’ils ne peuvent se permettre de lambiner fait de la propagande politique et commet une faute grave, il demande à ceux dont il a la charge d’annexer l’avenir en étendant les modes de production du présent au futur.
Il convient de faire exactement l’inverse : se taire et creuser au vilebrequin un peu de vide dans le plein, comme au jeu du taquin, ne pas rétrécir les marges, ne pas couper les haies, ne pas étouffer le silence et et voir venir.
Que le maître dise comme on le disait autrefois : il y a encore assez de pain sur la planche, l’école a suffisamment de ressources pour l'avenir, soyez assurés que nous ne manquerons de rien : un morceau de bois et un fil de fer, un peu d’espace et un peu de temps suffisent à lever le voile sur un coin du monde et de la connaissance.
Jean Prod’hom
Lemmes (9)


Sur la plate-forme en ligne du nouveau Plan d’études romand qui doit permettre aux enseignants de la région d’organiser leur travail dans les années à venir, on peut lire sur la même page les deux transcriptions suivantes : Plan d’étude et Plan d’études. Il semblerait donc bien qu’on ait hésité sur la nature de l’étude jusqu’au sommet et que les autorités ont souhaité garder une trace de cette hésitation en page de garde, comme elles l’avaient d’ailleurs déjà fait à propos du Plan d’études vaudois.
Pour le reste elles ont tranché en choisissant dans le gras de l’ouvrage la seconde transcription : Plan d’études. On peut raisonnablement apporter notre soutien à une telle décision, comme à celle qui a conduit jadis à parler de Mathématiques (et non de Mathématique), de Sciences (et non pas de Science). Faudrait-il encore que nos décideurs s’en expliquent. Pourquoi Histoire et non pas Histoires ?
J’aurais penché de mon côté pour l’autre transcription, Plan d’étude, arguant du fait que les enfants d’aujourd’hui, comme ceux d’hier et d’ailleurs, ont plus que jamais besoin d’apprendre à penser en intension plutôt qu’en extension. Tout n’est en effet pas comptable, ni le sel de l’existence ni le silence. Et pour l’étude, pas besoin de châteaux ou de palais, un simple plan de travail et un abri auraient suffi.
Jean Prod’hom
Lemmes (8)

Les manuels scolaires, les plans d’études, les lois et les règlements constituent les différentes parties de l'ancre qui interdit au vaisseau-école d’appareiller et de changer d’horizon. Trop gros désormais, trop lourd pour le stopper si on le mettait en route. On le maintient donc à une certaine distance de l’administration qui le surveille à quai, houle et clapotis. Des spécialistes s’assurent que les maillons de la chaîne tiennent, densifient les corps-morts, tiennent à jour des cartes maritimes devenues inutiles, font repeindre la coque du bâtiment, jettent du pain aux goélands qui crient. Il sera toujours temps de mettre ce Titanic en cale sèche si le vent forcit.
J’appellerais volontiers cette entreprise, si l’expression n’était pas trop forte et utilisée à mauvais escient, une kremlinisation de l’école.
Mais regardez bien tout autour de l’auguste embarcation, regardez la multiplication des petits rafiots qui fendent l’eau, récupèrent ce que le grand ne digère pas, regardez les barques et les pédalos, solitaires, radeaux, périssoires, mystics de luxe ou gondoles, regardez les remorqueurs, barquettes et youyous, bachots et optimists que barrent des bénévoles ou des requins, des coachs de toutes obédiences, des répétiteurs et des répétitrices, des grands-parents, des amis, des psychologues et des gourous. Cette population qui grouille tout autour du mastodonte, ce n’est pas très bon signe.
Oui, quelque chose flotte et le gros temps guette.
Jean Prod’hom
Lemmes (7)

Curieux d’imaginer les complets et les vestons, le bruit feutré des pas sur la moquette des longs couloirs et des bureaux cossus du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, les chuchotements, les briefings et les débriefings, les petites rivalités, les postes à repourvoir, les départs à la retraite, les papiers qui s'échangent, les agendas qui débordent tandis qu’à l’autre bout du monde, à Combremont-le-Grand ou à Combremont-le-Petit, un enfant pleure à la sortie de l'école pour une mauvaise note qu’il n’ose pas ramener à la maison. Et, tandis qu’il le regarde par la fenêtre s’éloigner avec le sentiment d’être un moins que rien, le maître regrette une fois encore d'avoir suivi des directives assassines.
Jean Prod’hom
Lemmes (6)

Si le ton supérieur hiérarchique te répète avec force que tu es un professionnel, il t'avertit simplement qu'il n'entrera pas en matière sur la question qui te préoccupe, qu'il va falloir te débrouiller seul et qu'il ne te soutiendra pas s'il y a du grabuge.
Combien sont-ils ceux que la hiérarchie n'a pas reconnus dans ce qu'ils faisaient, qui hébergent au-dedans d’eux un silence plein de rancœur et qui caquètent au tea-room ?
L’institution a pour tâche essentielle de soutenir ceux des siens qui proposent un avenir meilleur à ceux pour lesquels elle a été conçue. C'est au suicide que l’institution se prépare en se donnant pour seule fin celle de sauver les apparences, de se reconnaitre dans ce qu'elle était par la neutralisation de tout ce qui dépasse, par l'aménagement de fausses avenues et l’interprétation triviale du principe d'identité.
Jean Prod’hom
Lemmes (5)

En guise d’avertissement pour une absence dont il avait pris soin d’exposer spirituellement les raisons et qui ne semblait pas porter préjudice à la bonne marche de l'institution qu’il animait par ailleurs sans compter, un enseignant de mes amis reçut de son employeur le pataquès suivant : « J’aimerais vous rappelez la règle !» L’employeur exposait ensuite, dans la langue du caporal, les habitudes en la matière et esquissait une morale de Père Noël.
Par manque de courage peut-être, ou parce que le bon sens ne l’a jamais quitté, mon ami du bout du lac n’a pas osé, par retour du courrier, renvoyer le bonhomme à une règle orthographique qui ne souffre aucune exception.
Il ne faut pas réveiller le Léviathan qui dort.
Jean Prod’hom
Lemmes (4)

L’apprentissage est un jeu solitaire qui se joue à plusieurs.
Le maître est celui qui s’honore – et se satisfait – d’assurer l’existence de la case vide dans un jeu de taquin aux dimensions du monde. Un vide essentiel sans lequel les choses, la respiration, le mouvement et la rencontre des êtres ne sauraient se concevoir.
Le silence du maître, les haies dans le paysage, la case vide au jeu du taquin, c’est tout un.
L’école conçue comme chaîne industrielle (Bernard Collot) craint comme la peste les trous, les vides, le ciel, si bien que la machine scolaire ne dispose plus de jeu, les esprits s’échauffent, l’air devient chaque jour plus irrespirable.
- Les élèves voudraient combler au plus vite le vide que leur impose leur maître.
- Pourquoi ?
- Pour passer à autre chose.
- Mais à quoi ?
- A quelque chose qui n’aurait pas de jeu.
Jean Prod’hom
Lemmes (3)

Les élèves ignorent où se trouve leur maître, non pas qu’ils soient ainsi sous une menace continue, mais parce que le maître est nulle part. Que ceux qui le cherchent ouvrent les yeux, le trouvent au dedans et l’en chassent pour accéder à eux-mêmes.
Le maître se doit d’accompagner ses élèves au plus vite là où il n’est jamais allé, c’est-à-dire n’importe où.
Le maître dit à ses élèves : vous accéderez au monde lorsque vous vous intéresserez passionnément à ce qui ne vous intéresse pas, à ce qui ne m’intéresse pas, c’est-à-dire à ce qui n’intéresse personne. Sinon vous désormais.
Jean Prod’hom
Lemmes (2)

Le maître souhaite que ses élèves puissent faire leur vie sans lui. Mais s’il le veut c’est tout autant pour lui que pour eux. Car en se débarrassant d’eux le maître se débarrasse aussi du maître qui s’accroche en lui et qui alourdit ses pas.
Se débarrasser de ses élèves n’est pas tâche aisée car le maître n’a pas d’autre point d’appui pour y parvenir que les élèves eux-mêmes.
Tout ce que dit, fait ou montre le maître n’est qu’un leurre pour détourner son élève de ce face-à-face dont celui-ci attend tout, et lui désigner ce qu’il ne voit pas. C’est seulement lorsque l’élève se satisfait de la crête des vagues, des verbes être et avoir que le maître invite l’élève qui sommeille en lui à reprendre les choses à l’endroit où il les a laissées, sur la terre, dans le ciel et dans la mer.
Jean Prod’hom
Lemmes (1)

La vie du maître apparentée à celle du larron est faite d'occasions, le cahier de préparations est l’une des sept plaies de sa profession.
Sa tâche principale – essentielle – consiste à jouer petit, très petit, plus petit encore, pour que ceux dont il a la charge soient amenés naturellement à prendre la main. Même les plus récalcitrants. Comme au bridge. Pour autant que les uns et les autres jouent le jeu.
Quoi qu’on en dise le maître joue ses cartes à l’estime. Mais il se doit d’inviter ceux qu’il accompagne bien loin de l’école à faire une halte après chaque coup. C’est de son devoir de les obliger à se retourner pour tracer le chemin parcouru sur la carte de leurs pérégrinations, à regarder où pourrait les mener le pas suivant, de s’y rendre ensuite.
Jean Prod’hom
Après 1968

La cohorte des maoïstes, des staliniens, des trotskistes ont trouvé refuge dans le journalisme, l'instruction publique, les officines de médiation, à deux pas des champs de bataille qui font rage sans y mettre les pieds. Mais dites-moi, qu’aurait-on fait et que serait devenu le monde sans eux ? Que ferons-nous quand ils se seront tus, lorsque ces rêveurs auront rejoint le rivage des vieux combattants ?
S'il faut craindre chaque jour davantage que des enfants ne viennent armés dans les établissements scolaires et ne lâchent de dépit une rafale sur leurs camarades et leurs enseignants, ne faut-il pas s’attendre à ce que ceux-ci ne les singent pas un jour ?
Il ne faut pas s’en inquiéter pour l’instant, me dit Samuel, ce sont tous d'anciens gauchistes qui font du tir à l'arc.
Mais quand ceux-ci ne seront plus ?
Et hop! se dit-il fatigué d'avoir le cul entre deux chaises. Et il vécut debout.
Jean Prod’hom
Echec eschac skak

Une collègue me fait part cet après-midi de son étonnement. C’est incroyable, me dit-elle, les élèves ne supportent pas l’échec. Je me retiens de lui répondre parce que je ne sais ni quoi lui dire ni par où commencer. Et puis je connais la suite : la vie est ainsi faite, les enfants dont nous avons la charge doivent s’y faire, la vie est dure, il faut apprendre à rebondir, on ne réussit pas toujours, l’échec constitue une excellente préparation à la vie professionnelle,… Je décide de me taire et me dépêche de rentrer au Riau pour lire le Dictionnaire Historique de la langue française d’Alain Rey.

Deux histoires sont en concurrence sur l’origine du mot échec. Ce mot pourrait être une altération du latin médiéval eschac qui désignerait à l’origine l’interjection d’un des deux joueurs d’une partie d’échec, avertissant que le roi de l’adversaire est menacé. Ce mot serait emprunté au persan sah mat « échec et mat » qu’il faut traduire par « le roi est mort ». Une seconde origine proposée par Alain Rey et ses collaborateurs fait l’économie d’un détour non attesté par le persan. Il faudrait faire remonter l’origine du mot échec à l’étymon francique skak « butin, prise », si bien que l’ancien français eschac « prise de guerre » et eschac « pièce du jeu d’échec » seraient le même mot. Echec au roi signifierait « butin, prise de guerre », échec et mat signifierait « pris et détruit, mort », qu’on joue ou qu’on fasse couler le sang.
L’école est-elle pour nos gamins un divertissement au même titre que le jeu d’échec, ou une partie qui se joue au péril de leur vie ? une propédeutique où les coups se font pour semblant ou une première aventure à la vie à la mort ? Notre société hésite mais ne tranche pas.
Dans les mondes scolaires et professionnels, le mot échec est rapproché la plupart du temps du mot échouer qui semblent appartenir à la même famille, ce n’est en réalité pas le cas. Si l’origine du verbe échouer est incertaine – on a rattaché ce mot à échoir (excidere « tomber »), à escoudre « secouer » et à exsuccare « faire sécher » – tout devient plus clair du côté de son emploi. Echouer se dit en effet des embarcations qui filent le mauvais coton, celles qui « touchent le fond » et « ne peuvent plus naviguer ». On rencontre aussi un usage transitif de ce verbe, voici les vents, ils « poussent la frégate vers la côte » où ils l’échouent. C’est depuis 1660 seulement que ce verbe a pris le sens de « ne pas réussir » avant de donner à l’homme usé par la vie, deux cents ans plus tard, l’occasion de « s’arrêter en un lieu par lassitude ».
J’ai aperçu au tableau noir d’une classe où je me trouvais ce matin le mot de résilience, on l’enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge, ça peut servir. J’en rigolais hier, je me demande très sérieusement aujourd’hui pourquoi les parents et les avocats dont ils s’entourent depuis quelques décennies ne se sont pas mis à l’ouvrage et n’ont pas déposé une plainte devant la Cour pénale internationale de La Haye contre l'école qui met trop souvent leurs enfants en danger en les faisant échouer.
Il est heureux que les élèves ne supportent pas l’échec, mais qui bon dieu va nous faire sortir du Moyen Âge ?
Jean Prod’hom
Avocat ou oignon

Lorsqu’elle eut détaché de son petit gars, feuille à feuille, tout ce qui l’empêchait d’être l’enfant qu’elle souhaitait, l’élève qu’elle rêvait, lorsqu’elle eut décapé chacun de ses défauts, mis de côté ce dont elle voulait qu’il se débarrasse, sa dyslexie, son manque d’organisation, son attention vagabonde, le divorce de ses parents, ses pannes de conscience, ses rêveries, l’étroitesse de son bureau, ses petites nuits, lorsqu’elle eut annulé d’un geste les handicaps d’une hérédité dont elle n’avait naturellement pas à répondre, lorsque elle eut écarté les quartiers de l’ange qui n’étaient pas de noblesse, je la vis soudain perdre pied. Encore un pas et il allait falloir que la mère choisisse, faire de son fils un noyau dur, avocat sans défaut, être sans coeur qui répudierait à coup sûr l’imparfaite qu’elle était ? Ou pleurer les mains vides devant celui qui n’était déjà plus qu’un souvenir, petit rien qui avait filé entre ses doigts comme ce petit air qui s’échappe du coeur de l’oignon effeuillé ?
Elle revint en arrière pour remettre son gamin en l’état, comme elle l’avait trouvé au début de cette histoire.
Jean Prod’hom
Double bind

L’école propose à ses élèves des ouvrages indigestes, aussi indigestes que les gros bréviaires d’autrefois, mais elle n’hésite pas à égayer leurs pages austères d’illustrations réalisées par nos plus fins humoristes, déroutant ainsi ceux qu’elle a mission de mettre au pas.
Jean Prod’hom
Professionnalisation des enseignants

L’un des principes sur lesquels repose l’exerce des sciences médicales affirme depuis longtemps déjà que tous les hommes ne souffrent pas des mêmes maux et qu’il serait aujourd’hui insensé de proposer le même traitement à un homme à la main coupée et à un diabétique.

On ignore aujourd’hui sur quels principes fondamentaux repose l’organisation de notre école. On continue à trancher en tous sens, à couper, arracher ou raser, à proposer à chacun les mêmes menus, les mêmes régimes, les mêmes opérations, les mêmes exercices et les mêmes devoirs, dans un espace qui n’a pour ainsi dire pas changé depuis deux siècles. C’est, paraît-il, administrativement plus économique. Oui tant qu’on accepte de laisser tout le pouvoir au jacobin qui sommeille en nous. La centralisation administrative a pourri le rêve d’un monde plus équitable au XXème siècle, elle s’attaque désormais au monde libéral avec un succès comparable.
Qu’on se le dise une fois pour tout, il est impossible de maintenir l’idée de groupe homogène, qui est au principe de toutes les organisations scolaires actuelles, avec l’idée selon laquelle les besoins de chacun diffèrent. Vouloir mener ensemble ces deux objectifs nous condamnent à perdre sur les deux fronts. Il y a des grands écarts dont on pourrait ne pas se relever.
Les instituts de formation des enseignants me font penser à ces cirques de province que l’on parque à l’entre-saison en périphérie des villes, on s’y entraîne à l’abri des regards à moins souffrir des contradictions, en continuant notre apprentissage du grand écart, en s’initiant à la voltige, au contorsionnisme, au jonglage et à la prestidigitation. On appelle ça professionnalisation.
Jean Prod’hom
Foi

La sagesse populaire rabâche à nos enfants que le travail est une valeur fondamentale, la persévérance une vertu cardinale. Arthur bute pourtant ce soir sur les mots que sa prof d’anglais a inscrits en tête de l’épreuve qu’elle leur a remise ce matin : Good luck !
C’est vendredi, Arthur songe, Arthur calcule, confiera-t-il la semaine prochaine son sort à Dieu ou au calcul des probabilités ?
Jean Prod’hom
Wikipédia 2001

En 622 il y a eu la fuite de Mahomet pour Médine, la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, il y a eu l’apparition du tracteur dans les années 50. Plus tard, du temps de la Guerre froide, l'établissement de bases américaines au nord-ouest du Groenland. Il y a eu 1986, 1989, 1991. Il y a eu en 1999 la naissance d'Arthur au Riau. Il y a eu enfin dans nos écoles un événement considérable dont on va encore sentir les effets dans les années qui viennent, c’est le lancement de Wikipédia le 15 janvier 2001. Voici en guise d’illustration le mot que la répétitrice de l’un de mes élèves m’a fait parvenir ce matin.
Je m’étais en effet étonné auprès de celui-ci, il y a quelques jours, que cette répétitrice sur laquelle le garçon s’était déchargé pour justifier son forfait avait accepté de l’assister dans l'exploitation servile d’un article Wikipédia sur les oeufs de cent ans, un thème que cet élève de plus de 16 ans avait voulu traiter dans un billet qu’il désirait voir paraitre sur un site internet dont je suis le modérateur et que plus de 70 élèves font vivre depuis près dix ans. Je pensais sérieusement que cette répétitrice n’était que l’invention d’un coquin, car son billet n’était en réalité que le simple copier-coller d’un article de Wikipédia, tout à fait intéressant au demeurant, sur lequel l’élève avait fait main basse, sans aucune indication en bas de page qui eût pu atténuer ma peine et la sienne. il avait pris en outre les précautions naïves de pratiquer quelques micro-opérations de remplacement, de substitution, de déplacement ou d’inversion, en prenant garde de ne rien ajouter qui eût nécessité des recherches supplémentaires. Il avait fait attention encore de gommer du billet les éléments qu’il ne comprenait pas. C’était au final un article sans intérêt qu’il n’y avait aucune raison de publier et que l’auteur aurait dû refuser de signer. J’ai donc été bien surpris lorsque ce matin l’élève en question m’a apporté le mot suivant signé par sa répétitrice :
Monsieur Prod'hom,
Je confirme par la présente avoir aidé V. à rédiger son texte sur les oeufs de cent ans. Nous pensions pouvoir utiliser le site Wikipédia comme seule référence, s'agissant d'un court texte sur un blog. Nous ne pensions pas que ceci serait mal vu et nous nous en excusons.
Je tâcherai de bien aider X pour sa prochaine présentation en faisant attention au plagiat.

Nous avons désormais la lourde et difficile tâche d’inventer des dispositifs et de proposer quelques voies, étroites, qui obligeront nos élèves, non pas tant à bannir Wikipédia et les encyclopédies mises à leur disposition, mais à les utiliser comme sources secondes, susceptibles de leur permettre d’aller plus loin, d’ouvrir des portes qu’ils ne soupçonnent pas, d’entrevoir l’imprévu, de poser les questions qui sont les leurs, des questions qui leur permettront de ne plus avoir à ajouter en bas de page le prénom et le nom du voleur dont l’école se fait la complice.
Certains diront que les choses n’ont pas beaucoup changé, car diable autrefois, si les élèves se rendaient bel et bien dans les bibliothèques municipales pour emprunter tel ou tel livre sur le castor ou le lion, c’était pour recopier par tranches entières ces informations qui seraient lues dans le silence et l’ennui des après-midi de janvier. Je le concède. Mais si cette opération n’était pas aussi efficace pédagogiquement que certains nostalgiques feignent de nous le faire croire aujourd’hui, elle obligeait les élèves à recopier un texte qu’un trèfle-c et un trèfle-v suffisent aujourd’hui à transférer de l’autre à soi. Et puis ils étaient sortis de chez eux, avaient pris le bus, s’étaient adressés à la bibliothécaire. Et s’ils n’avaient ni tué ni capturé de renard ou de castor comme les aventuriers de leurs rêves, les bambins d’avant Wikipédia avaient eu l’immense chance de découvrir autour de Noël la ville et son labyrinthe, ses secrets, ses rues obscures, loin de la maison et de l’école, d’avoir vu du pays avec un bonnet de Davy Crockett sur les oreilles. Ceux d’aujourd’hui vont de l’école à la maison et de la maison à l’école les mains nues, Wikipédia les suit où qu’ils se trouvent. L’ancienne tâche é-ducative de l’école, celle qui devait aider les parents à conduire hors de chez eux leur progéniture ne pourrait bientôt plus être à l’ordre du jour. Mais prenons garde, car ce jour-là, les enfants n’auront pas plus de raisons de grandir que de quitter le giron familial.
Jean Prod’hom


Souvent le monde font couver les oeufs de cane ...

Sinon, ces canes-là, noires à tête blanche, sont capables pour élever des canets. Souvent le monde font couver les oeufs de cane par une poule parce que la poule est bonne meneuse, qu’on dit. Oui, mais elle se trouve embêtée tout de même quand les petits canets se mettent à nager sur la mare et qu’elle reste à marcher au bord.

C’est un livre d’histoires pour les vivants qui raconte l’arrivée du tracteur dans nos régions autour des années 50, dit au plus près et dans la langue de la Mayenne – on n’y parleront pas le latin de Paris – ce qu’on pouvait voir et vivre de chaque côté de cet événement, innombrables histoires qui s’achèvent aujourd’hui avec la mort de ceux qui auront vécu tout près des basses-cours avec tout autour de la cour les bâtiments de la ferme.
Jean-Loup Trassard écoute Vincent Loiseau, il se souvient de ce qui l’a occupé sa vie durant et qu’il a décidé de garder vivant jusqu’à la fin. L’homme se tourne dans son lit aujourd’hui comme autrefois lorsque Quadrille, sa jument de tête devenue brave limonière tombe malade. Elle ne mange plus, se tient à peine debout. Le vétérinaire l’ausculte avant de déclarer : « C’est fini. Faut l’emballer. Pas la peine de faire des frais. » Vincent aurait préféré la garder elle aussi jusqu’à la fin, mais ça aurait coûté trop cher. Alors au dernier matin, il va la brosser, la peigner, lui caresser la tête. « … et puis je suis allé laver le peigne, l’étrille et la brosse à la pompe, enveloppés dans un bout de journal, je les ai mis dans le bas de mon armoire et je suis parti barbeyer. »
C’est sur les talus et au pied des haies que Vincent s’assied, l’homme est usé, il reprend à voix basse les travaux que ses ancêtres ont commencé, utilise une dernière fois les outils du domaine de La Hourdais avant de les emballer dans un bout de journal, dans une langue singulière qui fait entendre ce que furent les rapports de l’homme et la terre.
Jean Prod’hom
Ne jamais tourner le dos au progrès

Au début nous hésitions tous sur le y de dyslexie parce que dyslexiques nous l’étions tous un peu. Mais des dyslexiques il y en eut chaque jour davantage, un pourcentage toujours plus important, davantage encore. Nous avons alors comme il se devait pris acte du mal qui se répandait et quelques mesures inoffensives. Mais le coin avait été planté dans l’angle de la noble institution et de nouveaux arrivants souffrant de maux étranges rejoignirent bientôt les premières victimes de l’école naissante. On nomma cette seconde vague les dyscalculiques avec y pour ne pas les stigmatiser et les apparier aux premiers dont on atténuait ainsi l’isolement.
Pourquoi les dyscalculiques ne se sont fait connaitre qu’après les dyslexiques ? nul ne le sait, peut-être parce qu’il y a toujours un peu de dyslexie dans la dyscalculie, on ne gaspille pas aisément les premières récoltes. Toujours est-il qu’ils se tenaient tapis dans les couloirs, se rongeaient les ongles, leur biscotte dans la poche, inquiets à l’idée d’être découverts, soulagés lorsqu'un nom vint souligner leurs tourments. Les uns et les autres n’ont pas été mécontents de mélanger leurs handicaps si bien qu’on se mit à rencontrer dans les années qui suivirent des enfants dyslexiques et dyscalculiques.
La situation se stabilisa, mais on s’avisa bientôt qu'il restait un nombre important d’enfants au comportement audacieux, gestes déplacés, habiletés motrices hésitantes, échecs fréquents, qui occupaient les places laissées libres au fond de la classe. Comme toujours les difficultés invisibles, ou peu visibles, ont été interprétées comme de la mauvaise volonté. Mais à l’instigation des doctes, il fallut bien donner un nom à ces troubles, on garda le y qui tenait ses promesses et on appela ceux qui en souffraient des dyspraxiques.
Praxies ? On appelle praxies les gestes conçus, programmés et exécutés par un sujet volontaire, gestes susceptibles de se dérégler lorsque plus rien ne va, dérèglement que le sujet a tendance à masquer en développant d’autres troubles, des troubles bien identifiés, troubles du langage ou de l’attention, dyslexie et dyscalculie, avec ou sans hyperactivité.
Beaucoup d’entre nous furent pris de vertige. Quant aux enfants ils comprirent très vite ce qu’il leur restait à faire s’ils voulaient un jour aller tête nue et battre la campagne.
Jean Prod’hom
Les danaïdes

Des cinquante jeunes femmes que leur père, Danaos, offrit aux cinquante fils d'Egyptos, leur oncle, pour prévenir les inévitables conflits liés à leur succession, des cinquante danaïdes qui plantèrent une aiguille effilée dans le coeur de leurs cousins avant que ceux-ci ne les tuent, de leur arrivée aux Enfers et de leur jugement, la tradition n’aura retenu que la terrible punition qui s'en suivit et le désespoir dans lequel les plongea l'absurdité de leur supplice : les danaïdes noyées dans un désespoir sans fin emplissent encore aujourd’hui des tonneaux sans fond.

De la tradition, on ne retiendra ici que deux ou trois choses. L’extraordinaire sculpture d’abord que réalisa Rodin à la fin du XIXème siècle pour la Porte de l'Enfer et qu'il intitulera La Source. La chevelure de la suppliciée en pleurs coule sans discontinuer dans la poche de marbre d’où le sculpteur l’a tirée.

Mentionnons encore la représentation assez classique réalisée par John William Waterhouse en 1903 dans laquelle de belles danaïdes aux seins généreux remplissent une bassine avec une telle équanimité qu'on se demande bien pourquoi elles n’ont pas derechef quitté les lieux lorsqu’elles se sont aperçues que la bassine était trouée.
Il y a bien sûr Apollinaire qui les évoque en cette même année 1903 dans sa Chanson du Mal-Aimé :
Mon coeur et ma tête se vident | Tout le ciel s'écoule par eux | O mes tonneaux des Danaïdes | Comment faire pour être heureux | Comme un petit enfant candide


Si la fontaine que réalisa en 1907 Hugues Jean-Baptiste près de l'église Saint-Vincent-de-Paul à Marseille ne mérite pas notre attention, la plaque de marbre qui avertit le passant que l'eau n'est pas potable doit nous alerter. Le supplice des danaïdes assoiffées est plus grand encore que ne l'imaginait Eschyle.

Un mot encore sur le bronze de Brancusi, doré à la feuille, réalisé en 1913 que Christies's adjugea en 2007 pour 19,3 millions. Brancusi a-t-il voulu représenter le visage d'une danaïde désespérée ou, à ce prix, le tonneau sans fond qu'elle est condamnée à remplir ? Nul ne le sait.
Mais il faudra désormais compter avec une nouvelle interprétation iconographique du mythe des Danaïdes, une appellation qui aurait d’ailleurs avantageusement remplacé celle des Trois Danseuses attribuée aux trois nouveaux bâtiments scolaires du Mont-sur-Lausanne en référence à l'oeuvre aérienne de Degas. Pas tellement en raison du gouffre financier dans lequel de telles réalisations plongent immanquablement les communes habitées par une certaine idée du prestige, mais en raison des éviers installés dans l’un de ces nouveaux bâtiments. Que l’affaire se déroule dans les salles de sciences n’est évidemment pas anodin. Mais chaque chose en son temps, penchons-nous pour l’instant sur le renouvellement de l’interprétation du mythe.
Le supplice trouve ici son expression la plus aboutie : l’eau du robinet fixe coule directement, lorsqu’on l’ouvre, dans l'ouverture du trop plein ménagée dans la bonde qui rend le bassin étanche. La scène est nue, brutale, à son comble. Il y a du Maurits Cornelis Escher dans cette réalisation, mais on atteint ici les limites supérieures de l’art, si bien que les danaïdes, habituées pourtant au pire, n’auraient pu survivre à une telle épreuve. L’artiste en a fait l’économie, le désespoir va désormais seul, sans hésiter, dans la nuit d’une salle de sciences vide.

Jean Prod’hom
E-banking à l'école

Dès la rentrée scolaire 2013, il sera demandé aux enseignants du canton de Vaud d’utiliser une application accessible depuis Internet permettant de gérer des données confidentielles. Ce logiciel, baptisé NEO (Notes pour l’Enseignement Obligatoire), devrait donc permettre à l’école de faciliter certaines de ses tâches en les centralisant, le transfert et le stockage des notes par exemple. Pour le reste on se perd en conjectures.
On peut toutefois indiquer la conséquence majeure d’une telle entreprise, la multiplication des précautions et des contrôles d’accès. C’est fait; on avertit en effet les usagers que l’accès à cette application et à certaines de ses données nécessitera une identification dite « forte », c’est-à-dire identique à celle proposée lors de l’ « e-banking ». Il faudra donc non seulement que les usagers montrent patte blanche en inscrivant leur prénom, leur nom et un mot de passe, mais il leur faudra encore fournir une troisième information provenant d’une carte matricielle distribuée annuellement ou de codes aléatoires transmis par téléphone portable.
On se demande bien s’il est judicieux, sachant la tourmente dans laquelle se trouvent les banques depuis quelque temps, de vouloir calquer ses actes sur un modèle qui a mis sous cadenas des bombes. A vouloir mettre sous clef des données dites confidentielles, on atteint dans des domaines qui ne le méritent pas, ou méritent bien autre chose, le comble de l’opacité.
Dans quelle mesure les notes scolaires devraient-elles être considérées comme confidentielles ? Parce qu’on doute de leur pertinence ? Parce qu’elles constituent de véritables agressions symboliques ? de petits crimes contre l’humanité ?

Après l’ère du soupçon celle du secret. Nous voici résolument entrés dans celle de la confidence. Pas sûr que nous y gagnions au change.
- Qui es-tu ?
- Personne.
Oh ! les beau jours des identifications faibles !
Les confidences entrées dans des systèmes à identification forte, tôt ou tard y sont captives, tôt ou tard en ressortent, explosent par manque de place.
Les systèmes à données confidentielles doivent être nourris. Lorsqu’un champ est épuisé, il suffit de recycler de vieilles jachères et de rendre confidentiels le trèfle et le mouron.
Un jour, bientôt peut-être, toute parole – information, idiotie, argument – sera traitée du point de vue juridique comme une donnée confidentielle.
Pour terminer ceci : dans le livre d’histoire que l’école remet aux petits Vaudois, on lit à propos de Rodolphe de Habsbourg les lignes suivantes :
La première tâche qu’il entreprit fut d’éliminer un obstacle de taille qui avait pour nom Ottokar, roi de Bohême (…) Après sa victoire sur Ottokar, ses amis le poussèrent à faire le voyage de Rome pour recevoir du pape la couronne impériale (…) Il refusa. La réponse qu’il aurait faite à ces sollicitations donne à penser qu’il redoutait d’être l’otage du pape.
« Un jour, expliqua-t-il, quatre animaux furent invités à se rendre dans une caverne, sur une montagne. Tous firent comme on le leur avait dit. Seul le renard voulut vérifier si tous pouvaient ressortir de cette caverne. Aucun ne revint. Alors le renard prudent, n’y entra point ». (…)
Les autorités avertissent donc les petits dont elle a la charge de surveiller l’usage des boîtes noires dans lesquelles on entre mais dont on ne ressort pas. C’est bien, l’éthique est sauve.
Jean Prod’hom
Aimer la grammaire

Le temps s'est réchauffé, on annonce plus de 20 degrés cet après-midi, je lance pourtant un feu dans le poêle qui s'éteindra certainement dans la journée. Le bois qu'Arthur a rentré hier me rappelle qu'il me faut en commander deux stères, les vendangeuses sont en fleur, quelques roses éclosent. Au Mont une petite pelleteuse retourne la terre autour de la première Danseuse, la réalité se rapproche dangereusement du plan des architectes, le rêve n'est bientôt plus qu'un rêve.

Au collège, le responsable informatique m'indique que le nouveau meuble dont l'établissement a fait l'acquisition il y a peu pour ranger et transporter les ordinateurs portables ne porte pas le nom de porteur de portables comme je l'écrivais hier, mais de classe mobile. Je fais une petite recherche sur internet en rentrant et j'apprends que le Mobile Classroom de chez Bretford, qui nous accompagnera au Mont désormais, traduit en français par classe mobile, s'appelle aussi classe nomade, c'est plus joli mais assez retors. Grâce à ce meuble d'un peu plus de 70 kilos et moins de 1800 euros pour ranger, protéger, charger et transporter 20 ordinateurs, l'élève pourra rester fixé à sa chaise et le monde défiler sous ses yeux. C'est donc fait, le portable se comporte désormais comme un ordinateur fixe et condamne définitivement l'élève à faire le cul de plomb, l'enseignant fera le reste, il poussera le service-boy au joli nom de classe nomade pour enchaîner l'élève immobile aux effigies et aux soldats de plomb.
Le soleil claire l'herbe haute qu'il me faudrait faucher, mais je renvoie à demain ce qui peut attendre. Poursuis dehors la lecture du Plateau de Mazagran d'André Dhôtel. A Rigny il y a un salon de coiffure, celui que Charles Crevain souhaiterait remettre à son fils Maxime qui ne montre guère d'enthousiasme. Comment ne pas songer à Philippe Didion qui tient une rubrique Poil et plume dans ses Notules dominicales de culture domestique. Je recopie un long extrait où il en est question.
Le lendemain Maxime se leva tôt pour balayer le magasin (Crevain ne fermait pas le lundi mais le jeudi). Ce qui avait le plus d'importance à ses yeux, ce jour-là, c'était la splendeur de l'automne. Les ondées avaient nettoyé les rues pendant la nuit, et maintenant le ciel était encore traversé de nuages dont la débandade obscure rendait l'azur plus vivant. Dans les glaces du salon de coiffure, Maxime voyait passer ces nuages qui alternaient avec le soleil.
Il balaya mécaniquement, rinça les trois cuvettes, puis envoya torchon et balai à la volée au fond d'un placard.
- Tout cela m'est bien égal, dit-il enfin.
- Qu'est-ce qui t'est égal ? demanda Charles Crevain qui venait de descendre l'escalier.
- Ça m'est égal d'être coiffeur, ou juge de paix ou marchand de peaux de lapins.
- Sans doute, il y a de plus mauvais métiers, dit Crevain.
- Mais je pense que cette histoire de coiffure ne durera pas, précisa Maxime.
- Je tiens à ce que cela dure, m'entends-tu ? déclara Crevain.
- Je veux dire qu'un jour ou l'autre nous nous retrouverons peut-être au Paradis et que la coiffure peut mener au Paradis tout aussi bien qu'autre chose.
- Très certainement, répondit Crevain déconcerté.
Le premier client du matin entra : c'était Verdot, le voisin qui tenait la quincaillerie. Il fut suivi bientôt par Steille, le marchand de vaisselle, autre ami de Crevain. Lorsque le greffier Caron survint à son tour, la conversation allait bon train, dominant les éclats des coups de ciseaux et les murmures du rasoir. Toujours les mêmes rengaines : après le subtil exercice de langage qui consistait à apprécier la qualité exacte du temps qu'il faisait, ce furent des généralités sur l'avenir de la jeunesse : « Eh bien, Maxime, tu succéderas à ton père. Moi, quand j'étais jeune... » Tout cela pour tâcher de provoquer chez Maxime je ne sais quelle protestation qui eût dévoilé son vrai jeu. Maxime regardait l'automne scintiller dans ses ciseaux et sur les robinets de la boutique. Automne irremplaçable et inoubliable. Il se sentait heureux, et lorsque la matinée se termina sur le presto d'un shampooing il jura qu'il ne travaillerait pas l'après-midi.
Je cherche à comprendre pourquoi tous les récits d'André Dhôtel me déroutent à chaque instant. Mais lorsque j'essaie de suspendre ma lecture pour y voir un peu clair et fixer les raisons de mon trouble, rien ne tient, le texte part en morceaux, Maxime, Charles, Juliette, Gabriel, Emma radotent, tout est invraisemblable, ne tient à rien ou à des mots insensés, à des phrases sans queue ni tête, tout s'évapore et il ne reste rien, sinon une espèce de dégoût envers ces personnages pour lesquels je me suis pris d'amitié, des êtres de papier, sans consistance, contradictoires, légers. Un enfant de 10 ans oserait à peine. Et pourtant.
C'est qu'il n'existe aucune volonté chez l'Ardennais de faire tenir ensemble l'immense variété des choses et des discours. Aucune volonté de déléguer au narrateur le pouvoir d'y voir tout à fait clair, quand bien même il s'y essaie parfois. Ce sont alors de brèves éclaircies ou de mauvais présages, mais jamais au grand jamais le narrateur ne prend définitivement la main sur l'affaire, il le fait ici ou là pour dérouler un décor pauvre et immense derrière lequel les personnages pourront reprendre leur souffle, des forces, du repos, avant de les remettre à la nécessité ou au hasard, de les laisser prendre un peu d'avance, dire et faire n'importe quoi, et de feindre qu'il en est toujours allé ainsi, et qu'on ne peut que les suivre pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque l'affaire va trop loin ou que les personnages lui échappent, avec le risque qu'ils fassent l'école buissonnière ou même disparaissent, le narrateur convoque d'autres personnages, imprévus, qui surviennent pour mettre un peu d'ordre ou un peu plus de ce désordre qu'ils partagent avec lui. Tout est à recommencer de manière plus essentielle encore, si bien qu'à la fin tout le monde a tenu ses engagements à tort et à travers, sans que personne ne soit assuré de leur teneur, parce que le désir de vivre est plus puissant que toute promesse, qu'il nous faut rejoindre un pays qui s'ouvre sous nos pas comme la mer et que, quoi qu'il en soit, tout finit en déroute parce que personne n'a jamais été dans le secret des dieux.
C'est le dernier des sept de la première série, il y en aura trois encore, Arthur le copie en fin d'après-midi à tous les temps, c'est le verbe aller. Il sait bien qu'il y en aura d'autres, il grogne avec le sentiment qu'il fait cet exercice chaque année et par tous les temps. Mais est-ce un exercice ? Il se demande si c'est bien utile, je me le demande aussi, n'y a-t-il pas d'autres voies pour saisir l'ensemble des formes verbales et le système qu'elles constituent ? N'y a-t-il pas une manière de goûter à la grammaire réputée rébarbative, d'aller à l'essentiel sans lequel ce qui en découle est incompréhensible ? Un petit livre indique la direction, il s'appelle Aimer la grammaire.
J'envoie l'extrait du Plateau de Mazagran à Philippe Didion.
Jean Prod’hom




Porteur de portables

Pas sûr que le couverture nuageuse, lourde et nonchalante, encourage vraiment le jour à faire son entrée ce matin, ni moi non plus d'ailleurs. L'ombre du soir a pris du retard et traîne à l'ouest, aucun signe encore à l'est, je décide donc de faire la course solitaire et en tête. Fais du feu avant 6 heures et pars pour la mine avant 7. Mais le brouillard ralentit considérablement la circulation dans laquelle je ne trouve ma place qu'avec difficulté, si bien que l'avance prise ce matin se réduit vite sur le plateau de Sainte-Catherine. Je bâille à 7 heures 30 et reprends le rang dès 8 heures, avec l'unique souci de recalibrer mes ambitions et de rester collé au peloton jusqu'au soir.

Les élèves, comme souvent le lundi matin, sont des statues de cire, froide. Ardu de les réchauffer et de mettre en mouvement les bielles de leur mâchoire, c'est vrai qu'il fait froid dans les classes, le chauffage est en panne, une panne due, dit-on, aux mastodontes de chantier qui ont écrasé les conduites d'eau chaude passant dans la cour et alimentant les radiateurs du collège.
Ils tracent sur leur cahier quelques mots que j'ai notés au tableau – oxymore, antiphrase, hyperbole, litote, énumération -, le visage impassible. Le jour a fini par faire son entrée, quelques rayons se font remarquer, quelques visages se réveillent, déridés par les obliquités de Voltaire dans Jeannot et Colin, l'examen des valeurs du subjonctif fait le reste.
Je lis quelques pages du Plateau de Mazagran pendant mon heure de permanence et reprends les hostilités en fin de matinée.
L'école vaudoise ne cesse de faire parler d'elle dans les salles des maîtres, comme si elle ne leur appartenait plus. Les enseignants doutent des réformes, notamment des dernières, celles qui m'ont plongé dans le désespoir le plus vrai, le plus profond, sans même ce petit élément qui fait si souvent espérer chacun d'entre nous dans les pires situations. Je ne crois plus ni à la providence ni au hasard, pas plus qu'en mon intelligence, bref un désespoir heureux, détaché et libre. Il ne sert à rien de s'agiter, il est juste temps de faire ce qu'on peut. J'ajuste donc mes forces et tente de faire comprendre aux grands élèves de la 9 que les problèmes des accents aigu et grave qu'ils doivent maîtriser sont des problèmes de peu d'importance, au fond, mais qu'ils ont provoqué un beau et gros remue-ménage en 1996. On a tranché. Exception ? On gardera le é dans médecin, un peu de respect, please, à l'égard de nos élites. Tout ça est drôle et mérite d'être connu. Ce sont même ces connaissances de second niveau qu'il nous faut enseigner à nos élèves, parce qu'elles enveloppent sans trop de sérieux celles du premier niveau, que les élèves maîtriseront à leur insu, sérieuses, normatives et passagères.
Je prends à nouveau de l'avance en fin d'après-midi et termine avant l'heure. Vais faire un tour, monte au Châtaignier par le Petit-Mont, le soleil guigne entre le Jura et le Plateau, je cherche Montricher. Le chemin qui serpente dans les bois est plus prononcé qu'autrefois lorsque nous l'avions, les élèves et moi, élevé au rang d'annexe scolaire. On l'appelait la boucle et les élèves l'empruntaient parfois pour travailler en marchant, comme les Aristotéliciens dans le quartier du Lycée d'Athènes. C'était une boucle d'un peu plus d'un kilomètre et d'un peu moins de 50 centimètres de large qui plongeait en son milieu dans l'ombre de la Valleyre.
Au terrain de football j'aperçois des visages connus, trois ou quatre élèves de la classe 11 qui s'entraînent assidûment. Un autre plus loin, mais plus ancien, il pilote un petit avion de sagex, il a fait un apprentissage de luthier mais peine à se mettre à son compte. M'arrête en redescendant par le chemin des Neuf Fontaines au Central où des habitués se taisent devant une bière.
À 19 heures 30 je rencontre les parents de la classe 9 auxquels je ne raconte pas l'histoire de cet élève à qui on demande, un lundi matin, quelle méthode il utiliserait pour déterminer la température de l'eau d'une fontaine qui murmure dans la cour et qui répond qu'il suffit de réfléchir. À la proposition de se rendre sur place et d'y tremper la main ou d'user d'un thermomètre, il rétorque qu'il est quand même moins pénible de réfléchir que de se lever et descendre jusqu'à la fontaine. Il n'avait d'ailleurs pas tout à fait tort. Je leur raconte en remplacement d'autres histoires anodines, avec dedans des silences, c'est ce qui leur parle le mieux.
Je passe à la salle d'informatique avant de rentrer, je tombe sur un coffre-fort, le nouveau chariot pour les ordinateurs portables. Oui oui ! un porteur de portables.
Au Riau, Sandra et Suzanne préparent leur voyage à Berlin. Les enfants dorment.
Jean Prod’hom


Il y a du Grand Meaulnes dans la Grande Beune

Assure la mise sur orbite de nos trois satellites, qui peinent au réveil, se retournent, se détournent, s'enroulent dans leur couette avant de mettre soudain le turbo et de me reprocher, tandis qu'ils regardent flotter dans un bol de lait leurs corn flakes, de les avoir martyrisés en leur offrant, je le croyais, ce qui se fait de mieux en ces circonstances, les chansons de la jeunesse de Georges Brassens chantées par lui-même : Avoir un bon copain, On n'a pas besoin de la lune, Le Bateau de pêche, Le Petit Chemin,... On m'y reprendra.

Présente aux élèves de la 6 une activité autour des Temps modernes (1453-1776), une activité dont je cherchais depuis quelque temps la clef, laquelle m'est apparue hier alors que je roulais entre Cugy et Morrens, Bretigny, Montheron et Froideville. La solution s'est imposée d'un coup : extraction en forme d'arborescence de la structure - appelons-la sémantique - de l'introduction aux Temps modernes du manuel d'histoire des années passées rédigée par Raymond Darioly ; importation dans cette arborescence pour l'éclairer, l'étayer, exemplifier l'un ou l'autre de ses aspects, de cinq éléments textuels extraits des 88 pages du manuel Nathan mis à la disposition des élèves cette année, consacrées aux XVIIe et XVIIIe siècles ; recherche sur le net et importation de cinq documents iconographiques complétant l'éclairage; rédaction pour chacun de ces documents d'une légende, c'est-à-dire de consignes de lecture – que faut-il regarder sur cette image ? –, susceptibles de fonder l'une ou l'autre des assertions, illustrer leurs significations, mais aussi susceptibles d'étendre l'intelligibilité du parcours.
Il me faudra plus de trente minutes pour préciser l'affaire aux élèves, ses enjeux, mais aussi sa simplicité : apprendre à lire, croiser ses sources et goûter aux joies de l'exploration libre.
Pendant que les élèves de la 9 planchent cet après-midi sur la course aux colonies à la fin du XIXe siècle, je lis Genette la canaille, il y a de la fouine chez le bonhomme, du furet ou de la belette.
Mon propre conseil de lecture serait donc : surtout, ne «picorez» pas (un livre n'est pas une basse-cour), lisez dans l'ordre, ligne à ligne, sans rien sauter (parfois glisser, peut-être), sous peine de manquer les effets volontaires, ou plus souvent offerts par ce hasard qui souvent fait si bien les choses, de proximité (de «bricollage»), de contraste (de coq à l'âne) ou de transition ; retenez éventuellement les entrées qui vous semblent obscures ou elliptiques, puis relisez une deuxième fois d'un œil plus curieux, voire indiscret, propre à percevoir quelques fils conducteurs, et quelques images dans le tapis : contrairement à moi, vous avez toute la vie devant vous. Mais j'ai dit «serait», sans illusion ni sanction : l'auteur propose, dans le meilleur des cas, le lecteur dispose, et de toute manière il est déjà un peu tard pour un tel divertissement.
Bien sûr, il y a bricolage et bricollage, mais on ne saura pas avant l'après trilogie de Codicille, Bardadrac et Apostille, c'est-à-dire dans l'ouvrage suivant – s'il y en a un (dont le titre devrait commencer très logiquement par la lettre Z en vertu de la loi de l'Eternel retour du même) –, sur quoi portaient les guillemets.
Termine en rentrant La Grande Beune, un récit plus court, plus ramassé encore que le souvenir gardé, à peine un récit. Le lire et le relire autant de fois qu'il le faudra pour réduire son empan et saisir sa phrase, la courte phrase qui le fait frémir tout entier, percevoir le souffle unique qui le traverse. Il y a du Grand Meaulnes dans la Grande Beune.
Réunion des parents d'élèves à Moudon, la Broye coule noire.
Jean Prod’hom






Gérard Genette

Louise sourit lorsque je lui souhaite un joyeux anniversaire, et ce sourire qui n'a pas toujours été si large au réveil me réconcilie avec les démons de l'histoire qui m'enjoignent de quitter la maison pour gagner mon pain. Yves vient ce soir, Arthur et Lili sont dans le secret, Louise l'ignore.

Travaille ce matin successivement avec chacune des trois classes qui m'ont été attribuées au début de l'année, sans répit, avec le souci de leur faire entendre – trop souvent peut-être –, ce qu'on est en mesure de saisir de nos pouvoirs derrière les apparences. Non pas tant le comportement irrégulier de certains verbes en -dre ou la présence à l'écrit d'une lettre i inaudible, mais la faculté de surmonter ces difficultés en élaborant des outils ad hoc. Les connaissances positives engrangées à la fin de nos parcours scolaires occupent un si faible volume, souvenons-nous, qu'on se doit, chaque fois que cela est possible, et ça l'est toujours, de minimiser leur valeur et de réévaluer ce qu'on met en jeu pour surmonter les obstacles. Ce faisant, les derniers arrivés sont amenés à maîtriser non pas seulement tel usage particulier, telle idiotie héritée de leurs pères mais à entrevoir et saisir parfois ce qui appartient en propre à l'espèce.
Tire quelques photocopies des épreuves que je vais soumettre aux élèves ces prochains jours. Nous avons en effet mis en évidence des problèmes, nous les avons interrogés, pesé leur importance, nous avons élaboré des réponses ; une feuille blanche sur laquelle ils auraient eu à tout écrire aurait dû suffire, attestant par là que tout ce qui ne leur appartenait pas jusque-là – les questions comme les réponses – leur appartient désormais.
On ne sait rien à moitié, on sait les choses toutes, mais avec la certitude que ça ne tient qu'à un fil, un fil qui nous permet de rentrer à la maison chaque soir après le travail. Ce que je fais à un peu plus de 13 heures.
Sandra à oublié le gâteau d'anniversaire à Lausanne, je descends le récupérer, passe dans une librairie. J'ai la curieuse impression que les livres de la rentrée dont on fait grand bruit datent de saisons passées. J'ai le sentiment de les avoir tous lus, sauf un, l'Apostille de Gérard Genette qui me tend les bras. Rien de tel pour rester éveillé que la lecture des textes de ce jeune homme de plus de 80 ans, un peu canaille, qui a entrepris après Bardadrac et Codicille un troisième tour du monde.
M'arrête à l'Hermitage à 16 heures 30, on y expose une cinquantaine de peintures, dessins, affiches d'Asger Jorn, tout semble avoir été fait, même quand c'est pour la première fois, dit et redit mais de dos, essaie de rattraper quelque chose qui me dépasse. À Sauvabelin il pleut, les canards et les oies ont déserté le lac et pataugent dans la pelouse, bois un café et goûte, avant de reprendre la route, une dernière apostille qui croque sous la dent.
Jean Prod’hom








Il nous faudrait aujourd'hui mille Henri Calet

Il a plu des perles toute la nuit sur les velux, je me réveille avec un peu d'anxiété, c'est que nous allons ce matin, Raymond et moi, faire visiter au élèves de la classe 11 et de la classe 6 la mine des Roches et le quartier qu'elle alimente depuis 1842. C'est la dernière grosse source privée du coin, une source bien vivante, une source qui débite plus de 100 litres-minute. Les propriétaires ont changé il y a peu toutes les conduites, de la plaque Menu – du nom de celui qui l'a fondue en 1905 – jusqu'aux Roches, les Meules, la Croix-Blanche, la Dubarde, en Lussy. J'apprends que les propriétaires du Serget ont renoncé à leur part.
Descends une fois encore dans la chambre de partage, une fois encore m'enthousiasme devant cette galerie de plus de 190 mètres creusée entre 1868 et 1872 qui s'enfonce dans la molasse, admire la ténacité de ces hommes, leur inventivité, la bienveillance des autorités communales.

Le beau temps revient au milieu de la matinée et il fait soudain si bon au soleil. Je mange à midi avec Raymond, sa femme, son fils et son petit-fils à la Dubarde après avoir jaugé le débit de sa fontaine. Il faudrait que je réalise enfin ce petit ouvrage sur l'histoire de cette mine de 1842 à aujourd'hui, j'ai les informations, mais où trouver le temps ?
Sandra est descendue au CHUV avec Louise, tout va bien, les résultats des examens sont bons. Elle part en début d'après-midi à la HEP présenter le programme de l'option spécifique Mathématiques-physique de l'enseignement obligatoire, je reste avec les enfants.
Les filles, je ne les verrai plus de l'après-midi, il n'en va pas de même d'Arthur qui me demande à 15 heures de l'aider. Il doit répondre à des questions portant sur La Main de Guy de Maupassant. On en termine à 18 heures, trois heures pour répondre tant bien que mal à 24 questions. L'intention de l'enseignant était louable et j'en ai profité pour rendre attentif le mousse sur quelques points que j'étais en mesure d'éclairer. Mais si le travail a été si long et si difficile, c'est qu'Arthur et moi, nous avons eu de grosses difficultés à comprendre toutes les questions. On ne s'est toutefois pas plaints, on a engagé notre coeur et toute notre bonne volonté, on a fait des conjectures, on a remis l'ouvrage sur le métier, rien n'y a fait, certaines questions ont résisté. Mais on a fait au mieux, oui on a fait au mieux, si bien qu'à la fin on a eu quand même l'impression de ne pas être complètement idiots. J'espère qu'Arthur saura écouter et sera en mesure de comprendre les explications de son maître quand il aura à corriger ce travail en classe.
Je pense ce soir aux camarades d'Arthur, qu'ont-ils fait cet après-midi, étaient-ils seuls devant ces difficiles questions. Notre école est, je le crains, une école qui ne connaît guère la bienveillance, ni le pardon ; n'y nagent que ceux qui ont appris à nager ailleurs. Je ne crois pas que notre société ait raison de continuer ainsi.
J'ai proposé autrefois, un peu pour rire, un peu pour provoquer, un peu pour de vrai, déposer une plainte à la Cour pénale internationale de La Haye contre l'école qui met trop souvent nos enfants en danger, personne ne m'a suivi. Entre temps, on a inventé un concept qui a bon dos, le concept de résilience.
Décidément, il nous faudrait aujourd'hui mille Henri Calet et mille Combat.
Jean Prod’hom








Lui livre alors ma tête sur un plateau

Il y a eu le levant qui a n'a pas résisté à la poussée du levant, il y a eu la nuit qui a fui et le jour, il y a eu les draps tendus du ciel. La mine ensuite.
Passe à 16 heures une bonne heure avec un collègue pour anticiper ce qui pourrait être ou n'être pas, et nicher là, malgré tout, justement, ce qui pourrait être. On a réussi, je crois, à ne pas nous faire trop d'illusions, induire le maigre nécessaire. On s'est promis de l'entreprendre avec sérieux, sans rien dire, sans nous prendre nous-mêmes trop au sérieux.
Murielle, comme c'est curieux une bibliothèque en fin d'après-midi, comme c'est curieux une bibliothèque sous clef, curieux une bibliothèque vide, une bibliothèque dont on ne voit plus les livres mais le jour promis !
Il est près de 18 heures lorsque je quitte le collège vide, avec le sentiment d'en avoir terminé avec quelque chose dont je sais bien peu.
Au Riau, avant même le seuil, Louise me demande si je devine le résultat du travail que sa maîtresse lui a proposé autour des verbes les plus usés des langues indo-européennes et qui continuent à hanter nos existences : être, avoir, aller, faire et dire, au présent, à l'imparfait et au futur. Je le devine, son sourire la trahit, nous jouons alors un instant au chat et à la souris. Nouvelle chorégraphie autour de son travail d'orthographe, la demoiselle sourit encore, je feins de ne rien comprendre, elle insiste, lui livre alors ma tête sur un plateau. Ce n'est pas tout, elle m'annonce triomphale que son affût a débouché sur l'arrestation de la souris qui courait dans la chambre de Lili, je l'embrasse.
J'entre enfin et prends acte de la fin de la semaine. Maison silencieuse, Arthur devant l'ordinateur, Lili et Mylène dehors dans leur cabane près de l'étang. Je prends la mesure de cette vacance, respire, n'y crois pas.
Descente éclair en début de soirée au Mélèze où le club du Passepartout reçoit son champion du monde. David raconte sa course en Autriche sous l'oeil avisé de Jean-Daniel qui l'a accompagné des années durant jusqu'à ce formidable exploit. Jean-Daniel raconte dans sa langue le contrepoint. On applaudit, la nuit tombe, il fait cru. Tout le monde se met à l'abri, sauf Arthur et moi qui remontons à Corcelles.
Lili et Mylène regardent Shaun le mouton dans les combles, Louise est couchée en chien de fusil, elle écoute des airs de guitare que son maître a enregistrés, je regarde son visage, les yeux fermés, me réjouis d'une relation dont je ne sais rien, de la passion qu'ils partagent. J'aurais voulu occuper la place de l'un, la place de l'autre, une place qui fut mienne à mon insu, je m'en souviens. Comme la vie est parfois bonne !
La souris est morte, Lili et Mylène dansent, il est passé dix heures.
Jean Prod’hom


Un peu d'eau se mélange à la nuit qui s'éclaire

Je pars du Riau alors qu'un peu d'eau se mélange à la nuit qui s'éclaire, pour terminer au collège ce que je n'ai fait qu'entamer la veille. Des grenouilles et des feuilles, mortes bientôt, miroitent sur le bitume détrempé, j'évite les premières, pas les secondes qui recouvrent en tourbillonnant cette sotte espérance d'une interminable belle saison. Quelque chose s'est retiré ce matin.
Je m'avise, une fois encore, que les soirées des adolescents sont longues et que certains attendent avec un certain bonheur l'école du lendemain pour se reposer enfin et se remettre de ce qui les a tenus éveillés jusqu'à tard dans la nuit. Et quand je m'étonne de la brièveté de leur sommeil, ils hochent la tête pour demander un peu de compassion. Les plus crânes sourient en me prenant à parti : mais enfin, vous avez connu tout cela, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Je comprends un peu.
Je tente à 10 heures de soulever la paupière de ceux qui sont encore endormis en leur parlant de l'idée de substance, de ce qu'on dit et de ce qui se dit à travers nous, de la fragilité de nos identités, espérant par ces interrogations naïves faire tache d'huile et les relancer sur une voie qui pourrait être la leur. Mais est-ce le bon moment de leur parler ? Trop tôt ? trop tard ? Mais alors quand ? Celui qui le veut ne fera-t-il pas sien, quoi qu'il advienne, ce qui lui revient de la tradition ?
Je termine la matinée avec l'impression que bien peu d'adolescents profitent de l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, ils sont au chaud quand il fait froid, à l'abri quand il pleut, en compagnie lorsqu'ils ont un chagrin. Mais cela suffit-il ? Je remonte au Riau.
Passe une bonne partie de l'après-midi à bidouiller des fichiers Adobe Digital Editions. J'obtiens partiellement ce que je souhaitais, des fichiers ePub sans DRM, lisibles sur iBooks, de Jeannot et Colin, Derborence et L'Ardent Royaume. Je dois m'avouer vaincu lorsqu'il s'agit d'écrire un script qui me permette de virer le DRM à partir de Terminal, comme je l'ai lu dans un forum.
Elsa a passé l'après-midi avec Louise, nous avons réservé, Sandra et moi, un vol Genève-Naples et un appartement sur la via Toledo, j'ai entendu quelques accords d'accordéon, on n'a pas su piéger la souris qui est dans la chambre de Lili qui dormira dans la chambre d'Arthur.
Les pommiers se sont alourdis, ce sont leurs branches qui les soutiennent du bout des doigts. Les températures ont chuté, la neige est annoncée à 1700 mètres demain, les verts ont terni. Je vois arriver avec circonspection ce temps où la neige recouvrira le rouge, le jaune et le praliné des ronces, des feuilles des tilleuls et des foyards, il me faudra alors à nouveau charger le poêle tôt le matin. J'ai beau chercher ailleurs, il n'y a rien, personne sur les places de jeu, les tracteurs ne pénètrent plus dans les champs détrempés, les arrosoirs traînent dans les coins des hangar, rien, pas même un poème de Verlaine. Rien, sauf la respiration silencieuse des enfants qui dorment, le rouge des sorbiers et le mouvement de la mer en avril au pied de Santa-Lucia.
Jean Prod’hom






N'aurai pas vu grand chose

N'aurai pas vu grand chose tout au long de la journée, l'alignement des élèves dans les classes excepté qu'il m'est toujours plus difficile d'accepter. Et pourtant dehors le ciel est bleu et la chaleur ardente. Les architectes, bien sûr, répondent à l'air du temps, mais qui donc leur demande de réaliser des bunkers pour culs-de-plomb ? Le lobby des vendeurs de matériel scolaire ? Il faut savoir en effet que les tables – qui semblent lestées de plomb – coûtent plus de 700 francs la pièce. Tout cela semble normal, c'est dans le budget, mais je m'étonne qu'on ne trouve pas un sou pour mettre une tablette ou une liseuse à la disposition de chaque élève, libre alors d'aller de son côté.
A ce propos, j'ai voulu commander aujourd'hui 27 exemplaires du Derborence de C.F. Ramuz. Payot Lausanne m'indique sur son site que l'ouvrage est indisponible dans les éditions Poche Grasset & Fasquelle (13 francs 90). Je vais voir ailleurs. Amazon n'en a que 6 exemplaires en stock (9 francs 20). Pas suffisant, il m'en faut 27 ! Une solution, se tourner vers l'édition numérique. Le Derborence de C.F. Ramuz est en effet disponible chez Grasset digital au format epub, à un prix qui varie de moins de 7 francs à plus de 10 francs.
Mais peut-on décemment demander aux parents des élèves de faire cet achat si leur bambin ne dispose pas d'une liseuse ou d'une tablette ?
J'ai commandé en désespoir de cause 27 exemplaires de Où es-tu de Marc Levy qu'Amazon a en stock. Il nous faut repenser au plus vite la page A4, le livre, la table, la chaise, la classe, les bâtiments scolaires, et bien sûr l'école. Mais quand et avec qui ?
Je n'aurai pas atteint des sommets aujourd'hui, je m'en rends compte ce soir en jetant ces notes. Petite journée donc rythmée par des ratés, d'avoir oublié au Riau le pique-nique que je m'étais préparé pour midi et dans une classe l'appareil de photos qui ne me quitte pas. Je mange donc orphelin sur la terrasse de la Châtaigne et me contente de mon iPhone.
Je ne tarde pas à 15 heures 30, fais quelques photocopies pour mercredi et rentre. Arthur et Sandra travaillent en bas en silence, je sors avec Oscar.
En direction du bois situé au nord du pré de la Moillette, un bois où autrefois les chanterelles d'automne pullulaient. Trop sec aujourd'hui. M'assieds dans l'herbe et lis la seconde partie de L'Ardent Royaume, m'étonne que Grasset qui met en vente cet opus au format epub ne s'offre pas un correcteur pour ajouter un espace entre des mots soudés pour des raisons que j'ignore. Ces accouplements contre nature se comptent pas dizaines et dérangent passablement la lecture.
Longe la lisière d'un champ de maïs, rien de dépasse, à l'image de ma journée.
Françoise est à la véranda, les cheveux flambant neuf, le sourire dans tous les sens, la retraite semble ne pas l'effrayer. Les filles rentrent d'Oron avec Suzanne, le maître a donné à Louise une masse de travail qui la réjouit. Lili est plus discrète sur sa leçon de piano. On mange dans une agitation propre au premier jour de la semaine, une agitation à laquelle le sommeil donnera la seule réponse sensée
Jean Prod’hom






C'est cher payé

Les principes sur lesquels reposent notre système scolaire engendrent aujourd'hui plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, des complications idiotes qui l'affaiblissent chaque jour davantage. On s'en défend en invoquant la nécessité interne, les obligations externes. la tradition. Or il ne s'agit que d'une impuissance conjuguée à un manque de courage, j'en suis.
Les forces déployées sans compter par les enseignants trouvent leur foyer dans une fidélité aveugle au principe d'égalité sous toutes ses formes et dans une obéissance forcenée en l'impératif de justice. Plutôt que de prendre la chose par l'autre bout, on plâtre et replâtre une affaire qui se lézarde, les mailles du grillage se multiplient, on diminue le diamètre des fils qui lâchent à la moindre pression sans qu'on ne rêve jamais plus à l'école buissonnière, mais au contraire à la circonscription de nouveaux quartiers surveillés d'une prison équipotente à l'espace lui-même, dans lesquels on aurait le choix de se soumettre tout entier ou n'être rien.
J'ai vécu ce matin la première conférence des maîtres de l'année scolaire. J'aime ce moment où sont annoncées les formules qu'on entendra désormais, ainsi l'expression temps de répondance qui remplacera bientôt le mot de délais. Il y a toujours aussi quelques acronymes tout frais qui dissimulent dans le sourire qu'ils provoquent la visée des nouvelles institutions qu'ils désignent, celle de parasiter et d'étouffer, comptabiliser et contrôler l'aide dispensée autrefois librement.
Une révolution est annoncée ce matin, les élèves n'auront plus l'obligation de chausser des pantoufles dans l'établissement. Il était temps. Mais il eût fallu aller plus loin encore et leur imposer le port des bottes pour qu'ils n'hésitent pas à brasser la boue dans laquelle traînent les pépites de la connaissance.
Remonte à midi au Riau promener Oscar, mais ne trouve pas la clé que Louise et Lili auraient dû laisser sur une poutre lorsque Michel est venu les chercher après notre départ. Je crochète donc la porte de la véranda, avec succès, fier d'ajouter à ma carte de visite le titre de monte-en-l'air. Oscar lui n'en mène pas large, il vomit au détour du refuge de Ropraz les champignons auxquels il a imprudemment goûté. Il avance au pas avant de se remettre à trotter sans trop s'éloigner. L'automne n'est pas loin non plus, des feuilles isolées jaunissent, celles des trembles, rouges même quelques feuilles de merisier, les plantins et les orties colonisent les bords de chemin. Mais les pluies de ces deux derniers jours ont donné de la vigueur aux prairies dans lesquelles les vaches font un festin sonore.
Redescends au Mont pour une demi-heure, une rencontre était prévue avec quelques collègues qui enseignent le français, on prend la décision de se voir bientôt, c'est déjà quelque chose. Fanny m'aide à contacter Dorigny, c'en est une autre, le film sur les Mentawai est à ma disposition à la BCU.
Il me faudra une grosse heure pour arriver à la Cure où je fais une halte comme je me l'étais promis, fais quelques photos. Le douanier à qui je m'adresse regarde passer les véhicules, il a l'oeil triste, vous savez, c'était un village qui possédait trois bars, plusieurs hôtels, tout ça n'est qu'un souvenir, nous étions à l'ouvrage, les grosses prises ici c'est terminé, à tel point que l'hôtel à côté du poste-frontière est devenu un centre de détention pour les demandeurs d'asile, des Tamouls partout, après plus rien.
Arthur est très content de sa semaine, des moniteurs et des camarades. Ils se sont échangé leurs adresses et comptent bien se revoir l'année prochaine. Ils sont allés grimper au Pont, à la Dôle, à Saint-Cergue, Arthur est monté en tête, a appris mille et une choses auxquelles je ne comprends pas grand chose.
On s'arrête à Dorigny au retour, j'embarque la cassette VHS contenant le documentaire sur les hommes-fleurs d'Indonésie, les Mentawai. Je ne pourrai en disposer que quatre jours, huit si je fais une prolongation. Quoi qu'il en soit, je vais devoir le ramener sur place, c'est cher payé. A quand une mise à disposition de ces documents sur le Web ?
Jeremy apporte en fin d'après-midi l'ancien piano électrique dont il se servait avec Repris de justesse, on le place dans la chambre de Lili.
La nuit est tombée. Sandra prépare ses cours de physique, Arthur regarde un James Bond, les filles se sont endormies.
Jean Prod’hom














Edification morale

Dans la section Problèmes de récapitulation du Recueil pour le calcul écrit à l'usage des élèves du degré intermédiaire des écoles primaires, édité en 1904 par le Département de l'Instruction publique et des Cultes du Canton de Vaud, on peut lire ceci.
26. Dépenses inutiles.
a) Un fumeur dépense chaque jour 30 c. en cigares. A combien se monte sa dépense pour 4 semaines ?
b) Un homme entre au café 3 fois par jour et dépense chaque fois 40 c. Que dépense-t-il ainsi en une semaine ?
c) Un ouvrier a bu un jour un petit verre de 10 c., 1 absinthe de 15 c., un demi-litre de vin a 110 c. le l. et une chope de 20 c. Quelle serait sa dépense en une semaine, en supposant que le dimanche il boive double ration ?
d) Combien de demi-litres de lait, à 20 c. le l., cet ouvrier pourrait-il donner à ses enfants avec l'argent dépensé ainsi en une semaine ?
Il est naturellement difficile d'évaluer le succès de ces formes de sensibilisation aux grands maux du siècle passé. Je ne suis pas loin de penser cependant qu'il faudrait revenir à ces formes quasi objectives de dissuasion, intégrées aux domaines relevant strictement du quantitatif, malgré la violence retorse de l'implicite et des sous-entendus, d'autant plus que l'augmentation du prix des cigarettes, des cigares ou du café, le passage à l'euro, l'arrivée massive de drogues variées, l'augmentation générale des prix permettraient de rendre toujours plus attractifs des calculs qui contribueraient mine de rien et pour presque rien à l'édification morale de chacun.
Jean Prod’hom
On n'est jamais là lorsqu'il le faut

Pour Gaël
On n'est jamais là lorsqu'il le faut et la mort ne nous avertit pas de toutes ses visites. Sache que ce jour-là nous avons tous perdu un père, et certains pour la seconde fois.
Le vent soufflait du nord-ouest, nous étions à Herculanum – enfouie autrefois sous une pluie de cendres et une nuit de boue – , le soleil se déversait en un torrent de feu qui se mêlait au tuf jaune et à la lave noire. Nous nous levions de temps en temps pour secouer cette masse qui nous eût engloutis et étouffés sous son poids. Tu pourrais te vanter qu’au milieu de ce désastre il ne t’échappa ni une plainte ni une parole qui annonçât de la faiblesse. Enfin cette noire vapeur se dissipa un peu, comme une fumée ou comme un nuage. Bientôt après nous revîmes le jour et même le soleil.
L'Espagne avait sorti le Portugal et allait sortir l'Italie qui nous accueillait en ses terres, il faisait un cagnard d'enfer, nous nous mîmes en route sur les flancs du Vésuve qui avait enlevé le 24 août 79 Pline l'Ancien à Pline le Jeune.
Ceux qui t'ont accompagné en Campanie, ceux qui sont restés au collège, nous tenons tous à te témoigner notre profonde sympathie, à toi et à ta famille. Nous sommes de tout cœur avec toi.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Faire voir du pays

Est-il bien judicieux de vouloir faire voir du pays aux adolescents, dont l'arrimage identitaire tient essentiellement au refus obstiné de l'altériré, à la mise à distance continue de l'étranger, au refus panique de l'inhabituel, incapables qu'ils sont d'imaginer d'autres arrangements avec le monde que ceux qui les tiennent forclos dans l'immédiateté de leurs désirs ?
Il y a un prix à payer pour devenir quelqu'un, c'est-à-dire un autre. Mais comment faire accepter ce prix à ceux qui refusent de s'éloigner de leur passé, en les y obligeant sans qu'ils crient à l'injustice et qu'ils nous fassent voir trop de pays ?
Jean Prod’hom
Ontologie

C'est une spécialiste de l'ontologie qui termine son gros ouvrage par un long post-scriptum dans lequel elle indique avec mille précautions qu'elle aurait pu dire la même chose tout à fait autrement, que ce n'était là qu'une des innombrables manières d'aborder la question de l'être. Elle voulait ainsi, je l'imagine, rassurer ceux de ses lecteurs – j'en suis – qui ne seraient parvenus à entendre ni son dit ni son dire, en les laissant supposer que le silence – ou l'un ou l'autre de ses avatars – aurait pu en faire tout autant. De tout cela elle aurait naturellement pu ne rien en dire.
Elle conclut son post-scriptum par une évocation saisissante, l'évocation d'une crainte, celle qu'elle éprouva soudain qu'on pût croire un instant qu'elle n'avait rien à dire.
Jean Prod’hom
Naples 1

Le Grecs sont à la recherche de terres nouvelles et étendent leur influence aux VIIIème et IXème siècles avant J.-C. sur le pourtour de la Méditerranée occidentale.
Des navigateurs venus vraisemblablement de Rhodes – établissent un comptoir sur l'îlot de Megaris. La colonie prend le nom de Parthénopé. C'est en effet sur cet îlot qu'aurait échoué Parthénopé, la sirène désespérée de n'avoir pu séduire Ulysse. Les Rhodiens lui dressent un tombeau. La colonie se développe ensuite, commercialement et militairement, le long de la côte.
PARTHENOPE
La République parthénopéenne est une république proclamée le 21 janvier 1799 à Naples par les troupes françaises commandées par le général Championnet qui se rend maître de la ville gouvernée jusque là par le roi Ferdinand IV qui prend la fuite sur un bateau britannique. Elle ne fera pas long feu, elle disparaît 6 mois plus tard.

Une autre colonie grecque s'établit à Cumes autour des années 750 avant J.-C., Cumes dont la Sibylle avait fourni à Enée le rameau d'or qui lui permit de descendre aux Enfers. Les ressortissants de cette colonie essaime et fonde la ville de Neapolis au VIème siècle, sur un plateau de roches volcaniques, l'ancien emplacement prendra le nom de Palaïopolis.
Les Romains conquéront plus tard les cités grecques de Campanie et, au IVème siècle, Neapolis et Palaïopolis ne feront plus qu'une seule ville. Mais Naples conservera son indépendance culturelle et continuera à parler grec.
Au IIIème siècle avant J.-C., Rome reconnaît par un traité, foedus neapolitanum, l'autonomie de la ville avec ses 30 000 habitants. Mieux, les Romains attirés par la culture grecque font de Naples et de la Campanie leurs lieux de villégiature : Auguste, Cicéron, César Néron,... Et bien sûr le général Lucullus, qui rapporte d'Iran les premiers cerisiers. Il s'établit dans une villa construite aux alentours de Megaris, occupe le Borgo marinario où se dresse le Château de l'Oeuf : il y installe de vastes viviers, un théâtre et une bibliothèque dans laquelle Virgile aurait rédigé l'Enéide.
CHÂTEAU DE L'OEUF
Jean-Noël Schifano raconte après d'autres qu'il existe un oeuf sacré dans l'une des caves du château. Il est plongé dans un récipient placé dans une cage suspendue à une poutre. Vie précaire. La légende veut que si l'oeuf venait à se briser, le château serait entraîné dans les flots et tout Naples à sa suite. Lorsque les avions américains bombardèrent Naples avant septembre 1943, on craignit le pire, les Allemands avaient placé leur DCA sur les toits du château de l'Oeuf.
Cet oeuf est appelé communément l'oeuf de Virgile. De l'oeuf à l'oeuvre il n'y a qu'un pas.




Traces de la Grèce et de Rome dans Naples
- Les trois artères orientées est-ouest : decumanus superior (vie Sapiens et Anticaglia), major (via Tribunali), inferior (Spaccanapoli - vie Forcella et dei Librai ).
- Place San Gaetano, sur le parvis de San Paolo, les restes du temple des Dioscures (Castor et Pollux, fils de Zeus et Léda, frères d'Hélène et de Clytemnestre).
- La silhouette du théâtre romain, entre la via Anticaglia, via San Paolo ai Tribunali e vico Giganti.
Jean Prod’hom
Personne ne les verra pas même ceux qui les ont vus

Les couloirs du collège sont déserts, la bibliothèque aussi, toutes les portes fermées à double tour jusqu'à lundi. Mais ces adolescents-là ne montent pas tous au chalet le week-end, à Villars ou aux Diablerets, il est 17 heures, la bise redouble.
Les politiques locaux n'ont jamais estimé qu'un centre de loisirs fût nécessaire, le tea-room dépasse leurs moyens et le silence dedans l'église les effraie. Je les aperçois alors qui entrent et sortent des toilettes publiques qui jouxtent la salle paroissiale. Ils tardent à rentrer chez eux, mais une maison en ont-ils seulement une ? et quelqu'un les attend-il ? J'y pénètre pour assurer ma conscience que ne s'y déroule pas un drame. Pourquoi pas, ne sommes-nous pas dedans cette fois ? Ils sont trois, je les reconnais, il y a une jeune poète, un enfant placé dans une institution et un pierrot lunaire qui revient d'un pays d'où l'on arrive jamais, tous les trois embonnettés, perdus dans des odeurs de tabac, avec cet air que prennent les repentis et les enfants de choeur dans les lieux exigus. Ils me reconnaissent, le pierrot lunaire tire la fermeture éclair de son petit sac à dos qui se referme sur un énigmatique trésor. Je ne demande rien, eux non plus, ils n'attendent qu'une seule chose, que je me tire, je suis de l'autre côté.
Avant de leur tourner le dos, pourtant, je les encourage, – ne peux pas m'en empêcher –, les encourage à sortir, dire tout haut ce qu'ils ont à dire, je bégaie, me rétracte, me tais, ce ne sont pas des velléitaires, ils ne veulent qu'un peu d'espace pour fourbir les inoffensives armes qui les protégeront des ennemis invisibles qui les assaillent, des mots qui les ont blessés et le doute qui les ronge, ils se réjouissent aujourd'hui, simplement, de ne pas être seuls, ils imaginent qu'ils respirent l'air frais d'une poche qui aurait été oubliée, parlent sans écouter, un peu seulement et chacun son tour, ils ont la révolte disciplinée.
Ce sont eux qui font vivre les dessous des banlieues riches, sans rien demander, pas de place au-dessus, ni grange abandonnée ni réduit de tôles, pas de bouzigues entre les haies et les maisons mitoyennes, on a brûlé les baraque des bûcherons depuis qu'elles ne servent plus, les bois ont fui l'avancée des zones constructibles. Restent les chiottes.
Les damnés fument tout bas, appuyés contre des catelles de faïence bleue, bleu ciel, joints étanches, chauffage au sol, il fait bon dans les chiottes de la commune qu'ils squattent sans pancarte en bordure des trompeuses richesses et à l'abri des assauts de la bise, persuadés que personne ne les verra, pas même ceux qui les ont vus.
Jean Prod’hom
Ça tient comme une fleur

C'est un pays sombre et triste ; la route d'E. vous guide par des courbes douces au regard dans une auberge ravernie. O le vin aigre, les cigares étouffants ! Mais il y a un beau ciel clair et gris sur les collines. L'église aiguë de Cossonay crève le moutonnement des verdures bleuâtres. Tout près de moi bouillonne une source de lait dans le canal. Perrette Perrette, je suis heureux et triste à la fois. Ma fuite n'est pas que folie, et Dieu, malgré l'affreux spectacle de ce coeur empoisonné me rendra peut-être la voix que j'ai perdue.
S'il regarde ainsi dehors, ce n'est pas tant qu'il rêve avec dans son dos les tâches qui l'étranglent et ceux qui s'affairent chevillés à leur quant à soi, c'est qu'il fait son école buissonnière, vole debout par-dessus la butte et les branches couleur de cendre des feuillus nus du préau. Il a l'esprit loin à l'horizontale, au-dessus des moilles et de l'étang du Sepey, au pied de l'horizon, à L'Isle et Montricher. Ce serait peut-être bien que ceux d'en face en fassent autant, un jour les hommes laisseront tout ça en plan.
Non non, il ne rêve pas, ne conçoit aucun lieu secret, ne creuse aucune tanière, ne ramènera aucun galet, ni la baguette du sourcier. Son esprit vagabonde dans le vent, l'infatigable vent, ajuste de mémoire les parties du paysage qu'il a parcourues, les habitants qu'il y a croisés et les fontaines qui chantent sur la place des villages déserts, maisons agglutinées, vides, fenêtre fermées, portes murées, dépenses condamnées, plus d'épicier, mais des vieux, les derniers vieux.
Il colle tout ça ensemble avec le ciel désintéressé en-dessus qui écarte les murs qui le soutiennent, ça tient comme une fleur. Tout est à sa place, en-deça de l'obligatoire et du facultatif, les choses sont là, pour tout le monde, avec l'évidence qui sied à ce qui est.
Il ramasse en un seul geste les prés et les bois, les lisières, les chemins, les faufile et les pend par d'invisibles fils aux bords du ciel. De là-haut, il en voit plus qu'il ne l'imaginait, mais il s'agit de tout prendre. On perçoit alors quelque chose comme une poussée qui dure intacte, un appel malgré le détournement que chacun fait de soi-même. Et le zénith s'installe au coeur de chaque chose, et rampe, il n'y a personne devant la grande fenêtre, ne le cherchez pas au pied du Jura terme du contrat. Pour traverser le creux que rien ne remplit, il lui avait fallu autrefois un permis de voyageur de commerce, hier un traité de marche en plaine. Besoin de rien aujourd'hui, plus rien à faire ici.
Jean Prod’hom
Le fil ténu qui me fait tenir debout

Pour Floriane
Méditation de Thaïs | New Philharmonia Orchestra / Lorin Maazel violon & direction
Tous les enseignants en convenaient, elle était douée de telles qualités qu'aucun obstacle ne lui résistait quels que soient les domaines, si bien que nous redoutions que nos besaces manquent un jour de ce qui la rassasiait. Vaine inquiétude, elle se montra toujours à même, en puisant je ne sais où, de distinguer un frémissement dans les coins délaissés et les matières les plus inertes. Elle rendait notre métier facile et agréable, on en aurait aimé une demi-douzaine comme elle dans nos classes, brillantes et vivantes.
Nos craintes ne se dissipaient pas complètement cependant – c'est ainsi dans nos métiers – et revenaient par une porte dérobée. Ignorant le chemin que la jeune fille empruntait pour faire tenir ensemble ce qu'elle embrassait, je me mis à craindre sottement qu'elle ajoutât un jour à son menu, sans en connaître les conséquences, l'ultime tâche qui lui eût fait baisser les bras, placer sur le bûcher et brûler ce qu'elle avant engrangé.
Un jour je la vis triste, elle m'apprit qu'une blessure l'empêchait pour quelque temps de se livrer à une passion dont elle ne parlait pas, j'en fus réconforté. Je me mis à soupçonner que la musique avait quelque chose à faire avec la grande santé qui l'animait et mes craintes qu'elle en portât trop s'éloignèrent.
C'est de ce jour que date au fond, je crois, ma certitude que tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici avec un réel plaisir ne l'auraient pas comblée si le vide creusé sur les bancs d'école n'avait pas accueilli dans le même temps, là-bas, la musique dont elle charriait l'instrument dans une boîte noire, son violon. Les derniers mois passèrent, elle me sembla s'éloigner toujours plus des lieux qu'on partageait.
Arriva enfin le jour des promotions, à l'occasion duquel il est convenu qu'on se dise au revoir, elle monta sur scène. J'entendis alors un peu de ce qui l'animait et qui lui donnait la force de changer en or ce qu'elle touchait. J'entendis distinctement ce que je n'avais pas imaginé tout au long des années. Elle n'était plus assise tête penchée sur ses devoirs, mais debout devant un lutrin, la tête dans les étoiles. Elle n'était plus l'élève de tête écoutant parmi les autres la parole du maître, mais seule, ou presque seule, faisait entendre par l'une des petites fenêtres de la cellule de sa passion la voix de son violon. Elle me livra le fil ondoyant d'une méditation, fragile et courtoise, et j'acquiesçai à ce qu'elle ne disait pas, écoutez-moi maintenant, écoutez le fil ténu qui me fait tenir debout et qui allège la charge de ce que je sais, écoutez le souffle de ma passion, je m'éloigne, libre enfin.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Il paraît qu’il faut rentrer

Il paraît qu’il faut rentrer, mais rentrer où ? Restés dedans auprès des nôtres le temps des vacances, il est plutôt temps, grand temps de sortir, sortir au grand air de l’autre temps, celui qui dure, où se déroule ce à quoi on ne songeait pas et avec lequel on va avec soi hors de soi
De l’air, de l’air, de la légèreté. Mais comment sortir où que ce soit avec sur le dos de tels fardeaux ? Combien de livres inutiles, lourds à crever et qui durent, des livres pour sauver l’apparence ou fédérer nos appartenances, des livres-musées sur lesquels on émousse ses dents, des livres-signes. Personne n’y est jamais entré, rien n’en est sorti. Où êtes-vous puissants récits écrits sur les ailes du papillon ?

Jean Prod’hom
Quitter le giron

Pour Marine H
Il était midi sous un soleil de plomb. On grimpait à flanc de coteau au sommet du Kahlenberg, pas loin du Leopoldsberg d’où Charles V de Lorraine, le roi de Pologne – Jean Sobieski – et leurs 20 000 cavaliers étaient descendus au galop pour mettre fin, en 1683, à la seconde occupation de Vienne par les Turcs. Ce n’est pas sans mal que nous avions quitté le centre ville où nous logions pour la semaine. Il avait fallu s’orienter dans la complexité du centre historique sur lequel la rose des vents ne règne plus, choisir celui des nombreux bus qui passaient au pied de notre hôtel, enfiler le Ring dans le bon sens, ne pas se tromper dans les correspondances successives, monter dans le tram dans le sens qui convenait, pour atteindre enfin le pied du Kahlenberg.
Les difficultés qu’on éprouva pour nous arracher du centre de la ville impériale sans nous égarer fut d’un autre type que celles qu’on endura pour parvenir au sommet de la mémorable colline. Je songeai, chemin faisant, à l’aisance avec laquelle Charles de Lorraine et Jean Sobieski avaient fondu sur leurs ennemis, empruntant les premières sentes à peine visibles, tout en haut, qui conduisaient à des chemins plus bas un peu plus larges, à double ornière bientôt, route puis boulevard menant au camp des Ottomans.
Tous les chemins en effet mènent à Rome. Mais comment quitter Rome ? Et où aller ? S’il y a identité formelle entre les trajets qui quittent le centre ville et ceux qui y ramènent, il n’en va pas de même pour nous les vivants. Si les centres villes attirent ceux qui orbitent à leur périphérie, il est bien difficile de s’en éloigner et de vivre loin de leurs séductions.
Je pris un certain retard et me retrouvai en queue de peloton, rejoint bientôt par une demi-douzaine de filles qui ralentissaient le pas et accéléraient leurs rires pour réduire leur peine. J’y allai de ma contribution.
- Est-il plus aisé de rejoindre le centre-ville depuis un point quelconque de sa périphérie, ou de le quitter pour atteindre un point défini de ses faubourgs ?
Elles sourirent, était-ce pour me faire plaisir ? Le silence s’installa et on marcha quelques minutes. L’une d’elles s’immobilisa enfin et, les mains sur les hanches, répondit.
- Il est évidemment bien plus facile de réjoindre le centre que de le quitter.
Ses camarades partagèrent unanimement son avis. Je leur demandai pourquoi. L’une d’elle me répondit par une formule oubliée mais cousine de l’idée selon laquelle il est plus simple d’aller du simple au complexe, du rare au dense que l’inverse. Je n’osai pas le mot d’anisotropique, mais il me semblait en effet que les propriétés du réseau des chemins dessinés par le pied des piétons changeaient selon la direction du flux.
On se réjouit de cette étrange trouvaille et des corolaires qui fleurissaient. Je leur demandai alors ce qu’une telle réflexion éclairait de leur vie aujourd’hui, elles avaient 15 ans et tout l’avenir devant. L’une d’elles me répondit.
- C’est plus facile de rentrer à la maison que de quitter sa famille.
Je méditai jusqu’au sommet du Kahlenberg, devenu soudain tout proche.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Tout recommencer

Après des ans
des ans comme des jours
l’examen d’admission reprend
Le Gouverneur après ce temps
nouvelle cérémonie est élu commis,
valet ensuite
à présent reçu balayeur
Ainsi de rang en rang abaissé
un jour sera retrouvé aux étables, à la porcherie
Descendra-t-il plus bas ?
On l’y portera...

Second d’une liste de passage qui comprend également ceux à qui j’ai remis il y a un mois à peine une attestation de fin de scolarité obligatoire, j’attends agité. Nous sommes quelques-uns à battre le pavé de la cour qui longe le bâtiment d’en-haut, long et vitré, au pied de la classe du rez-de-chaussée que nous avons occupée trois ans durant, moi comme enseignant et eux comme élèves, vide encore à cette heure, et fermée à clé. Aucune indication sur la porte, personne à l’horizon, ni l’expert ni Monsieur D. – prof de latin au gymnase – qui doivent évaluer notre travail.
Agité, agité plus que les autres, je n’ai en effet pas relu les livres sur lesquels portera l’épreuve, par insouciance ou inconscience, m’en souviens peu ou pas et m’inquiète Et puis ces livres, je ne les ai pas emportés, ignorant où ils se trouvent, disséminés dans la classe ou à la maison. Panique. Je demande à A. de me prêter les siens lorsqu’il aura passé l’épreuve. Cet élève brillant sur lequel j’ai pu autrefois compter fronce les sourcils, froissé, gêné, mais il ne peut rien pour moi, il doit rentrer à la maison sitôt l’examen terminé et remettre ses livres à sa mère. Je désespère de trouver une bonne âme. Planté au milieu de la cour, je mets au point une stratégie pour franchir l’obstacle : choisir une page au hasard et entreprendre consciencieusement le commentaire suivi de ce qui y est écrit, objectivement, l’honneur sera sauf. Une phrase de Michaux citée par Maulpoix me revient à l’esprit : Je ne comprends rien de ce que disent les gens, les auteurs. Il faut que je refasse tout dans la tête. C’est pénible mais c’est peut-être cela l’invention et l’originalité.
Lorsque je relève la tête, plus personne dans le préau, mais des élèves inconnus qui rient aux éclats derrière les fenêtres du rez. Aurais-je dormi tout ce temps ? L’examen se passe ailleurs, Monsieur D. nous avait prévenus, mais j’ai écouté de travers, je n’en souviens maintenant, l’examen a lieu à l’Ancienne Académie, dans le bureau de Monsieur C. dont j’ai suivi les cours de philosophie. Sera-t-il là lui aussi ? Il me faut m’y rendre au plus vite. Je parque mon karting au bas du Valentin, une petite place suffit, la maniabilité de l’engin est extraordinaire, je m’en réjouis, c’est tout ça de gagné. Mais le temps a passé, c’est évidemment trop tard, tant pis, je laisse tout tomber. Il vaut mieux renoncer que de faire piètre figure. Alors tout s’éclaire et s’allège, les nuages s’éloignent, je sors vivant de ce cul-de sac.
Pourtant il me faut du temps pour sortir de cette vilaine nuit et m’assurer que ces examens qui n’auront jamais lieu sont derrière moi. Quelque chose de pénible, d’incompréhensible, de lourd, d’incontournable me poursuit. Et si je constate que ce rêve s’est bel et bien éloigné, il n’en va pas de même de la peur panique qui me suit au-delà du réveil et me pousse dans le voisinage des deux passes qui bornent nos vies, celle que nous noyons dans les cris et les larmes, celle qui nous attend à l’autre bout et dont nous sortirons, je l’espère, moins que rien et silencieux.
Jean Prod’hom
Initiation à l'art du porte-à-faux

Pour Anouck
L’une des missions essentielles de l’école est d’initier ceux dont elle a la charge à l’art du porte-à-faux, en les obligeant à répondre simultanément et continûment à deux exigences que tout oppose : prendre la mesure des connaissances fixées par la société des savants dans les domaines bien circonscrits d’une encyclopédie partagée mais toujours déjà désuète et éveiller leurs conciences en y instillant un doute radical dont l’application résolue les conduira au seuil d’un territoire sans cadastre, aux propriétés inconnues, d’où ils auront, jeunes encore, à dessiner de nouveaux horizons et à la table duquel ils auront à écrire les récits et les mythologies de demain.
Aider les géniteurs à faire de larves aphasiques, en moins de dix ans, des adultes polyglottes, telle est sa tâche. En leur donnant assez de confiance pour que, assistés de leurs petits courages et de savoirs-faire confinant souvent au déraisonnable, ils soient en mesure de s’écarter des normes de la cohorte, abandonner le paradigme dont plus rien ne sort, s’avancer en des lieux que ne rend familiers aucun jeu de questions et de réponses. Pour que ces femmes et ces hommes nouveaux soient prêts à retrousser les impasses, à penser l’inconcevable en nouant ses mailles et donner une chance au réel et à ce qu’on n’imaginait même pas.
Vaste programme pour un impossible métier, d’autres l’ont dit. L’école n’a en effet jamais été à même de répondre à cette double tâche, pas plus que l’histoire n’a su éradiquer le mal ou assurer le progrès promis. Idée régulatrice cependant qui anime l’enseignant qui enseigne. Personne n’a donc rencontré les demi-dieux de cette mythologie. Parfois pourtant la chance est là et le pédagogue en rencontre une incarnation, assez solide pour accepter les dures exigences qui nous viennent de l’ancien et suffisamment fragile et légère pour s’élever dans le ciel et tenir sous ses ailes le nouveau paysage.
J’en ai rencontré une. Elle éclairait tout ce qu’elle touchait, s’affairait avec un soin qui nous ramenait aux grands travaux des temps anciens : respect des règles, des traditions, respect des personnes, des textes, respect du temps, des lieux,... non pas que cet asservissement assouvît ses désirs, mais parce qu’il constituait comme une ascèce préparatoire, une propédeutique à la grande aventure de la pensée dans laquelle elle s’engageait naturellement, avec la discrétion de ceux qui volent haut et qui voient grand angle. On la voyait là préparer l’avenir, s’assurer de la nature de chacune de ses parties, de leurs relations, quêter d’autres ordres, reprendre s’il le fallait ces travaux de l’esprit qui vont à la vitesse de l’éclair, un éclair qu’on apercevait briller dans ses yeux rieurs. Ne s’agissant pas de puzzle, il n’y avait ni pièce manquante ni clé de voûte, mais elle savait que ce qui vaut la peine d’être fait est ce qui ne l’a pas été. Elle allait vent arrière dans le silence, en équilibre sur deux pieds de sa chaise ou la tête plongée dans son ombre, toute à elle-même au service de quelque image qu’on peine à dire. Alors on devinait que la grâce devenait une propriété de la pensée et, sur le visage de cette jeune fille fragile et déterminée, le porte-à-faux donnait lieu à une danse réglée et aventureuse.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Virevoltant au-dessus des ornières

Pour Lea
On pourrait ne pas prendre acte de leur existence, car elles délaissent au cours de leurs premières années le centre, où qu’elles soient, à ceux et à celles qui ne peuvent pas vivre loin des projecteurs. Et tandis que, un peu maladroites, elles butent contre les plinthes en caressant de l’épaule les murs blancs, elles regardent intriguées et naïves les ambitieux monter à l’assaut de la citadelle. Sans bien comprendre.
Elles n’en veulent pas à la bande de sauvages qui s’approprient le langage et le monde qui va avec, elles leur lancent même parfois un sourire qui les apaisent un instant. Qu’on les laisse tranquilles. Pourtant ne croyez pas qu’elles sommeillent, elles butinent sans effrayer personne, discrètement. Tout est si fragile, alors n’en rajoutons pas. Et tandis qu’elles vont sur la pointe des pieds, leur esprit vif pince le tout-venant qu’elles remontent à tire-d’aile, de quoi faire un nid dans lequel elles accueilleront plus tard ceux qui viendront. Elles vont assurées, assurées de ce qu’elles peuvent mais incertaines de ceux qui les entourent, reines, reines, reines sans couronne.
Et soudain, sans avertir, voici qu’elles se mettent à parler, à dire ce qu’il était temps de dire. Ce sont ces voix que tout le monde attendait, présentes lorsqu’on en a besoin, lorsque le mauvais temps s’installe, voix longtemps tues, hésitantes autrefois fermes aujourd’hui, pleines de cette sagesse qui ralentit le carrousel de nos existences, voix apaisées vers lesquelles les visages marqués par le désarroi se tournent, patientes, inébranlables.
C’est dès le début, lorsque je l’ai vue il y a longtemps déjà, se confondant avec l’air qu’elle touchait à peine que je compris qu’elle était de cette race-là. Tout dans son être était retenue, de son poignet fin qui virevoltait comme une hirondelle près de son épaule, à ses paupières qu’elle fermait lentement pour ne pas froisser l’air qui l’entourait. Elle était comme ces feuilles solitaires que le vent porte et qui tombent sans bruit sur le miroir de l’étang.
Je la soupçonnais parfois de ne pas être parmi nous, feignant de nous écouter pour ne pas blesser notre amour-propre, bercée par le vent du large, attachant bout à bout des bouts de pensée lointaine qui plus tard constitueraient non pas un conte de fées mais ce foyer qui ménage une place à ceux qui auront à reprendre ce qu’on leur a laissé.
Elle n’était jamais là où l’on croit, c’est-à-dire là où elle était, ne s’offusquait pas du tour que prenaient les événements si bien que, quand bien même elle ne le voulût pas, elle rendait idiots ceux qui croyaient qu’elle pût être ailleurs ou qu’il pût en être autrement.
Elle fut certainement dans une des vies qui précéda la sienne un de ces papillons blancs qui accompagnent l’été le promeneur sur les chemins forestiers, insaisissable, le précédant sans le laisser s’approcher, fragile et obstiné, virevoltant à midi au-dessus des ornières, à deux pas du promeneur qui sourit.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
La gymnastique intellectuelle entame leur sérénité

Pour Lucas
La gymnastique intellectuelle entame leur sérénité, les exercices les dégoûtent, les méthodes lorsqu'elles ont livré leur secret les rebutent. Un profond ennui les paralyse aussitôt qu’ils comprennent que l’institution scolaire, et ils le comprennent finalement assez vite, leur demande avant tout d'être en mesure de répéter aveuglément ce qu’on leur a fait découvrir, extraire des connaissances qui n'ont plus cours, mémoriser ce qu'ils auraient pu mémoriser ailleurs et plus rapidement, entonner des hymnes à la gloire de ce qui va de soi.
Je veux dire ici de leur esprit ce que Claude Levi-Strauss dit du sien : ... mon esprit présente cette particularité, qui est sans doute une infirmité, qu’il m’est difficile de le fixer deux fois sur le même objet. Au diable les procès verbaux, les rapports, les listes, les repérages, les corrections, les transcriptions, à d'autres ces activités qui nous empêchent d'aller plus loin, de vivre, de défricher de nouvelles terres et de construire des ponts. Ils sont de la race des conquistadores.
Lévi-Strauss écrit plus loin : Les aptitudes me manquent pour garder sagement en culture un domaine dont, année après année, je recueillerais les moissons : j’ai l’intelligence néolithique. Pareille aux feux de brousse indigènes, elle embrase des sols parfois inexplorés; elle les féconde peut-être pour en tirer hâtivement quelques récoltes, et laisse derrière elle un territoire dévasté. Je n'ose imaginer la détresse de l’ethnologue lors de la rédaction des Structures élémentaires de la parenté ou des Mythologiques. Je n'ose imaginer parfois la leur.
Celui auquel je pense aujourd’hui était de la même tribu, frère d'un autre, ils avaient tous deux l'intelligence néolithique, n'aimaient ni lire ni écrire. Ce n’est pas que le langage ne les séduisait pas, au contraire ils y étaient sensibles comme des musiciens. Qu’il soit correct ou incorrect, ils s’en battaient l’oeil, comme Cendrars, pourvu que ça soit bien vivant. Ils aimaient rêvasser autour d’une chose ou d’une idée. Mais l’ennui, l’ennui, l’ennui quand on écrit, l’ennui – Cendrars revient souvent là-dessus, tellement ça le dégoûte, tellement c’est contraire à sa nature et à son tempérament – ... Imaginer une histoire, des personnages, un sujet, les faire évoluer et les mêler à une aventure d’accord, tout ça c’est amusant. Mais le jour où on doit mettre en forme tout cela sur du papier, comprenez-vous, c’est un métier tellement ingrat, et réellement, réellement, Cendrars le disait en toute sincérité, j'ai peu eu de satisfaction devant une page, c’est exceptionnel. Me dire ça mon petit Blaise, c’est pas mal torché et c’est même très bien, ce satisfecit-là, on se l’accorde bien, bien rarement, parce qu’on pense surtout, quand on écrit quelque chose, à tout ce qu’on n’a pas mis dedans, ce qu’on avait envie d’y mettre, mais c’est tellement difficile de cerner les choses avec l’écriture et avec des mots qu’on reste déçu.
Cendrars et les deux frères avaient besoin de faire autre chose, d’abord parce qu’écrire c’est une grosse fatigue, et puis écrire ce n’est pas réellement vivre, ce n’est pas la vie de l’esprit, la vie de l’esprit c’est la contemplation. Ils n’aimaient pas écrire et se justifiaient par le fait qu’ils n'étaient pas les seuls. Ils ont raison, j'en suis. Jamais Cendrars n'a été un monsieur qui écrivait tant d’heures par jour dans un cabinet, c’est lui qui le dit, au bout d’un certain moment il en avait marre et il ne souhaitait qu’une seule chose, s’arrêter et foutre le camp. Eux c'était la même chose, l’école n'était pas à leur dimension. S’ils aimaient les calembours et les jeux de mots, ils ne se trompaient pas sur leur fonction et ne les confondaient pas avec la réflexion.
Ils n'ont jamais perdu de vue la vérité immédiate, c'est dire qu' ils excellaient dans les activités orales qui laissent une place à l’improvisation et à l’intrusion immédiate du monde dans lequel on est, l’écrit les désolait. Ils se tournèrent alors vers la musique et les arts graphiques, croyant jouir là de la liberté qui leur manquait. Plus tard ils se remirent à écrire, sans qu'ils s'en rendent tout à fait compte, avec leur sang, des paysages et des fugues, des rhapsodies et des cathédrales. Ces aventuriers avaient-ils le choix ?
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
L'enfant qui a la tête en l'air

Pour Nathan
L'enfant qui a la tête en l'air
Si on se détourne, il s'envole.
Il faudrait une main de fer
pour le retenir à l'école.
L'enfant qui a la tête en l'air
ne le quittez jamais des yeux:
car dès qu'il n'a plus rien à faire
il caracole dans les cieux.
Il donne beaucoup de soucis
à ses parents et à ses maîtres:
on le croit là, il est ici,
n'apparaît que pour disparaître.
Comme on a des presse-papiers
il nous faudrait un presse-enfant
pour retenir par les deux pieds
l'enfant si léger que volant.
Ce poème de Claude Roy que l’institutrice a demandé à Louise d’apprendre pour jeudi m’a conduit ce soir à faire défiler quelques-unes des têtes en l’air que j’ai croisées depuis le temps sans être en mesure de les accueillir comme il le fallait. Mais le peut-on lorsqu’on sait qu’elles ne songent qu’à caracoler dans les cieux ? C’est lorsqu’elles s’envolent pour de bon qu’on se prend à les regretter, regretter notre main de fer qui n’a saisi que du vide.
Ils sont légions les enfants des talus, ils hantent les livres que l’école fait lire aux enfants sages. Qu’on songe à Bosco, à Dhôtel, à Rimbaud et à tous les autres. L’école buissonnière a nourri l’école obligatoire depuis Jules Ferry. Sauf que parfois ils s’en vont pour de bon.
Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d’une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n’ai qu’à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs.
De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle-Etoile. Dès le début de la classe, je me suis aperçu que Meaulnes n’était pas rentré après la récréation de midi. Son voisin de table a bien dû s’en apercevoir aussi. Mais, dès qu’il aura levé la tête, la nouvelle courra par toute la classe, et quelqu’un, comme c’est l’usage, ne manquera pas de crier à haute voix les premiers mots de la phrase :
« Monsieur ! Meaulnes... »
Je sais que Meaulnes est parti. Plus exactement, je le soupçonne de s’être échappé.
Il était un peu de cette trempe, rien ne retient l’enfant qui a la tête en l’air, aucun récit, aucune promesse. On le croyait ici, il était déjà bien loin. Caché derrière la frange buissonnante de ses cheveux, il clignait des yeux pour que jaillissent des gerbes d’étoiles, un pied sur le devant, dressé comme un conducteur de char romain, secouant à deux mains les guides, il lance sa bête à fond de train et disparaît en un instant.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Le couloir était éclairé par des sourires

Pour Jill
Tu es allé de la cuisine au salon, le couloir était éclairé par des sourires, de la salle de bains à la chambre du fond pour ton compte. Tu as entrepris sur ton édredon des voyages autour de ta chambre, élevé des châteaux de sable qui se sont effondrés sous ton regard ravi, tu as fait des parties de cartes avec des amis nés de ton imagination, joué avec des ombres. Et sans l’avoir décidé tu as appris à marcher, à construire, explorer, raconter et jouer. Tu as même fini hors toute obligation par distinguer la lumière de l’ombre sans lesquelles tu n’aurais rien su de tout cela.
On t’a fait croire ensuite, dès ton entrée à l’école, à toi et à tes camarades que la connaissance c’était autre chose, qu’elle s’obtenait méthodiquement, par alignements et entassements. On vous a demandé instamment de mémoriser des lettres et des mots, des opérations et des dates, des syntagmes de glace et des coques vides, de suivre les lignes, répéter les refrains, faire vite les comptes qui assureront votre promotion. L’institution scolaire et la société civile se sont aperçus à la fin de l’efficacité discutable de l’entreprise, nos élèves ne savent pas lire, vos enfants ne savent pas compter, c’est la faute aux parents, aux enseignants, à la société, aux élèves. Nous allons changer de manuels, nous allons user d’autres méthodes pour trois petits tours et puis s’en vont. C’est ainsi, pas même le mont de Piété, c’est du pareil au même, je n’y puis rien.
Que faire aujourd’hui sinon, chaque fois que l’occasion nous en est donnée, montrer que les connaissances ne sortent pas d’un chapeau, ne tiennent pas alignées sur un bâton. Pas de truc, ou des trucs issus de patientes mise en scène.
C’est en octobre 2012 que notre Etablissement scolaire disposera de bâtiments scolaires tout neufs. Ils accueilleront les enfants des nouveaux arrivants. Pourtant, si on regarde par la fenêtre, il n’y a rien, un gros trou seulement, des ouvriers qui vont et viennent, des machines qui ne fonctionnent pas et des camionnettes vides, un chantier qui semble s’éterniser et ne déboucher sur rien. Qu’on ne s’y méprenne pas, les travaux ont commencé il y a plusieurs années déjà...
Je ne suis pas un spécialiste mais je sais en effet qu’il a fallu discuter de la nécessité de construire de tels bâtiments, coûteux, il a fallu prendre en compte l’évolution démographique de notre région, déterminer l’emplacement de ces nouvelles constructions, garantir leur accord avec les règlements cantonaux, leur compatibilité avec l’environnement immédiat, s’assurer de la facilité des accès. Déterminer leur forme et les éléments qui les constitueront, présenter les choses de telle façon qu’elles ne déclenchent pas un cortège d’oppositions, convaincre les payeurs. Il a fallu appeler une entreprise pour liquider l’ancien et démolir la villa de Mottier, verser une larme, abattre des arbres, assurer la sécurité, amener la petite grue pour dresser la grande, creuser enfin, renforcer, protéger, isoler... pour que la construction de la nouvelle école puisse enfin débuter.
Les choses sérieuses ont commencé bien avant avant qu’elles ne commencent, c’était il y a des années déjà. Reste aujourd’hui un trou, tout est joué, ce ne sera qu’un jeu d’enfants d’aligner et d’entasser bientôt les briques. Notre nouvelle école a été terminée bien avant que les travaux ne commencent.
Il est temps de comprendre que la construction des connaissances ressemble sous cet angle étrangement à la construction d’un bâtiment. Pour qu’une connaissance tienne debout, je dois en comprendre la nécessité, en accepter les désagréments momentanés, en anticiper les gains. Je dois vaincre les oppositions tant internes qu’externes, défaire les connaissances qui occupaient les lieux, garder ce qu’on est bien incapable de modifier, préparer les outils indispensables dont on aura besoin, établir l’ancrage des notions principales, anticiper les liens qui feront de ces connaissances des éléments dans un réseau plus vaste, ménager des ponts, des liens. Et enfin, ne pas fermer la possibilité de s’en défaire, car les connaissances, comme les châteaux de sable se font renverser un jour par les vagues.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dans un monde que ni eux ni nous n’imaginions

Pour Rick
On ne le dit pas assez, mais une des tâches de l'école – la principale peut-être et un peu à son insu – vise à décoller l’enfant du giron ménagé par ceux qui l'ont accompagné jusque-là, au sein d'un milieu doux et étroit, mère et père. dans leurs bras d’abord, attaché à leurs basques ensuite sous la bienveillante protection des lares familiaux, et de le conduire – sans qu’il s’attache trop aux passeurs que l’institution a mis sur son chemin (parce que tout serait à recommencer) – à la rencontre de nouveaux horizons, au-delà desquels s'étendent des plaines sans fin et d'autres mers, vivent des dieux inconnus, où se succèdent les guerres et frémit cette liberté à l’acceptation de laquelle le nid douillet dans lequel il a passé les premières années de sa vie ne le prépare pas.
En ce sens les récits lus à l’école jouent un rôle majeur. On y est invité à tourner les premières pages de livres dont on se serait dessaisi peut-être sur le champ, maintenus ouverts par obligation parfois, mais qui ont eu l’inestimable vertu de nous égarer loin des pénates.
Je me souviens bien de cette année-là, nous avions lu Thomas Platter (Ma vie), Jules Verne (Le Tour du monde en quatre-vingts jours), Blaise Cendrars (L’Or), Alain-Fournier (Le Grand Meaulnes), Georges Simenon (Maigret s’amuse), Charles-Ferdinand Ramuz (Si le soleil ne revenait pas) et Philippe Claudel (Les Âmes grises). Et lui, qui ne demandait rien hors les jeux et le plein air qui le comblaient, se mit à lire avec curiosité la merveilleuse histoire du général Johann August Suter. Il s’intéressa sans prévenir au contexte géo-historique de la découverte de l’or en 1848, à la figure conquérante de Suter débarquant sur la côte californienne, au petit air de jazz qui accompagne la lecture des textes de Cendrars. Un hasard? Je me suis souvenu alors que le garçon avait, par sa mère, la moitié de sa parentèle du côté de Bâle et qu’il parlait la langue rugueuse de Johann August Suter de Rünenberg. Tout vient de là.
Je me souviens d’un autre moment encore. Le garçon connaissait Saint-Martin, il s'y était rendu enfant avec ses parents, un séjour dont pourtant il ne lui restait rien sinon l’idée d’une forte pente, il y était retourné à deux reprises il y a peu avec un ami. On lisait donc Si le Soleil ne revenait pas, et le garçon, un peu remué, s’interrogea sur le fait pour lui impensable que le Saint-Martin où se déroule le récit de Ramuz n’épousait pas exactement le village cadastré du Saint-Martin d'aujourd'hui. Il avait en outre ouvert par curiosité l’annuaire téléphonique de la région dans lequel il avait découvert que les patronymes des personnages du récit du Ramuz en avait été tirés, pas un ne manquait. Il prit conscience alors que le Saint-Martin de son enfance n'était pas le Saint-Martin de Ramuz, que le Saint-Martin de Ramuz lui donnait accès à un autre monde que le sien, une géographie différente de celle de l’administration, que seule la littérature est en mesure de figurer : il y a le haut et le bas, des lignes de partage et des lignes de fracture sur lesquelles s'échelonnent des valeurs et des temps différents. Il découvrait alors que le réel, comme les récits qui en lèvent partiellement le voile en multipliant les mondes d’au-delà de l’horizon, peut être lu comme une mythologie sans laquelle les autres ne seraient pas.
Comme si, pour qu'il y trouvât son compte, un point devait le relier à son passé d'enfant, qui lui donnerait l’impulsion mais aussi le courage d'aller de l'avant. N’en va-t-il pas de même pour nous autres? C’est, au fond, ce qui nous retient, ce qui nous ramène en arrière, les souvenirs, les sensations qui nous propulsent en avant. La matrice d’où l’on sort et le nid familial qui nous abritent ensuite ne s'opposent pas aux milieux ouverts et complexes qu’on est amené à investir. Ils ne vont pas les uns sans les autres, ils se rencontrent en un point qui porte le nom de désir.
On ne s'éloigne ni de ses proches ni de ses ancêtres, on s'en décolle. Ils demeurent si proches qu’on les retrouve à la fin transfigurés dans un monde que ni eux ni nous n’imaginions.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
L'inconnue du jour de la rentrée

Pour Julia
C’est lundi jour de rentrée, ils s’approchent avec des souvenirs plein derrière la tête, somnambules et naïfs. Ils ont mené la belle vie, en témoignent leur visage de bronze et les sourires qui strient leurs visages jusqu’aux oreilles, que de choses à raconter, corps reposés et déliés, heureux de revoir ceux qu’ils ont quittés sans même se dire au revoir, c’était la veille, ce matin à peine bonjour, pas la peine. Ils rayonnent assurés d’avoir fait le plus beau des périples, pressés de tout dire. Chacun à son tour en fait le récit assourdissant.
C’est un lundi d’août, dernier jour heureux, les inconscients débordent d’idées neuves, on reprendra tout depuis zéro, cahiers neufs, notre agenda sera le compagnon de l’intime, écriture de gala et bestiaire aux couleurs des poissons de la Mer Rouge, je serai à leur image. Ils se regardent comme des frères et soeurs, leurs sourires se croisent, oh! comme tu as changé, tu reviens d’où, des quatre coins du monde, d’Acapulco ou de Lozère, de Brazzaville ou de la Gruyère. Il y a celui qui parle à tort et à travers et celui qui l’écoute, il y a ce qu’on ne dit pas ou qu’on murmure en baissant les yeux, on hoche la tête, il y a ceux qui écoutent un peu en retrait, ceux qui s’évitent, la belle élégance de celle à la jupe aux coquelicots et celui qui l’admire.
Parmi eux, cette année-là, une inconnue, il faisait beau, t’en souviens-tu? Elle semblait se demander ce qu’elle venait faire dans cette galère. Elle s’est assise la première, à l’arrière, dans le troisième cercle, celui d’où on regarde les choses venir, elle a déposé son sac à main sur la chaise voisine, vide.
Ils discutent, choisissent un compagnon ou une amie, négocient les places, mettent la main sur l’espace qu’ils se partagent, rappellent des promesses, prennent des résolutions, Le travail? personne n’y croit encore, que fait-on là? Ils glissent alors leurs souvenirs avec les papiers-brouillons sous la table, c’est pour tout à l’heure, le silence s’insinue finalement le long des rangées, l’une après l’autre, ils se mettent tous à la cape.
La nouvelle se tiendra toute la journée hors la mêlée. Elle m’apprendra plus tard dans la classe vide qu’elle revient de Floride, où elle a vécu avec sa famille. Combien d’années sont-ils restés dans le Nouveau Monde, je l’ignore. Me l’a-t-elle dit, le lui ai-je demandé ou ai-je oublié? Ce doute que je n’ai jamais voulu ou pu éclairer, qu’elle ne m’a peut-être jamais invité à dissiper, je l’ai peut-être soigneusement entretenu, si bien que la nouvelle n’a jamais cessé d’apparaître à mon esprit comme la nouvelle, tout au long des jours qui ont suivi et bien au-delà. J’avais l’impression qu’elle avait laissé en arrière des malles qui resteraient fermées, n’emportant dans son sac à main que le strict nécessaire. Qu’allaient lui réserver ce nouveau pays et les amis qu’elle y retrouvait? J’avais le sentiment qu’elle était à tout instant sur le point de repartir, prête à rejoindre avec les siens sa vraie maison.
En attendant il fallait lui ménager une place de fortune et lui laisser du temps pour s’acclimater et apprivoiser ce nouveau nouveau monde, panser les blessures de l’exil. Je n’y puis rien, la première image s’incruste, on le sait. Sans que je le veuille, sans qu’elle m’en dissuade, la nouvelle est restée à l’arrière du petit théâtre qu’est la salle de classe, occupant les lieux les plus éloignés, près de la porte ou des fenêtres qui donnent sur l’océan, disparaissant même parfois derrière ceux qui prennent le gros de la place. Mais la mémoire me trompe-t-elle?
Lorsque je me suis rendu compte de l’empire que cette première image avait exercée sur moi, je me suis avisé qu’elle avait tout au long de ces années appris mille et une choses, compris, écouté, progressé, qu’elle avait bien été là, parmi nous. Mais cette remise au pas, par la raison, n’est pas parvenue à effacer l’idée que la nouvelle n’allait pas rester, qu’elle allait tout et tous vite nous oublier. On va venir la chercher en fin d’après-midi, elle n’est que de passage, elle va reprendre l’avion qui l’a déposée la veille, à tel point que j’entends parfois dans le français qu’elle parle l’anglais qui l’habite. Oui, je l’imagine américaine encore.
C’est au bord d’un champ de colza, assis sur une de ces pierres que les paysans retirent des labours, sous le ciel bleu et les traînées d’un long-courrier, que j’écris ces lignes qui m’aident à comprendre le peuple de ceux qui, en raison des circonstances, vont et viennent par-dessus les océans. La nouvelle élève a fait voir, au cul-terreux que je suis resté, la possibilité même d’une vie de transit, dans un espace multiple où l’on ne sait jamais avec certitude si l’on se rend quelque part ou si l’on en revient, si les pas que nous faisons nous rapprochent ou nous éloignent de notre vraie maison. J’ai souri, il faisait beau et chaud, je l’imaginais dans ce long-courrier, voyageant pour affaires, parlant deux langues. Il y a des gens dont on ne sait jamais s’ils partent ou s’ils reviennent, alors on oublie un peu qu’ils sont bien là. Mon Dieu que le temps passe vite.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Elle avait envie de disposer un peu plus d’elle-même

Pour Gabriella
Elle se savait un peu plus âgée que les autres, avait l’envie de disposer un peu plus d’elle-même, oh seulement un peu, à peine, mais à cet âge ça compte, à cause de l’idée qu’on s’en fait. Et puis nos institutions taillent dans le temps de manière si arbitraire qu'il suffit que vous soyez né en mai pour que vous deveniez un petit parmi les petits, en août pour que vous intégriez le groupe des grands. Supposez encore un instant que vous soyez pour des raisons qui ne vous appartiennent pas un prématuré, ou un tard venu, et vous serez convaincu que l’institution qui devait assurer l’égalité des chances devient, par un manque de souplesse congénital, une immense loterie.
Grande, un peu plus grande, elle avait l’envie d’un peu plus de liberté, pour garder, parmi les plus petits, au moins symboliquement, l’avance qu’elle avait prise au commencement. Mais la demande qui lui fut faite de placer ses velléités d'indépendance sous l’étouffoir au prétexte qu'elle se trouvait désormais avec des plus petits la condamna au grand écart : être loyale avec ceux qu’elle avait dû quitter et qui continuaient leur chemin un peu en avant d'elle et ralentir son allure pour se glisser dans les traces de ceux qui venaient de l'arrière, des traces presque à sa taille pour autant qu’elle les acceptât. Partagée donc entre ceux qui n’étaient plus là, ceux parmi lesquels elle avait commencé à devenir et qui lui avaient assuré cette première reconnaissance essentielle et ceux qui n'étaient pas encore là, les plus petits, parmi lesquels elle dut recommencer à devenir, pour la seconde fois.
Il fallut du temps pour que le grand écart se réduise et qu'elle se fasse à sa nouvelle condition sans baisser la tête. Et c'est dans cet espace laissé pour compte par les uns et par les autres qu'elle grandit, leva la tête et accéda, je crois, au monde qui l'entourait, C'est dans cet espace qu'elle calibra ses ambitions, établit ce qui lui restait à faire pour être auprès d'elle-même. C'est dans cet espace que les parties dont nous sommes tous faits trouvèrent petit à petit leur cohésion et leur centre de gravité. On est tous pareils, même si les chemins qui conduisent au fragile équilibre sont variés, c’est dans la différence qu’on s’approche de ce qu’on sera à la fin, sans qu’on sache exactement si on y parviendra. C’est le travail de chacun, nouer ce d’où on vient avec ce vers quoi on va pour être là où on est, sans que ce qui nous entoure ne nous dévore en nous faisant croire que la vérité est celle de l'alliance du nombre et de la pression, c’est-à-dire de l’appartenance.
Tout ne va pourtant pas sans heurt, nos cicatrices en témoignent, plus d’une fois on est las, prêt à laisser de côté le travail obstiné, tenté que nous sommes d’aller au plus court pour rejoindre au plus vite ces lieux qui exhibent les signes de notre temps, où l'on croit les choses si vraies et si belles qu’on est sur le point d’y attacher nos existences. Plus d’une fois il m’aura fallu du courage et me reprendre, surmonter la tentation des images. Mais qu'ont-ils devant eux ceux qui sont devant moi ? Qui m'appelle? Que ceux dont je suis sur les pas et que ceux qui me suivent ne deviennent pas ceux qui m'empêchent de me pencher sur ce qui se présente sur les côtés du chemin.
Il est temps de réformer mon entendement, car les choses ne vont pas comme on le veut, et c'est bien ça la question. La rage n'est pas un gage, et il ne sert à rien que nous chargions de nos manques celui qui n’en peut rien. Faudrait-il que le monde se comporte autrement ? Puis-je infléchir ma condition, cesser enfin de recourir à mon bon droit qui ne ferait que différer d'un tour le courage qu’il faut pour se consacrer à ce qu’on ignore ? Convient-il de tirer au plus court ? par désir d'économie ou économie du désir ?
Aujourd’hui je l’aperçois sur une terrasse du bord du lac, avec une amie d’hier et une de demain, elle évoque ses projets. Mais est-ce bien elle ? Elle a un petit geste qui montre le sud, un pays et le soleil au-delà des Alpes, après que le Rhône s’est couché dans la mer. Oeil brun et vif derrière des lunettes à soleil, l'oeil de quelqu’un qui veut ce qu’il veut et qui sait ce qu'il peut, elle dit, on n’a rien sans rien, elle dit aussi, on ne réduit jamais complètement le grand écart qui nous a fait. Et puis ce rien qu'on met dans le pot pour être enfin quelque chose qui ressemble à quelqu’un, c’est un sacré travail d’en étendre la portée.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
C’était au début, elle riait avec ses yeux en amande

Pour Anne-Sophie
C’était au début, elle riait avec ses yeux en amande qui disparaissaient dans l’éclat sonore de sa voix, éloignant les questions qui lui étaient posées, n’y répondant pas, peu ou à côté. Que voulez-vous ? elle était comme ses camarades, à mille lieues du terroir qui les avait vu naître et du foyer qui alimentait leur sens. Ce n’est pas qu’elle ne voulait pas jouer le jeu, mais elle en comprenait mal les règles et au fond n’y croyait pas. J’avoue qu’elle n’avait pas tout tort et son honnêteté souriante lui a permis de franchir des étapes que tous ses contemporains n’ont pas surmontées avec la même sérénité. Pensez donc!
En les soumettant dès leurs premiers pas à l’idée qu’elle détenait fermement un ensemble fini de questions auquel correspondait un ensemble fini de réponses nécessitant les unes et les autres une formulation stricte, l’école obligeait ses bleus à une première épreuve qui devait les conduire d’emblée à une conversion épistémologique majeure. Si formellement l’affaire ne semblait pas hors de leur portée, elle l’était pourtant dans sa réalisation et allait les conduire, de déception en déception, de chicane en chicane, à un carrefour où il leur faudrait prendre une difficile décision.
Accepter les présupposés de l’entreprise, pactiser avec l’inconcevable, prendre plaisir aux parcours de dressage et tirer quelques avantages mondains de l’application mimétique de singeries scolastiques ? Ou renoncer à ces présupposés et, partant, refuser la récompense promise à ceux qui s’approchaient du but et qu’on encourageait en les invitant, pour qu’ils patientent, à revêtir l’uniforme des seconds couteaux ou à endosser le rôle du muet dans une pièce à laquelle plus personne ne croyait vraiment ?
La déception fut grande, autant pour les sages qui avaient élaboré le plan et le programme que pour ceux qui en respectaient scrupuleusement les parties ou qui en avaient perdu de vue le sens. Il fallait s’y résoudre, de telles années de formation ne mèneraient nulle part, sinon à la maîtrise abstraite d’un ensemble de coques vides et de formulaires dont la maîtrise ne permettrait rien d’autre que de parasiter et pasticher ce que l’homme a à compendre. Chacun avait à composer au plus vite avec ce douloureux constat.
Car une seconde épreuve les attendait, autrement plus radicale: les réponses n’ont aucun intérêt parce qu’elles sont toutes contenues dans les questions qui vérifient leur pertinence. Pire, il y a bien plus dans les questions que dans les réponses, qui emmènent dans leur sillage ce qu’elles ont laissé de côté pour circonscrire leur champ. Il faut donc reprendre les choses depuis le début, commencer enfin les observations si souvent différées et les réflexions auxquelles les réponses attendues d’autrefois barraient l’accès. Il faut se résigner à se mettre enfin au travail, et plutôt que de rédiger des réponses à des questions qui ne se sont jamais posées hors les traditions, chacun doit se mettre à l’étude du monde qui l’entoure et de la tradition à laquelle le premier est suspendu, chacun doit prendre le risque de s’en approcher en lisant les récits qui en donnent le corps véritable et en fournit la légende. Car ce sont les contes et légendes qui éduquent nos enfants, c’est-à-dire les conduit hors de l’école, les dissuade d’y rester pour rejoindre au plus vite ce dont elle les a éloignés et qu’elle avait la charge de leur présenter. Pour retrouver le réel dont il a fallu réduire un instant la voilure, histoire de déchiffrer le b.a.-ba des langages qui seront leurs alliés lorsque ils auront à rejoindre la jungle du début, quand ils auront à y instituer ce qui n’est pas, dans des régions qui ne sont pas encore.
Elle était comme ceux de son âge, croyait qu’il existait un lot de questions et de réponses définitives, qui attendaient sagement dans un réduit qu’on s’y intéresse et auxquelles on aurait accès lorsqu’on serait adulte. Je me souviens de ses doutes, au début. Elle était jeune et, comme ils se doit, ne voulait saisir du monde que ce qu’elle en voulait, dans l’insouciance du temps. Et puis, de fil en aiguille, sans heurt ni bousculade, elle a accepté qu’il en allait autrement, que le monde n’est pas à son image, et qu’il méritait les égards de son attention. On l’a vue alors à la fin s’approcher du monde et s’y intéresser, dans ce qu’il a de beau mais aussi dans ce qu’il a de difficile, de s’y inscrire et de s’y montrer efficace.
Je l’imagine aujourd’hui sur une terrasse de café, c’est l’été, elle n’est pas pressée, bien mise dans des habits Abercrombie & Fitch qu’elle a achetés à Copenhague, elle lit le journal, intéressée aux affaires du monde. L’obligatoire et les jeux d’enfants sont derrière elle. Elle attend une amie qui a un peu de retard, mais ne lui en veut pas, elle sait profiter du temps qui passe. Elle sourit d’aise derrière ses lunettes à soleil. Elle se souvient de ses rêves d’autrefois et de la mer. Elle sait ce qu’elle va entreprendre dans les années qui viennent, sans ignorer que la route est encore longue. Elle aime l’année des quatre saisons. C’était à la fin, elle riait avec deux yeux en amande qui disparaissaient dans l’éclat sonore de sa voix. Elle riait des questions qu’elle se posait et qui ouvraient les portes cochères du monde, un monde immense aux dimensions de nos existences.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Elle était du premier et du troisième cercle

Pour Lucy
Elle était du premier et du troisième cercle, mais pour le comprendre il faut retourner au commencement...
C’était un espace qui répondait à des règles strictes, hémicycle entourant une place vide que venaient occuper à tour de rôle ceux qui avaient pour mission de transmettre aux nouveaux-venus les savoirs-faire que l’humanité avait développés durant plusieurs millions d’années. Les vicaires avaient à leur disposition neuf ans pour mener à bien leur tâche. Tout le monde saisissait l’importance de l’affaire, sans toutefois être en mesure d’évaluer correctement la dimension de l’entreprise qui s’avéra, comme vous le devinez, impossible. Avec le temps la scène se stabilisa et les acteurs trouvèrent leurs marques. On peut aujourd’hui, avec un peu de recul, schématiser la situation de la manière suivante.
Les nouveaux-venus se répartissaient chaque début d’année en trois demi-cercles concentriques. Devant, une couronne dense mais réduite, celle des individus éveillés à toute heure du jour et de la nuit, actifs et volontaires, avides de connaissances, prêts même à donner une ou deux heures de leurs loisirs quotidiens pour réduire d’une ou deux années le temps de leur formation et en finir au plus vite. Ils devenaient avec le temps un peu songeurs, résignés de constater que leurs initiatives n’accéléraient pas les choses, révoltés même lorsqu’ils se rendaient compte qu’ils devraient malgré tout aller jusqu’au bout.
Derrière ce premier cercle, la couronne plus dense de ceux qui avaient deviné que les places du milieu leur permettraient de répondre à leur double nature : dresser l’oreille lorsque c’était nécessaire, pour saisir l’information dont ont leur demanderait de se souvenir plus tard et dont ils auraient à rendre compte, mettre de côté les pierres d’angle et les clés de voûte des édifices qu’il leur suffirait de reconstruire lorsqu’ils en auraient besoin. C’était affaire de quelques minutes au cours de la journées, ils vaquaient le reste du temps à leurs petites affaires, publiques ou privées, avec la discrétion de ceux qui ont saisi les règles du jeu et qui ne demandent rien à personne.
Et puis à l’arrière, dans le troisième cercle, ceux qui ne voulaient rien savoir, rien voir, rien entendre et étaient là, bien au chaud, fermement décidés à terminer le rêve qu’un réveil trop brusque avait interrompu et organiser le temps qui leur reviendrait lorsque l’institution voudrait bien les laisser partir. Ils souhaitaient en outre pouvoir s’entretenir sans être dérangés et sans déranger non plus leur voisinage des affaires du monde, allégeant ainsi l’atmosphère, il faut le convenir, des milles futilités qu’ils y jetaient sans lesquelles les espaces clos deviennent aussi mortels que des prisons. Et puis, mélangés à eux, le public des curieux, ceux qui ne voulaient pas trop s’impliquer mais souhaitaient, tant qu’à faire, considérer avec le recul nécessaire la scène qu’ils avaient à jouer et qu’ils étaient bien résolus à ne pas jouer trop tôt.
Elle était du premier cercle, éveillée, toujours pimpante, alerte, prête à se mettre à l’ouvrage, mais il lui fallait un certain temps avant de réellement s’y engager. Il lui fallait en effet considérer la situation, observer attentivement ses caractéristiques toujours changeantes, hésitant même parfois à faire le pas, non pas qu’elle doutât de l’intérêt des tâches qui lui étaient proposées, mais parce qu’elle aurait voulu en savoir plus sur le sens de l’entreprise. On savait bien que finalement elle s’y ferait, elle se mettait alors au travail sans qu’on le remarquât, un peu résignée vraisemblablement, mais toujours avec le sourire. C’est ainsi que, locataire du premier cercle, elle mettait un zeste de l’atmosphère qui régnait à l’arrière, allégeant d’un certain poids le sérieux qui pouvait habiter ceux du devant. Je crois bien qu’elle s’y sentait bien, toute proche du centre de gravité apparent de la scène, et pourtant, profondément distante. Avec elle c’était le troisième cercle qui se plaçait devant. C’était peut-être la meilleure place pour mettre toutes les chances de son côté, ne pas être dérangée en manifestant une présence forte et vivifiante, mais garder une distance suffisante pour ne pas s’engager tête baissée dans une entreprise dont l’institution se gardait bien d’expliquer comment et quand on en sortirait.
Je savais qu’elle aurait aimé être ailleurs, souvent, sur une autre scène, sous un tilleul ou une treille, avec un livre et du soleil. C’était une infatigable lectrice peu décidée à se lancer tête baissée dans les tâches qu’on lui présentait bien peu romanesquement, mais assoiffée de lecture, refusant de lâcher cette naïveté sur laquelle l’enfant lit, vit et construit son avenir, en maintenant à distance le monde qu’il serait toujours assez tôt de rejoindre.
Je l’imagine aujourd’hui heureuse dans la cafétéria d’une bibliothèque – bibliothécaire, étudiante, enseignante ou responsable de la cafétéria – avec les amies auxquelles elle est toujours restée fidèle, quand bien même chacune d’elle a pris une autre trajectoire que la sienne. Elle n’en dédaigne aucune, c’était une infatigable lectrice, j’imagine qu’elle l’est aujourd’hui encore, gardant près d’elle ces récits qui nous permettent d’apprivoiser le monde brutal dans lequel on vit, ces récits qui ont remplacé un jour, avantageusement, l’école qu’il a bien fallu que nous acceptions.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Cette passion de connaître les choses

Pour Marine E
Cette passion de connaître les choses, par l’allure d’abord, les racines ensuite ne devrait pas l’avoir quittée. Mais ce dont elle cherche aujourd’hui à dégager la vérité n’a vraisemblablement plus la même origine. Lorsque je l’ai connue elle avait soif depuis longtemps déjà et visait la perfection dans tout ce qu’on lui proposait d’entreprendre. Elle répondait avec un soin extrême aux tâches qu’on lui enjoignait d’accomplir et aux objectifs qu’on lui demandait d’atteindre. Elle le faisait non seulement avec une volonté qui ne faiblissait pas, mais avec une méthode et une intelligence telles qu’elle conduisit imperceptiblement les responsables de l’institution à se bonifier, clarifier leurs propos, préciser leurs buts, affiner le sens des devoirs qu’ils soumettaient à ceux dont ils avaient la charge. La donzelle, en voulant bien faire et en honorant l’institution en tout obligea celle-ci à devenir meilleure, toujours meilleure, c’est-à-dire à devenir enfin ce qu’elle prétendait être.
Mais lorsqu’elle s’aperçut que l’institution n’y parviendrait pas et ne serait pas en mesure de la satisfaire comme elle le souhaitait sa vie durant, elle prit le parti de choisir elle-même les domaines où elle pourrait étancher sa soif. J’ignore le moment où elle prit cette décision et si même elle la prit, j’en doute, les choses ne se passent pas ainsi, mais je sais que cette prise de conscience fut accompagnée d’un sourire dont elle ne se départit jamais plus, comme si elle avait compris qu’elle avait été bien folle de croire en l’institution avec une telle ferveur, de placer une telle confiance en ceux qui l’avaient accompagnée jusque-là. Elle ne leur en a jamais voulu, mais elle s’aperçut par là-même que si l’institution n’était pas sans faiblesse, elle non plus n’en manquait pas. Elle prit conscience simultanément de ses limites, elle ne pourrait pas en tous les domaines viser la perfection. Mais elle ne manqua jamais à l’idée que ce qu’elle entreprendrait, elle le réussirait.
L’inquiétude qui l’habitait de ne pas être à même d’honorer les commandes s’est dissipée à mesure que croissait la conscience qu’elle pouvait être à elle-même sa propre commanditaire et se pencher librement sur les domaines circonscrits par ses envies. On ne s’approprie pas le monde dans le langage de ceux qui nous le donne, mais dans celui qui finit par être le nôtre, un peu bègue et hésitant. Mais la volonté obstinée de comprendre ceux qui nous précèdent, dans leur langage, la confiance qu’on leur voue lorsqu’on est enfant, la difficulté ultérieure de s’en défaire ne sont pas inutiles. Plus l’univers de celui qui l’assujettissait était riche, plus il enrichira son propre univers en le débarrassant de l’autre (Elias Canetti).
Je l’imagine toujours aussi passionnée, sans rien avoir perdu des exigences qui la portaient autrefois. Je l’imagine affairée, n’hésitant pas à poser des questions à ceux qui l’entourent, pour embellir leur vie, la simplifier ou les aider, sans être rongée par le sentiment de ne pas y parvenir, mais en souriant d’aise de pouvoir s’en approcher et y prêter son concours. Je l’imagine aujourd’hui à la tête d’une entreprise ou à la maison, dans les bureaux d’une ONG ou sur les bancs d’un groupe parlementaire, honnête et l’oeil brillant de cette ironie apparue dans ces années-là. Elle sait que ce qu’on a réalisé et réussi dans la peine n’est presque rien. Je l’imagine où qu’elle soit parmi les autres, phare discret, exemplaire de ce qu’il est possible : passer outre les injonctions et l’attente désespérée, conjuguer le sérieux de l’existence, son cortège de soucis avec la légèreté, l’ironie et l’apparition souriante de l’aube.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Enfant on le disait bagarreur

Pour Raphaël
Enfant on le disait bagarreur, mais personne n’y prêtait foi parce qu’il était les égards mêmes. Le temps a passé, seul lui s’en souvient et peut-être en rit. Pourtant, à la réflexion, alors qu’on a perdu de vue cette idée ou parce qu’il n’y a pas lieu qu’on s’en préoccupe, le souvenir des kilojoules qui animaient sa forte tête, lorsque on y songe aujourd’hui, se déployant dans toutes les directions pour embrasser ce qui se présentait à lui et qu’il n’eût pas été possible d’embrasser sans eux pourrait nous amener à rectifier l’idée préconçue. Car sans les circonstances dont il sut tirer profit, le bambin n’aurait-il pas renoué avec les manières belliqueuses de ses premières années, prêtées peut-être à tort, qui font du plus bel esprit un bagarreur? Pour chacun d’entre nous, la distance est faible entre deux destins.
Tout était bon pour son appétit d’ogre. Depuis qu’il avait accepté que les circonstances attisent son intelligence, il en redemandait. D’un esprit vif, il dormait bien, en éveil continuel et doté d’un physique dur à l’épreuve, n’hésitant pas dès l’aube à pénétrer les secrets de nos habitudes et déjouer les pièges semés sous les pas des nouveaux-venus pour les assagir. Mais il ne perdait pas de vue les refuges que sa prudence lui avaient conseillé de ménager pour garder intacte la fraîcheur de ceux qui s’éveillent. Le mélange a réussi, je m’en souviens, intéressé au monde dans ce qu’il a de normatif, acceptant même pour mieux les dépasser les règles qu’on rencontre dans les officines de dressage, les saisissant même jusqu’à l’extrémité de leur fonction. Il a su, quand il le fallait, se mettre à leurs services lorsqu’il s’avérait que leur partage était, morale provisoire, essentiel au bon fonctionnement du jeu démocratique au bénéfice duquel il n’a pourtant jamais mis sa liberté en dot.
J’imagine aujourd’hui qu’il a réussi le plus difficile, ce qui chez la plupart d’entre nous demeure inatteignable, écartelés que nous sommes par le désir de la réussite sociale et l’ivresse de la liberté, j’imagine que lui appartiennent non seulement les grandes avenues des capitales mais aussi les chemins buissonniers qu’aperçoivent dès la première heure ceux qui ont bon pied, dans le préau et dans les livres, derrière les talus qui bordent les autoroutes et parmi les camomilles qui soulèvent les pavés, curieux de ce qu’on voit du seuil, à mesure qu’on prend goût au plein air et au vent du large, au-delà de la raison qui tient ensemble les convenances. N’est-on pas toujours déjà bien loin des murs qu’il nous a fallu habiter, de l’autre côté de l’Atlantique ou en Patagonie? Intrigués par des conjugaisons inouïes, par les bizarreries de nos habitudes, les hésitations de l’histoire qui nous font voir les nôtres?
Il est aujourd’hui vraisemblablement de ceux qui ont su garder les pieds sur terre et la tête au ciel, je ne l’ai pas revu depuis des années. Je l’imagine assidu, aux prises avec une lecture ardue dans une bibliothèque de quartier ou au côté d’un criminel dans le prétoire d’une grande ville, dans une banque dont il tiendrait avec soin les cordons de la bourse, l’oeil ouvert sur la liberté et l’horizon de notre espèce, sans lequel la première se vide de son contenu et la seconde va au mur. Je l’imagine en fin d’après-midi, le visage assombri par le sérieux, en taxi par exemple, consultant un dossier dont j’ignore la teneur, et même le domaine, s’assurant qu’il en va comme il l’a voulu. Je l’imagine le soir, souriant avec le soleil qui se couche, baskets et baladeur, il court sur les quais de l’Arno ou du Tibre, pour tenir en équilibre ce qu’il a choisi, car tout est plus facile lorsque le corps entraîné se tient droit. C’est ainsi qu’il gère ses troupes en gardant les marges sans lesquelles les autres n’ont aucune chance d’être avec vous, et vous avec eux. Il vit, somme tout, une vie analogue à celle de n’importe qui.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Avertissement
C’est à cet exercice proche de la fiction que je me suis livré, non pas pour esquisser les lignes d’un destin dont je ne sais ma foi trop rien, mais pour rendre à chacun une existence propre, imaginaire, construite à partir de presque rien, dont on ne retiendra pas l’adéquation avec ce qui a été, est ou sera, mais l’intention, celle de redonner une consistance au corps et à l’âme que l’institution a pris en otage pour exercer au mieux sa tâche, avec le risque de les user jusqu’à la corde. Il était temps de me mettre sur la pointe des pieds et d’imaginer des personnes et des événements qui sont devenus avec le temps la possibilité même de l’avenir.
Pour Raphaël :Enfant on le disait bagarreur
Pour Marine E : Cette passion de connaître les choses
Pour Lucy : Elle était du premier et du troisième cercle
Pour Anne-Sophie : C’était au début, elle riait avec ses yeux en amande
Pour Gabriella : Elle avait envie de disposer un peu plus d’elle-même
Pour Julia : L’inconnue du jour de la rentrée
Pour Rick : Dans un monde que ni eux ni nous n’imaginions
Pour Jill : Le couloir était éclairé par des sourires
Pour Nathan : L’enfant qui a la tête en l’air
Pour Lucas : La gymnastique intellectuelle entame leur sérénité
Pour Lea : Virevoltant au-dessus des ornières
Pour Anouck : Initiation à l'art du porte-à-faux
Pour Marine H : Quitter son giron
Pour Floriane : Le fil ténu qui me fait tenir debout
Pour Gaël : On n'est jamais là lorsqu'il le faut
Jean Prod’hom
Derborence

M’enthousiasme à cause de Derborence, évoque Si le soleil ne revenait pas et La Grande Peur dans la montagne. Ne le dis pas, mais c’est Derborence que je préfère. M’emporte un peu lorsque j’entends les élèves se réjouir du visionnement, la semaine prochaine, du film réalisé par Reusser. Leur promets les plus hautes déceptions auxquelles conduisent immanquablement tous les cinéastes qui ont voulu exploiter les trouvailles stylistiques d’un écrivain. M’emporte pour ça jusqu’à l’épuisement. Me demande même si je vais rester debout, mais tiens bon. Il fait beau lorsque les élèves s’en vont, fais un crochet par l’étang pour essayer de relever la tête. Vomis discrètement derrière un gros frêne.






Toute la partie orientale de l’étang est transfigurée, on entend ici puis là des coassements sourds et profonds. Les gelées des grenouilles se substituent lentement aux gelées de l’hiver, si fines désormais qu’on croirait des osties. J’aperçois deux grenouilles qui traversent le chemin leur donne un coup de main. J’ai hâte que la nuit vienne, rentre et l’attends. Faut-il encore que je puisse en disposer. Je diffère la rédaction d’une note sur Le Génie subtil du roman d’Olivier Rolin, renonce à mettre de l’ordre sur mon bureau, brûle d’en finir. C’est fait, je suis resté debout et vais me coucher.
Jean Prod’hom
Ecoles à Berne

En début de novembre 2010, la classe de 11VSB a eu l’occasion de passer une semaine au coeur de la ville fédérale, dans le cadre du projet Ecoles à Berne. Le but de cette association est de sensibiliser les jeunes à la politique afin qu’ils deviennent des citoyens actifs dans notre démocratie….
(la suite, c’est ici : ECOLES A BERNE-2010
LXVIII

Deux collègues pleurent le temps passé en chantant la belle l’époque, le temps des petits Larousse dont elles énumèrent les innombrables vertus. Elles se disputent un peu à propos de la couleur de la couverture: rose, beige, rose-beige, rose-saumon,... elles rient, elles se taquinent, mais c’est pour rire. Elles se rappellent surtout de la page des bannières, étonnées et heureuses d’avoir pris conscience, tels Leibniz et Newton, simultanément, que toutes les bannières du monde étaient rectangulaires, toutes, excepté celles de la Suisse et du Vatican.
Les yeux embués, elles regrettent le beau temps des voyages sur la moquette, tout a tellement changé. Elles au moins découvraient le monde. On avait, soupirent-elles, une toute autre façon de voyager, une vraie. Et mine de rien on se coltinait le réel, la Suisse, le Vatican, les gardes suisses. Magiques ces bannières! Réellement magiques!
J’opine avant de reprendre ma lecture de l’Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXème siècle, avec le sentiment désagréable que cette anthologie mérite déjà de solides compléments.
Jean Prod’hom
XXI

Le garçon s'est fait piquer dimanche soir par une abeille, tout près de l'oeil si bien qu'on l'a gardé à la maison tout le lundi. Il ressemble à Quasimodo.
Arrive en fin de journée un copain d'école, un papier à la main listant les travaux que ses camarades ont réalisés pendant la journée: mathématiques, allemand, conjugaison, musique et histoire biblique. Il doit les rattraper avant d'être autorisé à retourner à la mine. Ses parents se sont mis à l'ouvrage, il a neuf ans, c'est leur Quasimodo et ils l'aiment.
J'ai compris ce que les enfants apprennent en priorité à l'école, à ne pas être malade. C'est bien!
A minuit, lorsqu'ils en ont eu fini avec ses devoirs, le père et le fils ont regardé Notre Dame de Paris, avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn. C'était une belle époque où l'on était assez pauvre pour savoir qu'il aurait été vain de vouloir rattraper quoi que ce soit.
Jean Prod’hom
Image de la connaissance

L'enseignant sera, dans les années qui viennent, aux prises avec des difficultés dont il envisage à peine le contour. L'une d'elles se précise toutefois aujourd'hui. Elle concerne la mutation de l'image de la connaissance dans la conscience des jeunes gens. Ils sont nombreux déjà, dans nos écoles, ceux qui croient que la connaissance est déposée dans des encyclopédies numériques mises à leur disposition, dans lesquelles il suffit de puiser ce que listent quelques moteurs de recherche, de le transférer sur un support au bas duquel l'ajout d'un prénom et d'un nom feront de ces simples opérateurs des experts.
Nous aurons donc à distinguer à nouveaux frais le savoir et la connaissance, c'est un fait essentiel. Car si le premier réside bel et bien dans les choses et les livres, la seconde ne se trouve pas hors les sujets vivants.
Cette importante mutation de l'imagerie a fait du chemin et les enseignants sont déjà quelques-uns à s'en être faits les complices, à leur insu peut-être. Dans un article publié par La Provence, Marcel Gauchet répond à Laurent d’Ancona.
En tant qu’instrument technique, Internet est un outil fantastique. Mais à travers lui, se joue une évolution de l’image de la connaissance qui porte beaucoup plus loin. Ce qu’on pourrait appeler une extériorisation du savoir. Il est déposé dans des banques de données, et il suffit de se brancher sur des sources disponibles. C’est pas la peine de se farcir la tête de choses pour lesquelles il suffit d’avoir la clé d’accès. En ce sens-là, Internet donne à ses utilisateurs l’idée qu’ils peuvent tout savoir sans rien savoir.
Marcel Gauchet
Aujourd'hui, le savoir est devenu facultatif",
in La Provence, 3 décembre 2008
Comment ne succomber ni à Charybde ni à Scylla, comment éviter d'être les hérauts d'une image surannée de la connaissance ou, contrits, les cassandres de sa disparition? En résistant et, à coup sûr, en imaginant! L'enseignant aura dans les années qui viennent à mettre sur pied des dispositifs simples, élémentaires, qui obligeront ceux qu'il forme à ne pas recourir à l'Internet et ses banques numériques, inutiles en la matière.
Il aura en effet à réhabiliter la connaissance du particulier que seul un travail hic et nunc permet d'approcher: connaissance de son quartier, rencontre de son voisin, approche du monde. De tout cela, la vie scolaire confinée dans des laboratoires toujours plus sophistiqués et couteux nous en a éloignés. Elle nous en rapprochera peut-être à nouveau, pour peu que nous le souhaitions.
C'est ce que réalisent depuis quelques semaines certains élèves du Mont-sur-Lausanne dans leurs notes journalières...
Histoires de trottinettes
Le grec
Les surdoués: de drôles de zèbres!
Pourquoi le vaccin?
Une nouvelle boulangerie au Mont-sur-Lausanne
L'eau en voie de disparition
Une nouvelle bibliothèque au Mottier
Jean Prod’hom
Dimanche 15 février 2009

Je termine à l'instant la rédaction des notes que je destine à chacun des vingt-six élèves dont j'ai la charge. A les considérer avec un peu de hauteur, elles peuvent se réduire à la reconnaissance de quelques attitudes.
- Prendre de la hauteur, précisément, c’est-à-dire être en mesure de s'interrompre dans son travail à n'importe quel moment, où qu'on soit et quoi qu’on fasse, lever la tête comme le saint Augustin de Carpaccio et jeter par la fenêtre un long coup d'oeil au monde avant de s'interroger sur la nature et le bien-fondé de la tâche à laquelle on s'est attelé. Pour recadrer nos actions, redimensionner notre effort, redresser les dérives, rappeler le but à atteindre, se réapproprier le sens de l’entreprise, se désinquiéter aussi.
- Cartographier ensuite la problématique, repérer les difficultés et attribuer chaque fois que cela est possible - et ça l'est toujours - un nom à chacune des difficultés rencontrées, les résoudre alors l’une après l’autre. C’est une technique infaillible pour se débarrasser de nos ennemis. (Les trois Horaces et les trois Curiaces l'ont démontré à l'occasion de la guerre entre Rome et Albe-la-Longue. Les Curiaces furent tous les trois blessés rapidement et deux des Horaces tués. La bataille devenait inégale. Le dernier Horace s'enfuit. Les Curiaces blessés se mirent à ses trousses. Mais ceux-ci ne le rattrapèrent pas au même moment si bien que le dernier Horace les tua l'un après l'autre.)
- Honorer la sacro-sainte loi du moindre effort. Il ne sert à rien en effet de naviguer contre le vent, il y a des efforts qui parfois sont sans effet et sans raison. L’homme se fourvoie trop souvent dans l’action.
- Aller de son côté et écouter le bruissement du monde lorsque le groupe obéit aveuglément au principe d'inertie, s'en éloigner mais laisser traîner comme si de rien n'était une oreille pour ne pas être piétiné lorsque le groupe est sur vos talons.
- Enfin, écrit René Char dans les Feuillets d'Hypnos, autant que se peut, ... devenir efficace, pour le but à atteindre mais pas au delà. Au delà est fumée. Où il y a fumée il y a changement.
En prenant encore un peu de hauteur, je me rends compte que ces mots que je destine aux élèves - les attitudes dont je chante les vertus - s'adressent d'abord à moi. Je lève la tête et jette un coup d'oeil par la fenêtre, il fait encore nuit et j'imagine le ciel très haut, le ciel qu'il s'agirait de rejoindre pour demeurer à bonne distance du monde, et le considérer lui et ses hôtes avec un peu de justice.
Jean Prod’hom
Tout dire

C'est ce à quoi rêve celui qui s'y essaie. Mais écrire suppose de celui qui s'y aventure qu'il renonce à vouloir tout dire dès le premier mot. Son rêve ne s'éteint pas pour autant, bien au contraire, il lui faut désormais creuser dans le peu qu'il énonce les avenues de ce qu'il ne saurait dire.
Chaque mot ménage son silence et l'écriture, quelle que soit son apparence, va cahin-caha, de mot en mot, comme l'enfant qui saute sur les rochers du môle. Un invisible chemin de crête se dessine. Pour tout dire, celui qui s'y essaie n'écrit ni tout ni rien, mais un rien à bonne distance du tout et du rien. Il jette, bien loin devant, le secret espoir de tout dire.
Celui qui écrit est habité par une indéfectible confiance proche de l'innocence, l'innocence du funambule qui a pris la mesure du vide dont il est le laborieux artisan, celle de l'enfant aussi: il traverse à cloche-pied la marelle qui fait tenir ensemble l'aube et le crépuscule.
J'ai reçu l'autre jour le texte d'un tout jeune garçon. Avec une confiance et une tranquillité inouïes pour un enfant de son âge, il jette à gauche et à droite de son récit quelques leurres sur lesquels il ne reviendra pas, il n'en dit rien sinon qu'ils sont là. Ces leurres creusent d'immenses tranchées qui agrandissent démesurément le monde que son récit fonde et qui lestent les événements que celui-ci traverse.
Je lui ai demandé s'il en savait quelque chose. Il m'a avoué, un sourire dans les yeux, je crois mais je ne m'en souviens plus exactement, qu'il n'en savait rien, lui non plus.
Jean Prod’hom
Pierre Bergounioux... et puis un rêve

Nous nous sommes retrouvés au collège une petite dizaine, samedi matin à 10 heures, pour la seconde séance d'information autour de Maîtrise de français et sa grammaire – enseignée quelque temps encore dans le canton de Vaud. Moins tendu que lors de la séance de mercredi passé, j'ai su lever l'essentiel de ce que j'avais projeté. Moins de précipitation donc, moins d'agitation, de confusion...
Il faut dire que pour introduire mon propos j'avais trouvé un allié de poids en la personne de Pierre Bergounioux. Son Ouvrir la grammaire (Nathan, Paris 2002) est une petite merveille dont les avant-propos. introduction, préambule,... méritent le détour.
Ce court traité postule simplement que le lecteur, comme tout homme, en possède la maîtrise pratique. Il voudrait rattacher une discipline perçue comme tristement scolaire à son principe même, à la vie et à sa dimension proprement humaine, celle de son sens. Il n'établit rien que le lecteur (jeune ou moins jeune) ne sache déjà, mais d'un savoir qui fréquemment s'ignore et que les pages suivantes ne font que porter à jour.
Avant-propos
Nous sommes doubles, faits d'un corps et d'un esprit. Le premier est matériel, prisonnier d'une heure – le présent – et d'un lieu (ici, maintenant). Le second, quoique immatériel, n'est est pas moins très réel, puissant et libre. Il peut se transporter ailleurs, revenir dans le passé ou se porter dans l'avenir, imaginer ce qui n'est pas. Tel est le privilège de la pensée. Nous ne sommes pas seuls au monde... Pour faire connaître ce que nous sommes aux autres et pour savoir ce qu'ils pensent, nous nous parlons.
Introduction
En français, huit espèces de mots suffisent à tout dire...
Les deux espèces majeures sont le nom et le verbe parce qu'elles se rapportent aux deux dimensions de notre expérience: l'ESPACE et le TEMPS, qui composent le MONDE.
Morphologie
La parole est, avec le rire, le propre de l'homme. Elle est au coeur de toutes les activités. Elle constitue la principale ressource de nombreuses professions (enseignant. interprète, avocat, psychologue, parlementaire...). Elle peut être tarifée (téléphone). Elle a un PRIX – en temps, en argent, en fatigue – que l'on cherche à réduire. Minimiser le coût linguistique, telle est l'utilité du pronom ...
Le pronom
Et puis j'ai avancé de deux ou trois pas dans le rêve que j'ai fait à la suite de la séance de mercredi passé. Tout d'abord nous nous sommes retrouvés dans la nouvelle bibliothèque, assis ensuite sur de vraies chaises, au profil de violons rouge griotte, face enfin à de vraies tables.
Ce n'est pas tout: on se retrouvera qui voudra le premier samedi matin du mois d'avril, on ouvrira la salle d'informatique, on ouvrira la salle attenante à la bibliothèque, la classe 11,...
Si l'on nous y autorise!
Jean Prod’hom
Éclaircies

De l'opacité chronique qui règne dans les relations entre l'école et ses usagers surgissent parfois des éclaircies qui annoncent des jours meilleurs.
Ainsi hier matin à l'aube, je lis un mail signé par les parents d'un élève – envoyé à 00:44:00 GMT, tous les détails comptent lorsqu'on a besoin de réconfort! – qui m'ont fait le plaisir d'accepter la veille au soir mon invitation à une séance d'information autour de la grammaire et de son enseignement aujourd'hui dans le canton de Vaud, une séance promise il y a quelques semaines déjà à l'occasion d'une réunion de parents.
Ils me remercient en faisant preuve de la gentillesse et de la bienveillance qui concourent si souvent à atténuer les peines et les remords de l'orateur, engendrés par le souvenir de ses imprécisions, de ses précipitations, de ses omissions – il faut s'y faire, les choses sont irréparables.
Au terme de leur message je lis : Votre proposition d’organiser d’autres soirées à thème trouve notre entière adhésion. Cette question du but de l’enseignement, en lien avec la quantification du travail scolaire, nous semblerait un sujet intéressant à débattre…
Je me prends à rêver...
Ce serait un soir de printemps, le mercredi 22 avril ou un matin, le samedi 24 avril, on nous aurait mis à disposition la bibliothèque du collège – qui s'appellerait Chez Nono – on s'assoirait autour d'une vraie table, avec de vraies chaises et on dirait la variété de nos attentes, l'irréductible, le possible, l'impossible, le nécessaire, le souhaitable... On prendrait avant de se quitter un apéritif, il ferait grand beau, les enfants joueraient dans la cour, etc.
Jean Prod’hom
Catéchisme au collège Archimède

Nous rappellerons chaque jour à nos élèves que la loi du moindre effort est une loi sacrée dont l'application obligée conduit chacun d'entre nous à l'allègement de son fardeau ou à l'augmentation de ses peines. Rien ne se fera sans elle ni sur les pentes du mal ni sur celles du bien, foi de charbonnier.
Tu ne cesseras pas de chercher des raccourcis pour rapprocher les fins, des martingales pour faire fortune, des remèdes pour abréger les souffrances. Tu étudieras pour éviter de devoir répéter l'ensemble des expériences de l'humanité et pour pointer présent au bout du temps. Tu iras à l'école pour quitter ta famille en un temps raisonnable. Peut-être n'aimeras-tu qu'une femme? Tu obéiras servilement, comme tout le monde, à la loi du moindre effort.
Mais tu apprendras la contrepartie de cette loi: son application aveugle et immédiate mène aux enfers, celui qui cède à ses séductions sans honorer les conditions de son exercice est condamné aux travaux forcés, Sisyphe ou charbonnier. En souhaitant trop vite n'avoir rien à faire, tu te retrouveras au premier rang le matin à transporter le charbon; le soir, noir de suie, tu marcheras seul et fourbu dans l'air glacial de l'hiver. Tu prendras conscience alors que son application heureuse nécessite des efforts immenses. Cette loi n'équivaut pas à l'abandon de l'effort, mais à son culte.
En définitive tu veilleras à ne pas perdre de vue une ou deux choses que tes parents t'ont chargé de remettre à tes enfants: quelques sous, de l'amour et des lumières.
Regarde l'homme de pierre dans la cour, c'est l'inventeur du levier, oisif aujourd'hui, il a su, grosse tête et corps chétif, déplacer des montagnes.
Jean Prod’hom
Courage citoyen!

La tête rongée dedans par les allées et venues d'une armée de rhinovirus et dehors par le brouillard qui ne se lève pas, il n'en suffit pas plus pour que je sois amené à penser que je vais vivre quelques jours encore – dans des souffrances qui m'épargnent évidemment moins qu'un autre – avant de mourir, tout simplement. Je ne vois plus aucune autre issue, c'est irrémédiable.
La réalité indubitable de mes sensations m'apparaît avec l'évidence du rêve si bien que ma conscience, qui ne va pas au-delà du constat qu'il n'existe pas plus de raisons que mes souffrances s'interrompent que de raisons qu'elles n'aient commencé un jour – et je n'en vois aucune –, est incapable de rivaliser avec ce qu'elle aurait pu considérer comme la conclusion erronée d'un raisonnement miné par la contradiction. J'attends donc la mort. Hôte de parasites indésirables je suis réduit à n'être qu'un champ de bataille, je perds le peu de sagesse que je croyais avoir acquise, je décline et je rage.
– C'est certainement un petit refroidissement, me rassurent quelques collègues.
Ces consolations, nées de la bienveillante bienveillance de l'homme et qui auraient dû me convaincre que je n'en ai pas fini encore avec la vie, résonnent comme des condoléances et me précipitent au contraire plus loin dans le désespoir en m'avertissant que ce mal qui a envahi mon cerveau et ronge mes facultés n'est qu'une faible image des maux qui auraient pu et peuvent encore me menacer.
En désespoir de cause je m'informe. Ces rhinovirus appartiennent à la famille des picornaviridae qui sont à l'origine du rhume banal. Mais ce que j'apprends ensuite me fait trembler: ils peuvent être aussi à l'origine de la méningite. Pire! selon un professeur dont j'ignore évidemment tout mais qui s'y connaît à coup sûr, les picornavirus auraient des effets destructeurs sur les cellules de l'hippocampe, sans lequel je n'apprendrais ni ne mémoriserais rien. Mon état est donc plus grave que je ne le pensais, mon refroidissement, comme ils disent, pourrait entamer le peu de raison qui me reste, il est temps que je me batte pour que je m'en sorte. Car si on doit accepter de mourir, il n'est pas élégant de mourir n'importe comment. Je n'ai plus une minute à perdre.
Il y a quelques raisons désormais que je sorte vivant de cette épreuve.
Jean Prod’hom
Dimanche 11 janvier 2009

Certains viennent à l'école à contre coeur, fatigués, ils n'appartiennent plus tout à fait au monde que l'institution leur propose. Grands déjà, ils ont comme abandonné l'enfance qui décidément les ennuie. Ils se savent plus à l'aise dans les affaires, des affaires de toutes espèces: coeur, argent, bons coups, ambitions, appartenance, alliance et exclusion en tête. L'école leur tombe des mains comme les livres d'enfants.
D'autres sourient, se saisissent de tout ce qui traîne, histoires, bruits, mondes, ficelles, images, livres,... quels qu'ils soient. Tout est bon, ils recyclent à tour de bras et sourient à journée faite, ils se baignent comme Porculus dans la bonne boue, si douce de l'enfance.
Et puis les autres qui hésitent à mi-chemin.
Emerveillé je l'ai été mardi passé lorsqu'une élève d'une douzaine d'années a lu aux vingt camarades qui l'entouraient un livre pour les tout petits:
Elle lit consciencieuse chacune des pages de ce récit, sa voix sourit, elle rayonne. A droite en bas, elle baisse la voix puis s'interrompt un long instant avant de poursuivre au verso, lève les yeux, nous regarde comme si nous avions gardé près de nous ce qui était autrefois en nous, retourne le livre comme un morceau de verre, pour nous faire voir les images jaunes, vertes et bleues qu'elle a goûtées peu avant et qu'elle nous offre. Ses yeux rient aux éclats de la surprise qu'elle nous fait.
A chaque double page le rituel reprend, chaque fois on entend quelques rires dans l'assistance: les rires cristallins du temps des jeux et de l'ignorance, et les rires éloignés de ceux qui savent. Elle ne dédaigne aucun d'eux, ni les fronts lisses ni les fronts creusés par la méditation, le calcul et l'esprit de sérieux.
J'aurais aimé que la lecture de ce livre se prolongeât.
Jean Prod’hom
Dans un petit carré de lumière

Autour de midi en hiver, lorsque le soleil vient frapper les lucarnes de nos greniers, des nuées de mouches dont on ignore les lieux de retraite – ou de nidification – font leur apparition sur le mode de la génération spontanée. Elles frottent bruyamment et sans discontinuer leurs ailes contre le verre réchauffé. Personne n'a été en mesure de déterminer précisément l'instant de leur réveil. Elles s'agitent, ivres d'abord elles volettent en tous sens. Epuisées enfin elles rejoignent en chute libre les lames du plancher, grésillent par à-coups plusieurs minutes, elles brûlent leurs dernières forces. Un dernier coup d'ailes, un dernier coup de pattes, elles meurent enfin serrées dans un petit carré de lumière.
Un collègue m'avertit qu'il a retrouvé dans l'une des poches de son ordinateur des photos égarées et qu'il les a fait parvenir à un ancien élève, aujourd'hui en formation professionnelle, qui les lui demande depuis plusieurs semaines déjà.
Le jour même de cet envoi, un e-mail de cet élève m'avertit de la publication dans son album, sur Facebook, d'une photo. Elle met en scène sur les rives du lac Majeur les cinquante acteurs de ce festin sportif. Sous la photo leurs prénoms et leurs noms, détenteurs pour la plupart d'un compte sur Facebook. Je m'y reconnais.
Il aura suffi de quelques secondes à peine pour que le premier des cinquante disparus envoie un message de condoléances. Les bougies s'allument. Et dans les heures qui suivent affluent les messages de la diaspora.
Le feu dure quelques jours, puis les disparus disparaissent, le livre se referme, les bougies s'éteignent. Diaspora.
Fin août 1985 sur la rive gauche de l'Ardèche, au-dessus de Viviers où nous avons dormi. Nous marchons toute la journée et c'est le crépuscule. S'offre alors un spectacle qu'il est difficile d'imaginer: d'innombrables fragments blanchâtres d'une matière indéterminée, déchiquetée et nervée, tournoient tout autour et saturent l'espace. On n'y voit plus rien, ce sont des éphémères. Le ballet dure un instant, dix minutes peut-être, et la nuit tombe.
Au matin, les rives de l'Ardèche sont recouvertes d'un épais suaire à la couleur indécise, détrempé, poisseux: le décor d'un film d'épouvante.
Jean Prod’hom
Le Papa de Simon

Chacun de son côté, eux du leur et moi du mien, si bien que nous avons travaillé dur et en silence mercredi passé, comme il convient lorsque l'on se met en demeure d'apprendre autre chose que ce que l'on sait déjà, la tête dans l'encre noire une heure durant, courbés sur un beau récit de Maupassant, Le Papa de Simon.
Nous l'avons écouté il y a une dizaine de jours dans une version proposée par la RSR; et puis je leur ai remis il y a une petite semaine une copie du texte pour qu'ils puissent en prendre soigneusement connaissance à la maison. Certains l'ont lu, d'autres lu et relu, annoté, crayon, plume ou couleurs, d'autres enfin confiants, trop confiants...
C'est l'histoire de Simon, un garçon de sept ou huit ans qui ne connaît pas son papa – est-ce sa faute, à cette fille, si elle a failli? Les gamins de l'école avec lesquels Simon ne galopine pas dans les rues du village ou sur les bords de la rivière n'ont pas de pitié – pas plus que leurs parents – pour cette chose extraordinaire, monstrueuse, cet être hors de la nature. Ils le mettent en demeure de répondre de cette absence.
Ce mauvais coup contre lequel n'existe aucune parade renforce la cohésion des galopins, malins et cruels, et contribue à l'égarement de Simon qui sent monter en lui l'impuissance. Il songe à mourir.
Maupassant raconte le chemin difficile que doit emprunter Simon, à deux pas d'en finir avec lui-même et les autres, pour disposer d'un nom, le nom d'un père qui accepte, et le fils et la mère; un nom autour duquel le groupe pourra se reconstituer comme autour de la loi et non plus hors-la-loi autour de l'enfant innocent qui n'en a pas. Simon rencontre Philippe, un grand ouvrier qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés, qui épousera sa mère au terme du récit.
– Mon papa, dit-il, c'est Philippe Remy, le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal.
Philippe Remy promis!
Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit, et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupes et se mirent à chuchoter.
Un élève s'approche, il veut me parler, de ce qui s'est passé la veille dans la salle d'informatique alors qu'il travaillait avec deux camarades. L'un l'a frappé sur la tête sans raison apparente. Je m'assure d'abord que chacun d'eux a un père, c'est le cas.
Le temps passe et je finis par m'approcher des deux acteurs absents jusque-là qui m'avouent ne s'apprécier que très partiellement, ils en sont venus autrefois aux mains, aujourd'hui ils en restent aux mots, des mots qui volent comme des coups.
L'étonnant de l'affaire c'est que pour s'armer et entamer l'intégrité de l'adversaire, chacun fait siens les mots convenus de notre temps, chacun reproche en effet à l'autre d'avoir un comportement monstrueux à l'égard de ses propres parents.
– Toi tu insultes ton père!
– Toi tu es un enfant-roi!
Moi j'ai trouvé! L'histoire de ces deux élèves retrousse le récit de Maupassant comme un gant. Si les gamins du village de Normandie se constituent en une bande solide en excluant Simon parce qu'il n'a pas de papa, deux gamins – et d'autres à coup sûr – de mon village s' accusent l'un l'autre, dans un miroir, non pas d'en manquer mais de vouloir s'en débarrasser.
Il faudrait aujourd'hui écrire une nouvelle histoire, celle de Pierre, Jacques et Jean, des gamins de onze ou douze ans qui ont tous un bon papa, mais qui sont dans le regret de ne pas avoir à leur disposition un petit Simon, une chose extraordinaire, monstrueuse, un être hors de la nature. L'histoire raconterait comment la communauté des gamins – et des adultes – retrouve la paix en conduisant Pierre, Jacques ou Jean au parricide.
Cette histoire me dit quelque chose...
Jean Prod’hom
Deux fois ravi

Il est un peu plus de 10 heures 30 et les élèves travaillent en silence un beau conte de Maupassant, Le Papa de Simon.
Désoeuvré, j'aperçois à travers la vitre de l'une des fenêtres aux cadres turquoise de la villa du Chemin du Mottier un vieil homme qui s'affaire. Dans le ciel file un merle à tire-d'aile, il stoppe son vol, pieds joints sur une branche basse de l'un des trois pins qui se dressent là, devant moi à deux pas... Je me réjouis.
Je me réjouis de ce que l'école, malgré l'orientation qu'elle a prise depuis le commencement, soit encore si proche de ceux qui n'y sont plus et que j'aperçois de temps à autre par les grandes baies vitrées de la classe, enchanté que l'école se dresse en compagnie des arbres et des merles à l'air libre.
Tandis que les élèves s'enfoncent dans une petite ville de province et rejoignent Simon au bord de la rivière, Philippe Remy dans sa forge, Blanchotte dans la chambre, je demeure la tête hors de l'eau, perds le fil de ce pourquoi je suis là, observe les feuillus, nus, qui se dressent dans la pelouse interdite, je devine plus loin le Gros-de-Vaud, le Jura et l'Amérique.
Dans le même temps pourtant, je me sens abandonné, exclu du monde, habité par le sentiment tenace de jouer une partie dans une réalité moindre. J'aimerais être ailleurs, dans le bruit du monde ou le creux des ravins, vivre à mon tour et ne rien attendre, obtenir l’immédiat et m’en suffire.
Comme souvent alors je songe à quelques mots d’Yves Bonnefoy qui me suivent depuis tant d'années.
Il me semble dans ces moments qu’en ce lieu ou presque: là, à deux pas sur la voie que je n’ai pas prise et dont déjà je m’éloigne, oui, c’est là que s’ouvrait un pays d’essence plus haute, où j’aurais pu aller vivre et que désormais j’ai perdu.
Yves Bonnefoy, L'Arrière-Pays
Albert Skira, Paris, 1972
Le mirage a creusé un manque qui m’a écarté de la route, il m’a déposé nulle part, à deux pas de mes rêves, plus proche que jamais des êtres qui s'éloignent.
Jean Prod’hom

Un ancien élève écrit à la rédaction du Journal, il souhaite que deux textes qu'il a rédigés à l'occasion d'un atelier d'écriture, il y a sept ans, soient retirés du site du Journal, ils lui rappellent de bien mauvais souvenirs, c'était une difficile époque de sa vie. Je retire donc du site les liens qui conduisent à ces deux textes.
Mais Google est une grosse machine mémorielle qui prend un temps important avant de nettoyer les résultats de ses explorations, si bien que, chaque fois que cet ancien élève tape son prénom et son nom sur Google, ceux-ci apparaissent sur une page, suivi de quelques-uns des mots que cet ancien élève veut bannir du monde.
Lorsqu'on tente de télécharger ces deux textes, par un clic sur les adresses fournies par Google, celui-ci signale son impuissance par les mots: Objet non trouvé! Error 404. Ces textes n'existent plus en effet sur aucun serveur. Ce que l'élève voit lorsqu'il tape son prénom et son nom, ce ne sont plus ses textes proprement dits, mais l'empreinte qu'ils ont laissée, des simulacres qui rappellent qu'un objet a existé mais qu'il n'est plus là.
L'élève m'envoie alors plusieurs jours de suite un message dans lequel il me prie instamment de supprimer ces empreintes. Je n'en suis pas capable et j'ai beau le lui répéter; je lui soumets pourtant quelques solutions qui ne le convainquent pas: s'adresser directement à Google – mais il n'est pas si aisé de s'attaquer à une pieuvre géante –, attendre et espérer que la blessure s'atténue, ou renoncer à vouloir supprimer les empreintes de ce qui a été.
Car on ne se débarrasse pas si aisément de son passé. Et comment pourrait-il en être autrement? Comment vivraient les hommes s'ils n'avaient aucun accès à l'ensemble des événements qui les constituent? On ne se refait pas dans la vie comme au poker!
Cet ancien élève est-il condamné désormais à taper son prénom et son nom, indéfiniment, pour s'assurer que rien de son passé ne fait retour? A vouloir escamoter les traces et les images de celui qu'on suppose avoir été, on se condamne aux travaux de Sisyphe. Le déni n'amène aucun réconfort, rien ne nous garantit qu'aucune trace n'existe ici ou là, que nous ne rencontrerons pas, au moment où on s'y attend le moins, demain ou après-demain, celui qu'on avait voulu voir disparaître.
Il est vain, logiquement et ontologiquement, de vouloir s'assurer de l'inexistence de quoi que ce soit.
Jean Prod’hom
Jouer dehors

Hier, Marc, un très bon élève discute avec une enseignante. Ils avaient déjà parlé la veille de l'utilisation de l'informatique dans la rédaction des rapports de TP. Ils parlent alors de choses et d'autres, du dossier d'évaluation, des TP encore, de ce début d'année en septième secondaire baccalauréat, du travail pour le lendemain,... Tout va pour le mieux!
Sinon qu'au moment de se quitter, en réponse à une question sur le travail à faire à la maison, Marc répond:
– Ça va,... Ça fait trois semaines que je ne suis pas allé jouer dehors!
Jean Prod’hom
Dans une mandorle

Chaque année B glisse dans notre casier de la salle des maîtres un dépliant publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS) intitulé La Population de la Suisse. Notez que je ne le lis pas soigneusement chaque année – notre pays est en effet si bien réglé que nous semblons suivre sans broncher la pente calculée par nos offices de statistiques.
Je reçois donc, avec l'année de recul qui convient pour réaliser de tels travaux, les statistiques 2007. Je prends le parti cette année de les lire avec attention. Je me coule un bain et me noie dans les chiffres.
J'apprends tout d'abord que la Suisse compte 34 jeunes gens pour 100 personnes en âge de travailler, alors qu'ils étaient 76 en 1900. A l'inverse, le nombre des personnes âgées qui dépendent de ceux qui travaillent a doublé. Cette inversion ne revient pourtant pas au même, il faut le répéter, nous sommes un peuple de vieux!
J'apprends aussi que l'espérance de vie en 1900, et j'en tremble rétrospectivement, se montait à 49 ans pour les femmes et à 46 pour les hommes. Nous pouvons aujourd'hui, et c'est heureux, rêver à une prolongation, presque une seconde mi-temps.
J'apprends encore qu'il existe plus de Suisses qui quittent leur pays que de Suisses qui y reviennent. Ça n'est pas un très bon signe! Un meilleur? 668'100 Suisses sont établis ailleurs dans le monde!
Quant aux hommes ils se remarient plus facilement que les femmes, je les devinais moins naïfs. Il faut savoir en outre que près d'un tiers des mariages en Suisse sont des remariages, c'est-à-dire des unions où au moins l'un des deux partenaires est divorcé-e ou veuf/-ve. C'est beaucoup et ce chiffre démontre l'obstination de nos ressortissants à persévérer dans un domaine abandonné par beaucoup.
Demeure la pyramide des âges, que l'on croyait stable mais qui n'a plus rien à voir avec les illustres tombeaux construits pour l'éternité. A moins que...
La pyramide des âges en Suisse comme en Europe cache en effet de moins en moins sa vérité mortelle. Elle s'est faite champignon, champignon atomique, qui jette toujours plus haut dans le ciel son large anneau de promesses sombres. L'Europe explose, tous nos vieux – femmes et hommes égaux enfin tous ensemble dans la même mandorle – sont poussés année après année vers le ciel, toujours plus haut, toujours plus nombreux. Assomption!
L'explosion n'est pas terminée, nous sommes à mi-parcours, chapeau pointu. Il nous reste encore quelques années avant que nous ne retrouvions la stabilité d'une nouvelle pyramide, cul par-dessus tête. Il nous faudra alors remettre nos représentations à l'endroit: quelques enfants en haut près du ciel et les vieux en bas, en pagaille près de la terre où on redevient poussière.
Jean Prod’hom
Coup de pouce

Je reçois il y a quelques jours un mail d'un jeune électricien de Genève. Il me prie de retirer du site du Journal de l'Etablissement un texte qui y figure. Pourquoi cet ancien élève dont le nom ne me dit rien souhaite-t-il que ce texte disparaisse du site? Le texte était-il si mauvais, lui rappelait-il de mauvais souvenirs? Je vais immédiatement le consulter et comprends alors la méprise. L'électricien genevois n'en est pas l'auteur!
Il s'agit en fait d'une lettre argmentative écrite en juillet 2003 dans le cadre du Certificat d'études par Jonathan, un excellent élève dont je me souviens bien. Pour la faire figurer sur le site comme exemple, j'avais estimé judicieux de substituer aux prénom, nom et adresse réels qui figuraient en tête de sa lettre, des prénom, nom et adresse fictifs.
Par un pur hasard j'ai choisi ce jour-là un prénom et un nom que portait déjà un adolecent genevois bientôt électricien.
Celui-ci n'avait donc jamais été un élève du Mont-sur-Lausanne. Quant à l'adresse mentionnée en tête de la lettre, elle aurait dû lui suffire, au risque de se compter parmi les fous, pour ne pas faire de lui-même un autre...
C'est en recherchant les occurences du prénom et du nom des deux homonymes sur Google que j'ai compris peut-être l'intention de l'électricien genevois. Google place en effet en tête de sa liste de résultats la lettre argumentative de l'élève fictif du Mont-sur-Lausanne – et non pas les coordonnées de l'entreprise d'électricité que met sur pied le jeune loup de Genève. En me priant de retirer cette lettre qu'il savait ne jamais avoir écrite, l'électricien genevois espérait que je lui libère la première place et offre à sa nouvelle entreprise un avenir dégagé de toute ambiguïté.
C'est ce que j'ai fait sur le champ. Laissons vivre les petites et moyennes entreprises!
Jean Prod’hom
Souhaitable

– L'école demain?
– Et bien pêle-mêle je te répondrai qu'il serait souhaitable que chaque élève dispose d'une boîte dans laquelle, pour ne pas se perdre, il regroupe quelques objets ramassés au bord du chemin, rencontre un jour celui qu'il n'a pas choisi, citoyens tous deux demain, non pas pour en faire un ami, mais pour mieux comprendre ce dans quoi nous avons été précipités, cède sa place chaque fois qu'un autre prend le risque de dire ce qu'il a à dire, use de la liberté ailleurs que dans le choix de ses chaussures ou d'une boisson, ait l'occasion de rencontrer la loi, possède quelques objets qui survivent plus de quatre saisons, s'assure qu'il n'est seul et partage une part de l'imaginaire du monde, suive le chemin imprévisible de la mouche sur la vitre lorsque le printemps revient, aperçoive la porte qui se cache au fond de l'ennui, saisisse que ce que la tradition lui remet est sans prix, dorme les heures qu'il lui faut pour mieux se réveiller parfois à l'aube, ne mange pas seul à midi et le soir, dispose d'un tamis pour distinguer, lorsqu'il le faut, le grain de l'ivraie, apprenne à ne plus craindre ni la nuit ni les carrefours, et quelquefois, les soirs bleus d'été, foule l'herbe menue...
– Halte! ce n'est pas nouveau!
– Et ce ne sont que des mots!
Jean Prod’hom
Lipp et Genevay

Les fossoyeurs sont à la tâche dans le canton de Vaud, on nous demande en effet d'enterrer une certaine manière d'enseigner le français. L'entreprise de renouvellement, qui a débuté avec Maîtrise de français en 1979, va s'interrompre au cours de cet hiver.
La Direction générale de l'enseignement obligatoire du canton de Vaud a demandé aux établissements scolaires du canton de décider dans les jours qui viennent de la prochaine ligne de matériel qui sera désormais utilisée dans nos classes. Les discussions vont bon train. Nous avons à choisir entre deux collections, françaises toutes deux. Beaux livres, belles brochures dont nous saurons à coup sûr disposer. Ces ouvrages font l'impasse pourtant sur l'observation fine que nous proposent depuis près de trente ans Lipp, Besson, Genevay, Genoud, Nussbaum et leurs successeurs.
C'était hier à midi à la salle des maîtres, des collègues évoquaient les difficultés de certains élèves à analyser le groupe la tienne dans:
Marthe, Louise a perdu toutes ses bagues, tu as de la chance, la tienne est à ton doigt.
Hésitant, je demande ce qu'il en est.
– Un pronom possessif!
Chacun opine; c'est en effet l'analyse que propose le ministère de l'éducation nationale française – je suis allé voir – dans son Bulletin officiel spécial (6) du 28 août 2008. Mais cette appellation n'est-elle pas réductrice? S'agit-il d'un pronom? En quel sens?
L'analyse que proposaient Genevay, Lipp et Schoeni, conseillés par Huot, Delesalle et Corblin (Français 8e Notes méthodologiques, Grammaire, LEP, 1986, 39–54 ) fait voir ce que nous allons perdre.
Le groupe la tienne est traditionnellement – une tradition vers laquelle nous sommes donc conviés à retourner – rattaché aux pronoms possessifs. Or les deux groupes toutes ses bagues et la tienne ne sont pas coréférentiels, et seul manque dans le second groupe un nom pour le considérer comme un groupe nominal. Les auteurs romands remarquent aussi que le groupe la tienne contient un déterminant comme n'importe quel groupe nominal, auquel il est préférable donc de l'apparenter, d'où son appellation de groupe nominal sans nom réalisé. En résumé, le groupe la tienne contient un déterminant identifiant (la), une suite du nom (tienne) et fait l'impasse sur le nom noyau. Quant au mot tienne, il joue un double rôle: suite du nom bague (nom non réalisé auquel il s'accorde en genre et en nombre) et reprise pronominale du nom Marthe. Il fallait le démontrer!
Cette analyse ne trouvera plus grâce. Son plus gros défaut? N'être indexée que trois fois seulement sur Google?
Il m'a semblé hier à midi que l'affaire était donc jouée, que le tournant avait été pris et que nous retournions d'où nous venions. On s'y fera en peu de temps, j'en suis sûr. Et puis, ce que nous allons perdre peut-être du côté de la finesse sera compensé par les bénéfices que nous récolterons: nous vivons la fin de l'isolement du canton de Vaud et de la Suisse romande dans le concert de l'enseignement du français. Ce n'est pas rien! A la vôtre!
Jean Prod’hom
Dimanche 30 décembre 2008

Ils étaient encore il n'y a pas si longtemps - vingt, trente ans? - sur les bancs d'école, je les vois encore distinctement, ceux du premier rang, du centre, du fond ou des issues,... Ils ont si peu quitté la classe que j'ai proposé à ceux d'entre eux qui regrettaient de ne pas pouvoir aider leurs enfants dans le domaine de l'analyse grammaticale pratiquée aujourd'hui dans nos régions – ils n'ont connu ni Chomsky ni Benveniste – de me rejoindre un prochain samedi matin dans la salle 11 pour un recyclage. Plusieurs se sont annoncés, ils n'ont pas quitté l'école, le rendez-vous est pris, j'organiserai donc sous peu un nouveau raout grammatical.
Ce qui m'a frappé chez toutes ces mères et tous ces pères – près de cinquante – rencontrés hier soir, c'est la prédominance d'un mélange, celui du sérieux, de l'attention et de la dérision, c'est-à-dire l'esprit de légèreté! Ils n'ont pas quitté définitivement l'enfance, leur oeil, à peine moqueur, s'allume à tout instant comme celui de leurs enfants. Est-ce à dire qu'ils sont les mêmes? Non!, ils ont en plus ce dont manque l'enfant et que l'école contribue à lui apporter, l'art de la bonne distance.
Au centre de la fête, donc les absents qui ont, j'en suis tout à fait certain, trouver une raison pour de ne pas regretter l'absence de leurs parents.
J'aurais voulu qu'ils puissent un instant écouter les propos - sérieux, attentifs et dérisoires - qui les ont entourés tout au long de la soirée et puiser dans la confiance lucide de ceux qui les accompagnent, l'équanimité qui transforme les apprentissages en théâtres, drames et mystères. Voeu de Pygmalion! ils n'ont pas assisté à la scène et tant mieux. Peut-être l'ont-ils imaginée et cela suffit bien; car si nous, parents et enseignants, sommes avec eux des locataires du réel, pour eux des représentants du symbolique, nous sommes aussi loin d'eux les hôtes de leur imaginaire.
Nous avons hier soir élèves, parents et enseignants passé notre examen.
Jean Prod’hom
Silence

Au terme d'une analyse du texte de S paru avant-hier sur le blog11, qui raconte l'héroïsme ordinaire de cinq adolescentes, je prends conscience à près de midi que le clapotis qui agite l'estomac des élèves est sur le point de submerger mes commentaires comme une marée d'équinoxe. La déception guette. Je comprends même qu'il y a urgence et qu'il me faut faire vite quelques chose si je ne veux pas que la demi-heure qui nous reste ne passe dès à présent au bilan des pertes.
Je me tais donc séance tenante. Dans ces circonstances, le silence est un opérateur redoutable: j'aperçois les élèves redresser le buste, les sourcils se lever. Je maintiens l'instant à bonne hauteur pendant un temps qui apparaît à certains comme l'image exacte de l'éternité. Il me faut une pincée de courage et beaucoup d'obstination – ce n'est pas si simple de suspendre nos actes lorsque quelque chose se défait et laisser, encalminés dans le pot-au-noir, la main au silence.
Je tiens donc le coup et complète leur stupeur en les obligeant à disposer sur le champ de la liberté pour réaliser, seul ou avec d'autres, quelque chose qui trouve son sens dans ce qu'on vient de voir. Je me retire ensuite du devant de la scène, m'assieds derrière mon bureau et boutique.
Leur stupeur double d'intensité et le silence d'épaisseur avant que tout ne bascule de leur côté. Il ne faudra en effet que quelques secondes pour qu'un premier groupe s'agrège, puis un second. Tous les élèves, debout ou assis au coin d'une table, parlent, négocient, rient, proposent...
Un élève interrompt la rumeur, irrépressible, qui gonfle.
– Monsieur, on a le droit de ...
Je l'interromps avant qu'il ne termine, craignant que la réponse circonstanciée qu'il attend ouvre la voie à mille autres questions du même acabit – je sais l'affaire – et entame leur liberté.
– Désormais, sachez-le, je réponds par un oui à toutes vos questions!
L'oeil encoquiné de certains m'avertit que je ne perds rien pour attendre et que je pourrai regretter ma réponse. Je ne bronche pas si bien qu'ils reprennent leur commerce et leurs négociations.
La demi-heure a passé dans la colonne des gains et a ouvert un imprévisible horizon. J'entends alors un clapotis, c'est mon estomac qui m'appelle à d'autres réjouissances, il est midi.
Jean Prod’hom
Patchwork

Fin de journée en eau de boudin, carottes rouges et poireaux. Ce que j'ai mis en place est un peu juste, un rien a fait vaciller une architecture fragile. C'est bien sûr à cause des autres, les temps sont pourris, je suis le mal aimé, d'ailleurs c'est bientôt la fin du monde...
Les dix minutes qui suivent la fin des cours, je les passe seul et épuisé dans la salle d'informatique, en compagnie des quinze ordinateurs qui ronronnent; les mots bienveillants d'un collègue finissent de me remettre la tête d'aplomb, mais je ne suis pas en mesure d'exiger de mon esprit qu'il mette de l'ordre dans les quelques pensées qui m'ont accompagné ce matin et cet après-midi tandis que je traitais de la syllabation, que j'évoquais Balboa découvrant le Pacifique ou que les élèves inventoriaient les désignations du Grand Meaulnes.
J'aperçois, je ne sais où dans cette salle déserte, pêle-mêle, des morceaux de réflexion, des lambeaux de pensées,... et quelques pépites pour survivre et ne pas désespérer complètement, les satisfactions paradoxales que m'apporte l'enseignement de la syllabation et des accents, les lignes sur le tiret dans le Traité de la ponctuation française de Jacques Drillon et la délicate question de l'accord du participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir, qui apporte tant de plaisir à Pascal Quignard lorsque leur complément est un nom féminin.
J'aurais tenté – si les précautions matérielles de l'ingénieur avaient été à la hauteur des ambitions pédagogiques de l'architecte – de mettre bout à bout tout cela, à quoi j'aurais ajouté pour border le patchwork de ma difficile journée la liste des problèmes de peu d'envergure que je rencontre chaque jour et qui ont fait de cette fin d'après midi quelque chose comme la fin du monde, bien sombre si je ne l'avais sauvée en soirée par la découverte sur mon ordinateur de la combinaison-clavier du tiret.
Jean Prod’hom
Emancipation

Doit-on réveiller Hegel ou sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de l'esprit? L'ancienne dialectique qui devait conduire à l'émancipation de l'élève n'est en effet plus exactement ce qu'elle était. Je reçois, il y a quelques jours, d'un élève le mot suivant:
A cause des problèmes sérieux de mon ordinateur ces derniers temps, je suis dans l'impossibilité de mettre dans mon classeur l'ancienne version de mon texte pour le blog 11 car elle a été supprimée.
Si vous désirez plus de détails, faites-le-moi savoir demain.
Meilleures salutations et bonne fin de soirée.
Une collègue me signale ce matin cet autre message trouvé au bas d'une évaluation d'allemand:
PS: Si vous n'arrivez pas à lire, veillez me contacter!
Jean Prod’hom
Dimanche 23 novembre 2008

C'est le moment pour moi d'avouer que les manuels scolaires me tombent des mains. D'avoir autrefois participé à la rédaction de l'un d'eux n'y change rien.
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé; avant chaque nouvelle année et son cortège de nouveaux élèves, je m'imagine être en mesure d'en faire usage - de quelques-uns au moins. Et puis en août, sitôt que nous entrons en scène, je les regarde méfiant, les écarte de l'avant-scène, les éloigne plus loin ensuite dans les rayons d'une bibliothèque pour ne plus y repenser dès Noël.
Mais je le répète et je le dis tout haut, je n'ai jamais pris la résolution d'y renoncer, les manuels scolaires finissent tout simplement par me tomber des mains. Et il faut savoir que cette affaire n'est pas sans conséquence, elle me prend la tête et beaucoup de mes forces, je crois même que le gros de mon travail en début d'année consiste à penser ou à imaginer le chemin qui m'évitera de toucher aux manuels scolaires.
Et s'ils me tombent des mains, ce n'est pas en raison de leurs qualités - car chacun d'eux en a à revendre - c'est parce que je suis incapable d'en faire un usage efficace, de trouver la distance qui convient pour disposer de leurs trésors et en faire partager les élèves.
Et puis, et surtout, les manuels scolaires me mettent profondément mal à l'aise. Ils sont en effet organisés autour d'une double perversion, celle de toujours cacher leur jeu - mais pas trop pour ne pas perdre l'élève -, et celle d'escamoter l'essentiel - avec la louable intention de le faire découvrir par l'élève lui-même. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi du genre!
(La perversion des manuels scolaires, et donc de l'enseignement dans certaines de ses dimensions, trouve une belle illustration dans le film de Marguerite Duras intitulé Les Enfants (1984), "un film comique infiniment désespéré dont le sujet aurait trait à la connaissance". C'est l'histoire d'Ernesto qui refuse d'aller à l'école parce qu'on y apprend ce que l'on ne sait pas. Ou qu'on y apprend ce que l'on sait déjà.)
Noël approche et les manuels scolaires ne sont plus sur mon bureau, ils attendent un peu plus loin leur exil annuel...
Mais par un hasard ou une ruse de la raison, je crois avoir, il y a peu, dépassé l'aporie dans laquelle je me trouve, surmonté le malaise que j'éprouve.
Depuis août en effet, je travaille avec vingt-six élèves, des élèves vifs à très vifs. Dans l'impossibilité de construire avec l'ensemble du groupe les fondations des trois ans qui viennent, j'ai distribué il y a quelques semaines à chacun d'eux une brochure intitulée Activités en grammaire 7e, avec la fort discutable intention d'occuper l'esprit et les mains de la moitié d'entre eux, à tour de rôle, de les faire patienter donc, pendant que je me consacre à l'autre moitié et à des activités plus louables.
Ils se montrent gloutons sans saisir ce que les auteurs de ce manuel avaient en vue en le rédigeant. Comment les arrêter donc dans une activité qui ne mène nulle part? Tenter de moraliser leurs actions et leur comportement en leur demandant de ralentir, mieux comprendre, s'arrêter, relire,... n'aurait conduit à rien! Les laisser aller sans autre forme de procès eût été une nouvelle perversion ajoutée à celle qui structure ces Activités en grammaire 7e.
Plutôt que de laisser l'élève se faire embarquer dans son sillage, il me fallait donner à l'élève les moyens d'observer le travail de cette perversion. J'ai donc fait ma petite révolution copernicienne.
L'objectif que propose désormais aux élèves, ce n'est plus de maîtriser les contenus que les auteurs ont brillamment mis en scène (subordonnées, relatives, compléments, effacement du sujet,...), mais de dégager et de maîtriser l'architecture de ce manuel, les titres, les enchaînements des parties, les dispositifs proposés, les intentions des auteurs, les implicites, les présupposés, les difficultés des auteurs, les faiblesses, les leurres...
L'élève sera gagnant deux fois, j'en suis convaincu: d'abord parce qu'il aura étudié un type de texte avec lequel chacun d'entre nous a été, est ou sera aux prises pendant plus de neuf ans. Mais encore parce que, pour parvenir à dégager les caractéristiques de ces Activités en grammaire 7e, il aura dû comprendre, passage obligé et autre ruse de la raison, tout ce que l'auteur a voulu lui faire découvrir. Mais l'élève l'aura fait loin des perversions. L'honneur de tous sera sauf, l'élève aura rédimé les perversions du maître.
J'appelle bon manuel scolaire le manuel qui se prête à ce jeu de retournement.
Jean Prod’hom
Trésy des Amoureux

Avec quelques élèves qui ont terminé l'inventaire des prénoms de tous les êtres qui les entourent et qu'ils aiment, j'écoute les noms de lieux que Valère Novarina a scandés en 2007 à l'occasion de l'émission A voix nue d'Odile Quirot.
Me parviennent alors par un canal dont j'ignore le tracé quelques syllabes sonores d'un nom de lieu que Novarina ne dit pas, Trésy des Amoureux.
Je mets ces quelques syllabes de côté et les élèves au travail; casquée comme un pilote long courrier, sous le regard curieux de ses camarades, M égrène le chapelet de prénoms de ceux qu'elle aime et qu'elle a mis en page comme un poème. Pas si simple de donner une allure sonore à cet objet, l'architecture et l'intention manquent encore, mais le texte de Valère Novarina et ce que recèle le nom de Trésy des Amoureux me rassurent.
C'était au printemps 1991, je venais de lire le texte de Jacques-Etienne Bovard sur la Venoge. Nous avions organisé, un collègue et moi, une balade de trois jours sur ses rives, de Saint-Prex à l'Isle en passant par Cuarnens la honte, Nous avions intitulé cette sortie de fin d'année: De l'Enfer au Paradis en passant par Trésy des Amoureux. Trois belles journées, têtes à l'air, dont je me souviens jusqu'aux moindres détails. Et si ceux-ci demeurent vivants aujourd'hui, c'est, je crois, par la grâce sonore de Trésy des Amoureux.
Jean Prod’hom
Dimanche 16 novembre 2008

Le ciel est gris au Riau. Sur la crête du Bois Vuacoz de haut sapins dégarnis jusqu'au cou montent la garde; ils tournent le dos au sud et contrôlent l'horizon de l'orient à l'occident. Ils ne voient rien venir et ne s'amusent pas du ruban de fumée blanche qui déroule ses volutes irrégulières en contrebas. C'est la fin des travaux des champs, les tracteurs sont alignés sous les couverts.
Je suis seul à la maison, avec Fleur qui sommeille à mes côtés, et je peine à faire ce que j'ai à faire. Je pense au saint Augustin de Carpaccio, l'oeil fixé depuis quelques siècles sur une réalité que le peintre tente de déchiffrer et à laquelle, plume suspendue, il tente de donner une forme, le saint n'a encore rien écrit. Plus tard peut-être... si le petit chien blanc assis à ses pieds ne le détourne pas de sa tâche et ne l'emmène pas dans les ruelles de Rome ou de Milan.
La fumée blanche a cessé de virevolter, il est grand temps de me mettre au travail. Je prépare le plan de la réunion des parents du premier décembre, transcris le nom des enseignants qui interviennent dans la classe, attribue à chacun un temps de parole, décide de l'ordre de leur intervention. Je diffère encore un instant le coeur de ce que je m'étais proposé de faire... Que vais-je dire aux parents? Qu'attendent-ils? Je sens bien que je me pose les justes questions mais suis incapable de trancher. Je liste donc quelques-uns des points qui animent mon travail et sont susceptibles de les intéresser, les réconforter, les rassurer. J'écris donc sur un bout de papier...
- Agenda, dossier d'évaluation et travaux en cours
- La bonne distance, le nez dans le livre, l'esprit dans les nuages
- Apprendre mine de rien et la loi du moindre effort
- Christophe Colomb, Jules Verne, le manuel d'histoire
- Initiative personnelle et réévaluation
- Extraire, copier, citer, conjuguer les voix, dire, signer, la question de l'identité
- Liberté individuelle et détermination sociale
- Dedans et dehors, ami et collègue, texte et marge
...
Je m'interromps craignant que la liste ne s'allonge et que je ne sois plus en mesure de décider quoi que ce soit.
Je déciderai demain ou après-demain, c'est à dire au moment voulu. Le ruban de fumée virevolte à nouveau et Fleur frissonne. Il est temps de la faire sortir.
Jean Prod’hom
Scène de lynchage

Il est 10 heures et c'est mercredi, jour de surveillance. Les élèves semblent paisibles, ils couvent et nourrissent ici et là ces écheveaux d'histoires qui n'ont pas quitté les préaux depuis des décennies, et dansent malgré quelques mouvements hasardeux un ballet statistiquement prévisible. Je demeure immobile au centre de la cour et, orienté sud-ouest / nord-est, je profite des rayons vifs du soleil chauffé à blanc en leur interdisant de se mêler à l'air froid qui vient du golfe de Gascogne. Romain me rejoint et on échange quelques mots.
Lorsque j'aperçois à ma gauche un groupe d'une quinzaine d'élèves qui se précipitent en un point et entourent sourire aux lèvres un objet que je ne distingue pas; je laisse filer l'affaire et, sans essayer de décrypter les règles de l'étrange jeu auquel se livrent les adolescents, je songe un instant à la course au Caucus qu'organise le Dodo dans Alice au pays des merveilles. On poursuit avec Romain l'échange commencé.
A nouveau attiré sur ma gauche par d'étranges bruits, je me retourne et vise les mêmes adolescents que tout à l'heure qui projettent vigoureusement du pied une bouteille de plastique qui virevolte. L'innocent désordre se brouille tout à coup, on n'entend plus la bouteille de plastique raboter le sol et un silence abyssal creuse l'instant comme avant le tonnerre. Tous les adolescents se jettent alors avec précipitation en un point, rient et crient aux éclats, entourent un objet qu'ils battent et frappent sans retenue.
Je prends conscience alors que cet objet n'est pas objet, mais l'un des leurs désigné comme l'anthropologie nous l'a appris par le hasard. C'est l'un des leurs qu'ils tentent de réduire à un objet, qu'ils font disparaître sous leurs cris et leurs coups. Il ne s'agit pas d'une innocente course au Caucus, mais d'un lynchage collectif.
Je l'entends déjà m'expliquer qu'il n'est pas le seul à participer à ce jeu, que ce sont les autres; je les vois trop bien, le sourire aux lèvres arguant avec conviction qu'il ne s'agit que d'un jeu, qu'ils sont tous tour à tour des victimes consentantes. J'aurai beau leur dire que l'anthropologie a déjà la vérité sur tout cela, j'aurai beau citer mille sources, les renvoyer à l'histoire qui racontent ces scènes et les fous rires sinistres qu'elles ont engendrés; rien n'y fera car ils sont devenus fous l'espace d'un instant, possédés par la meute qui dicte parfois sa sotte loi.
Je ne leur dis donc rien mais hurle comme une bête, les anges disparaissent alors en un vol organisé, comme les étourneaux à la fin de l'automne lorsqu'ils ont pillé les labours.
Dispersés ils tournent dans la cour bras ballants, un étrange sourire pend à leurs lèvres qui pincent et retiennent ensemble la culpabililité et l'innocence.
J'ai été à nouveau inquiet ce matin à 10 heures 30.
Jean Prod’hom
Comme le Petit Poucet

Notre école n'est pas généreuse en toutes circonstances, ou n'a pas toujours les moyens de sa générosité de principe. Il me semble en effet que le fonctionnement effectif de notre école condamne en quelque sorte l'élève qui n'a pas pris la mesure d'une problématique sérieuse, au moment voulu par l'institution, à y revenir de son propre chef et à l'éclairer de ses lumières intérieures.
Pourquoi? Parce que nous nous méprenons sur la fonction de nos programmes d'enseignement. C'est la confusion en effet entre les prescriptions de ceux-ci et les curricula effectifs de nos élèves, entre ce qu'ils sont supposés savoir et ce qu'ils savent effectivement qui nous conduit à rabattre le temps complexe de chacun d'eux sur le temps idéal qui rythme nos programmes.
C'est l'imparfaite prise en compte par l'institution de la relation de ces deux temps qui amène, me semble-t-il, beaucoup de nos élèves à passer à côté de ce qui est prescrit; c'est ce mécompte qui nous conduit, nous enseignants, à verser avec effet immédiat ceux de nos élèves qui n'ont pas su - au tempo programmé et par la grâce de l'enseignement prodigué - dans le groupe de ceux qui sont supposés savoir. Il n'y a plus qu'un pas pour faire de ceux qui ne savent pas, mais qui sont supposés savoir, des élèves qui savent. Si bien que, trop souvent, tous les élèves, qu'ils sachent ce qu'ils sont supposés savoir ou qu'ils ne le sachent pas, font partie lorsqu'ils accèdent au cycle ou degré suivants au groupe de ceux qui sont supposés savoir. Le pas est franchi, on peut désormais compter les dommages.
Pour illustrer la thèse qui précède, il suffit d'écouter certains de nos commentaires en début d'année.
- C'était au programme et ils ne le savent pas!
Faut-il s'en étonner? Je ne le crois pas, mais il convient de ne pas s'en satisfaire et de construire un dispositif tel que cette distance se réduise au fil des ans et qu'elle tende vers zéro en fin de scolarité. Nous avons en conséquence à cartographier chaque région de la connaissance qui se prête à cette opération et dont nous souhaitons une maîtrise définie - le français notamment. En y plaçant, d'un commun accord et à l'échelle de nos Etablissements, comme les douze stations de nos anciens chemins de croix, les douze carrefours tirés du grand livre de nos programmes.
Rendez-vous obligés, abris lorsqu'on est perdu, toujours là; incontournables haltes pour nos élèves et les chemins divers qu'ils empruntent; haltes maintenues en totale visibilité, de l'élève comme du corps enseignant; lieux à significations denses, racontés, annotés, repris, complétés; lieux toujours déjà visités où celui qui ne savait pas peut à tout moment faire la preuve qu'il sait désormais ce qu'il est supposé savoir, mais lieux d'émancipation aussi d'où l'esprit peut cheminer, dans des régions inconnues de nos programmes et que l'élève devenu adulte aura à cartographier demain.
En continuant à bricoler cet objet qui conjugue les nécessités du programme et les réalités des curricula, j'ai proposé aux élèves ce matin ce que j'essaie de mettre en place depuis quelques années, je veux faire en sorte que chaque élève puisse, comme le petit Poucet, revenir à n'importe quel moment sur ses pas pour faire la preuve qu'il sait désormais ce qu'il était supposé savoir et qu'il ne savait pas au moment voulu par l'institution. Mieux encore, je veux l'encourager à faire la preuve, s'il en marque le désir, qu'il sait des choses bien au-delà de ce que prescrivent les programmes. Ainsi...
Réévaluation
A l'élève qui a laissé apparaître dans les domaines dont je suis responsable qu'il n'a pas atteint, à l'occasion des travaux significatifs, le seuil de satisfaction (4), je fais la proposition suivante:
Tu es autorisé à faire la preuve, tout au long de l'année scolaire mais pas au-delà de la semaine 35, que tu maîtrises désormais ce que tu ne maîtrisais pas lors du travail significatif.
Les réévaluations de la maîtrise de ces objets ont lieu pendant les heures d'appui dans la classe 11.
C'est à toi qu'appartient la tâche de préparer le mode que tu souhaites utiliser pour revenir sur ce que tu ne comprenais pas et me convaincre de tes nouvelles acquisitions.
Initiative
A l'élève qui souhaite, dans les domaines dont je suis responsable, aller au-delà de ce qui lui est demandé, je fais la proposition suivante.
Tu peux, tout au long de l'année scolaire mais pas au-delà de la semaine 35, prendre une initiative et déposer un projet au terme duquel tu veux faire voir ce qui mérite d'être vu mais que l'institution scolaire ne prévoyait pas. Avant de te lancer dans la réalisation de ce projet, il te faudra en négocier les modalités et les conditions de succès.
La réussite de cette entreprise sera reconnue par l'attribution d'un 6.
Dossier d'évaluation
L'élève placera les traces de ces épreuves dans le Dossier d'évaluation.
Jean Prod’hom
La vitrine de nos oeuvres

Deux élèves attentionnés m'envoient au cours du week end un commentaire à la note de l'une de leurs camarades consacrée à la lecture d'un récit terminé il y a peu. Leurs deux textes sont malheureusement minés d'erreurs orthographiques que l'un et l'autre auraient aisément pu éviter s'ils avaient pris un peu de ce temps que Dieu a mis à notre disposition pour ramasser les déchets, les ratés, les coquilles,.. que nous sommes immanquablement conduits à produire dans nos ateliers.
Dans nos cours de récréation aussi où les élèves de la classe 11 sont conviés chaque mercredi matin à collecter les papiers multicolores que leurs camarades abandonnent nonchalamment.
Je décide donc de rayer de mes charges mes bons offices de concierge et de ne pas corriger leurs commentaires, à l'inverse de ce que je fais depuis 15 mois, chaque jour ouvrable, à la réception de chacune de leurs contributions. Et j'édite séance tenante leurs deux commentaires.
Le lundi matin, je fais part aux élèves de ma décision en ajoutant sentencieusement que si le blog est bel et bien la vitrine de l'excellence de leur travail, il peut devenir le théâtre de la transformation de leurs vertus en vices.
Un élève m'écoute tout particulièrement - c'est l'un des généreux commentateurs de la veille; il semble avoir compris le message et semble m'indiquer par un sourire qu'il a décidé à l'instant de prendre en main son destin et la vitrine de ses oeuvres. Je m'en réjouis.
A 13 heures 30 donc, je reçois de l'élève son commentaire récrit à nouveaux frais, des erreurs ont disparu. C'est la démonstration partielle que la question de l'orthographe française ne relève pas de l'orthographe, mais d'une décision éthique.
Des erreurs ont disparu certes, mais pas toutes, de nombreuses erreurs clignotent encore. La partie n'est pas gagnée.
Quant à l'autre commentateur pas de nouvelle!
Jean Prod’hom
Josquin Desprez

Alors qu'un élève relevait - dans la troisième partie du court texte que Jules Verne a consacré en 1883 à Christophe Colomb - la mise en place par le roi Ferdinand du premier service mensuel de transport entre l'Espagne et Haïti, son voisin lève la main et, sans craindre les effets du coq à l'âne, demande si le français d'alors ressemblait à la langue que nous parlons aujourd'hui. Je ne comprends pas immédiatement de quelle langue il veut parler; de celle de Jules Verne? de celle des rivaux français de Christophe Colomb? de celle d'avant?
Je renonce à me perdre en conjectures, et selon le principe pédagogique qui veut que c'est toujours l'occasion qui fait le larron, je décide séance tenante de leur faire entendre d'abord un poème d'amour du treizième siècle, un texte un peu plus tardif ensuite écrit par Jean Molinet, dans lequel on repère aisément les empreintes de notre langue et que Josquins Desprez à mis en musique. Je donne aux élèves une copie du texte avant de leur faire entendre l'enregistrement que l'ensemble Jannequin a réalisé.
Anesthésié par la légère fierté que l'on éprouve parfois d'avoir cru avoir bien joué la partie, mon esprit s'égare et je rêve d'autrefois en cette fin de vendredi après-midi.
En raison du caractère fini de tout ce qui nous advient, je me réveille. J'aperçois alors vingt-six paires d'yeux défaits qui ne me lâchent pas: Josquins Desprez n'a visiblement pas passé!
Je m'étonne et me perds dans d'inutiles explications, dresse un faisceau d'arguments, feins l'étonnement,... Rien n'y fait! Les élèves le disent haut et fort: ils n'écoutent pas cette musique. Pire! ils écoutent tout, sauf cela! Pour faire bon poids, une élève musicienne ajoute:
- Je crois, et j'ai une assez bonne oreille, qu'ils chantaient faux!
J'ai donc tout perdu: les élèves n'auront pas prêté l'oreille à la musique qu'on entendait dans les cours bourguignonnes du seizième siècle ni n'auront prêté attention à ce que le français d'aujourd'hui doit au français d'alors.
Il est 15 heures 30, l'heure de se séparer.
Une élève reste seule en classe. Elle me demande alors:
- Voulez-vous écouter la musique que j'aime bien.
Je n'ai donc pas tout perdu, mais je dois sur le champ commencer mon éducation musicale pour leur faire entendre un jour Josquins Desprez.
Jean Prod’hom
La note de l'absente

Tout au long de la journée j'ai attendu. J'ai attendu que l'élève qui nous a quittés il y a un mois m'envoie par educanet l'article promis. Ce mercredi c'était son tour et, le jour de son départ, il m'avait confié, ému aux côtés de sa maman, près du banc nouvellement placé en face de l'entrée de la classe 11, qu'il me ferait parvenir son article.
J'ai attendu donc - diffusément - jusqu'au soir. Avant de me coucher, j'ai jeté un dernier coup d'oeil dans ma boîte aux lettres, j'espérais peut-être secrètement que nous ne soyons pas tous déjà complètement oubliés... Cet espoir fait-il partie de nos métiers? Est-ce une faute professionnelle? La nuit fait son travail, tout cela est oublié.
Et pourtant, j'ai beau me sermonner depuis quelques minutes, quelque chose insiste, quelque chose comme une pensée, une bouffée de pensée, une pensée lointaine, sans forme, archaïque, une de ces pensées qui ne nous lâchent pas. Je sais qu'elle ne se retirera que lorsque je lui aurai donné l'esquisse d'une forme...
Je m'inquiète, je m'inquiète pour l'espèce, dont l'une des particularités constitutives est de pouvoir manquer à ce qui la fonde, de pouvoir être anéantie par ce sans quoi elle ne saurait être. Tout homme peut en effet retirer le gage qu'il a engagé, tout homme peut tromper celui qui lui fait confiance, tout homme peut manquer à sa promesse. Mais quelle serait l'identité de l'homme sans les engagements et les promesses à travers lesquelles il devient et demeure? (Si la confiance, l'engagement et la promesse ne trouvent pas leur place dans les programmes ne nos écoles, c'est d'abord parce que ceux-ci les supposent. Nous avons donc pour tâche prioritaire de les maintenir vivants.)
Quoi qu'il en soit et en guise de réparation je substitue mon geste à celui de l'élève. Et je reprends espoir. N'est-ce pas l'élève qui nous a quittés il y a un mois qui fonde en dernier ressort ces lignes.
Je n'ai plus à ouvrir ma boîte aux lettres, son texte m'est bien parvenu, comme promis.
Jean Prod’hom
Dimanche 9 novembre 2008

Je relis aujourd'hui la note d'un élève publiée sur le blog de la classe 11 vendredi passé. Je repense à sa genèse et à son histoire qui me semblent exemplaires.
D'abord l'élève ne veut pas à tout prix être original, il s'arrête modestement sur un point qui l'aiguillonne.
- Quelles sont les règles d'utilisation des prépositions "à" et "chez". C'est une question, écrit-il que "je me pose presque quotidiennement lorsque je me rends en ville".
N'étant pas en mesure de résoudre seul cette difficulté, ou pour vérifier certaines de ses hypothèses, l'élève se lève et fait des recherches, s'enquiert à gauche, s'enquiert à droite. Immanquablement celui qui cherche trouve, en l'occurrence un site qui lui fournit une petite règle.
Commence alors le lourd travail de rédaction, il s'agit pour l'élève de rendre aux deux voix ce qui leur revient, de les entremêler sans que l'une dévore l'autre, la sienne qui interroge et la voix du site québécois qui répond: polyphonie.
L'élève réussit dans cet exercice difficile et pourtant si essentiel; il maintient en effet à bonne distance les deux voix, les conjugue sans les confondre. On insistera jamais assez dans notre métier sur le travail à entreprendre sur cette question si l'on ne veut pas continuer à recevoir des travaux qui ne sont que des copies à peine transformées de textes d'inégale valeur, que des élèves s'attribuent sans gêne et qu'ils signent sans l'ombre d'une inquiétude.
C'est à l'école certes de faire en sorte que les connaissances de l'élève croissent, mais c'est à l'école de prendre les mesures nécessaires pour que l'identité de chacun ne soit pas bafouée.
Avant de le publier, nous passons une bonne demi-heure à régler encore quelques aspects de son texte, des points de détail qui mènent souvent si loin, au coeur des problèmes. Je passe un de ces moments qui enchantent les enseignants désormais prêts à se battre pour reculer l'âge de la retraite.
Je lui envoie alors un mot, qu'il ne croie pas que la demi-heure passée à reprendre quelques points de son texte entame la valeur de celui-ci, je le félicite pour l'indépendance de son esprit, la recherche honnête qu'il a effectué sur internet, du temps important qu'il a passé à la rédaction de son texte, des égards dont il a fait preuve pour l'orthographe et la syntaxe du français. Et je conclus par l'évocation de l'excellent moment que j'ai passé à retravailler son texte avec lui.
Par retour du courrier, je reçois un mot de remerciement. Je décide de reculer plus encore l'âge de ma retraite.
Jean Prod’hom
Le silence

Une élève posait au fil de sa note une question qui me met mal à l'aise. J'y reviens aujourd'hui.
- Quel serait le sujet de nos conversations, si nous savions tout? demande-t-elle.
Cette question me hante depuis longtemps, elle me hante et me dérange à la fois. Je la comprends bien parce que, plus d’une fois, je me suis trouvé mal à l’aise lorsque, au coeur d’une relation ou d’une communication, un mauvais silence s’installait. Simultanément, c’est une question que je ne peux pas entendre sans un immense malaise - un malaise semblable à celui que j’ai évoqué à l’instant - parce que cette question suppose dans ses plis que nos conversations ne sont là que pour nous divertir d’un silence que nous serions dans l’obligation de rejeter, chasser hors de notre vie.
Le silence n’est-il pas aussi ce qui nous lie, loin du jeu des questions et des réponses? Mais y est-on prêt, y est-on formé? L’école nous invite-t-elle à des exercices de silence?
Je lui conseille d'écouter quelques mots d’un poète, Jean Grosjean, dont j'ai placé un extrait dans la marge du blog 11. Il dit dans Si peu la beauté dont le bon silence est gros. Et puis je lui conseille encore d'écouter quelques mots de Jacques Dupin à propos de ses promenades avec André du Bouchet.
Les écoutera-t-elle?
Jean Prod’hom
Nous irons à pied

- Consommez, consommons!
- Consomme, consommons, consommez! pour que l'on maintienne à tout prix la pente de notre croissance, et la qualité de notre vie actuelle. Et entendez, je vous prie, la raison de ce principe et les dangers que nos sociétés avancées pourraient courir si elles n'honoraient pas ce mot d'ordre!
Pourtant, ce principe lancé à l'unisson par tout ceux qui comptent dans notre monde, me plonge dans une espèce de stupéfaction effrayée, comparable à celle que j'ai éprouvée un jour - c'était un dimanche à Bursins - en voyant un bus rempli d'enfants lancé à toute allure contre un mur; il n'y avait bel et bien aucune autre issue que le mur pour l'arrêter. J'aurais voulu ce jour-là que le bus ne fût pas parti.
Stupéfait, effrayé, je désarme donc devant ceux qui savent et leurs litanies, qui ont la consistance de ces mots obscurs qui tympanisent certains de nos rêves et qu'on se réjouit de voir s'éloigner à l'aube. Mais cette liturgie est bien réelle et ce sont mes rêves qui s'éloignent le matin.
La tête me tourne, car lorsque je me retourne, le soir, pour considérer ce qui reste de ce qui n'est plus, ce qui m'a réjoui, la paix et la confiance indispensables à l'accomplissement du saut inquiétant dans la nuit, je ne vois presque rien: une ou deux choses sans prix: une attention, un geste, une odeur, un mot,... des riens qui n'appartiennent pas aux rayons de nos consommations.
Et ma raison tremble car j'ai la conviction que nous nous ressemblons, et qu'à côté de nos besoins élémentaires, nous ne sommes comblés que par des choses sans prx, la paix et la confiance, hors de prix.
Nous irons désormais à pied.
Jean Prod’hom
La honte

Une honte ? Vraiment?
Mais à quel titre, bon dieu, les journalistes se permettent-ils de disqualifier ceux qui se sont livrés corps et âme à leur passion et à celle de leur public? Qui sont-ils? Qui sommes-nous ? Des héros?
De leur côté, à deux pas, les uns jubilent. Les vois-tu? Ils sont dans le miroir et ils te disent avec la naïveté de ceux qui aiment:
- On s'est livré corps et âme! On aurait pu perdre, on a gagné!
Doivent-ils le regretter? Ils ne t'entendent pas, les gagnants font la fête. Applaudissons! Et allons à l'essentiel... là où tout le monde gagne.
Je suis un maître d'école, je fais au mieux, ce n'est pas simple, tu es un élève, tu fais au mieux, c'est difficile. Mais n'est-on pas sous le même toit?
Tu perds la partie, ne sois pas aigre! je perds ipso facto la mienne. As-tu compris?
Tu comprends et tu avances, tu creuses, tu découvres, je te suis, j'ai fait mon travail, tu as fait le tien, personne n'a perdu, on a gagné. Inouï!
Inouï, il existe des jeux où tout le monde gagne et nous le savons désormais.
Jean Prod’hom
Zep

- Mais au fond, devrait-il encore continuer?
Comment interpréter cette question?
Faut-il, avec les sages, se faire à l'idée que toute chose - bonne ou mauvaise - a une fin?
Ou faut-il entendre que les choses ne sont pas aussi extraordinaires qu'on le prétend? Qu’elles sont même franchement mauvaises?
Je dois avouer que je ne connais pas les aventures de cet homme, je n'en ai lu que quelques pages, une ou deux un jour peut-être, des aventures dont il ne me reste qu'une image, tenace, celle d'un petit homme au visage vieilli, la langue pendante et qui ne sait pas toujours ce qui se dit dans ce qu'il dit.
Mais je me trompe peut-être... et je me promets que, lorsque "Le sens de la vie" passera dans la mienne, je n'hésiterai pas à lire avec soin ce récit. Je pourrai alors en parler et on m'apprendra à cette occasion, si on ne l'a pas fait encore, ce qu’on voulait me faire entendre par cette énigmatique question.
Jean Prod’hom
Identité

Un élève, si j'ai bien compris son propos, pose la difficile question de l'identité personnelle et de la liberté, et il conclut en substance: "Si toutes nos décisions relèvent en définitive des circonstances et du regard que nous portons sur les autres, que deviennent notre identité et notre liberté?"
Une de ses camarades écrit à la suite un commentaire dans lequel elle semble dans un premier temps d’accord avec lui. Et puis, dans un second temps elle se distancie de sa position en affirmant.
- Seules quelques filles sortent du lot et se démarquent avec un style différent...
Il serait donc possible de se démarquer les uns des autres et de tracer son propre chemin, le chemin d’un seul.
La difficulté montre immédiatement son nez: cette recherche du chemin singulier, du chemin unique, du chemin choisi librement, du chemin original, n’est-elle pas la recherche forcenée à laquelle se livre identiquement l’homme moderne?
Ainsi suivre l’autre, dans ce qu’il est et ce qu’il a, ne différerait essentiellement pas de la quête effrénée de l’originalité. On se trouve dès lors dans une impasse et il nous faut conclure que la liberté et l’identité ne se nichent ni dans l’exercice de la solitude ni dans celui de l’appartenance.
Demeure la confiance! L'auteur de la note ajoute sous la forme d'un impératif:
- Il nous faut faire confiance!
Je joins ma voix à la sienne: il nous faut faire confiance, confiance en ce qui est, confiance en ceux qui nous accompagnent sans lesquels nous serions sans identité, loin de la liberté.
Jean Prod’hom
