Funérailles de Joffre

Gustave Roud s’est trompé, la transmission intégrale des spectacles, visuelle aussi bien que sonore, n’a pas rendu la description parlée superflue. Léon Zitrone et Stéphane Bern n’ont pas cessé de nous le rappeler. Mais Gustave Roud a vu juste en écrivant le petit texte qui suit et qui montre que rien ne vaut l’écriture pour dire l’événement qu’a constitué pour nos régions reculées l’arrivée de la radio, qui a mis Paris à portée de nos pas. Qu’ici aussi, dans le Jorat, on s’est tu lorsque le cercueil du maréchal Joffre a passé sur sa prolonge et que le cortège, chose impensable, a traversé nos chambres basses. (JP)
« Un seul déclic et la chambre basse tout à coup résonne de la rumeur d’une foule immense, mais de cette rumeur très particulière de l’attente, faite du contrepoint de mille phrases interrompues et reprises indéfiniment sans qu’un silence total ou des tumultes subits en rompent la monotonie. Puis une voix toute proche se dessine sur la confusion de l’universel murmure ; elle décrit, détaille, commente le spectacle dont seul l’écho aveugle nous parvient et qui est celui des funérailles de Joffre.
Cette formule de « reportage » (comme l’on dit) par T.S.F., où la voix d’un commentateur se conjugue au déroulement sonore d’un événement pour lui assurer un rendu instantané aussi parfait que possible, n’est pas nouvelle, et l’on peut prévoir le temps où une transmission intégrale du spectacle, visuelle aussi bien que sonore, rendra superflue toute description parlée. Telle qu’elle se présente maintenant, avec sa superposition du direct et de l’indirect, semblable retransmission, il faut bien le dire, est déjà quelque chose d’hallucinant. Cette brutale mise en communication, cet espace qui se substitue d’un seul coup à votre espace, cette petite chambre campagnarde qui contient Paris, ce temps qui annule votre temps – car là-bas c’est midi et ici treize heures, et les deux chiffres contradictoires s’énumèrent ensemble – tout aiguise l’imagination et la rêverie. On oublie sans peine tout le mécanisme qui sert de support et de guide à cette chose en train de se produire, là-bas vivante, vivante ici. D’ici, dit la voix, je commence à distinguer le cortège du côté du pont Alexandre III. Le ciel s’éclaire (on le voit s’éclairer). Voici le lord-maire de Londres, ou du moins il me semble le reconnaître tel que je l’ai vu récemment lors de mon séjour dans la grande capitale avec son manteau rouge. M. Chiappe, préfet de police ; il se mouche. Les tribunes se garnissent. Voici le prince de Brabant. Je commence à entendre les fanfares (et presque tout de suite, en effet, de la houle sonore émergent quelques cris de clairons). O cortège ami, que tu es lent à te rapprocher ! Etc., etc… Le rôle du coryphée (dont nous nous amusons à transcrire ici quelques phrases, parce qu’elles indiquent bien sa tâche, qui est, par une suite de détails familiers qui se juxtaposent, de suggérer un tout sans cesse modifié) va diminuant d’importance à mesure que se rapproche le cortège funèbre, et le vent glacé qui se lève (nous dit-il, – on sent aussitôt sa morsure sur son propre visage) paralyse peu à peu sa parole. Et le fantôme de cortège traverse lentement la chambre, le pas des chevaux sur la chaussée couverte de sable, les cuivres qui éclatent et s’éteignent, les tambours anglais comme un gong intermittent, l’infanterie en marche, cette espèce de halètement rythmique des pas scandés, l’artillerie, et le cercueil enfin sur sa prolonge tirée par six chevaux noirs. Une atmosphère est recréée dans sa totalité ; faite de tristesse, de grandeur et de gloire, – avec mille diversions familières, comme cet assaut de photographes trop audacieux auxquels une lointain voix irritée crie : Non, non non, non ! Et déjà, d’une voix liquide, Barthou commence : Monsieur le Président de la République…
Il nous plaît de souligner l’instant où une invention devient assez parfaite pour faire oublier les moyens dont elle se sert et ne nous laisser songer qu’à ses réussites. Ce « reportage » de toute évidence en est une. »
Gustave Roud, « Funérailles de Joffre »
in Ecrits à Carrouge, Fata Morgana, 2011
Publié dans Aujourd’hui le 15 janvier 1931
(Les obsèques du maréchal Joseph Joffre ont eu lieu le 7 janvier 1931)
Jug

« Pardonnez, Monseigneur, l'importance que je mets à ce fait. Il faut avoir éprouvé toutes les angoisses d'une instruction aussi pénible ; il faut avoir suivi et dirigé cet homme-plante dans ses laborieux développements, depuis le premier acte de l'attention jusqu'à cette première étincelle de l'imagination, pour se faire une idée de la joie que j'en ressentis et me trouver pardonnable de produire encore en ce moment avec une sorte d'ostentation, un fait aussi simple et aussi ordinaire. »
Jean Itard, Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron, 1806

Jug – carafe en verre soufflé à travers un os de vache gainé d’un cuir ourlé (MUDAC, Lausanne, de la série Craftica réalisée par Fendi, 2012)
« Au milieu de ces méprises, ou plutôt de ces oscillations d'une intelligence tendant sans cesse au repos, et sans cesse mue par des moyens artificiels, je crus voir se développer une de ces facultés caractéristiques de l'homme, et de l'homme pensant, la faculté d'inventer.
Je me rappelle que dînant un jour en ville et voulant recevoir une cuillerée de lentilles qu'on lui présentait, au moment où il n'y avait plus d'assiettes ni de plats sur la table, il s'avisa d'aller prendre sur la cheminée et d'avancer, ainsi qu'il l'eût fait d'une assiette, un petit dessin sous verre, de forme circulaire, entouré d'un cadre dont le rebord nu et saillant ne ressemblait pas mal à celui d'une assiette.
Mais très souvent ses expédients étaient plus heureux, mieux trouvés, et méritaient à plus juste titre, le nom d'invention. Je ne crains pas de donner ce nom à la manière dont il se pourvut un jour d'un porte-crayon. Une seule fois, dans mon cabinet, je lui avais fait faire usage de cet instrument pour fixer un petit morceau de craie qu'il ne pouvait tenir du bout de ses doigts. Peu de jours après, la même difficulté se présenta ; mais Victor était dans sa chambre, et il n'avait pas là de porte-crayon pour tenir sa craie. Je le donne à l'homme le plus industrieux ou le plus inventif, de dire ou plutôt de faire ce qu'il fit pour s'en procurer un. Il prit un ustensile de rôtisseur, employé dans les bonnes cuisines, autant que superflu dans celle d'un pauvre sauvage, et qui, pour cette raison, restait oublié et rongé de rouille au fond d'une petite armoire, une lardoire enfin. Tel fut l'instrument qu'il prit pour remplacer celui qui lui manquait et qu'il sut, par une seconde inspiration d'une imagination vraiment créatrice, convertir en un véritable porte-crayon en remplaçant les coulants par quelques tours de fil. »
Jean Itard, Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron, 1806

- Dites-moi Madame Guérin, c’est vous qui avez fait cet objet ?
- Ma foi non, Docteur!
- Et bien c’est Victor !
- Victor ? Mais c’est le vieux manche à gigot !
- C’est un porte-craie. Il l’a fabriqué lui-même.
- Comme c’est bien !
- Ah oui ! C’est très bien.
- Dis-moi, Victor, c’est toi qui as fait ça ? C’est toi Victor ? Oui ? C’est très bien Victor, c’est magnifique. Je te félicite, je suis très content.
François Truffaut, L’Enfant sauvage, 1969
Jean Villard Gilles et la question des origines

Nos ancêtres les Waldstätten
Nos pères qui j’imagine
encore au temps des Bernois
recherchant leur origine
dans le saladier vaudois
vous mélangeaient Burgondes
Latins Celtes et Savoyards
et ça fait beaucoup de monde
pouvaient se croire des bâtards
Nous les fils on est tranquilles
car depuis 150 ans
pas besoin de s’faire de bile
nous savons exactement
la chose est tout à fait claire
nous savons qui sont nos pères
Mais pour les chanter
il faut adopter leur manière en vérité
Ainsi que certains Noirs d’Afrique
pouvaient avec (?) un président-roi
de la cinquième république
dire (?) nos ancêtres les Gaulois
nous Vaudois de langue française
plutôt mous par tempérament
nous n’éprouvons aucun malaise
et le 1er août notamment
à célébrer d’un coeur sincère
avec ceux d’Schwytz et ceux d’Olten
Nicht wahr! Bolomey mon vieux frère
nos ancêtres les Waldstätten
Comme nous les Ticinese
nonchalants et langoureux
sont devenus par antithèse
de vrais Suisses aux bras noueux
et l’on se sent l’âme fière
en pensant que Guillaume Tell
et quelques rudes compères
sans le moindre colonel
avec en fait de mitraille
des troncs d’arbre et des rochers
ont réduit en cochonnaille
leurs baillis empanachés
On aurait voulu en être
de cette fête champêtre
et pour ça chanter
il faut adopter leur manière en vérité
ach Gott !
ach! c’est la manière forte
mais nous on peut pas se forcer
eux ils allaient pas de main morte
nous faudrait plutôt nous pousser
on n’aime pas tant les histoires
l’ordre établi même Bernois
même si c’est la mer à boire
on y tient par amour des lois
C’est pas nous faut le reconnaître
qui aurions fait à Morgarten
ce qu’ils ont fait contre leur maître
nos ancêtres les Waldstätten
Aujourd’hui la chose acquise
nous chantons la liberté
mais cependant quoi qu’on dise
quand un peuple révolté
par les abus prend les armes
nous sommes dans tous nos états
et prêts à verser des larmes
sur le sort de Batista.
et pourtant Castro Fidel
et nos rudes montagnards
c’était les mêmes rebelles
et les mêmes maquisards
ils ont dit « Nous serons libres. »
ils avaient ça dans la fibre
Mais pour les chanter
il faut emprunter
son air à la liberté
un air parfait pour nos chorales
et nos orateurs pleins d’onction
on chante avec un accent mâle
au milieu des interdictions
des défenses des formulaires
des contrôles des règlements
de la censure et des barrières
que diraient-ils en nous voyant
si soumis si repus si riches
ceux qui un jour à Morgarten
on dit merde à l’empereur l’Autriche
nos ancêtres les Waldstätten
Jean Villard
Rematérialisation des textes et des morts

Urne funéraire
Urne livre-noyer-decor-floral
295 x 200 x 85
299 euros
J’ai commencé par les livres. je finirai par eux. Pensons au problème que pose actuellement la numérisation électronique des livres dans les bibliothèques. Cette opération technique ne fait rien moins que dématérialiser les livres, convertissant leurs feuilles et leurs textes en une réalité, certes lumineuse (puisqu’elle s’affiche sur des tubes cathodiques), mais fragile et impalpable. Le livre, dont le texte a été numérisé, réduit et transportable comme le mort crématisé et informatisé, est un livre qui a perdu son « corps » : sa forme et sa matière. Dès lors, télématiquement transmissible, il devient une archive vagabonde, partout et nulle part à la fois, disséminée, partageable et sans lieu propre – une abstraction, comme les cendres nomades du défunt incinéré.
Il est fort intéressant de constater qu’un éminent collaborateur de la Très Grande Bibliothèque, Roger Chartier, a exprimé l’opinion suivante, à savoir que s’il faut admettre comme nécessaire la dématérialisation électronique des textes, il n’en faut pas moins envisager, à l’aide de substituts qui restent à inventer, de compenser les effets de cette opération par des procédures de rematérialisation afin, précisa-t-il, de préserver chez le lecteur la sensation du contact, la mémoire de la forme et la perception d’une présence, celle du livre en l’occurrence.
De même à propos de l’incinération, d’une archive à l’autre, si l’on doit bien admettre la dimension dématérialisante de ce « procédé de l’avenir par excellence », son utilité et même sa nécessité en contexte urbanisé, à très forte densité de population, ne faut-il pas cependant, dans une optique analogue, promouvoir également des procédures symétriques de rematérialisation pour les morts crématisés ? Question de trace. Question de place et de signe ultime à dresser entre le néant et l’illusion, pour la présence sociale des morts et contre l’absence nue, contre l’obsédante immatérialité du fantôme ou la béance sans nom ni lieu qu’une urne vide sur un piano, il faut bien en convenir maintenant, n’est pas à même de combler.
Aussi le Petit Poucet, s’aventurant dans la forêt pour retrouver sa route, se mit-il à semer des petits cailloux tout au long du chemin – afin de se souvenir…
Jean-Didier Urbain
L’Archipel des morts, Cimetières et mémoire en Occident,
Petite Bibliothèque Payot, 2005 (1ère édition - 1989)
Postface 335-336

Petite visite à eux-mêmes
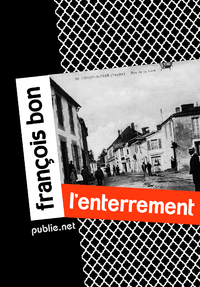
Un village ce n’est plus le destin commun de familles réunies, aujourd’hui on s’en va vivre sa vie où on peut mais le cœur sur la main, pleureuses, elles étaient venues et avaient coiffé le masque fixe du deuil, nulle n’aurait manqué ce matin et la mère rendrait la pareille quand il le faudrait : le deuil des autres c’est le meilleur moyen qu’on a de revenir un peu dans les siens et la seule façon qu’on vous laisse parler de vos morts au moins le temps pour l’autre de préparer sa réponse C’est comme moi je. Et puis le cimetière on y a sa propriété chacun, on n’irait sinon que pour la Toussaint et aujourd’hui les condoléances terminées on y ferait un petit tour en passant, le vent souvent renverse un pot de fleurs et toujours il y a les mauvaises herbes à gratter dans le carré de famille, il y a toujours à faire et c’est le canif à la main pour nettoyer qu’on se recueille le mieux. Les vieux se faisaient préparer leur coin de caveau longtemps avant d’en profiter pour de bon (comme perdurait disait-on cette manie d’emmurer chat tué ou louis d’or dans le parpaing d’une maison qu’on bâtit), sur le granit gris poli d’avance gravé : nom prénom date de naissance trait d’union, à chaque cérémonie se rendant ainsi petite visite à eux-mêmes. De toute façon, pleureuses, n’importe quoi qu’on ait fait de sa vie, l’enterrement la rattrape, tout le monde y a droit d’autant plus que celui-là a manqué ce qu’il vous semble avoir réussi, et en déployer dès la voiture et votre robe la marque et les signes, dignité de menton : faire à quelqu’un le dernier bout de conduite garantit qu’on ne partira pas tout seul non plus. « Ce qu’on fait de bon cœur ne pèse pas », de tout cela il n’y a pas à parler : il en est ainsi depuis si longtemps. On n’imaginerait pas ici de funérailles deux le même jour...
François Bon, L’Enterrement, Publie.net, Temps réel, 2012
Qu’est-ce que tu fais ?

- Qu’est-ce que tu lis ? R… a… muz ?
- Ramuz, c’est le nom de l’auteur.
- Derborence, c’est quoi alors ? l’endroit où il est né ?
- Non, Derborence, c’est le titre de ce récit. Souviens-toi de la yourte dans laquelle tu as dormi cet automne. En face, on apercevait un lac, c’était le lac de Derborence, au-dessus on voyait le Pas-de-Cheville et les Diablerets.
- Je me souviens de la yourte mais pas du reste. Dis voir, ton livre c’est pas un gros livre.
- Louise, tu me laisses tranquille, j’aimerais terminer la première partie.
- Pourquoi tu soulignes des mots ?
- Pour y voir clair. Et maintenant, tu me laisses terminer.
- Mais les pages qui suivent sont aussi soulignées.
- C’est pas la première fois que je lis ce texte, tu me laisses terminer ?
- Combien de fois tu l’as-lu ?
- Quatre ou cinq fois.
- Pourquoi tu lis plusieurs fois, c’est idiot.
- Parce que j’aime ce livre et parce que j’aimerais terminer la première partie.
- C’est quoi qui est bien ?
- Tout et le détail, tout et tout dans tous les sens. Ma petite Louise, ce livre est extraordinaire, c’est un des plus beaux livres que j’aie lus.
- On voit que tu n’as pas lu le Club des Cinq et Game Over.
- J’ai lu le Club des Cinq, plusieurs aventures même. Mais pour l’instant j’aimerais terminer la première partie. Veux-tu peut-être que je la lise à haute voix ?
- Oui !
- Oh! a-t-elle dit à sa mère, et toi, est-ce que tu crois qu’il est mort ?
- Lui c’est son mari, Antoine. La mère, c’est Philomène, Thérèse c’est sa fille.
- Celui qui est monté dans le pâturage accompagner son troupeau ?
- Comment sais-tu ça ?
- Je viens de lire ça au dos du livre.
- Oui, c’est Antoine qui a disparu dans l’avalanche.
- Il est mort ?
- On ne sait pas encore. Il faut attendre. On ne sait rien ; ils viennent seulement de partir.
- Qui ?
- Le médecin et la justice.
- Ah ! a-t-elle dit, il faut attendre ? il faudra attendre jusqu’à quand ?
- Jusqu’à demain ou après-demain. On te promet qu’on te dira tout.
- Il va revenir ?
- Oui, au début de la seconde partie.
- Oh! a-t-elle dit, c’est pas la peine.
Elle a dit .
- Pourquoi est-ce qu’ils se dérangent ?
Elle dit :
- Et moi, est-ce que je ne pourrais pas monter avec eux ?
Elle s’est assise sur son lit, pendant que les deux femmes accourent, l’ayant prise chacune par une épaule et l’obligent à se recoucher.
- Elles sont deux ?
- Il y a aussi sa tante Catherine.
- A quoi est-ce que tu pourrais bien servir là-haut, ma pauvre fille ? Il n’y a qu’attendre, vois-tu. Fais comme nous. Car qu’est-ce que nous pouvons faire, je te demande un peu, ah ! oui, qu’est-ce que nous pouvons faire, nous autres, ma pauvre fille ?
Parmi les larmes qui lui coulaient le long des joues :
- Et il te faut penser à lui.
- Qui ? Lui ?
- Le fils d’Antoine et de Thérèse. Thérèse est enceinte.
- Qui ?
- Lui, le petit, s’il doit venir.
- Bon !
Elle se laisse faire, elle se laisse aller en arrière, elle est de nouveau toute tranquille sur son oreiller. Elle a croisé les mains sur le drap. Les montagnes vont bientôt devenir roses. Les montagnes nous tombent dessus. C’est beau à voir, mais c’est méchant.
- Méchant ?
- Parce que l’avalanche a tué son mari, je pense.
Elle a dit :
- Et si j’ai un enfant ? Si j’ai un petit enfant d’Antoine ? Lui je sais qu’il ne reviendra pas. Mais alors, ce petit enfant, il serait orphelin, il serait orphelin avant d’être né ?… Ah ! a-t-elle dit, ça lui aurait fait pourtant bien plaisir, à Antoine. Je lui aurais dit le secret à l’oreille… Et bien ! je ne lui dirai rien. Il ne saura jamais rien, jamais. C’est drôle.
Tout à coup elle a crié :
- Et bien, je n’en veux pas… je n’en veux pas. Un enfant qui n’aurait pas de père, est-ce que c’est encore un enfant ? Oh ! ôtez-le-moi, disait-elle, ôtez-le-moi, ôtez-le-moi !
- On va le lui ôter ?
- Je ne m’en souviens pas, je te lirai la suite un autre jour si tu veux.
- Lire cinq fois le même livre et ne pas se souvenir de ça ! Vraiment, je ne sais pas à quoi ça sert.
- Je ne sais pas exactement non plus et je ne sais pas par où commencer.
Jean Prod’hom
Emaz chez Veinstein

« C’est pourquoi je fais une séparation nette entre les deux formes d’écriture. Pour le poème, – on peut revenir à du Bouchet, j’écris aussi loin que possible de moi –, il y a effectivement cette volonté d’écartement, la volonté de ne pas retomber dans le sentimental ou la confession, je m’y exerce depuis le début. Par contre, en ce qui concerne les notes, l’évolution a été inverse. Si l’on prend Lichen, Lichen ou Lichen, encore, on peut dire qu’il s’agit uniquement de notes sur la poésie, de notes de critique. Par contre, depuis Cambouis et Cuisine, je m’approche de quelque chose qui est ou intègre du personnel. Mais ce qui est dessous, je crois, c’est toujours cet écrire-vivre, c’est-à-dire que j’essaie, et la note s’y prête bien, il s’agit d’une forme informe, une forme chewing-gum, une forme élastique, d’intégrer tout ce qui est, le feuilleté de vivre, les multiples strates de nos vies. Par son côté très souple, – Quignard parlait de la variété de l’angle d’attaque dans une Gêne technique à l’égard des fragments, c’est très juste – la note ou le fragment explore un angle du vivre qui est à chaque fois différent : je peux faire une note sur le fait d’être prof, en faire une autre sur Jaccottet, il n’y a aucun problème. Mais vous avez tout à fait raison, il y a une contradiction, ou une tension entre, d’un côté, des poèmes qui vont dans le sens du délavement du moi, sans le perdre – on n’arrive pas à s’exclure complètement – et puis de l’autre, quelque chose qui semble aller vers du plus personnel, sans jamais pourtant épouser la forme du journal. »
Du jour au lendemain, Alain Veinstein reçoit Antoine Emaz, 22 novembre 2012
Beauregard

Le renard a passé ce matin. Ne restent sur la terre battue du poulailler qu'un tas, la blanche, et Cacao tétanisé. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, Carole m'attend à Moudon pour neuf heures. Une barrière de brouillard me ralentit après Syens, là où la Bressonne et la Carrouge se jettent dans la Broye, Moudon est dedans, j'envoie un message à Sandra. On aperçoit en haut, par de larges déchirures, des morceaux de ciel et Beauregard.

La toute nouvelle hygiéniste dentaire fait du zèle et ne me libère qu'après trois bons quarts d'heure, avec une poignée de conseils que j'applique sur le champ en passant à la pharmacie. Puis monte au Bourg. De la place autour de laquelle se dressent les châteaux cossus de Rochefort et de Grand'Air, on devine la Mérine qui descend libre le vallon de Sottens avant de se faufiler, à l'étroit, dans la ville basse. Pas grand monde dans les rues, le musée Eugène Burnand est fermé, entre comme un bandit dans les couloirs des Anciennes Prisons, j'y entends un groupe d'enfants qui déclament, marchent, rient, c'est un cours de théâtre. Redescends et m'arrête au coin-café de la COOP, tout Moudon fait ses courses, remplissent leurs cabas ceux du bourg et ceux d'en-bas.
Le soleil et le souvenir du texte de Philippe Jaccottet me poussent à rentrer par le chemin des écoliers, par la route de Martherenges et Beauregard.
Beauregard, un nom que le poète a aimé et qui lui faisait signe, écrit-il, aux abords de sa petite ville natale, ce devait être une ferme ou un domaine sur la pente qui descend vers la Broye (je pourrais m'en informer mais peu importe), je me souviens simplement de ce nom comme s'il avait eu une résonance plus riche que d'autres, et pas même, je crois, à cause de son sens implicite, simplement «comme ça», pour rien ; comme si, quand on disait «Beauregard» autour de moi dans la vaste maison toujours froide en hiver dès que l'on s'éloignait des hauts poêles de faïence dont certains prétendaient même tiédir deux pièces à la fois, quand on disait ce mot, on faisait tinter une cloche justement pour accéder à quelque lieu inconnu que je n'aurais certainement pas trouvé si j'étais allé vraiment me promener près de cette ferme, de ce domaine.
Beauregard, c'est une ferme et un domaine. Il faut prendre la route de Corrençon et non celle de Martherenges pour y parvenir. Un vieux bâtiment attire d'emblée le regard, une vieille bergerie, le premier bâtiment du domaine, me confie le fermier. Il n'y a d'abord eu ici que des moutons. Et puis on a construit au début du XIXème siècle la ferme, qui a brûlé autour des années 1890. C'est en 1932 que le grand-père de mon interlocuteur a loué ce domaine à la commune de Moudon. On imagine leur vie difficile : les visages fatigués ou mornes, les mains usées, les assiettes sur la table miroitante (on a vendu ou brûlé celle en bois), la vie tempérée d'aujourd'hui, un peu vide, à moins qu'elle ne dissimule une violence souterraine, qui explosera plutôt en désespoir qu'en éclats de joie.
Ils ont connu cette violence, les fermiers de Beauregard, en 1942. Les quatre frères de celle qui deviendra sa mère meurent l'un après l'autre, asphyxiés dans la fosse à lisier dont ils sont en train de réparer le mécanisme de brassage. La ferme et le domaine ont oublié et effacé les traces de cette tragédie, mais aujourd'hui, j'entends certains de ses échos dans le nom de Beauregard.
De Corrençon la route traverse le bois de Bourlayes avant de plonger sur Saint-Cierges. C'est dans cette forêt qu'il nous faut, comme dans un tunnel qui ferait un virage à 180 degrés, tourner le dos à l'est et aux Préalpes et porter résolument nos regards sur le couchant et le Jura. Je m'y promène jusqu'en début d'après-midi : Boulens, Peyres-Possens, Chapelle, Martherenges, Sottens, Villars-Mendraz, Chardonnay-Montaubion, Villars-Tiercelin.
Le soleil s'est imposé partout. Il me condamne à passer la tondeuse une dernière fois cette année dans le jardin.
Jean Prod’hom








Vérifier

Ils ne pensèrent pas à se serrer les mains. Jeanine portait des vêtements de sport recouverts d'une pèlerine serrée. dont le capuchon cachait à demi des boucles blondes. Elle détacha un sac suspendu à sa ceinture et le jeta dans les bras de Martinien.
- Porte-moi mon sac. Je suis fatiguée.
- D'où viens-tu ?
- Je t'expliquerai. Mais je te jure que je n'ai jamais cru que tu pourrais te trouver à notre rendez-vous.
- Je n'y croyais pas, moi non plus. Il m'était pourtant nécessaire de vérifier que tu n'y serais pas.
André Dhôtel, Ydylle au Chesne-Populeux in Ydylles, 1961

Pars avec la seille à verse et reviens avec le soleil de travers. Pas mauvais d'autant plus que nous sommes tous les cinq au seuil de quinze jours fériés. Et ce soir les nuages blancs et blonds poussent comme des champignons.
Jean Prod’hom


Indépendant de soi-même

Etre assez indépendant de soi-même pour ne pas se retirer avec l'assurance que nous savons où mène ce qu'on laisse en partage, ne pas économiser non plus ses forces, batailler, reprendre. Mais renoncer à la fin, bien avant d'y parvenir, et laisser l'énigme aller de l'avant. Laisser donc à d'autres le soin de faire la lumière ou l'obscurité sur ce qu'on n'a que partiellement éclairé ou qu'on a jeté plus avant dans la nuit. Et recommencer.

Colman Tiger King | L'Homme d'Aran | Robert Flaherty
Ceux qui se sont réveillés à 2 heures du matin ne sauraient certainement pas dire d'où provenait toute l'eau qui tombait sur les tuiles des maisons du Riau avec la régularité de la pluie. Je me suis rendormi avec le souci des gouttières qui débordent et qu'il faudrait nettoyer. J'ai proposé hier au mousse de me donner un coup de main, échelle, corde et baudrier. Il fait encore nuit lorsque je boute le feu aux petits bois du fond du poêle.
Un chauffard me brûle la priorité au débouché de la route de la Goille sur la route de Lausanne. Je klaxonne et lève les bras au ciel, c'est que j'ai 4 enfants avec moi, des enfants qui ne m'avaient jusque-là jamais vu en colère contre un inconnu. La promenade que j'entame avant huit heures avorte avant la Mussily, il pleut assez fort pour que je rebrousse chemin.
Visionne L'Homme d'Aran que Robert Flaherty, d'origine irlandaise, réalise entre 1931 et 1934 après avoir lu l'ouvrage de Synge sur les îles d'Aran. Les premières et les dernières images de cette ode à la vie primitive sont étonnantes et nous interrogent sur les progrès du truquage au cinéma. Flaherty filme en effet une tempête au cours de laquelle des hommes et une femme manquent de mourir à chaque instant. S'il y a bien montage, on ne voit pourtant pas comment Flaherty s'y est pris pour ne pas mettre en danger ses acteurs. Je relis les pages que Nicolas Bouvier consacre à ce film dans le Journal d'Aran pour en avoir le coeur net.
Quand il eut enfin réuni son plateau : le père, la mère, le fils et les équipages des «curragh», Flaherty leur fit prendre des risques qui paraissent aujourd'hui invraisemblables. et que ses «acteurs» par défi et bravade acceptaient en grommelant. Plus le temps était fort, plus il voulait tourner. Dans une séquence terrifiante de tempête où l'on voit la mère, cheveux défaits, se jeter dans les vagues énormes pour sauver son mari dont le bateau vient de chavirer sur lui, elle – une comédienne sauvage et superbe – frôla la noyade d'un cheveu. Il est impossible de voir aujourd'hui ces images sans penser qu'elles ont été truquées : elles ne l'étaient pas ; ce naufrage n'était pas prévu.
- Je m'en souviens bien, dit le père, j'étais là, j'avais un petit rôle de figurant à mi-hauteur de la falaise. Nous avons tous dévalé sur la plage, voyant ce qui se passait. Cela non plus n'était pas prévu. C'est miracle que ce film se soit terminé sans mort d'homme. Cette femme, Maggie – la mère – vit toujours. Elle ne quitte son lit que deux heures chaque matin et ne veut plus voir personne. Elle pense que la terre entière l'a vue dans cette minute d'agonie et qu'elle a été grugée. En tout cas elle ne veut plus entendre parler de cette histoire.
Nicolas Bouvier nous en apprend, d'autres bien bonnes sur ce film, mais il m'aura aussi fait voir ce qu'il ne décrit pas ou peu, pour autant que je m'en souvienne : les colères de l'océan qui fascinent Flaherty et qui font couler dans les pentes tourmentées des falaises, lorsque la vague se retire, des torrents de diamants sur la pierre nue.
Prépare à manger pour les filles qui vont arriver. Le soleil a écarté les gros nuages gris du matin mais ne parvient pas à s'imposer, il reste à l'affût derrière le second rideau blanc poussé vers le nord-est, je remets une bûche dans le poêle. Fais une partie de Catane avec Louise avant de la mener avec Mylène et Lili, dans la précipitation, à l'arrêt de bus, le jeu ne me convient pas. Reprends la lecture du Plateau de Mazagran jusqu'au retour des filles. Je conduis à 4 heures Lili à Curtilles, les nuages n'en finissent pas de filer, mais en rangs moins serrés si bien que le bleu et le soleil se mêlent au cortège. M'installe sur la terrasse du Café fédéral de Curtilles et poursuis ma lecture du Plateau que je termine aussitôt rentré. La Broye charrie de lourdes eaux. On mange, les enfants se couchent, on ferme les rideaux.
Jean Prod’hom
La chanson des manilles et des mousquetons

Une sacrée bagarre s'est engagée au-dessus du Catogne, surpris par l'attaque mais bien décidé à rester à l'écart ; habituelle pierre d'angle il se fait tout petit, l'affaire le dépasse. Des nuages, on les dirait tout jeunes, blanc d'oeuf et gouache liquide, s'attaquent alors aux Dents du Midi et brassent les dernières coulées d'aurore. La haute pression ne parvient pas à mettre au pas leurs arabesques, ils fanfaronnent un instant jusqu'à l'arrivée côté jardin d'une immense vague grise et molletonnée venue tout droit du golfe de Gascogne, qui déplume ces blancs-becs en les embarquant à sa suite. Ils se fondent alors dans l'édredon épais bourré d'embruns qui recouvre la vallée du Rhône de Genève à Martigny.

Sitôt arrivé au Mont, je mets en ligne les informations sur les Inuit. L'année prend forme et les choses peuvent enfin commencer avec les nouveaux élèves de la classe 11, par la projection du film de Robert Flaherti au titre de petit livre pour enfants, Nanouk l'Esquimau – le titre anglais Nanook of the North l'est moins –, carrefour aux innombrables destinations : le film documentaire d'abord et Jean Malaurie, mais aussi le Passage du Nord-ouest et son histoire, la question climatique, les batailles qui ont fait rage et qui font rage encore dans l'Arctique. La Guerre froide n'est pas terminée.
Opération analogue avec les élèves de la classe 6 autour du film de François Truffaut, L'Enfant sauvage, et le texte du Docteur Jean Marc Gaspard Itard (15 ans en 1789), Mémoire et Rapport sur Victor de l'Aveyron (1801 et 1806), une patte d'oie qui nous permettra d'aborder par la bande le siècle des Lumières, après Jeannot et Colin (1764) de Voltaire, la Déclaration d'Indépendance américaine et la Révolution.
Quant aux élèves de la 9, je reste aux aguets sans quitter une route de moyenne altitude, conventionnelle, de largeur usuelle sans danger apparent. Prendrai pas de risque pour l'instant.
Je reçois dans l'après-midi un mot de quelqu'un que je croise régulièrement depuis une trentaine d'années. Ce serait devenu un ami si nous nous étions vus plus souvent, mais le travail et la famille nous ont tenus à distance. Nous avons marché une ou deux fois ensemble, dans les Alpes je crois, je ne me souviens plus exactement où, il préférait la bicyclette. C'est lui, si je me souviens bien, qui m'a fait découvrir Henri Calet. Nous nous sommes rencontrés à Grignan un jour d'été de l'année passée, – ou la précédente le temps passe si vite –, nous avons été un soir voisins de table sur la terrasse du restaurant du théâtre de Vidy, c'était l'anniversaire de Louise ou d'Arthur, Dimitri le fils avait fait le funambule sous un chapiteau. On se croise quelquefois sur Facebook, il passe parfois sur ce blogue. Et voilà qu'il me propose de travailler avec lui pour un job qui ne manque pas d'intérêt. C'est son ironie, son rire, sa retenue qui me poussent à lui répondre sur le champ. On va donc peut-être se voir plus souvent, je le souhaite, et on ira marcher. Pour la bicyclette c'est moins sûr que je sois partant. A ce propos, tiens ! voilà un poème d'un petit frère de Calet.
Passant dans la rue un dimanche à six heures, soudain,
Au bout d'un corridor fermé de vitres en losange,
On voit un torrent de soleil qui roule entre des branches
Et se pulvérise à travers les feuilles d'un jardin,
Avec des éclats palpitants au milieu du pavage
Et des gouttes d'or – en suspens aux rayons d'un vélo.
C'est un grand vélo noir, de proportions parfaites,
Qui touche à peine au mur. Il a la grâce d'une bête
En éveil dans sa fixité calme : c'est un oiseau.
La rue est vide. Le jardin continue en silence
De déverser à flots ce feu vert et doré qui danse
Pieds nus, à petits pas légers sur le froid du carreau.
Parfois un chien aboie ainsi qu'aux abords d'un village.
On pense à des murs écroulés, à des bois, des étangs.
La bicyclette vibre alors, on dirait qu'elle entend.
Et voudrait-on s'en emparer, puisque rien ne l'entrave,
On devine qu'avant d'avoir effleuré le guidon
Éblouissant, on la verrait s'enlever d'un seul bond
À travers le vitrage à demi noyé qui chancelle,
Et lancer dans le feu du soir les grappes d'étincelles
Qui font à présent de ses roues deux astres en fusion.
Lorsque je longe le couloir sud du collège, il me semble entendre le cliquetis des haubans et des étais, le battement des halebas, des écoutes, focs et grandes voiles, la chanson des manilles et des mousquetons, le chariot sur le rail de déplacement, le tiraillement des cordes dans les chaumards et les taquets, le va-et-vient hésitant des manivelles oubliées sur des winchs, ça sent le large et le port. La vue par les grandes baies vitrées des classes porte ouverte ne dément pas cet air du large. On est bien sur le quai, j'aperçois mâts, têtes de mât et girouettes dressés immobiles dans le ciel blanc, avec de l'autre côté du pont une vieille bâtisse. À peine un rêve, pas de vent, ce sont les innombrables tubulures des échafaudages et leur accastillage qui soutiennent mon hallucination acoustique et la dalle du deuxième étage du nouveau bâtiment scolaire, bien loin de l'océan.
Jean Prod’hom




Aimer la grammaire

Le temps s'est réchauffé, on annonce plus de 20 degrés cet après-midi, je lance pourtant un feu dans le poêle qui s'éteindra certainement dans la journée. Le bois qu'Arthur a rentré hier me rappelle qu'il me faut en commander deux stères, les vendangeuses sont en fleur, quelques roses éclosent. Au Mont une petite pelleteuse retourne la terre autour de la première Danseuse, la réalité se rapproche dangereusement du plan des architectes, le rêve n'est bientôt plus qu'un rêve.

Au collège, le responsable informatique m'indique que le nouveau meuble dont l'établissement a fait l'acquisition il y a peu pour ranger et transporter les ordinateurs portables ne porte pas le nom de porteur de portables comme je l'écrivais hier, mais de classe mobile. Je fais une petite recherche sur internet en rentrant et j'apprends que le Mobile Classroom de chez Bretford, qui nous accompagnera au Mont désormais, traduit en français par classe mobile, s'appelle aussi classe nomade, c'est plus joli mais assez retors. Grâce à ce meuble d'un peu plus de 70 kilos et moins de 1800 euros pour ranger, protéger, charger et transporter 20 ordinateurs, l'élève pourra rester fixé à sa chaise et le monde défiler sous ses yeux. C'est donc fait, le portable se comporte désormais comme un ordinateur fixe et condamne définitivement l'élève à faire le cul de plomb, l'enseignant fera le reste, il poussera le service-boy au joli nom de classe nomade pour enchaîner l'élève immobile aux effigies et aux soldats de plomb.
Le soleil claire l'herbe haute qu'il me faudrait faucher, mais je renvoie à demain ce qui peut attendre. Poursuis dehors la lecture du Plateau de Mazagran d'André Dhôtel. A Rigny il y a un salon de coiffure, celui que Charles Crevain souhaiterait remettre à son fils Maxime qui ne montre guère d'enthousiasme. Comment ne pas songer à Philippe Didion qui tient une rubrique Poil et plume dans ses Notules dominicales de culture domestique. Je recopie un long extrait où il en est question.
Le lendemain Maxime se leva tôt pour balayer le magasin (Crevain ne fermait pas le lundi mais le jeudi). Ce qui avait le plus d'importance à ses yeux, ce jour-là, c'était la splendeur de l'automne. Les ondées avaient nettoyé les rues pendant la nuit, et maintenant le ciel était encore traversé de nuages dont la débandade obscure rendait l'azur plus vivant. Dans les glaces du salon de coiffure, Maxime voyait passer ces nuages qui alternaient avec le soleil.
Il balaya mécaniquement, rinça les trois cuvettes, puis envoya torchon et balai à la volée au fond d'un placard.
- Tout cela m'est bien égal, dit-il enfin.
- Qu'est-ce qui t'est égal ? demanda Charles Crevain qui venait de descendre l'escalier.
- Ça m'est égal d'être coiffeur, ou juge de paix ou marchand de peaux de lapins.
- Sans doute, il y a de plus mauvais métiers, dit Crevain.
- Mais je pense que cette histoire de coiffure ne durera pas, précisa Maxime.
- Je tiens à ce que cela dure, m'entends-tu ? déclara Crevain.
- Je veux dire qu'un jour ou l'autre nous nous retrouverons peut-être au Paradis et que la coiffure peut mener au Paradis tout aussi bien qu'autre chose.
- Très certainement, répondit Crevain déconcerté.
Le premier client du matin entra : c'était Verdot, le voisin qui tenait la quincaillerie. Il fut suivi bientôt par Steille, le marchand de vaisselle, autre ami de Crevain. Lorsque le greffier Caron survint à son tour, la conversation allait bon train, dominant les éclats des coups de ciseaux et les murmures du rasoir. Toujours les mêmes rengaines : après le subtil exercice de langage qui consistait à apprécier la qualité exacte du temps qu'il faisait, ce furent des généralités sur l'avenir de la jeunesse : « Eh bien, Maxime, tu succéderas à ton père. Moi, quand j'étais jeune... » Tout cela pour tâcher de provoquer chez Maxime je ne sais quelle protestation qui eût dévoilé son vrai jeu. Maxime regardait l'automne scintiller dans ses ciseaux et sur les robinets de la boutique. Automne irremplaçable et inoubliable. Il se sentait heureux, et lorsque la matinée se termina sur le presto d'un shampooing il jura qu'il ne travaillerait pas l'après-midi.
Je cherche à comprendre pourquoi tous les récits d'André Dhôtel me déroutent à chaque instant. Mais lorsque j'essaie de suspendre ma lecture pour y voir un peu clair et fixer les raisons de mon trouble, rien ne tient, le texte part en morceaux, Maxime, Charles, Juliette, Gabriel, Emma radotent, tout est invraisemblable, ne tient à rien ou à des mots insensés, à des phrases sans queue ni tête, tout s'évapore et il ne reste rien, sinon une espèce de dégoût envers ces personnages pour lesquels je me suis pris d'amitié, des êtres de papier, sans consistance, contradictoires, légers. Un enfant de 10 ans oserait à peine. Et pourtant.
C'est qu'il n'existe aucune volonté chez l'Ardennais de faire tenir ensemble l'immense variété des choses et des discours. Aucune volonté de déléguer au narrateur le pouvoir d'y voir tout à fait clair, quand bien même il s'y essaie parfois. Ce sont alors de brèves éclaircies ou de mauvais présages, mais jamais au grand jamais le narrateur ne prend définitivement la main sur l'affaire, il le fait ici ou là pour dérouler un décor pauvre et immense derrière lequel les personnages pourront reprendre leur souffle, des forces, du repos, avant de les remettre à la nécessité ou au hasard, de les laisser prendre un peu d'avance, dire et faire n'importe quoi, et de feindre qu'il en est toujours allé ainsi, et qu'on ne peut que les suivre pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque l'affaire va trop loin ou que les personnages lui échappent, avec le risque qu'ils fassent l'école buissonnière ou même disparaissent, le narrateur convoque d'autres personnages, imprévus, qui surviennent pour mettre un peu d'ordre ou un peu plus de ce désordre qu'ils partagent avec lui. Tout est à recommencer de manière plus essentielle encore, si bien qu'à la fin tout le monde a tenu ses engagements à tort et à travers, sans que personne ne soit assuré de leur teneur, parce que le désir de vivre est plus puissant que toute promesse, qu'il nous faut rejoindre un pays qui s'ouvre sous nos pas comme la mer et que, quoi qu'il en soit, tout finit en déroute parce que personne n'a jamais été dans le secret des dieux.
C'est le dernier des sept de la première série, il y en aura trois encore, Arthur le copie en fin d'après-midi à tous les temps, c'est le verbe aller. Il sait bien qu'il y en aura d'autres, il grogne avec le sentiment qu'il fait cet exercice chaque année et par tous les temps. Mais est-ce un exercice ? Il se demande si c'est bien utile, je me le demande aussi, n'y a-t-il pas d'autres voies pour saisir l'ensemble des formes verbales et le système qu'elles constituent ? N'y a-t-il pas une manière de goûter à la grammaire réputée rébarbative, d'aller à l'essentiel sans lequel ce qui en découle est incompréhensible ? Un petit livre indique la direction, il s'appelle Aimer la grammaire.
J'envoie l'extrait du Plateau de Mazagran à Philippe Didion.
Jean Prod’hom




Trophées

C'est en lisant L'Ardent Royaume, il y a une quinzaine de jours, que l'envie m'est venue de relire, sans savoir exactement pourquoi, La Grande Beune de Pierre Michon. J'avais extrait alors du récit de Jacques Chessex les lignes dans lesquelles le narrateur décrit la tête de chevreuil à l'oeil luisant qui veille au-dessus de Raymond Mange et de Monna à l'Auberge des Champs de Donneloye, tout prêt de s'arracher du mur, avec autour des hôtes d'un autre monde, ahuris, monde primitif, égarés sur les hauts de la Mentue, son mufle noir, la graisse de jambon qui luit, une lumière de soufre, la poussière sur l'étagère du comptoir, pas ou peu de lumière.
Je relis donc cet après-midi les premières pages de La Grande Beune dont j'extrais ceci.

Il n'y pas de gare à Castelnau ; c'est perdu ; des autobus partis le matin de Brive ou de Périgueux vous y larguent fort tard, en bout de tournée. J'y arrivai la nuit, passablement ahuri, au milieu d'un galop de pluies de septembre cabrées contre les phares, dans le battement de grands essuie-glaces ; je ne vis rien du village, la pluie était noire. Je pris pension chez Hélène qui est l'unique hôtel. sur la lèvre de la falaise en bas de quoi coule la Beune, la grande ; je ne vis pas davantage de Beune ce soir-là, mais par la fenêtre de ma chambre me penchant sur du noir plus opaque je devinai derrière l'auberge un trou. On descendait par trois marches à la salle commune ; elle était enduite de badigeon sang de boeuf qu'on appelait naguère rouge antique ; ça sentait le salpêtre ; quelques buveurs assis parlaient haut entre des silences, de coups de fusil et de pêche à la ligne ; ils bougeaient dans un peu de lumière qui leur faisait des ombres sur les murs ; vous leviez les yeux et au-dessus du comptoir un renard empaillé vous contemplait, sa tête aiguë violemment tournée vers vous mais son corps comme courant le long du mur, fuyant. la nuit, l'oeil de la bête, les murs rouges, le parler ruse de ces gens, leurs propos archaïques, tout me transporta dans un passé indéfini qui ne me donna pas de plaisir, mais un vague effroi qui s'ajoutait à celui de devoir bientôt affronter des élèves...
J'essaie en vain de reprendre mon souffle, mais les temps changent. Je sors en coup de vent et suit celui qui n'est plus à lui jusqu'à ce qu'apparaisse dans la grange, emplissant tout l'espace de ses incompréhensibles rouages, une moissonneuse-batteuse verte de la marque John Deere...
Lili arrive au pas de course, il est 15 heures 30 à la grande pendule, elle se change et file au carrefour, c'est jour d'équitation à Curtilles. Louise la suit de près, elle entre souveraine dans le salon et prend sa guitare, je descends à Corcelles, le bus TL arrive dans mon dos, puis à Ropraz, Louise entame un blues, Arthur fait des exercices de math.
Me rends au restaurant des Terreaux de Moudon, par Vucherens, Vulliens et Syens. On fait le point respectif sur nos vies qui se reconnaissent et s'écartent. Ni l'un ni l'autre n'avons le temps de faire des politesses. Frédérique me remet l'album que des enfants en résidence à Montricher ont réalisé. C'était la mi-mai 1986 à Bois Désert.
Jean Prod’hom





Passion pour le Gulf-Stream

Pluie à verse dehors, et nuages en pétard, vent du sud-ouest en rafales. Dedans la radio crache en boucle les résultats des votations cantonales et fédérales du week-end, des occasions données à tous de parler ou de se taire, de gagner ou de perdre, si souvent tempêtes dans des bénitiers. Mais sur le coup, les Neuchâtelois ont perdu une belle occasion de se rabibocher en rapprochant les montagnes du lac.

Sur le chantier des Danseuses du Mont, quelques ouvriers s'affairent dans la nuit, se préparent à de gros travaux, ils n'auront cependant pas assez de leur patience et de leurs machines pour venir à bout des palplanches sur lesquelles la terre s'est refermée. A suivre. Termine au cours de la matinée Retour et en extrais ceci.
Or, revenu dans mes frontières, il se passa un événement non racontable et que je raconte quand même. Une virée à bicyclette selon la méthode expliquée plus haut, c'est-à-dire limitée à une dizaine de kilomètres, avec des ralentissements à cinq à l'heure et des arrêts n'importe où. Cette fois-là je fis un arrêt en un lieu le plus dépourvu d'intérêt qui fût jamais, au milieu des cultures plates assez loin du ruisseau et du passage à niveau pour qu'ils n'entrent pas dans le décor.
Alors que ne demeurait guère que l'espace pur et simple, j'eus l'idée soudaine qu'existait dans ces environs indéterminés un poète prodigieux, hors de tout exemple. Pas un amateur d'écriture ou de pensée, pas un artiste ni même un aventurier, mais quelqu'un qui était un événement vivant et impossible : Arthur Rimbaud dont je ne savais absolument rien, je le répète. Je ne songeais pas tellement à la proximité du hameau de Roche. C'était plutôt comme le passage d'un enfant perdu dans la campagne et dont la présence était aussi évidente qu'irrégulière et insolente.
Quoi comprendre à cette révélation d'une gratuité totale ? Cela ressemblait à ce désarroi d'un écolier qui en classe de math, aperçoit soudain accrochée au mur une carte de géographie et se prend de passion pour le Gulf-Stream.
Décidément il me fallait lire Rimbaud et savoir quelle était cette histoire originaire du positif terroir ardennais
Je dévie, mais c'est la grande affaire des paroles villageoises. On ne sait où on va. et puis soudain : "Il y a ceci". En tout cas j'ai été pris d'une admiration sans fin pour des personnes que l'opinion de hautes sphères littéraires et autres, considèrent comme médiocres, ou humbles ou encore propres à faire l'objet d'une étude de moeurs. Leur patience, leur attention vive, leurs inspirations inattendues, ces destins qui semblent en-deça de la vie et s'accordent secrètement avec un au-delà inimaginable...
Monte après midi sous la pluie à la Dubarde, avec une quinzaine d'élèves. Raymond les emmène au fond de la Mine par groupes de trois pendant que les autres, d'abri en abri, inventorient les fontaines et les chèvres, du Serjet aux Meules. Raymond m'offre un verre, sa femme des pommes mais il me faut être à l'arrêt de bus de Corcelles à 16 heures 30, Je l'aperçois qui monte à pied, on parvient au Riau avec le soleil dans le dos. Je sors une petite heure avec Oscar, les nuages filent par convois, le ciel se multiplie dans les flaques, ça donne le vertige, des torrents d'or en fusion forcent les lisières et coulent sur la terre noire des bois.
Sandra et les filles sont rentrées d'Oron, Lili aura cette semaine, après les noires, à se familiariser avec les touches blanches du piano, elle s'étonne qu'on lui refile deux clefs, celle de fa et celle de sol. Louise va devoir jongler avec deux guitares, pour la semaine prochaine : The Eyes of the Tiger et un blues en la majeur. Quant à Arthur, il nous lit son beau rapport de physique qui traite des méthodes de récolter le sel. Il se demande ensuite, après avoir lu les premières pages du Dernier Jour d'un condamné qu'il a choisi de présenter à l'école ce que celui-ci peut bien faire et penser avant son exécution. Avec l'école buissonnière qu'on ne fait qu'imaginer, sauter du coq à l'âne, c'est bien peut-être le meilleur de l'école.
Jean Prod’hom






Veillait une tête de chevreuil à l'oeil luisant

J'aperçois de loin, près du refuge de Ropraz, un cueilleur de champignons habillé tout de blanc. M'étonne d'un tel accoutrement. Il me lance de loin qu'il a déniché quelques bolets. Je comprends un peu plus loin en lisant les inscriptions sur un petit bus parqué derrière le refuge, l'homme est à la tête d'une petit entreprise de peinture et de papier peint sise près de Bussigny. Je m'assieds contre un foyard, le même que hier, et termine la lecture de L'Ardent Royaume. Impossible de copier dans Adobe Digital Editions, j'use donc de mes deux doigts.
Ils avaient déjeuné à l'Hôtel de la Gare, l'après-midi avait passé très vite et maintenant, sur le chemin du retour, ils s'étaient arrêtés à l'auberge des Champs, à Donneloye, au sommet de la vallée de la Menthue scintillante de neige.
Ils s'étaient assis près de la porte, ils buvaient du vin blanc. ils mangeait du jambon qui craquait sous la dent avec la croûte du gros pain. les lampes n'étaient pas allumées. A la paroi, juste au-dessus d'eux, veillait une tête de chevreuil à l'oeil luisant dans lequel couraient les couleurs orangées du crépuscule. Le mufle noir avait l'air encore humide de salive, la narine frémissait, la mâchoire tremblait, l'animal allait s'arracher du mur où il avait passé la tête un bref instant par curiosité drolatique, voilà, il allait rejoindre la campagne magique sous la neige où criait déjà la chouette, où s'égarait le vent d'hiver dans la dernière lumière du jour.
La tête demeurait immobile, le feu du couchant dans ses yeux de verre. ils étaient seuls. le patron était allé soupé à la cuisine. les rares autos du carrefour ne s'arrêtaient pas. Une lumière de soufre engluait toute chose dans sa phosphorescence. A cette heure tout était possible... des gouttes d'argent liquide brillaient sur les carafes, au comptoir. Les bois du chevreuil dardaient leurs couteaux d'os au plafond.
Ils avaient fini leur jambon dont la graisse luisait au bord de l'assiette fendillée. le vin était frais. Au-dessous des sapins s'allumaient les petites étoiles blanches dans le ciel saumon. Un ahuri à la blouse couverte de neige était entré en traînant les pieds, quand il avait commandé son vin sa grosse lèvre avait claqué sur ses gencives. Un benêt cueilleur de champignons, l'automne, à la pleine lune ? Un vieux de l'hospice ? Un Gaspard Hauser archaïque portant dans sa musette les lichens et les limaces de ses philtres ?
Ils étaient revenus à Donneloye au-dessus de la vallée. le soir faisait flamber les crêtes. des milliers de petites bulles montaient dans leur verre de bière. Comme toujours, les yeux de verre d'un chevreuil à la paroi luisaient entre la fenêtre et la lampe, et le bouquet de fleurs en papier du Nouvel An s'empoussiérait sur l'étagère du comptoir derrière les boîtes de cigares.
Une tranquillité bleue et rousse rafraîchissait les corps et les coeurs. La beauté des choses dans cette lumière crépusculaire était un trésor multiplié sur les tables, aux murs, aux carreaux des fenêtres dont les rideaux tout à fait immobiles tombaient, neigeux, comme des stalactites phosphorescentes, cependant que le regard du chevreuil, les verres, les miroirs brûlaient de feux courts chaque fois que l'un des bonzes à la bouche fendue par un rire silencieux ou le patron rouge au comptoir craquait une allumette et l'approchait en tremblotant d'un cigare imbibé de salive septuagénaire.
Affalés à la table du fond, trois initiés rigolards hochaient leur tête plissée et chauve à la certitude des séries de petits alcools blancs à absorber cette soirée encore comme tous les soirs que Dieu fait.
Soudain Me Mange avait compris que la vie ne pourrait jamais être meilleure que ces jours et qu'à cette minute. Non, jamais la paix ne serait plus étale, la joie plus fine, la pensée plus claire, le pays le plus ample et plus plein, les nourritures mieux liées au monde. Jamais la tendresse de Monna ne serait plus vraie pour lui. Jamais leur plaisir ne brûlerait plus profond. Ils se connaissaient depuis cinq mois. En cinq mois, Me Mange avait reconnu le mystère de Monna, avait appris à sonder, à parcourir ses terres dans l'angoisse et dans la douceur. Mais voici que s'ouvrait un temps égal qu'aucun autre nouveau règne ne vaudrait jamais. Il fallait le savoir et s'en montrer digne. Un commandement impérieux l'exigeait : la terre promise commençait ici, entre ce village silhouetté dans la douceur mauve et la rivière où sautaient les truites dans leurs nappes de cuivre fondu. A cette heure les premiers fantômes se mettaient en marche entre les sources et les chênes. Oui, ici s'ouvrait la terre promise : bois des pentes, châtaigniers de collines, vergers, pâtures, fermes aux longs toits pour couvrir l'ampleur des habitations, étables chaudes, écuries où craquait le foin plein de fleurs sèches dans la mâchoire des juments.
Je sors de la bibliothèque La Grande Beune.
Des souris sont en train d'établir leurs quartiers dans la maison. Il va falloir après avoir fait le taupier faire le dératiseur, une activité que je fais avec moins d'entrain. Pose un piège dans la chambre d'Arthur, un autre dans celle de Lili. Il y a des copeaux de je ne sais trop bien quoi dans un angle de l'entrée percé de plusieurs trous de souris. Je crains qu'elles n'aient colonisé la cavité sous les escaliers. Place à la fin deux pièges dans la chambre de Lili en raison de la présence attestée d'une souris que j'abandonne à ses instincts derrière la porte fermée.
Cherche au galop quelques images sur le net pour introduire demain la notion de discours rapporté avant d'emmener sitôt rentrées de l'école Lili et I. à Curtilles.
J'ai une heure à disposition pour baguenauder dans Lucens que je traverse en direction de Pra la Mort, loin du centre sur la route de Villeneuve. Bel ensemble d'arrosoirs.
L'orage gronde lorsque je rentre sans que la pluie ne fasse à la fin autre chose que noircir le sol et les pneus des voitures le bruit que fait le quart de boeuf lorsqu'on le jette dans l'huile bouillante pour le saisir. Je m'arrête sur la belle terrasse du café du Poids avant de reprendre les filles fiérotes d'avoir fait du galop dans le manège. Au Riau la chasse aux souris continue, on manque celle que Lili héberge contre son gré.
Comptais lire en fin d'après-midi Jeannot et Colin. J'écris en lieu et place ces notes avant de descendre à Ropraz récupérer Arthur. Je m'arrête et laisse la fin de journée à son erre.
Jean Prod’hom






Je lui avais apporté une bouteille de blanc

Je lui avais apporté il y a trois ans une bouteille de blanc, il l'avait mise au frais dans la fontaine, on s'était promis de nous revoir le lendemain pour la boire, ou le surlendemain. Trois ans ont passé, la bouteille n'est plus dans la fontaine.
Il est midi et demi, Raymond fait la sieste, son petit-fils l'a averti que je passerai. Il a comme toujours le sourire aux lèvres, immédiatement d'accord de nous faire visiter la chambre de partage de la mine des Roches. On sort nos agendas, dans quinze jours. C'est promis, j'amènerai une autre bouteille. Je photographie deux tableaux de sa maison avant qu'on ne se quitte, je reprends les cours à 13 heures 10.
Je fais quelques modifications sur le site de l'école, dans la précipitation, je dois être à 16 heures 45 à l'arrêt de bus sous le Torel, mais un convoi exceptionnel ralentit ma course, et puis des ouvriers remplissent de bitume les nids de poule que le gel et le dégel creusent chaque hiver entre Corcelles et la route de Berne. J'arrive un peu en retard, les filles ne m'en veulent pas.
Je m'inquiète en feuilletant le journal local de la multiplication des coachs de tout acabit, sous-produits de l'orientation psychologisante de la société. Leur jargon me sidère :
Force mentale apporte l'énergie d'activation nécessaire au transfert des forces mentales conscientes et inconscientes des deux parties de l'être : L'acquis et l'inné. Force Mentale agit donc telle la clé de voûte qui, réunissant les deux parties de l'arche, permet de supporter des poids considérables en étant entièrement autonome et sans artifices.
Les coachs sont partout et s'occupent de tout, prennent en charge aussi bien des gens qui viennent de nulle part que leurs voisins de palier, s'autorisant ce qu'autrefois des études longues et difficiles interdisaient. Les psychanalystes avaient appris à faire du silence une vertu par la grâce de laquelle l'analysant était susceptible de remettre la main sur sa vie. Les coachs, les consultants et les conseillers mettent la main sur la vôtre, ils néologisent avec la certitude qu'ils suffit d'être capables de rien pour être capables de tout. Voilà des gens qui sont coupés de l'histoire d'une discipline qui n'existe pas, des gens qui se présentent dans des mandorles entourés d'un sfumato qu'on trouvait au milieu du siècle passé sur les cartes postales envoyées des Balkans.
Les coachs font peur, comme les secrétaires sur lesquelles se reposent les patrons, comme les boulangères qui mettent des gants pour vous servir. Ils sont les héritiers laïques et modernes des tireurs de tarots, des voyants, des magiciens de foire, des usuriers, des chiromanciens et des cartomanciennes, des diseurs de bonne aventure, des nécromanciens et des sorciers. Mais à la différence de ceux-ci qui promettent le bonheur ou la guigne, le feu ou le paradis, les coachs ne sentent pas le souffre et parlent doctissimo. Ils vous convainquent qu'il est malgré tout préférable d'avoir bonne mine et des habits propres, ils vous invitent à faire toutes sortes de deuils : il n'y a effectivement pas d'appartement de 3 pièces sur le marché, mais il est finalement tout à fait possible de se satisfaire avec le sourire d'un 2 pièces, n'est-ce pas ?
Reprends en fin d'après-midi la cinquième rêverie de Rousseau et extrais ceci :
Mais s’il est un état où l’âme trouve une assiette assez solide pour s’y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d’enjamber sur l’avenir ; où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière ; tant que cet état dure celui qui s’y trouve peut s’appeler heureux, non d’un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu’on trouve dans les plaisirs de la vie mais d’un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l’âme aucun vide qu’elle sente le besoin de remplir. Tel est l’état où je me suis trouvé souvent à l’île de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l’eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d’une belle rivière ou d’un ruisseau murmurant sur le gravier.
Les pétales des fleurs battent des ailes, je cueille les quelques pruneaux qui n'ont pas été entamés par les moineaux, une nuée d'étourneaux s'envolent à mon passage, il est 19 heures 40, Louise se plaint d'un genou au retour de la longue balade qu'elle a faite avec Sandra et Oscar à la brune. Puis la nuit tombe, je dois allumer les phares lorsque je remonte avec Arthur de Ropraz.
Jean Prod’hom




Jean-Jacques Rousseau lecteur de Pierre Ménard

Le dedans de la maison s'est refroidi, mais il fait près de 15 degrés lorsque je monte dans la Yaris ce matin pour aller au Mont. Le calculateur de consommation a perdu la tête, comme toujours les saisons aussi, je fais le plein au Chalet-à-Gobet.
J'enchaîne cinq périodes. J'aborde tout d'abord la question de la situation du monde avant 1914, en un petit quart d'heure, un peu vite j'en conviens, mais il suffit finalement de prendre acte de la volonté de puissance des états aujourd'hui pour comprendre les tensions d'avant-guerre. Ou l'inverse, il suffit de considérer les tensions d'avant-guerre pour comprendre qu'on n'en a pas fini aujourd'hui avec la question des hégémonies.
Une équipe de la classe 6 présente aux petits de la classe 11 le site qu'il vont nourrir tout au long des trois ans qui viennent, avec les modifications que les anciens ont souhaitées, et notamment la création de deux nouvelles rubriques : Découvertes et Débats. Je prépare ensuite la maquette avec le groupe de liaison. L'affaire part sur de bons rails, d'autant plus que les élèves ne souhaitent plus que j'évalue leurs contributions à la fin de l'année. Ça fait une dizaine d'années que j'en rêvais.
Raul m'aide après midi à loguer le site à un service Web qui propose gratuitement de nous décharger de la gestion des commentaires.
Retour au Riau, Elsa et Louise font du vélo, Arthur et Lili sont à Servion. Je termine la seconde des Rêveries d'où j'extrais ceci :
Le jeudi 24 octobre 1776, je suivis après dîner les boulevards jusqu’à la rue du Chemin-Vert par laquelle je gagnai les hauteurs de Ménilmontant, et de là prenant les sentiers à travers les vignes et les prairies, je traversai jusqu’à Charonne le riant paysage qui sépare ces deux villages, puis je fis un détour pour revenir par les mêmes prairies en prenant un autre chemin. Je m’amusais à les parcourir avec ce plaisir et cet intérêt que m’ont toujours donnés les sites agréables, et m’arrêtant quelquefois à fixer des plantes dans la verdure. J’en aperçus deux que je voyais assez rarement autour de Paris et que je trouvai très abondantes dans ce canton-là. L’une est lepicris hieracioïdes de la famille des composées, et l’autre lebuplevrum falcatum de celle des ombellifères. Cette découverte me réjouit et m’amusa très longtemps et finit par celle d’une plante encore plus rare, surtout dans un pays élevé, savoir lecerastium aquaticum que, malgré l’accident qui m’arriva le même jour, j’ai retrouvé dans un livre que j’avais sur moi et placé dans mon herbier.
Enfin après avoir parcouru en détail plusieurs autres plantes que je voyais encore en fleurs, et dont l’aspect et l’énumération qui m’était familière me donnaient néanmoins toujours du plaisir, je quittai peu à peu ces menues observations pour me livrer à l’impression non moins agréable mais plus touchante que faisait sur moi l’ensemble de tout cela. Depuis quelques jours on avait achevé la vendange ; les promeneurs de la ville s’étaient déjà retirés ; les paysans aussi quittaient les champs jusqu’aux travaux d’hiver.
On se retrouve tous, ceux de Servion et les nôtres dans le jardin. Après quoi j'imaginai le récit suivant.
Je remontai après le goûter le chemin à double ornière jusqu'à la Mussily pour gagner par les bois l'ancien réservoir et de là, empruntant l'allée sauvage de feuillus, je me dirigeai vers la Moille-au-Blanc. On avait achevé le déchiquetage de la montagne de foyards et d'épicéas que Daniel avait amenés là ; le camion rouge et fumant avait disparu ; les ouvriers n'allaient plus revenir jusqu'à l'hiver, la place était livrée désormais au silence, et par l'ouverture du bout de l'allée, le brouillard allait descendre sur la Broye et les collines onduler indéfiniment jusqu'aux Vanils. Je m’amusai à identifier les villages avec ce plaisir et cet intérêt que m’ont toujours donnés les changements de perpectives auxquels nous obligent les promenades. Je crus repérer deux villages lointains, si lointains qu'on ne les voyait habituellement pas de la lisère du bois Vuacoz, mais que j'avais traversés autrefois et qui apparaissaient comme par miracle dans l'éclaircie d'une clairière. Cette apparition me réjouit et m’amusa très longtemps si bien que, après avoir parcouru en détail l'horizon qui se découvrait devant moi, je quittai les lieux, sans en avoir tout à fait conscience, et tentai tout en marchant de reconstituer de mémoire le paysage que j'avais eu sous les yeux, je listai les noms de chacun des villages que j'avais aperçus, puis les noms des essences que j'apercevais dans l'ombre, les dernières fleurs de l'été.
Lorque je me retrouvai à deux pas de l'ancien réservoir, je quittai peu à peu ces menues observations pour me livrer à l’impression non moins agréable mais plus touchante que faisait sur moi l’ensemble de tout cela. On avait achevé le déchiquetage de la montagne de foyards et d'épicéas que Daniel avait amenés là ; le camion rouge et fumant avait disparu ; les ouvriers n'allaient plus revenir jusqu'à l'hiver, la place était livrée désormais au silence, et par l'ouverture du bout de l'allée, le brouillard allait descendre sur la Broye et les collines onduler indéfiniment jusqu'aux Vanils.
Rentre alors pour écrire ce qui précède, lis le Pierre Ménard, auteur de Quichotte, puis la troisième, la quatrième et la cinquième des Rêveries d'un promeneur solitaire.
Jean Prod’hom




Pezzolato PTH 1400/900

Prépare des sandwiches pour Arthur avant de le déposer à l'arrêt de bus de Corcelles sur la route de Berne, et puis dans la foulée les filles au Torel. Madame A. est en pleurs, les bois de pins et d'eucalyptus entourant la maison de ses parents et de ses frères ont brûlé hier à Lordosa au Portugal, les savoir sains et saufs la console, mais il faudra, comme il y a 22 ans, tout recommencer.
De l'intérieur de la maison c'est un grondement sourd de fond de cale ; du refuge de Ropraz un tohu-bohu de chantier naval ; tout près plus difficile à dire, trop de bruit. Mais j'ai vu la bête, rouge, fumante, une broyeuse déchiqueteuse fabriquée à Envie au sud de Turin et montée sur un camion, un modèle fabriqué par la société Pezzolato pour la Coopérative suisse Sodefor qui exigeait, dit la publicité, une productivité très élevée, sans renoncer à la qualité des plaquettes. Le chargeur hydraulique, équipé d'une commande mobile, introduit des brassées de troncs jusqu'à 80 centimètres de diamètre qu'avalent trois rouleaux dentés. Le système d'expulsion ressemble à celui des becs cueilleurs de maïs. Un seul homme est aux commandes de la PTH 1400 mm (diamètre) / 900 mm (largeur), capable de réduire en plaquettes plus de 300 mètres cubes à l'heure. Oscar reste à bonne distance.
Plus loin le corps se déplie, le dedans et le dehors se cherchent, croisent leur trame avant de s'équilibrer l'un dans l'autre. Pas de quoi appeler du nom d'âme ce qui vient de l'intérieur, rien ne s'élance, mais quelque chose de poreux s'extrait des geôles du corps, laisse la porte ouverte. Entre veille et sommeil sur les chemins du bois Vuacoz, sans affection, un ténu sentiment d'exister, loin de la raison bruyante et des arguments sans pitié qui cadenassent à l'intérieur de nos frêles embarcations les corps légers des sensations. La pensée se défait, ce qui dure au fondement de ce qui ne dure pas monte à la surface, pas de raison que ça s'arrête, qui veut s'y adonner le peut, quelque chose ondule, ce que nous croyions enfouis dedans se noue dans les bords du dehors, le coeur bat à peine, feuilles mortes et rameaux, coule au delta des circonstances.
M'arrache pour me rendre à Montpreveyres acheter de quoi faire des hot-dogs, accueille à midi les filles qui sourient. On mange. Et puis c'est à nouveau l'école.
Lis après le repas la première des Rêveries du promeneur solitaire dont j'extrais ceci :
Sentant enfin tous mes efforts inutiles et me tourmentant à pure perte j’ai pris le seul parti qui me restait à prendre, celui de me soumettre à ma destinée sans plus regimber contre la nécessité. J’ai trouvé dans cette résignation le dédommagement de tous mes maux par la tranquillité qu’elle me procure et qui ne pouvait s’allier avec le travail continuel d’une résistance aussi pénible qu’infructueuse.
Et puis ceci :
Les loisirs de mes promenades journalières ont souvent été remplis de contemplations charmantes dont j’ai regret d’avoir perdu le souvenir. Je fixerai par l’écriture celles qui pourront me venir encore ; chaque fois que je les relirai m’en rendra la jouissance. J’oublierai mes malheurs, mes persécuteurs, mes opprobres, en songeant au prix qu’avait mérité mon cœur.
Ces feuilles ne seront proprement qu’un informe journal de mes rêveries. Il y sera beaucoup question de moi parce qu’un solitaire qui réfléchit s’occupe nécessairement beaucoup de lui-même. Du reste toutes les idées étrangères qui me passent par la tête en me promenant y trouveront également leur place. Je dirai ce que j’ai pensé tout comme il m’est venu et avec aussi peu de liaison que les idées de la veille en ont d’ordinaire avec celles du lendemain.
Entame la seconde lorsque j'entends la voix des filles, on grignote des biscuits. Je reste auprès d'elles pendant qu'elles font leurs devoirs. Vais cueillir le mousse à la sortie du bus. C'est le carrousel qui a repris depuis une semaine, Sandra conduit Arthur au trial, on mange à la véranda, Louise fait de la guitare, je descends à Ropraz, et ainsi de suite jusqu'à la nuit.
Jean Prod’hom








Elle était annoncée

Elle était annoncée, Arthur et Lil qui ont passé la nuit sous la tente en ont senti les effets, leur matelas est détrempé, ce qui ne les a pas empêchés de dormir jusqu'à tard ce matin. Nous n'avions plus eu de pluie depuis la nuit du 2 au 3 août à la Lécherette. Je conduis Oscar à Bussigny qui va passer 3 nuits au chenil du Lorelei, le ciel traîne derrière lui des lambeaux de brouille. La radio annonce le retour du beau temps dans l'après-midi.

Sandra et les enfants ont rendez-vous à Mézières avec les mamans et les enfants que nous rejoindrons demain sous Derborence, au refuge de Lodze.
M'occupe des tessons ramassés hier entre Perroy et Morges avant de lire Petite Poucette, court texte de Michel Serres dans lequel il analyse les difficultés des institutions, notamment l'école, à prendre acte de la mutation et à passer à autre chose en instituant de nouveaux modes de fonctionner.
... voici des jeunes gens auxquels nous prétendons dispenser de l'enseignement, au sein de cadres datant d'un âge qu'ils ne reconnaissent plus : bâtiments, cours de récréation, salles de classe, amphithéâtres, campus, bibliothèques, laboratoires, savoirs même..., cadres datant, dis-je, d'un âge et adaptés à une ère où les hommes et le monde étaient ce qu'ils ne sont plus.
Ce format-page nous domine tant, et tant à notre insu, que les nouvelles technologies n'en sont pas encore sorties. L'écran de l'ordinateur – qui lui même s'ouvre comme un livre – le mime, et Petite Poucette écrit encore sur lui, de ses dix doigts ou, sur le portable, des deux pouces. Le travail achevé, elle s'empresse d'imprimer. Les innovateurs de toute farine cherchent le nouveau livre électronique, alors que l'électronique ne s'est pas encore délivrée du livre, bien qu'elle implique tout autre chose que le livre, tout autre chose que le format transhistorique de la page. Cette chose reste à découvrir.
Prépare la balade que nous ferons demain avant de rejoindre en fin d'après-midi nos femmes et enfants au refuge de Lodze. Je ne retrouve pas la carte couvrant la région de Saint-Léonard, fais donc des copies-écran des cartes topographiques suisses que l'administration fédérale met à disposition. J'emporterai mon IPad.
Jeremy vient me chercher à 7 heures et on descend manger à Cully. Sur la terrasse du Bistrot. On y rencontre un drôle de bonhomme, une trentaine d'années, il revient d'Ecosse à vélo, il rentre chez lui sans un sou, il aimerait un peu d'argent. Plus de 8000 kilomètres déjà depuis son départ, il lui en reste deux mille. C'était son rêve depuis tout petit, quitter la Roumanie et faire le tour de l'Europe occidentale. Il parle un français impeccable, connaît l'italien, mais c'est en anglais, dit-il, qu'il s'exprime le mieux. Il était hier au Mont-d'Orzeires au-dessus de Vallorbe, il sera demain à Martigny ou Sion, après il ne sait pas, le Simplon peut-être. Il a bien une tente sur la remorque qu'il traîne derrière son vélo, mais plus de sardines, on les lui a volées sur l'une des îles britanniques. Il dormira donc au plus simple, dans un sac de couchage au bord du lac. Je lui aurais volontiers offert une couronne de lauriers si cela avait un sens, alors voilà dix francs.
C'est l'heure de rentrer, Jeremy me laisse au Riau, la maison est vide.
Jean Prod’hom








Reverdie

En mai au douz tenz nouvel
Que raverdissent prael,
Oï soz un arbroisel
Chanter le rosignolet.
Sarderladon
Tant fet bon
Dormir lez le buissonet
Si com g'estoie pensis,
Lez le buissonet m'assis,
Un petit m'i endormi
Au douz chant de l'oiselet.
Sarderladon
Tant fet bon
Dormir lez le buissonet
Au resveillier que je fis,
A l'oisel criai merci,
Qu'il me doint joie de li :
S'en serai plus jolivet.
Sarderladon
Tant fet bon
Dormir lez le buissonet
Et quant je fui sus levez,
Ci commenz a citoler
Et fis l'oiselet chanter
Devant moi el praelet.
Sarderladon
Tant fet bon
Dormir lez le buissonet
Li rosignolez disoit
Par un pou qu'il n'enrajoit
Du grant duel que il avoit
Que vilains l'avoit oï.
Sarderladon
Tant fet bon
Dormir lez le buissonet
Me sens c'matin vilain et rustaud, ben oui le cul dans les épines, que ce que j'fous là, mais p'tain qu'ça fait du bien d'rien foutre dans l'bois. Un geai se tire, pas d'place pour lui, moi j'lis Montaigne pardis, m'étonne plus trace du geai, m'vautre et baîlle, que ce que j'fous là, mais p'tain qu'ça fait du bien d'rien foutre dans l'bois. Trop dur d's'arracher, mais t'laisse le bois l'geai, moi m'vais lire Montaigne dans mon pré.

Louise aimerait comprendre les règles de la circulation routière, et notamment les panneaux d'indication de direction. Je lui explique : dessous le panneau indiquant la sortie immédiate, dessus le panneau indiquant la sortie prochaine : Morges - Aubonne, Aubonne - Rolle, Rolle on sort, direction plage du camping où nous avons rendez-vous avec le parrain de Lili, sa femme et leur fille de 9 mois.
Premier rond-point, j'aperçois par la fenêtre ouverte une main tenant un cigare, un cigare qui ressemble à ceux que Godard fume au cinéma. On engage la poursuite, l'inconnu fait une large boucle, traverse sans se presser une zone pavillonnaire. Il prend une avenue à sens unique, sort de sa voiture, je sors de la mienne un peu plus loin, marche dans sa direction, il photographie des fleurs qui buissonnent à l'entrée d'une villa datant de la fin du siècle passé, il ressemble à un faucon crécerelle, il est cinq heures. Une femme sort, coquette, elle attend qu'il en ait terminé, ils montent dans le véhicule, une Hyundai Getz de couleur noire.

- Une photo ?
- Si vous le voulez.
- J'aimerais vous voir.
- C'est fait.
- Vous revoir.
- C'est entendu.
- Bonne fin de journée.
- A vous aussi, à bientôt.
C'est non seulement à Socrate mais à Godard que Montaigne songeait lorsqu'il rédigea ces lignes :
Le jugement humain retire de la fréquentation du monde une lumière extraordinaire. Nous sommes tous resserrés et repliés sur nous et nous avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. On demandait à à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas : "Athènes", mais "du monde". Lui qui avait l'esprit plus plein et plus étendu faisait de l'univers sa ville, adressait ses connaissances, sa société et ses sentiments à tout le genre humain, ne faisant pas comme nous qui ne regardons que sur nous.
Mais lorsqu'on demande aujourd'hui au cinéaste d'où il est, il ne répond pas : "Du monde", mais "de Rolle". Fallait bien que quelqu'un rétablisse un peu de vérité.
Jean Prod’hom




Les arpenteurs du monde

Dès lors que l'on avait peur d'une chose, il était judicieux de la mesurer.
Daniel Kehlmann, Les arpenteurs du monde, Actes Sud, 2009
Que l'anneau des forêts vienne enclore

Que l'anneau des forêts vienne enclore un espace de champs et de prairies, ce lieu tout aussitôt se met à vivre d'une vie singulière derrière sa haute muraille de frondaisons et de fûts. Séparé du monde, et sans nulle rupture cependant, il n'en reçoit plus que la rumeur, mais comme décantée : tous les bruits que le vent brasse au-dessus des campagnes infinies glissent au creux de cette conque d'herbages sans y prolonger leur confuse mêlée. Chacun d'eux, et jusqu'aux plus opaques, y retrouve sa saveur propre et ne résonne que pour soi. Le vent lui-même, partout ailleurs plainte nulle errant sans but d'un bord à l'autre de l'horizon, redécouvre sa voix perdue et chante à chaque feuille. Oui, tout ici rejoint son chant, mais un chant d'une transparence mystérieuse et qui, simple écho presque toujours, n'en livre pas moins le dessin musical d'une présence.
Gustave Roud, Le Repos du cavalier, 1958
Pierre Soulages
C'était, à un mètre cinquante du sol environ, une sorte d'énorme éclaboussure noire, trace laissée probablement par le balai d'un cantonnier qui avait goudronné la rue. Elle avait une partie unie, surface calme et lisse qui se liait à d'autres plus accidentées, marquées à la fois par les irrégularités de la matière et par une directivité qui dynamisait la forme ; le contour était d'un côté rebondi, et d'ailleurs présentait quelques excroissances à demi inexplicables et à demi possédant cette cohérence que la physique donne à l'aspect des taches de liquide projeté sur une surface. J'y lisais la viscosité du goudron, mais aussi la force de projection, les coulures dues à la verticalité du mur et à la pesanteur, liées aussi au grain de la pierre.
Pierre Soulages


Jean Prod’hom
Partirez-vous seul ?

Partirez-vous seul ? Ici encore votre décision est dictée par les impondérables. Si vous avez quelque ami proche dont le pas au vôtre s'accorde, n'hésitez pas. Il y a des moments difficiles où sa présence (toujours agréable) deviendra précieuse. De façon générale, elle influe profondément sur votre attitude corporelle et spirituelle. Il y a presque toujours un échange très complexe, de délicates interférences. Vos sensations, si elles diffèrent, réciproquement s'annulent : vous retombez à zéro. Si elles concordent, elles se multiplient ; leur produit, c'est quelque chose d'enivrant...
Une amie ? Vous n'êtes pas toujours digne de la transfiguration qu'un visage impose au monde ! Et votre fuite tournera court, sous quelque ombrage où vous serez tout de suite bien loin de vous-même.
Plusieurs amis ? Le danger de la «la bande», où seul règne l'esprit de mystification. Le groupe tend à s'affirmer contre le monde, au lieu de communier avec lui.

S'agissant de choisir un compagnon, presque aucun de mes amis (ce qui est étonnant à dire), où que je me tourne, ne semblait faire l'affaire. : tant il est rare que les intentions et les comportements, même entre proches, s'accordent exactement. L'un était trop nonchalant, l'autre trop pointilleux ; l'un était trop empoté, l'autre trop impulsif ; l'un était trop maussade, l'autre trop joyeux.. Je trouvais celui-ci plus stupide, celui-là plus réfléchi qu'il ne fallait. Je reprochais à l'un ses silences, à l'autre ses bavardages ; je redoutais l'embonpoint et la graisse d'un premier, la maigreur chétive d'un second ; c'étaient la froideur et l'incuriosité, tantôt l'ardeur et l'excès d'activité qui me rebutaient. Tous défauts qui, malgré leurs inconvénients, sont tolérables dans la vie courante : l'affection peut tout supporter, et l'amitié s'embarrasse de rien. Mais, s'agisssant d'une expédition, la gravité de ces mêmes défauts devient redhibitoire. C'est pourquoi mon esprit exigeant, qui visait à la plus haute des joies, examinait autour de lui, pesant le pour et le contre, sans jamais blesser pour autant l'amitié : lorsqu'il pressentait, pour l'expédition projetée, une source possible de désagrément, son arrêt se traduisait par le silence.
Enigme, effacer aussi ce mot

Ce qu'il y avait eu là non pas devant moi ou autour de moi, mais dans l'amalgame de moi et de ce morceau du monde, avait été peut-être la plus grande densité d'incompréhensible contre laquelle j'eusse jamais buté – avec presque de la jubilation.
Ou faut-il imaginer que l'incompréhensible était comme un ciment qui nous aurait liés ensemble quelques instants ?
Chemins imprégnés de la vie de ceux qui les avaient lentement tracés, chemins écrits par le temps sans aucune violence dans la terre, ainsi que l'eau ailleurs en creuse avec patience et sans blessures.
Ici et maintenant, dans l'épaisseur de l'énigme, dans sa chaleur, dans son silence : un vieil homme parfaitement et irrévocablement ignare, et qu'on voit donner congé aux fées, congé aux anges, congé aux Vingt-quatre Vieillards de saint Jean. Lui-même partie prenante de l'énigme dans sa plus grande densité et qui sait s'il ne devrait pas effacer aussi ce mot – afin de mieux recevoir cette bonté venue de la terre couleur de terre, couleur de soleil bientôt couché, couleur de feu très ancien.
Philippe Jaccottet, Couleur de terre, Fata Morgana, 2009
Des Forêts et Bergounioux levés de bonne heure

Me 28. 11. 2001
![]()
Levé à six heures. Je prends congé de Cathy, qui se rend au laboratoire et descendra demain à Poitiers. Nous ne serons pas très loin l'un de l'autre. Je couvre deux pages sur le Limousin puis fais mon bagage et me rends à la gare Montparnasse. Je passe au guichet faire modifier mon billet pour Rouen. Départ à trois heures moins le quart. J'avais réservé une place en wagon fumeurs et le regrette. Mon voisin m'asphyxie, avec sa Gitane. J'ai repris Ostinato, entamé il y a quelques années, et délaissé. Décidément réfractaire à ce langage scolaire, aux abstractions («orgueil», «lâcheté», «outil ébréché du langage»), à cette casuistique datée, ébréchée, pour le coup. Un grand bourgeois qui n'a jamais connu de difficultés que génériques et dont les réflexions, le «style», pourtant, sont génériques. J'ai emporté d'autres livres mais j'hésite à les ouvrir de peur d'être fatigué, en soirée, pour parler.
![]() Pierre Bergounioux, Carnet de notes 2001-2010
Pierre Bergounioux, Carnet de notes 2001-2010
![]()
Levé de bonne heure, il ne fait que réitérer la question laissée en souffrance la veille au soir, après quoi, faute de trouver à y répondre, il l'écarte avec dépit pour se remettre à l'ouvrage, mais comment y parvenir tant qu'elle n'aura pas été résolue ? Il se prend alors le front entre les mains, et c'est dans cette posture apparemment réfléchie qu'il commence une journée qui déjà s'annonce aussi ardue que la précédente, comme il en ira sans doute de toutes celles à venir, sauf à passer outre en affectant de tenir la question pour négligeable, et au demeurant rien ne dit qu'elle ne le soit pas.
Quiconque remplit honnêtement sa besogne quotidienne ne gaspille pas son temps à s'interroger sur la manière de s'en acquitter au mieux, il lui suffit, le soir venu, d'éprouver la satisfaction de l'avoir tant bien que mal accomplie, il n'en demande pas davantage, et c'est ainsi qu'il vit en paix avec lui-même, l'heureux homme, qu'on se gardera toutefois de prendre pour modèle, ce qui reviendrait à préférer le réconfort sans risque ni péril au plaisir de la recherche aventureuse.
![]() Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu'au dernier, Mercure de France, 2001
Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu'au dernier, Mercure de France, 2001
Dimanche 29 janvier 2012

Avec la précision absurde à laquelle nous devions plus tard nous habituer, les Allemands firent l'appel. A la fin, l'officier demanda : « Wieviel Stück ?» ; et le caporal répondit en claquant les talons que les « pièces » étaient au nombre de six cent cinquante et que tout était en ordre. On nous fit alors monter dans des autocars qui nous conduisirent à la gare de Carpi. C'est là que nous attendaient le train et l'escorte qui devait nous accompagner durant le voyage. C'est là que nous reçûmes les premiers coups : et la chose fut si inattendue, si insensée, que nous n'éprouvâmes nulle douleur ni dans le corps ni dans l'âme, mais seulement une profonde stupeur : comment pouvait-on frapper un homme sans colère ?
Il y avait douze wagons pour six cent cinquante personnes. Dans le mien nous n'étions que quarante-cinq, mais parce que le wagon était petit. Pas de doute, ce que nous avions sous les yeux, ce que nous sentions sous nos pieds, c'était un de ces fameux convois allemands, de ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions si souvent entendu parler, en tremblant, et vaguement incrédules. C'était bien cela, très exactement : des wagons de marchandises, fermés de l'extérieur, et dedans, entassés sans pitié comme un chargement en gros, hommes, femmes et enfants, en route pour le néant, la chute, le fond. Mais cette fois c'est nous qui sommes dedans.
Primo Levi, Si c'est un homme, 1947 (Julliard 2003, 17-18)
On l'aura compris

On l'aura compris : ce que je cherche à faire surgir, tant avec l'espace all over des trajectoires animales qu'avec celui, rhizomatique, des déploiements, c'est de fournir des contre-exemples aux logiques de filiation et d'enracinement, c'est de dire, en quelque sorte, que le pays se dépayse de lui-même et que c'est ainsi, mystérieusement, qu'il devient ressemblant.
Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement, Seuil, 2011
De quel droit est-ce que j'ose appeler demain ?

Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini, il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leurs dernières forces. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance, et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords. D'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi, moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain ?
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, III, 14
Edouard Monot | Opus incertum

Lorsque nous nous sommes acquittés de nos dettes et de l’inévitable, lorsque nous en avons fini avec la pile des affaires courantes, les peines, les été pourris et l’hiver qui se prolonge, les longs couloirs, les sales affaires, la file des obligations, les salons, les successions, les petits plaisirs et les jours les plus longs, bref, lorsqu’on en a fini avec ce qui assure l’équilibre de nos vies précaires et de leurs saisons, n’est-il pas heureux de disposer d’un peu de temps, hors tout, pour retourner au monde qui nous était promis – ou dont on avait rêvé – et dont nous nous sommes tenus éloignés, silencieux, en pliant l’échine parfois ?
Il est de ceux qui ont su aménager le recoin d’une cuisine pour mettre bout à bout les morceaux d’une aventure esthétique singulière, aux contours indéterminés, une de ces aventures qu’on poursuit sans trop savoir pourquoi, avec le souci de la mener à bien, la conviction qu’on n’y parviendra qu’imparfaitement et l’assurance qu’elle nous laissera au mieux les mains vides.
Pas besoin d’un palais pour cela, ni année sabbatique ni résidence d’artiste, une antichambre, l’ombre d’une arrière-boutique, un atelier d’occasion et un peu de temps arraché chaque jour lui ont suffi pour rassembler au moment voulu une trentaine d’objets qui tiennent circonscrit l’incertain, saisi à peine entre ombre et lumière, offert à ceux des passants qui veulent bien renouer un bref instant avec la construction de ces châteaux de sable qui, l’été, irriguaient leur enfance et retrouver le sérieux qui les habitait, l’hiver, devant des puzzles géants.


Des petites fenêtres, rien d’autre que des petites fenêtres en trompe-l’oeil, et dedans une durée, une durée qui dure, un temps qui ne file pas droit, c’est-à-dire du temps roulé comme de la pâte, avec dedans la possibilité que quelque chose survienne.
Mais nous avions beau faire, notre reflet se mêlait à ce que nous croyions voir. Où que nous soyons, nous apercevions le reflet d’un visage captif et le milieu dans lequel il se complaisait, la silhouette d’un inconnu qui nous tenait éloignés de ce que nous étions venus chercher. Tout se passait à notre insu, dans un dialogue organisé hors de nous par la lumière, entre le monde qui va pour son compte dans les pièges d’un miroir sans tain et l’immobilité absorbante de ce qui reste de la représentation derrière les battants d’une fenêtre.
Il y avait pourtant dans ce mariage quelque chose à saisir, les ailes de feu d’un papillon exposé dans une vitrine, derrière ou devant un visage égaré. Mais qui du papillon ou du visage était le suaire, et pour quelle histoire ? 

Le soleil déclinait lentement vers l’horizon. Au ras de l’amoncellement rocheux couronnant l’île, la grotte ouvrait sa gueule noire qui s’arrondissait comme un gros oeil étonné, braqué sur le large. Dans peu de temps la trajectoire du soleil le placerait dans l’axe exact du tunnel. le fond de la grotte se trouverait-il éclairé ? Pour combien de temps ? Robinson ne tarderait pas à le savoir, et sans pouvoir se donner aucune raison il attachait une grande importance à cette rencontre.
L’événement fut si rapide qu’il se demanda s’il n’avait pas été victime d’une illusion d’optique. Un simple phosphène avait peut-être fulguré derrière ses paupières, ou bien était-ce vraiment un éclair qui avait traversé l’obscurité sans la blesser ? Il avait attendu le lever d’un rideau, une aurore triomphante. cela n’avait été qu’un coup d’épingle de lumière dans la masse ténébreuse où il baignait. le tunnel devait être plus long ou moins rectiligne qu’il n’avait cru. Mais qu’importait ? Les deux regards s’étaient heurtés, le regard lumineux et le regard ténébreux. Une flèche solaire avait percé l’âme tellurique de Speranza.
Le lendemain le même éclair se produisit, puis douze heures passèrent de nouveau. L’obscurité tenait toujours, bien qu’elle eût tout à fait cessé de créer autour de lui ce léger vertige qui fait chanceler le marcheur privé de points de repères visuels![]() Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 104)
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 104)
![]()

![]()
![]()
![]()

On ouvrit donc les fenêtres et on mit l’île autrefois sous cloche au vent. La Verzasca déboulait sous nos pieds, elle avait mis en pièces la montagne, creusait son lit dans un bruit assourdissant. L’eau insaisissable chantournait les éboulis et polissait les fragments d’un puzzle aux motifs inconnus. Elle écrivait de haut en bas un récit immobile qui se poursuivait et que rien ne pouvait arrêter. Les pierres s’arrondissaient, l’eau multipliait ses passages, modelait des réduits, creusait des poches, dessinait des avenues, dévalait la pente entre les cimes et le lac, aménageait les ruines de la montagne en d’innombrables petits chaos irrigués dessus dessous par l’eau qui tenait ensemble l’ensemble qu’elle faisait briller et chanter.![]()

![]()
![]()
![]()

Qu’avions-nous donc à faire de notre côté ? Reprendre une à une les choses mises en pièces en prenant à son compte la part laissée au hasard, reprendre une préhistoire dont on ne sait rien, dessus dessous, la recommencer comme un tavillonneur sous un ciel bleu, refaire ce dont le hasard n’aura été que la réponse paresseuse et immédiate à ce qu’on ne sait voir, reprendre pierre à pierre depuis le dedans, de proche en proche, différant le nom de ce qui commande l’aventure. Aucune appellation ne viendra donc boucler l’ouvrage, ou sans titre, une expression qui n’assure de rien. ![]()

![]()
![]()
![]()

Opus incertum, une manière de sonder latéralement l’insaisissable, de reconstruire solidement le précaire en lui offrant un fond, une coque pour autre chose. Ici pour rien ou pour elle-même, un ouvrage détaché de sa fin.
Les petits accidents jouent des coudes, la main écarte deux pièces pour rectifier l’équilibre, demi-tour, reculer ou avancer d’un plan, fort, da, les doigts reprennent des pièces, les refaçonnent, dessus dessous, établissent des ponts, creusent des galeries, collent et recollent, tout recommencer parfois.
Ça va tenir, ça va tenir sans titre, et si ça ne tient pas, on recommencera la partie. Mais sans laisser la main à celui qui n’en a nul besoin et qui fait vivre le monde comme un marionnettiste connaissant le fin mot de l’histoire, mais en prenant cette fois l’affaire sur soi et d’en-bas, comme un insomniaque qui guetterait le lever du jour, avec les mains qui retrouvent leurs fonctions ouvrières, à hauteur des pierres.
Les doigts se méfient des figures et des désignations qu’il tiennent prudemment à distance, ils exigent le silence et se taisent aussitôt que la représentation guigne avant de fondre sur leur attention et les détourner de ce qui est pour les enrôler dans ce qu’ils pourraient dire. Ça va tenir, ça va tenir donc en-deça de la représentation. Ça va tenir en équilibre, par la grâce d’une syntaxe élémentaire de formes rudimentaires, de formes concrètes tenues en un équilibre dont il faudrait faire le récit épique, du déséquilibre initial qui lui donne la chance unique d’aller au-delà de la nature morte au déséquilibre final qui en fait un tableau vivant, tiré à quatre épingles, debout et fragile, sans pierre d’angle ni clef de voûte.![]()

![]()
![]()
![]()

Mais on a beau dire au diable les maîtres signifiants, ils demeurent sur le qui vive. C’est l’eau qui sourd du chaos des rives de la Verzasca qui rend notre monde vivable, si bien que toute nature morte bien comprise n’a de sens que si elle reste vivante. La vie, je dis bien la vie, se fraie un passage dans le chaos auquel elle donne vie, l’aventure des coquelicots et de la camomille se prépare dans les interstices des pavés. C’est dire qu’une nature morte – et toute l’histoire de l’art n’est peut-être que l’histoire mouvementées de la nature morte – si elle ne raconte rien, n’en est pas moins le lieu même où se raconte la possibilité que quelque chose peut advenir.
L’un dira le berger, l’autre l’orage, un troisième la maison, bien-sûr personne n’y croit vraiment, mais chacun est assuré que quelque chose va se lever dans ce rien en équilibre précaire, quand bien même ce rien ne se lèvera pas, demeurera en retrait sur le mode de ce qui n’est pas encore.
Car au-delà du blanc sur fond blanc – ou en-deça – on est embarqué, avec le sens qui nous pousse de l’arrière et les choses qui nous attendent au contour. Papillons, coquelicots, mues de serpents ramassés au bord des routes, rouge sang, rouge pourpre, écriture enfin. Voici une macédoine, voici un banc de melons et de pastèques, voilà un jaune d’oeuf et une ribambelle de tessons usés par la mer. Malaxe, malaxe.![]()
Travaux actuels d’Edouard Monot
Exposition du 6 septembre au 5 octobre 2011
Horaires d'ouverture
Mardi au vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 17h
Jean Prod’hom
Une seule journée

« Ce qui a le plus changé dans ma vie, c’est l’écoulement du temps, sa vitesse et même son orientation. Jadis chaque journée, chaque heure, chaque minute était inclinée en quelque sorte vers la journée, l’heure ou la minute suivante, et toutes ensemble étaient aspirées par le dessein du moment dont l’inexistence provisoire créait comme un vacuum. Ainsi le temps passait vite et utilement, d’autant plus vite qu’il était plus utilement employé, et il laissait derrière lui un amas de monuments et de détritus qui s’appelait mon histoire. (...) Peut-être cette chronique dans laquelle j’étais embarqué aurait-elle fini après des millénaires de péripéties par « boucler » et revenir à son origine. Mais cette circularité du temps demeurait le secret des dieux, et ma courte vie était pour moi un segment rectiligne dont les deux bouts pointaient absurdement vers l’infini, de même que rien dans un jardin de quelques arpents ne révèle la sphéricité de la terre. Pourtant certains insignes nous enseignent qu’il y a des clefs pour l’éternité : l’almanach, par exemple, dont les saisons sont un éternel retour à l’échelle humaine, et même la modeste ronde des heures.
Pour moi désormais, le cercle s’est rétréci au point qu’il se confond avec l’instant. Le mouvement circulaire est devenu si rapide qu’il ne se distingue plus de l’immobilité. On dirait, par suite, que mes journées se sont redressées. Elles ne basculent plus les unes sur les autres. Elles se tiennent debout, verticales, et s’affirment fièrement dans leur valeur intrinsèque. Et comme elles ne sont plus différenciées par les étapes successives d’un plan en voie d’exécution, elles se ressemblent au point qu’elles se superposent exactement dans ma mémoire et qu’il me semble revivre sans cesse la même journée. »
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 218-219)
L'autre île

« ... quand il comprit soudain la cause de son éveil tardif : il avait oublié de regarnir la clepsydre la veille, et elle venait de s’arrêter. A vrai dire le silence insolite qui régnait dans la pièce venait de lui être révélé par le bruit de la dernière goutte tombant dans le bassin de cuivre. En tournant la tête, il constata que la goutte suivante, apparaissait timidement sous la bonbonne vide, s’étirait, adoptait un profil piriforme, hésitait puis, comme découragée, reprenait sa forme sphérique, remontait même vers sa source, renonçant décidément à tomber, et même amorçant une inversion du cours du temps.
Robinson s’étendit voluptueusement sur sa couche. C’était la première fois depuis des mois que le rythme obsédant des gouttes s’écrasant une à une dans le bac cessait de commander ses moindres gestes avec une rigueur de métronome. Le temps était suspendu. Robinson était en vacances. Il s’assit au bord de sa couche. Tenn vint poser amoureusement son museau sur son genou. Ainsi donc la toute-puissance de Robinson sur l’ile – fille de son absolue solitude – allait jusqu’à une maîtrise du temps ! Il supputait avec ravissement qu’il ne tenait qu’à lui désormais de boucher la clepsydre, et ainsi de suspendre le vol des heures...
Il se leva et alla s’encadrer dans la porte. L’éblouissement heureux qui l’enveloppa le fit chanceler et l’obligea à s’appuyer de l’épaule au chambranle. Plus tard, réfléchissant sur cette sorte d’extase qui l’avait saisi et cherchant à lui donner un nom, il l’appela moment d’innocence. Il avait d’abord cru que l’arrêt de la clepsydre n’avait fait que desserrer les mailles de son emploi du temps et suspendre l’urgence de ses travaux. Or il s’apercevait que cette pause était moins son fait que celui de l’île tout entière. On aurait dit que cessant soudain de s’incliner les unes vers les autres dans le sens de leur usage – ou de leur usure – les choses étaient retombées chacune de son essence, épanouissaient tous leurs attributs, existaient pour elles-mêmes, naïvement, sans chercher d’autre justification que leur propre perfection.. Une grande douceur tombait du ciel, comme si Dieu s’était avisé dans un soudain élan de tendresse de bénir toutes ses créatures. Il y avait quelque chose d’heureux suspendu dans l’air, et, pendant un bref instant d’indicible allégresse, Robinson crut découvrir une autre île derrière celle où il peinait solitairement depuis si longtemps, plus fraîche, plus chaude, plus fraternelle, et que lui masquait ordinairement la médiocrité de ses préoccupations.
Découverte merveilleuse : il était donc possible d’échapper à l’implacable discipline de l’emploi du temps et des cérémonies sans pour autant retomber dans la souille ! Il était possible de changer sans déchoir. Il pouvait rompre l’équilibre si laborieusement acquis, et s’élever, au lieu de dégénérer à nouveau. Indiscutablement il venait de gravir un degré dans la métamorphose qui travaillait le plus secret de lui-même. Mais ce n’était qu’un éclair passager. la larve avait pressenti dans une brève extase qu’elle volerait un jour. Enivrante, mais passagère vision. »
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 93-94)