Praz l'Armaz (Corcelles-le-Jorat)

Mon nez coule, les chevaux éternuent ; les chevreuils ont pris la couleur des feuilles mortes, les bouleaux tiennent haut leurs bras blancs dans la nuit qui tombe, mal de tête et courbatures. J’aurai passé la journée dans les combles à somnoler et lire quelques pages de François Dagognet et de Vladimir Jankelevitch sur la mort. Mon dieu que les philosophes parlent lourd, et du lourd c’en est, surtout chez le second, qui pourtant, par moments, me laisse supposer que nous tournons autour d’un même point.
Telle est la lointaine proximité que Maeterlinck a laissée en suspens dans Intérieur : entre la nouvelle fatale qui arrive dans la nuit et le bonheur paisible d’une famille encore ignorante du drame qui l’a déjà frappée, entre la subconscience soucieuse et l’heureuse incurie, il y a cette vitre et ce jardin, et cette épaisseur de ténèbres.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la profonde vérité rationnelle du souci et la profonde vérité superficielle de l’insouciance sont deux vérités contradictoires et pourtant également vraies.

On finit par sortir, la polaire vert pomme et la veste rouge cassis de Sandra s’allient au bleu et au jaune des ruches de la Mussilly, on enfonce dans la boue, Oscar lève dans le bois Vuacoz deux groupes de chevreuils qui ne s’y attendaient pas, personne ne sort par ce temps.
Bonne nouvelle pour Pâques prochain, on ira voir le pape. Sandra a loué un appartement sur le Campo dei Fiori.
Jean Prod’hom
COOP (Oron)

Depuis quelques années, je remarque que les circonstances ont un effet toujours plus marquant sur l’exercice de ma raison, à tel point que je me demande aujourd’hui si elle ne suit pas scrupuleusement les indications chiffrées que lui transmettent les mouvements de mon corps physiologique et les accidents du temps qu’il fait. J'ai le souvenir qu'adolescent rien ne pouvait m’arrêter lorsque j’avais décidé de légiférer sur le monde, qu’il neige ou qu’il vente, que j’aie bu un coca ou une vodka. Avec le succès que l’on sait.

De l’air, j’en brasse encore aujourd’hui, mais avec la conscience toujours plus vive de mon inefficacité ; mon attention aux circonstances m’incline désormais à ne pas en faire trop ; un rien m’arrête, m’amène à hésiter, me fait tousser ou me soulève, me remue, colore mon âme, paralyse mon esprit, fait patiner ma raison. Je les laisserai faire aussi longtemps qu’il m’en restera quelque chose, aussi longtemps que le corps qui les a circonscrits sera en mesure de les contenir. Et quand ce que j’ai cru être aussi pointu que l’extrémité de la plus fine des aiguilles se détachera, lorsque le pouce et l’index ne se refermeront plus, j’irai rejoindre l’étendue et la danse émoussée des poussières.
Je voudrais, avant, lever une peur qui grossit d’être contenue dans les filets d’un récit squelettique, je voudrais lever cette peur du mourir ; en marchant, en prenant du retard ou de l’avance, en écoutant et en écrivant de travers. Sans pourtant quitter la partie, comme lorsque je me trouvais le dimanche après-midi, après le repas dominical, étendu sur le canapé du salon, prétendument malade, écoutant les voix bien vivantes des gens que j’aimais et qui m’avaient oublié, comme mort, à l’image des portraits photographiques alignés sur le secrétaire. Un peu à côté, pas même une parabole, un pli, un pli bientôt défait, un pli du côté des vivants.
Jean Prod’hom
Bois Vuacoz (Corcelles-le-Jorat)

Il y a des jours ainsi, ni la tête ni le corps ne suivent ; alors on cherche à s’accrocher à quelque chose, à un mot, une phrase, à une image, un peu de soleil, au chant lointain d’une mésange. Rien. On se dit que ça va forcément arriver.

Ce sera un épicéa, huitante ans, trente mètres, abattu cet après-midi. Ils s’y sont mis à deux, coins, masses et tronçonneuses, il a serré les dents puis s’est effondré.
Jean Prod’hom
Véranda (Corcelles-le-Jorat)

Ne jamais être entièrement à ce qu’on fait, ne serait-ce que pour en sortir.
Un ongle incarné peut ruiner une vie.
Elle n’en revenait pas d’être allée si loin.
Jean Prod’hom

Fey

A l’intérieur d’un cube de béton sans barreaux, j’accueille ce matin vingt-neuf élèves. Dans la boîte aux lettres ce midi, je récupère le numéro de la revue faire part consacré à Gil Jouanard et le papier annonçant la journée qui lui sera consacrée en mars au Cheylard.
Sur le chemin longeant la Menthue, cet après-midi, je fais une balade avec Edmond, autrefois employé agricole à Ropraz, aujourd’hui à la retraite ; il poussait alors une carriole de Vers-chez-les-Rod à la laiterie, dans laquelle il fixait soir et matin trois boilles à lait. Il chantait à tue-tête, lorsqu’il faisait encore ou déjà nuit, des mélopées au caractère indécis, entre louanges et imprécations, pour s’assurer de la protection du Très-Haut ou effrayer le diable qui hante depuis toujours ces fonds de la Corcelette.
Edmond est depuis quelques années l’un des vingt résidents de l’ancienne maison de la direction Nestlé chargée alors de fabriquer, dans les fonds de Bercher, le lait condensé. Edmond prie, Edmond s’inquiète de ce que lui réserve le ciel.
C’est de là-haut

C’est de là-haut, le regard tendu vers la maison aux volets verts, au deuxième étage de laquelle la vie de l’inconnu déclinait, que j’ai cherché à me représenter pour la première fois – à rêver ou à penser – le peu qui lui restait à vivre ; à concevoir un chemin qui croiserait le sien sans lui faire de l’ombre, à faire les premiers pas sur un tracé qui n’existait pas, que j’avais à la fois à imaginer et à emprunter, avec une exigence que j’aurais voulue égale à la sienne ; à marcher en pleine lumière, celle des jours auxquels il mêlait toujours davantage, à mesure qu’il s’allégeait, son propre silence et son évidence, même la nuit ; et à tenter d’écrire ce qui ne pouvait avoir lieu que de ne pas être dit.
C’est aussi de là-haut que je suis parti le dernier jour, à pied, pour rejoindre le jardinet de la maison aux volets verts, où l’infirmier-chef m’apprit que Monsieur était mort, seul comme il l’avait voulu, un matin de printemps, la fenêtre grande ouverte.
Jean Prod’hom

On l'appelait Monsieur

On l'appelait Monsieur dans le quartier. Et lorsque il n'eut plus la force de s'occuper de ses affaires, que sa marche devint trop difficile et qu’aucun signe ne laissa plus prévoir qu’il pourrait en aller autrement, il s'enquit d'un lieu qui lui offrirait un asile, à l'écart de la ville qu’il avait habitée sans y être vraiment, sans même la voir jamais, occupé qu’il fut aux travaux auxquels sa condition l’obligeait et auxquels il ne se déroba pas, qui l’éloignèrent de ce qu’il s’était promis de retrouver à la sortie du jardin de l’enfance, une innocence, et qui l’auraient amené à la fin, s’il n’y avait pris garde, à laisser à d’autres le soin d’écrire qu’il en avait été.
Jean Prod’hom

Toutes les minutes ne comptent pas

Toutes les minutes ne comptent pas, bien au contraire. Une seule suffit, celle qui se prolonge indéfiniment et dont il convient de ne pas nous couper, ni de nous écarter. Sans laquelle nous laisserions filer une fois encore ce qui nous échappe, condamnés à vivre à nouveau en-deçà ou au-delà. Une seule minute, qui s'élargirait jusqu'à envelopper ce qui nous manque, à laquelle nous nous joindrions, comme l'eau au goulet d'une fontaine qui déborde.
Jean Prod’hom
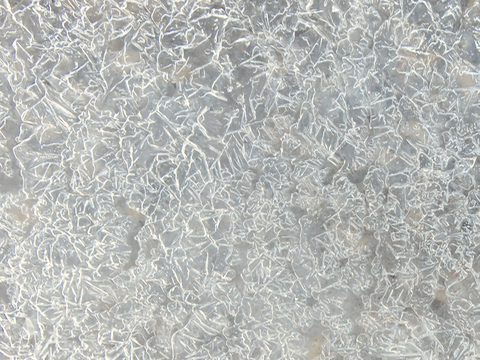
Ristorante Amici (Lausanne)

Anniversaire de Françoise, balade par les hauts puis la Goille, avec à l’est les préalpes à hauteur d’épaule, comme en Engadine.

Elisabeth raconte qu’elle et Edith montaient par le Calvaire jusqu’à l’Hôpital cantonal, où elles regardaient, le front collé à la vitre du pavillon qui leur était réservé, la rangée des prématurés. Tandis que Michel et moi, à quelques pas de là, dans la vallée du Flon qui roulait ses eaux sales, nous ramassions pour dix sous les cadavres des bouteilles jetées par ceux qu’on appelait les saoulons et qu’hébergeait l’Armée du Salut.
Nous avions une dizaine d’année, étaient entrées ensemble au rez-de-chaussée de Riant-Mont 4 une télévision, une caisse de boissons gazeuses et, parquée devant la boulangerie, une 4L.
Jean Prod’hom
Moille-aux-Blanc (Corcelles-le-Jorat)

Cher Pierre,
Grand retour du soleil, avec les jours qui s’allongent ; la vie a repris des couleurs, bruants, mésanges et moineaux sont de sortie et donnent à ce quartier du Jorat un petit air de printemps, c’est pourtant un jour à garder les mains dans les poches.

L’air froid, sec, et la neige bien serrée étouffent le bruit des pas du marcheur, les bêtes ne s’y trompent pas. Un chevreuil et un renard se sont donné rendez-vous à la lisière du bois Vuacoz ; le premier croque l’extrémité des jeunes pousses de foyard du printemps dernier, le second est de passage, jette un coup d’oeil à l’aire de pique-nique.
La Moille-au-Blanc, à quelques kilomètres de la ville, loin des horloges et de la succession des petits emmerd’s, offre ce matin une assez belle image de la durée, traversée en tous sens par le chant des oiseaux, le murmure de l’eau de la fontaine, les traits de lumière et les taches d’ombre, asile sans murs ni toit qui me désencombre.
Ce ne sont pas les moeurs et les coutumes des bêtes, leur repaire ou le territoire qu’elles contrôlent, qui me les rendent indispensables ; car au fond, elles vivent à peu de choses près ce que nous vivons. Non, ce qui me les rend indispensables, c’est le suspens dans lequel les circonstances nous installent elles et moi lorsqu’on se croise, avant que, assurées de ma réalité et du danger que je représente, elles se dérobent, se défilent sans se retourner, laissant en plan le chasseur que j’aurais pu être, mais abandonnant à mes pieds la certitude qu'il existe à côté de celle que croyais unique, une autre manière d’habiter la terre, au fond des bois qu’elles rejoignent par une ouverture de fortune, avec une élégance et une confiance que j’envie. Et cette apparition se prolonge par l’éclosion d’un espace aux dimensions que je ne soupçonnais pas, large et lumineux, où je ne suis plus seul parmi les hommes, et où vivre, vieillir et mourir deviennent à nouveau possibles.
Jean Prod’hom
Sainte-Catherine (Lausanne)

Adieu la vapeur, bienvenue à l’interconnexion généralisée, celle des machines, des systèmes et des personnes, bienvenue au sommet économique de Davos qui a ouvert ses portes hier, avec pour thème la quatrième révolution industrielle, celle qui va tirer parti de la rencontre de la physique, du numérique et du biologique.

J’en ai entendu parler ce matin à la radio, tandis que je roulais sur le plateau de Sainte-Catherine. Lorsque le spécialiste s’est tu, j’ai aperçu au Chalet-à-Gobet, montant d’Epalinges, une vague immense, menaçante, sur laquelle j’ai préféré, un instant encore, fermer les yeux en prenant la route du golfe.
Jean Prod’hom
Triage (Corcelles-le-Jorat)

Peu de bruit sous celui assourdissant de mes pas, la neige est haute et lourde. Il faut s’arrêter et tendre l’oreille pour s’assurer que la vie n’a pas cessé, deviner le ruisseau en contrebas, l’avion au-dessus du brouillard, la poignée de neige qu’une branche laisse échapper.

Le temps s’est adouci, il goutte, les couleurs ont disparu. Je monte au triage, on dit des bouvreuils pivoines qu’ils sont sédentaires ; les miens ont visiblement une résidence secondaire. Je demeure immobile, Oscar aux aguets ; c’est notre silence qui effraie le chevreuil caché dans le sous-bois, il se hâte de changer de quartier.
A la cime des arbres, le sifflement des oiseaux ne tiennent qu’à un fil.
Jean Prod’hom
Les Cullayes

Il a neigé cette nuit, Pierrot a ouvert la route à l'aube. Je monte à la Mussilly, la neige s’étend à perte de vue ; le soleil guette au-dessus du brouillard, personne pour nous arrêter. Je songe à Robert Walser marchant dans les collines d’Appenzell. Ce n’est naturellement qu’une image, et la neige n’est pas une page.

Mais s’il est allé mourir au bout de l’épuisement au-dessus de Hérisau, à quelques pas d’une barrière contre laquelle il ne se sera pas appuyé, préférant ouvrir les bras à la terre et au ciel, c’est qu’il avait déjà consciencieusement pris congé des hommes, s’efforçant depuis longtemps à n’être rien, ou presque rien. Les récits de Robert Walser en témoignent, par où la vie se manifeste, jolie et imprévue. Ils courbent l’espace que lui-même traverse en ligne droite, sans y toucher, laissant à la fin le livre ouvert, pages blanches dans lesquelles il ne fut jamais vraiment question ni de commencement ni de fin.
Jean Prod’hom
Salle 107 (Mont-sur-Lausanne)

D’être aujourd’hui ici, avec eux, seuls ou par deux, est le produit d’un concours de circonstances qui n’en finit pas, mais aussi de l’obstination des plus convaincus. C’est grâce à leurs dons de voyance que nous usons, presque tous, de l’écriture et de la lecture, sans lesquelles nous serions encore enchaînés à l’immédiat, inaptes à goûter de la liberté seconde, éclairée, éclairante, qui nous a rendus aptes à suspendre, à différer nos actes et nos jugements à l’emporte-pièce.

Beaucoup d’entre nous ont oublié cette genèse, ou ne l’imaginent qu’à peine, s’assoient chaque matin en traînant les pieds, avançant pour leur défense qu’il en sera ainsi aussi longtemps que l’obligation institutionnelle bâillonnera leur liberté première.
Un retour à l’immédiateté de seconde génération menace, susceptible de ramener l’espèce au rang des bêtes que nous avons été, analphabètes, livrés à la violence dont nous croyions nous être écartés pour toujours et qu’on voit poindre à nouveau. Il conviendrait donc, à côté des contenus colportés par les livres et par ceux qui sont supposés savoir, de faire voir et entendre ce qui les a rendus possibles, ce mystérieux retrait et ce sursis que nous ont apportés l’écriture solitaire et la lecture silencieuse.
Jean Prod’hom
Forum des Halles (Paris)

Dessus, quelques employés taillent l’un des deux cent cinquante-sept platanes qui bordent le boulevard Sébastopol. Trois équipes de sept à dix élagueurs, préposées la semaine à l’entretien des arbres de l’un ou l’autre des vingt arrondissements de Paris qui leur sont attribués, unissent leurs forces ce matin, pour prendre de l’avance sur un boulevard très fréquenté la semaine. Ils coupent à la tronçonneuse les basses charpentières et taillent les branches qui touchent aux façades. On compte plus de 100 000 arbres alignés dans la ville, des platanes surtout, mais aussi des tilleuls, des marronniers. Les élagueurs reviendront boulevard Sébastopol, dans sept ans.

Pas sûr, l’entretien de cet aménagement urbain né à la fin du XVIème siècle coûte cher ; les politiques et les acteurs économiques s’en sont avisés depuis longtemps déjà, ils ont organisé et financé de nouveaux travaux, d’autres suivront. Dessous les villes, en effet, on s’affaire.
Plongée sous-marine, pour m’en convaincre, dans les sous-sols du forum des Halles. Les nouveaux habitants avancent, décidés, des écouteurs en guise de pince-nez, un GPS à la main. Ils sont nés dans cette ville, certains n’ont jamais vu le jour. Je manque d'air, me perds ; m’accroche à quelques signes, un homme court ; sortie de secours, je m’en sors. Je les laisse en-bas, captifs, ne peux rien pour eux, l’étau s’est resserré, égarés eux aussi, autrement.
Quand la ville sera dessous, toute, qu’on aura dessus laissé l’inutile, brûlé les livres, lorsque l'ancienne ville sera rendue à la nuit et aux trembles, aux ronces, au gui et à l’églantier, il restera certainement aux habitants de la nouvelle cité des souvenirs de ce pays de Cocagne, des souvenirs de seconde ou de troisième main.
Comment racontera-t-on alors l’amble, les grands boulevards, et l’omble chevalier lorsqu’il glisse des mains du pêcheur ?
Jean Prod’hom
Beaubourg (Paris)

L’inconnue pleure dans le hall du centre Pompidou, celui qu’elle aime a le coeur sec. Je les retrouve le long du canal Saint-Martin, rempli de cadavres, l’eau n’y coule plus. Elle a le coeur plein, il a le coeur vide. On y fait des travaux jusqu’en avril. D’ici là l’eau aura coulé sous les ponts.

Jean Prod’hom
Belleville (Paris)

Zones franches,
landes et limbes,
rues Portefoin et Belleprison.
Oh Paris !

Walton Ford, Rhyndacus (détail), musée de la chasse et de la nature
Jean Prod’hom
Dijon

Réfléchir à la main,
ne rien effacer,
ni l’oubli ni l’ombre.
Et reprendre sur un autre versant.

Jean Prod’hom
Gif | 14 janvier 2016

Cher Jean,
Oui, c'est un anniversaire qui mérite d'être célébré. Vous avez tenu bon, persévéré, obstinément porté dans l'ordre second de l'écrit le temps évanescent, impalpable, irréparable, dévorant. La vertu de pareille opération est double. Il ne s'effacera plus, du moins cette part qu'on a fixée sur le papier, et la plume révèle ce qui échappe à la conscience nue, des arrière-plans étagés, un sens enfoui, de la réalité sous la réalité, à l'infini. C'est ce que n'ont cessé de répéter les anthropologues anglo-saxons qui se sont avisés de la contribution que l'écriture a apportée à l'éveil, à l'usage, à l'empire de la raison. On n'est pas les mêmes selon qu'on mobilise ou non l'outillage graphique. Bon anniversaire, donc, et en avant pour une nouvelle année, deux, cent...
Comment ne pas signaler aux habitants du Jorat qu'il n'a toujours pas gelé dans le Bassin parisien. Les jonquilles ont commencé à fleurir le 2 décembre et continuent imperturbablement. Des pommiers du Japon et un amandier sont en fleur et on a encore récolté une poignée de framboises, au jardin. Le réchauffement ne fait pas de doute.
Bonne année à vous et amitiés.
Pierre

Pierre Bergounioux | Carte géologique massif central
Corcelles-le-Jorat | 13 janvier 2016

Cher Pierre,
C’est le 14 janvier 2015 que je me suis lancé dans cette aventure, elle m’aura emballé. Voici la trois cent soixante-cinquième lettre que je vous adresse, il est temps de ralentir la cadence sans toutefois vous oublier. Je vous tiendrai au courant du temps qui passe, ici dans le Jorat, des saisons, des enfants qui grandissent, des forces qui manquent, de la prochaine reverdie.

J’ai été un lecteur enthousiaste des notes que vous avez rédigées entre 1980 et 2010, aveuglé par je ne sais quoi... j’attends d’ailleurs avec impatience la prochaine livraison. Et puis, vous m’avez envoyé, en mars dernier, vos notes de l’année 2014. Curieux mais inquiet, j’en ai différé la lecture par crainte qu’elles n’entament mes maigres forces en instillant dans cette correspondance – d’abord fictive, puis semi-fictive et enfin un peu réelle – questions et doutes qui les auraient épuisées.
Mais le temps est venu que je m’y penche, avec un intérêt accru ; on ne sort pas indemne d’un tel exercice quotidien. Il m’aura en effet permis d’en éprouver les limites, de donner une expression à mes jours et d’en accepter l’augure ; car cet exercice qui prétend consigner ce qui a été ne manque pas de mordre sur l’avenir en y traçant des attentes et des lignes de fuite, d’ouvrir sur ce qui n’est pas et qui ainsi souvent sera. Ces billets à vous adressés, de par leur aspect technique, de par les choix que je n’ai pas manqué de faire – on ne peut pas tout dire – frôle à tout moment la fiction : ils m’ont conduit à regarder ce que j’aurais ignoré, à nommer ce qui n’avait pas de nom, à donner un rythme à ce qui en manquait. Nos jours sont constitués d’une succession d’actions que l’esprit vertèbre en projetant une signification, et que l’écriture organise en une succession de mots et de chevilles que le diariste ajuste les uns aux autres – comme l’enfant combine les éléments du mécano de ses 6 ans, pour lequel les échafaudages, les grues et la ville à laquelle il rêve se confondent.
J’emporte ce soir à la bibliothèque vos notes de 2014, content comme un gamin qui ouvre à Noël une boîte de construction, réjoui à l’idée de retirer le voile et de goûter aux mots et aux chevilles, aux points-virgules et aux virgules, de tout ce qui permet, dans le langage, de nous dégager de nos vies de bêtes de somme, pour donner à nos existences une forme qui les transfigure, ne serait-ce qu’un instant. Suaire plutôt que peau de chagrin.
Amitiés.
Jean
Les morts n'emportent rien

Cher Pierre,
Il pleut lorsque je conduis Arthur à l’arrêt de bus, continue jusqu’à Mézières où je dépose au bancomat l’argent des pâtisseries vendues samedi à Romanel, et retire les euros dont j’aurai besoin en fin de semaine.

Il pleuvine lorsque je monte à la Mussily et l’eau roule, brune et huileuse, au fond du fossé qui borde le chemin à double ornière. Malgré ce temps de chien, Oscar trottine, court, lève la colonie de pinsons qui squattent depuis une semaine les restes de maïs au-dessus de chez Freddy. A y regarder de près, ce ne sont pas des pinsons ; j’aperçois un peu de jaune, un peu de vert, des verdiers ou des bruants jaunes.
Le responsable d’une revue locale souhaite consacrer un numéro à la poésie des alentours ; il m’a invité hier à y participer en précisant qu’il attend mon envoi pour le 29 janvier. J’apprends par la même occasion que Pascal est de la partie. Retrouver quelques-uns de ses textes à côté des miens, pour autant que le responsable de cette revue les accepte, me ravit. Quinze jours ? Pas le choix ! Il va falloir que je descende à l’atelier, que je me penche sur mes réserves. Et mes réserves, c’est ce site.
David Bowie est mort, tout le monde en parle, retient ses larmes, se souvient, offre des fleurs, rappelle ses oeuvres. C’est pour ne pas avoir à entendre le tintamarre qu’allait provoquer sa disparition qu’il a préféré mourir avant. Et si je ris ainsi des fossoyeurs, c’est parce que mourir prend du temps ; les fêtes et les louanges que déclenche la mort de nos héros ne sont qu’un détour parmi tant d’autres pour ne pas leur laisser le temps de mourir. Ne nous pressons pas, nous disposons chacun d’un bout d’éternité pour les honorer. Les morts s’en vont nus, ils laissent entre nos mains tout ce dont nous voudrons bien nous occuper, ils n’emportent rien.
Les élèves de 9P avec lesquels je travaille cet après-midi m’impressionnent ; la manière dont ils gèrent leurs échanges pour relancer ce qu’ils ont exploré, l’infléchir ou l’enrichir est admirable. Le reconnaître leur donne des ailes.
Je reste en classe jusqu’à 18 heures, rédige ces notes et télécharge quelques documents avant de ramasser Lili et trois de ses amies à Saint-Martin. Disons que ce ne sont pas seulement quatre filles que j’embarque, c’est aussi une foule de camarades qu’elles font défiler devant leur tribunaux, longues palabres entre Oron et Carrouge, succession d’approximations conduisant au jugement définitif qui fera l’unanimité. Elles se séparent les meilleures amies du monde.
Sandra a fait cuire des pommes de terre auxquelles elle a laissé leur robe des champs, mêlé des oeufs de chez Marinette à une salade, on entame un vacherin. J’assiste Louise dans la mise en ordre de la cuisine, il est 21 heures passées. Au lit ! Au lit ! Au lit ! Rien n’y fait. Il y a des soirs où nos enfants sont impossibles.
Jean Prod’hom
Prodon ou Proton

Cher Pierre,
Vous l’avez compris, je suspends jeudi prochain la rédaction quotidienne de ces billets – à vous adressés depuis janvier 2015. Etrange et belle aventure que cette correspondance fictive, semi-fictive, réelle, quand bien même ma vie, si on la balance à la vôtre, est bien légère. Mais soyez certain que je vous tiendrai au courant de ce que nous vivons ici au passage des saisons.

Il a plu toute la journée ; j’enchaîne à l’abri, comme chaque lundi, sept périodes éclairées par des lectures. Je lis aux élèves de 10ème la fin de la première partie du Grand Meaulnes, à ceux de 9P le troisième chapitre de La Vallée de la Jeunesse. Ceux de 9G se penchent sur les chapitres 12, 13 et 14.
Il y a des cartes postales qui font du bien, j’en découvre une à midi dans la boîte aux lettres, avec un chardonneret et un roitelet peints au XVIIème siècle par le Strasbourgeois Johann Walter. C’est Raymonde qui souhaite une bonne année à toute la famille ; on ne s’est jamais vus, mais son écriture trahit sa générosité ; elle nous mentionne tous, du plus vieux à la plus jeune, sans oublier Oscar.
Autre cadeau, un ami me signale par mail qu’on parle de Marges dans Le Matricule des Anges. Je n’y suis pas abonné et les terminaux français, sur internet, ne font pas confiance aux banques suisses, ils refusent ma carte de crédit. Adieu la version pdf.
Je fais un saut à la Bibliothèque cantonale. Inutile. Le numéro 169 de la revue ne leur est pas encore parvenu, il me faudra patienter.
Franck m’écrit en fin d’après-midi qu’il jettera un coup d’oeil dans sa bib, avant qu’Estelle, une abonnée, me fasse parvenir une copie de l’objet. Ce n’est pas un mot mais deux belles colonnes qui réchauffent mon amour-propre.
Une seule faiblesse, l’auteur, Monsieur ou Madame Dominique Aussenac, estropie mon nom en l’affublant, après l’apostrophe, d’un H majuscule. Je ne lui en veux pas, personne n’y peut rien. Nous devons nous y préparer, les années qui viennent vont nous précipiter dans les tourbillons du tambour numérique et mes enfants et leurs petits-enfants en ressortiront certainement nus, leur patronyme débarrassé de l’apostrophe et du h – majuscule ou minuscule – à valeur zéro. Ce seront alors des Prodom, des Prodon, ou des Proton.
Sandra et Louise sont à Oron, Arthur est au Parkour, Lili lit une BD ; Je parviens enfin à convaincre le service financier du Matricule de mon honnêteté et reçois la version pdf de l’article de Dominique Aussenac. Je prépare une salade, continue la lecture de La Carte et le territoire, réchauffe des restes.
Je suis le premier à me retirer, bien décidé à lire les dernières pages du Houellebecq. Quelque chose s’est essoufflé, chez lui ou chez moi. La carte et le territoire se termine en ligne droite, en ligne droite perdue dans un delta.
Jean Prod’hom
On en voudrait plus

Cher Pierre,
Hier soir, nous sommes rentrés tous les cinq avec une une seule voiture. Je retourne à Froideville en fin de matinée récupérer la Nissan, sous une pluie bien serrée qui semble décidée à ne pas s’arrêter. Je traîne, à l’affût des couleurs.

Il y a bien le vert tendre et brillant des mousses et l’orange cuivré des feuilles mortes accrochées aux rameaux des jeunes foyards, les flaques dans lesquelles le gris du ciel se fait presque bleu, un morceau de PVC du plus beau cyan : on en voudrait plus. A cet égard, les déchets de nos industries ont du bon par temps de pluie ; leurs œuvres sont durables dans la boue des chemins et les épines des bois, elles ont la couleur des ruches dans lesquelles les abeilles hivernent : rouges, bleues, vertes. Il y a aussi le jaune pissenlit des panneaux du tourisme pédestre qui nous promettent de plus longues promenades, le retour des papillons, des scabieuses et des centaurées. J’ai trouvé sur les bas-côtés du chemin qui mène à la Moille aux Frênes une dizaine de ces sachets jaune canari mis à la disposition des propriétaires de chien, qui les invitent à glisser les excréments de leur protégé dans une poubelle placée à côté du distributeur.
Je croise après la Route des Paysans quelques fantômes : deux dames bottées et encapuchonnées de noir qui promènent un chien à la laine blanche né, me précise l’une d’elles, des amours d’un bichon maltais et d’un coton de tuléar ; plus loin, lorsque je remonte de l’autre côté de l’un des nombreux affluents du ruisseau de la Rosse, entrent dans le bois un chien noir et une cape rouge sang avec, j’ose l’espérer, quelqu’un dedans.
J’arrive trempé, Lucette et Michel m’accueillent comme un rescapé, m’offrent un café, un croissant et un pain au chocolat, je ne m’attarde pas.
Au Riau, Arthur travaille dans sa chambre, Louise fait de la physique, Lili tourne les pages d’un horoscope. Je fais un feu pour me réchauffer et recevoir Lucie que Sandra va chercher à l’arrêt de bus au milieu de l’après-midi ; elle nous fait cadeau d’un gâteau des rois. On babille, elles organisent un prochain voyage à Londres. Je descends à la laiterie et nous préparons, Sandra et moi, le repas du soir : soupe, quiche, salade et tarte aux pommes.
Jean Prod’hom





Mina, tu vois Catane ?

Cher Pierre,
Edelweiss et Fleur ont la fâcheuse tendance, depuis l’automne dernier, de miauler au milieu de la nuit. Mais la courbe de leur patience, plate et obstinée, n’est pas de la même famille que la nôtre. Sandra cède avant moi, se lève, il est 4 heures. Elle descend ouvrir la fenêtre de la salle de bains, le silence revient. Ces incidents qui pourraient nous conduire au divorce nous rapprochent.

Je me lève à 6 heures, Sandra me demande de jeter un coup oeil dans la chambre d’Arthur qui devrait être rentré. Affirmatif. Je bois un café et sors Oscar, il pleut serré. Lorsque je m’en vais, Sandra travaille sur son ordinateur, au lit, pour ne plus rien avoir à faire lorsque les enfants seront debout.
Le MMM de Romanel ouvre ses portes à 8 heures, nous sommes à pied d’oeuvre un quart d’heure avant, quelques parents aident les cinq élèves de la première équipe à dresser les tables ; ceux-ci entreposent la marchandise sur les quatre tables mises à notre disposition.
Je monte au self, achète une eau minérale et installe mon campement dans un quartier paisible du supermarché, avec vue sur le patio, table basse, canapé et fauteuils paillés de plastique brun anthracite, coussins vert pomme. Toutes les places seront occupées à midi. En face le restaurant de la Chope d’or ne désemplit pas non plus.
Se succèdent de gauche à droite, dans l’ordre, une agence de voyages, un salon de coiffure, une première boutique de prêt-à-porter, le point de vente d’un revendeur d’accessoires pour la décoration d’intérieur, un commerce de chaussures, l’antenne d’une entreprise de télécommunications, une lunetier, un magasin de sports, une seconde boutique de prêt-à-porter, une troisième enfin, mêmes plumes, même griffe.
« Les oiseaux ce n’est rien », poursuivit Houellebecq, « des petites taches de couleur vivantes qui couvent leurs oeufs et dévorent des milliers d’insectes en voletant pathétiquement de part et d’autre, une vie affairée et stupide, entièrement vouée à la dévoration des insectes – avec, parfois un modeste festin de larves – et à la reproduction du même. Un chien porte déjà en soi un destin individuel et une représentation du monde, mais son drame a quelque chose d’indifférencié, il n’est ni historique ni même véritablement narratif, et je crois que j’en ai à peu près fini avec le monde comme narration – le monde des romans et des films, le monde de la musique aussi. Je ne m’intéresse plus qu’au monde comme juxtaposition – celui de la poésie, de la peinture.
Je reçois la visite d’anciens élèves et de parents, parlote, lis, descends aux nouvelles. Les élèves sont souriants, ce qu’ils proposent se vend, plutôt bien. Tablant sur la générosité des clients, ils n’ont fixé aucun prix.
Je mange à midi à la Chope d’or en poursuivant ma lecture de La Carte et le territoire. Coup de fatigue à 15 heures, je quitte le supermarché, me balade dans ce qui reste de la campagne, noyée par les pluies qu’aucun soleil ne vient éponger ; les pylônes ont tendu leurs fils, une douzaine de corneilles ruclonnent les restes de courges jetées dans un champ de chaume détrempé. Je contourne des lotissements conçus par des architectes peu scrupuleux, longe l’autoroute ; le vacarme ne parvient pas à faire fuir les oiseaux qui laissent des traînées dans les haies noires.
La dernière équipe est à son poste, il est 17 heures. L’argent rentre mais la cadence baisse ; il faut dire que la variété de l’offre se réduit. On remballe les restes, plie les tables. Au revoir ! au revoir ! A lundi ! merci. Dans la caisse, plus de 1400 francs. Mina, tu vois Catane ?
Belle soirée à Froideville, avec Lucette et Michel qui nous gâtent, avec Sandra et les enfants qui les aiment et qu’ils aiment, et cette idée peu catholique selon laquelle les peines et l’apaisement sont de plain-pied.
Jean Prod’hom
Sans avoir fait usage du coupe-circuit

Cher Pierre,
Louise chante à tue-tête, elle a karaoké ce matin à l’école. J’entends claquer à deux reprises la porte d’entrée, s’en vont les deux filles d’abord, Arthur et Sandra ensuite. A moi la maison vide. Edelweiss et Fleur se croisent sur le rebord de la fenêtre de la salle de bains, la seconde monte dans les combles, bien décidée à ne pas quitter le coussin qu’elle a adopté depuis la fin de l’automne. Oscar est dans les mêmes dispositions devant le poêle, je fais un feu, écoute les nouvelles et bois un café.

Platini renonce à sa candidature à la tête de la FIFA, il préfère se consacrer à sa défense. Gianni Infantino, un Suisse de Brigue et le cheikh Bahreini Salman de Bahrein, patron du football asiatique, se disputent le poste. L’UDC du canton de Vaud a choisi son nouveau président, ce sera Jacques Nicolet, agriculteur de Lignerolle. La Banque nationale suisse a terminé l’exercice 2015 avec un trou de 23 milliards, les propriétaires d’actions toucheront cependant 15 francs pour chacune d’elles. Le chômage en Suisse est passé de 3,4% à 3,7% en décembre (158’629), ce sont près de 10’000 personnes supplémentaires qui se sont inscrites au cours du mois de décembre auprès des offices régionaux de placements. Les Chinois se félicitent, le krach boursier n’a pas eu lieu cette nuit, Shanghai et Shenzhen bouclent la séance avec une progression de près de 2 %, sans avoir fait usage du coupe-circuit. Barack Obama ne soutiendra pas les démocrates qui ne s’engageront pas pour la réforme des armes à feu. Six femmes ont porté plainte pour des vols et des agressions sexuelles, commis pendant la nuit du nouvel an à Zurich par des hommes à la peau foncée. Federer rencontre Dimitrov ce matin à Brisbane, malgré son rhume. Il pleuvra aujourd’hui jusqu’à 1800 mètres, il neigera au-dessus.
J’ai longtemps cru que le dérèglement qui conduirait à la ruine de la société capitaliste seraient dus à la fragilité de son architecture, à ses montages de dernière minute, à la multiplication désordonnée d’étais de fortune et de contreforts d’appoint. Mais j’ai longtemps imaginé que la conscience et la raison en sortiraient intactes et reprendraient à zéro une histoire nouvelle. Je crois – et crains – aujourd’hui que l’histoire, la conscience et la raison vacillent avec tout l’édifice qui les a fait prospérer, et qu’il convient dès aujourd’hui d’appendre à habiter les ruines, de prendre un peu de hauteur pour nous réconcilier avec ce qui ne se relèvera pas : la mer, les prés, les bois, l’étendue.
Je vais à Mézières faire quelques courses, feuillète au Central le Terre et Nature du mois de janvier ; Céline Prior consacre quelques gentilles lignes à Marges. Je rentre à midi avec deux gâteaux des rois, Sandra est déjà à la maison, je réchauffe les restes de soupe et de pizza d’hier. Louise deviendra la première reine de la journée.
Je passe l’après-midi au Mont, le directeur m’annonce qu’il va dédoubler au second semestre la classe de 9ème pour certaines heures. Je risque d’en hériter deux. Sandra et les filles ne m’ont pas attendu pour tirer les rois, ma princesse est la seconde reine de la journée ; elles se préparent toutes trois à aller fêter Noël à Oron, avec les athlètes du club d’athlétisme, les entraîneurs et les parents ; quant à Arthur, il restera en ville jusqu’à tard ce soir. Puisqu’on m’abandonne, j’irai manger au bistrot, en poursuivant la lecture de La Carte et le territoire.
Jean Prod’hom
Un peu de neige ce matin au Riau

Cher Pierre,
Un peu de neige ce matin au Riau, détrempée : pas sûr qu’elle reste. Je quitte la maison sur les chapeaux de roue alors que Louise termine ses devoirs, l’école prend décidément de la place dans notre maison, trop parfois, dans nos sociétés, dans nos vies aussi.

La nouvelle présidente du conseil de la classe de 10ème vérifie, à 7 heures 30, que tous les membres sont au clair avec ce qu’ils devront cuisiner et emporter, le tournus et l’horaire qu’ils devront respecter. Nous allons en effet au MMM de Romanel, samedi prochain, vendre un lot de pâtisseries faites maison. Toute la journée. Le bénéfice ira rejoindre le fonds qui assurera, à terme, le financement du voyage qui leur permettra, en 2017, de découvrir les Îles éoliennes : Vulcano, Lipari, Stromboli.
Il pleut des seilles, le passage d’un bâtiment scolaire à l’autre me le rappelle. Je mange au réfectoire à midi, à la table de deux demoiselles de 9 et 10 ans qui semblent bien se connaître. Elles ne sont pas dans la même classe mais se connaissent depuis plusieurs années déjà, elle se sont immédiatement bien entendues lorsqu’elles se sont adressé la parole la première fois au réfectoire du Rionzi. La cadette a déjà fait le tour du monde, elle est née à Dubaï d’une mère russe, son papa y a travaillé quelques années avant que la famille rejoigne la Suisse, Berne d’abord, Neuchâtel ensuite, Le Mont-sur-Lausanne aujourd’hui. A Noël, ses parents ont pris quelques jours de vacances au Canada ; le voyage est interminable, elle a préféré rester chez sa tante.
Le papa de la seconde est un informaticien ukrainien, elle se réjouit de ses prochaines vacances à Zermatt. Elle aussi connaît Dubaï, ville qu’elle a visitée avec ses parents en été 2015. Rien ne ressort de ce train de vie, si jeunes, je m’en réjouis ; je me réjouis également de leur insouciance, pourvu que ça dure. Je ne peux toutefois m’empêcher de les imaginer dans une trentaine d’année : généreuses, bienveillantes ? suffisantes, arrogantes ?
Les élèves de 9ème travaillent sur le site, réalisent toutes sortes de choses qui intéressent leurs camarades, leur donnent de nouvelles envies et les font sourire. Tout va si bien et je me sens si inutile que je termine, pour ne pas les déranger, le second album des histoires d’Amadou, aussi merveilleux que le premier.
Personne n’est encore rentré au Riau, je lis le troisième album, La Bâche, dans lequel on apprend pourquoi Amadou a lâché les amarres, emporté dans le ciel jusqu’à l’océan par une grappe de ballons rouges, jaunes, bleus, verts, attachés à une cordelette fixée à l’un des arbres de la place de foire de Pierrecreuse : c’est parce qu’il est bousculé, moqué, humilié à l’école, parce que ses habits ne ressemblent pas à ceux de ses camarades et qu’il est premier de classe.
Amadou s’envole, frôle la mort avant de réaliser un rêve, celui de voir la mer ; il remplit ses poches de coquillages, mange huîtres, langouste et crevettes ; il devient l’ami du patron d’une guinguette, de Copain, un chien abandonné.
Mais Amadou, c’est aussi l’histoire de son retour à Pierrecreuse, succession d’aventures buissonnières : Amadou vit solitaire sans oublier personne, marche dans la nuit ; réalise ses rêves sans y toucher, sauve Scabieuse, la fille des vanniers ; construit un radeau, franchit une rivière, dort dans les arbres.
Les filles rentrent à 16 heures, Sandra à 17, il pleut. A 18 heures, je vais chercher Arthur à l’arrêt du Riau, il est content de son travail. On mange. Louise termine ses devoirs, je commence les miens. L’école est très présente dans nos sociétés. Trop. Silence dans la maison.
Jean Prod’hom
C’est le vertige mais aussi le piège de la relecture

Cher Pierre,
Les élèves de 9ème lisent ce matin, chacun de leur côté, une nouvelle de Peter Bichsel tirée des Histoires enfantines, « La terre est ronde », une nouvelle aux accents borgésiens. Je m’y plonge moi aussi, pour la cinquième ou sixième fois ; j’ai le sentiment alors – c’est le vertige, mais aussi le piège de la relecture – de parcourir, toujours plus admiratif, impuissant, sidéré, les sous-sols d’une architecture dont la perception globale m’échappe chaque fois davantage, à mesure que je crois m’en approcher ; un labyrinthe à ciel ouvert d’une complexité toujours plus dense, différant à tout jamais l’espoir d’en dégager la signification (il en va évidemment ainsi pour n’importe quel autre texte) en exhibant la description exhaustive de ses éléments et de leurs relations, feuille après feuille.

Je remonte au Riau à midi, Sandra a préparé du riz et une salade, un gâteau des rois en guise de dessert.
J’ai entamé ce matin la lecture du second album d’Amadou, Le Radeau. Ces histoires, décidément, devraient plaire à Lili. Je lui propose de les lui lire. Elle me répond qu’elle manque de temps, qu’elle doit se consacrer à Latitude zéro, le livre de Mike Horn qu’elle étudie dans le cadre scolaire.
- Ah bon ! Et où en es-tu de cette lecture ? Qu’est-ce qu’il fait, Mike Horn ?
- Il pagaie !
Il neige lorsque je pars pour les Cullayes, je fais une halte à Ropraz où des travaux ont commencé au bout du chemin du Pacoton, le corps de la ferme a disparu, restent l’étable et la grange. Je rencontre Ernest dans le hall de l’EMS, on se salue. Je lui raconte que j’ai pensé à lui à plusieurs reprises ces dernières semaines, chaque fois que je saluais Arthur au jardin d’hiver ou à la cafétéria. Il me dit que c’est à cause de lui qu’il est là : Arthur est mort.
Je trouve une chaise et me joins à la petite tablée. Arthur n’était pas en forme depuis une semaine ; il est descendu ce matin à la cafétéria. Un moment. Puis il est remonté mourir dans sa chambre. Arthur disait de cette maison qui l’accueillait depuis plusieurs années que c’était la maison du Bon Dieu.
Je monte à l’étage, T écoute la radio. Je lui lis deux chapitres du Sable Mouvant de Mankell, on les commente dans la bonne humeur. Je rentre.
Sandra a préparé une soupe, des hamburgers, un gâteau des rois pour le dessert. Elle sera reine pour la seconde fois aujourd’hui, le hasard fait bien les choses.
Jean Prod’hom


Je boucle ce billet un peu après 21 heures

Cher Pierre,
La prof d’anglais annonce par WhatsApp à ses élèves qu’elle est malade ; le départ habituel du mardi est donc différé d’une heure. Le bosco se met au travail, j’en profite pour m’égarer dans les archives de la RTS ; y retrouve des reportages sur quelques-uns des matchs de football qu’ont livrés les Seigneurs de la nuit à la fin des années soixante, visionne un gros plan sur Pierre Chapuisat – après son transfert à Paris – et le portrait du FC Barthélémy. Avant de faire la connaissance, un peu par hasard, de Jacques-Etienne Bovard.

Arthur déposé, je roule jusqu’à Oron ; la neige est tombée jusqu’au pied du Niremont et des Alpettes, un fort vent d’ouest taquine des bandes de brouillard qui se désolidarisent, s’allongent et s’enfuient. Je me procure à la librairie un petit carnet à spirale, bois une verveine au café de l’Union avant de me décider, le temps gris m’y encourage, à entrer dans le salon de coiffure.
Ma bonne humeur n’est pas contagieuse, la coiffeuse en semble même excédée ; je rentre donc ma tête dans les épaules et ne lui laisse, dépassant de la cape, que mes cheveux qu’elle taille généreusement. Mon silence délibéré l’amène à changer de ton, mais je ne mords pas à l’hameçon, en rajoute même un peu. Mon voisin, qui a plus de chance avec le patron qui le coiffe, lui raconte le succès des girons dans le canton de Fribourg, leur perte de vitesse dans le canton de Vaud. Je prends congé de celle qui m’a coupé les cheveux, en lui remettant 44 francs, froidement.
Le soleil trouve une fenêtre météo un peu avant midi, Oscar aboie et me pousse dehors, on fait le petit tour. Une cinquantaine de pinsons, planqués dans un chaume de maïs, y grappillent, s’envolent à notre passage et vont se percher dans de vieux fruitiers.
Elsa et les filles arrivent au Riau à 12 heures 30, et au moment où je m’apprête à m’en aller, Louise a pris les choses en main à la cuisine. Je reste jusqu’à près de 19 heures au Mont, avec les élèves d’abord, seul ensuite. J’ai reçu aujourd’hui par la poste les trois premiers albums des histoires d’Amadou que la Joie de Lire a réédités, je lis le premier, L’Opinel : je me régale. J’apprends au détour qu’Alexis Peiry, l’auteur né à Gruyères en 1905, avait entrepris la rédaction d’une autobiographie. Il en a publié en 1968 la première partie, intitulée L’Or du pauvre. La mort, cette même année, l’empêchera d’aller au bout de son entreprise.
C’est à Saint-Martin que je vais récupérer Lili et Valentine, où les entraînements d’athlétisme ont été déplacés. Il est plus de 20 heures lorsqu’on rentre au Riau, Sandra a réchauffé des lasagnes, fait une salade et acheté un gâteau des rois. C’est Arthur qui hérite de la couronne, Louise est revenue enchantée de sa présentation, du codex Magliabechiano, elle joue de la guitare après le repas. Lili se douche. Sandra travaille, je boucle ce billet un peu après 21 heures, il est impératif que je me couche tôt.
Jean Prod’hom

Une utopie qui orienterait nos vies

Cher Pierre,
Une pellicule de neige recouvre ce matin le Riau, assez importante pour que j’avance l’heure de mon départ. Inutile précaution, il y a peu de circulation sur la route de Berne et les conducteurs des chasse-neige ont fait le gros du boulot.

C’est donc jour de rentrée, je vais enchaîner sept périodes ; je ne m’en plains pas mais en sortirai, je le crains, en petit état ; je commence par la lecture de deux chapitres du Grand Meaulnes.
Les pages au cours desquelles Augustin fait la connaissance d’Yvonne de Galais sont à l’image de la fête organisée par Frantz et de toute la première partie de ce récit : ce sont les vides qui bordent les choses, précèdent et suivent les événements, les silences d’où se lèvent et où retombent les paroles des vivants, qui les font tenir ensemble, miraculeusement, en tenant éloigné deux fois le lecteur, éloigné par ce qu’en dit Meaulnes à François, et ce que François en raconte. Ce sont les courts-circuits, les ruptures, les absences, les disparitions, les ellipses, les interruptions, le jour, la nuit, les éclairs qui font l’étrangeté et le mystère de cette fête sans contour mais aux précisions déroutantes. Réussite donc née d’une virtuosité technique et de la poursuite effrénée d’une idée, qui donne naissance et consistance à ce qui est et n’est pas, telle une utopie qui orienterait nos vies, en lui donnant une forme, un sens et une fragilité.
Travail ensuite sur le récit – avec ou sans passé simple –, lecture de La Vallée de la Jeunesse d’Eugène et rédaction du journal.
Je remonte à 16 heures, en petit état, fais un détour par la Migros d’Epalinges où j’achète une salade, du fromage, de la pâte à gâteau, des yogourts et des fruits.
Arthur ne rentrera qu’en début de soirée ; Sandra et Louise, qui a son cours de guitare, quittent la maison pour Oron. Lili me montre un dessin qu’elle termine à l’instant, c’est le portrait d’un cheval avec un oiseau perché sur le chanfrein, il ressemble à un chardonneret, c’est en réalité un rouge-gorge. Je prépare à manger.
Nous regardons après le repas, en famille, Les Visages de la terreur, un documentaire français sur la dérive des frères Kouachi et Amedy Coulibaly. Si les choses s’éclairent, l’avenir s’assombrit. Au lit les filles !
Je regarde ensuite, seul, Du côté des vivants, un autre documentaire français sur la bande à Charlie, racontée par leurs proches et les survivants de la tuerie du 7 janvier. Beau. Le monde s’éclaire à nouveau. Un peu.
Jean Prod’hom
Lundi c’est demain

Cher Pierre,
Lundi c’est demain, et c’est un peu, je crois, pour m’y préparer que je me lève à 6 heures, m’active en faisant un feu dans le poêle, puis griffonne sur des fiches quelques notes en prévision des changements qui vont avoir lieu sur ce site. Je vais en effet revenir à une forme plus éclatée de ce journal, qui ressemblera, au moins en apparence, à celle de fin 2013. Mais avec la volonté d’en faire également l’atelier dans lequel seront entreposés les fragments d’un texte auquel je songe depuis quelque temps déjà. Sans oublier, en contrepoint, les Laisses que nous mettrons en route le 14 janvier, Stéphane et moi.

J’ai cru en regardant par la fenêtre qu’il ferait beau ; mais il a fallu déchanter, le brouillard n’a pas tardé à remonter de la Broye et à s’accrocher à la cime des épicéas et des sapins blancs. Louise me rejoint à 8 heures, Lili puis Sandra la suivent. Elles descendent toutes trois chez Marinette.
Il aurait fallu décrire la bataille silencieuse à laquelle se sont livrés, au Riau, les éléments ; décrire comment le soleil a repris le dessus, puis le dessous, le dessus, le dessous enfin, définitivement, avec le brouillard entre lui et nous. Ou à défaut, pour apprendre, relire les pages que Claude Lévi-Strauss en route pour le Brésil à bord du Mendoza a consacré, dans Tristes Tropiques, à la description d’un coucher de soleil.
Je dévoue le reste de ma courte journée à l’école, mets à jour le site des élèves et prépare la semaine prochaine. Lili est sur un projet dont elle ne veut rien dire ; Arthur travaille une bonne partie de l’après-midi enfermé dans sa chambre ; Sandra se penche en compagnie de Louise sur le codex Magliabechiano, elle prépare ensuite des lasagnes végétariennes, je lave une salade. Il fait nuit, on mange alors qu’il n’est pas 18 heures, la cuisine est réduite à 18 heures 30. On monte voir le téléjournal avant de rejoindre, un peu inquiets, nos appartements.
Demain c’est lundi.
Jean Prod’hom
Chambre 807 du Grand Hôtel Plaza à Rome

Cher Pierre,
Il pleut sur les tuiles et le velux ; je me réveille au milieu de la nuit et descends à la bibliothèque. Edelweiss et Fleur qui semblent m’attendre prennent les devants, je leur ouvre la fenêtre de la salle de bains, ils disparaissent sur le toit glissant.

J’hésite à descendre d’un étage et à ouvrir le frigo, mais un bref examen de conscience me ralentit : la fin des vacances approche et il convient que je retrouve une certaine discipline. Je remonte bien décidé à m’endormir, tarde pourtant, si bien que lorsque je me réveille, toute la maison est déjà sur le pont : Sandra et Louise besognent autour d’un livre de mathématiques, Arthur devant un puzzle de 2000 pièces. Lili, elle, prend du bon temps. Je décide de lire les dernières pages du Chardonneret, que je me félicite de terminer enfin ; les dernières pages, dont je recopie quelques éléments, me ravissent.
Parce que, si nos secrets nous définissent, en opposition au visage que nous montrons au monde : alors le tableau était celui qui m’a emporté au-delà de la surface de l’existence et qui m’a permis de savoir qui j’étais.
L’oiseau nous regarde. Il n’est ni idéalisé ni humanisé. C’est un oiseau, point. Vigilant, résigné. Il n’y a pas de morale ou d’histoire. Il n’y a pas de résolution.
... la transsubstantiation où la peinture est peinture et pourtant en même temps plume et os. Pas craintif, pas même désespéré, mais inébranlable et tenant sa place. Refusant de se retirer du monde.
... dé à coudre de courage, tout en duvet et os fragiles.
... il n’y a qu’en s’avançant dans la zone intermédiaire, le liséré polychrome entre vérité et non-vérité, qu’il est tolérable être ici et décrire cela, tout simplement.
Lorsque j’entre au milieu de l’après-midi dans la cafétéria de C, les pensionnaires de l’EMS sont nombreux à boire un thé avec leurs invités ; je leur souhaite une belle année mais ne m’y attarde pas. Je jette un coup d’oeil, avant de monter à l’étage, au grand salon où somnolent devant une série américaine deux personnes âgées et un homme encore jeune. Je connais le chemin, croise une infirmière jamais vue jusque-là, lui parle en élevant la voix pour que mon arrivée ne surprenne pas T. Celui-ci écoute la radio, couché dans son lit, il l’éteint ; nous nous souhaitons la meilleure année qui soit. Je déplace le sac à dos qui ne quitte pas la chaise noire contre laquelle sont appuyées ses cannes et sur laquelle je prends place. Je lis trois chapitres du Sable mouvant de Henning Mankell ; T semble si fatigué que je décide d’abréger sa visite.
Je bois un jus de pomme à la cafétéria avant de quitter l’établissement ; deux tables sont occupées : à la première, on y parle au ralenti ; à la seconde, un résident fait un mot fléché. Dans le coin cuisine, une employée met un peu d’ordre ; dehors le brouillard semble se retirer à mesure que la nuit tombe. Je rentre.
Au Riau, Louise analyse avec Romance une représentation de sacrifice humain tirée du codex Magliabechiano ; Louise m’accompagne lorsque je ramène son amie à 19 heures à Moille-Margot.
Au retour, nous nous retrouvons en famille autour d’un plat de pâtes et d’une salade préparées par Sandra ; après quoi, une fois n’est pas coutume, je regarde avec eux un film tout récent, Agents très spéciaux, qui a pour principal mérite de se dérouler en partie dans le Grand Hotel Plaza à Rome où Solo, Kuryakin et Gaby séjournent, et plus particulièrement dans les chambres 707 et 807. Eric Chevillard et Franck Garot ne sont évidemment pas pour rien dans ce choix. Et que leurs noms ne soient pas cités dans le générique de fin démontre une fois encore leur proverbiale discrétion.
La pluie n’a pas cessé de la soirée, et lorsque je me glisse sous l’édredon, je l’entends à nouveau pianoter sur le toit. Je tente de suivre, derrière l’écran de mes paupières, les gouttes d’eau s’écouler de l’arrête du toit, cascader de tuile en tuile, contourner les obstacles qui se présentent ; j’essaie d’en évaluer la quantité mais les perds de vue lorsqu’elles s’engouffrent dans les chéneaux puis les tuyaux de descente ; et à mesure qu’elles rejoignent, sous terre, les canalisations des eaux claires, je m’endors.
Jean Prod’hom
Mille cinq cent quarante-trois points-vigules

Cher Pierre,
Arthur est rentré discrètement ce matin, à un peu plus de huit heures ; on ne le reverra pas avant midi. Sandra, qui s’est réveillée un peu plus tard, s’est remise à la rédaction du second tome de son manuel de physique, les filles font leur cuisine au salon, j’avance dans la lecture de la dernière partie du Chardonneret.

Je fête aussi mon premier succès de l’année 2016 : la publication des 2500 fichiers des marges.net – avec les modifications dues au passage de l’an – s’est faite sans accroc ; j’en ai même profité pour ajouter deux catégories : Laisses et Amadou. Pour le reste, difficile de savoir ce qui m’a occupé, hormis l’examen quantitatif des signes qui ponctuent les 365 billets (178’509 mots) publiés sur ce site en 2015 :
AU BILAN
Points à la ligne : 5342
Points : 3602
Virgules : 13689
Points-virgules : 1543
Deux-points : 671
Points d’interrogation : 157
Points d’exclamation : 93
Points de suspension : 99
Ces résultats m’encouragent à reconduire la résolution prise fin 2014, visant à réhabiliter l’utilisation du point-virgule, à en explorer et en exploiter les pouvoirs.
Grand tour au milieu de l’après-midi avec Sandra et Oscar, par la Musslly, le chemin aux copeaux, la route de Froideville. On fait peu de bruit, Oscar trottine à l’avant ; il pleut un crachin dont le brouillard floute l’origine, on revient par le triage. Je fais quelques parties d’Uno au retour avec les filles.
Sandra prépare des pizzas, je fais cuire à feu doux une courge, trois tomates, une pomme et un gros bouquet de persil. On a avancé l’heure du repas pour allonger la soirée. A 18 heures 30, Louise et Arthur chargent la machine à laver la vaisselle, le nouvel an est derrière nous, on peut voir venir.
Jean Prod’hom

