Je fais le rabat-joie

Cher Pierre,
Les excellents résultats des élèves de 9ème année devraient me réjouir ; il serait en effet inhumain de résister aux larges sourires que ces réussites ont dessinés sur leur visage et au soulagement que leur annonce provoquera dans le giron familial – ils le savent lorsqu’on se quitte – sitôt le seuil de la maison franchi.

Mais leurs succès ne me réjouissent au fond qu’à moitié. L’objectivité en effet à laquelle prétendent ou font croire ces travaux, et les malentendus nombreux auxquels cette naïve croyance conduit, font beaucoup de mal ; un mal qui compterait pour bien peu si les questions auxquelles les élèves avaient donné exacte réponse ne constituaient pas quelque chose comme la fermeture des horizons dont ils sont curieux et vers lesquels on voudrait les voir aller.
On pourrait joyeusement consentir à ces épreuves, mais à la condition que chacun en voie les limites, aussi bien ceux qui les pensent que ceux qui les subissent, en observant ou en étudiant les raisons pour lesquelles elles sont toujours mal conçues, et pourquoi quelques-uns les réussissent, d’autres échouent ou peinent.
Le bonheur qu’éprouve l’enfant qui fait ses premiers pas n’appelle aucune évaluation chiffrée, la découverte qu’il marche soudain un jour le comble, lui et ses parents. Le voici prêt à aller de l’avant par ses propres moyens, à franchir les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter, sans l’aide de ceux qui devraient se réjouir de le voir tourner les talons.
Je fais le rabat-joie, je n’y puis rien ; je ne vois que trop dans ces épreuves rituelles et les jugements qui leur sont attachés la ruse de l’institution de maintenir captifs ceux qu’elle feint de laisser libres, dans un espace étroit, circonscrit en réalité, entravé par les innombrables signes d’une sujétion objective.
À une heure de l’après-midi, le lendemain, la classe du Cours supérieur est claire, au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l’Océan. On n’y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche, mais les harengs grillés sur le poêle et la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés de trop près.
On a distribué, car la fin de l’année approche, les cahiers de compositions. Et, pendant que M. Seurel écrit au tableau l’énoncé des problèmes, un silence imparfait s’établit, mêlé de conversations à voix basse, coupé de petits cris étouffés et de phrases dont on ne dit que les premiers mots pour effrayer son voisin :
— Monsieur ! Un tel me…
M. Seurel, en copiant ses problèmes, pense à autre chose. Il se retourne de temps à autre, en regardant tout le monde d’un air à la fois sévère et absent. Et ce remue-ménage sournois cesse complètement, une seconde, pour reprendre ensuite, tout doucement d’abord, comme un ronronnement.
Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d’une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n’ai qu’à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs.
De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle-Étoile.
Je lis aux élèves de 10ème le huitième chapitre du Grand Meaulnes (Le Gilet de soie), puis fais voir à ceux de 9ème les images de la première partie du Peuple légendaire que Jean Malaurie a ramenées de ses expéditions chez le Inuits.
Un peu de soleil est resté, il éclaire comme une bougie le rêve d’une classe vide de maître et d’élèves, il y a tant à faire sur la banquise, à apprendre dans les livres, à regarder dans le ciel et les bois, il y a tant de domaines mystérieux.
Le pied de Louise va mieux, la pluie a cessé, je fais des croûtes au fromage et une salade. Arthur a raté le bus, il prendra celui de 21 heures 30. Enregistrement de la troisième partie de l’introduction du Gustave Roud de Philippe Jaccottet.
Jean Prod’hom

Je voudrais être à l’image de ces ivraies

Cher Pierre,
La neige tombe si légère que certains des plus petits flocons semblent vouloir faire marche arrière, zigzaguant, comme dans une foule celui qui la fend, un peu ivre, pour rejoindre celle qu’il n’a jamais voulu quitter. Je voudrais être à l’image de ces ivraies emportées pas le contre-courant de la rivière qui font, loin des tourments, l’école buissonnière. Le flocon virevolte un instant, danse, pur instant de grâce, avant de renoncer, comme alourdi, et de se laisser emporter par la foule de ceux qui n’ont jamais désobéi aux lois de la gravitation universelle, et qui vont mêler leur sang au tapis blanc.

Louise se réveille avec un orteil aux reflets bleus, résultat de son enthousiasme et d’une malheureuse contremarche. Personne ne souhaite ce matin attendre dans l’antichambre d’un médecin, une heure, deux heures, pour se faire entendre dire à la fin que l’immobilité est le seul remède. On sort une paire de cannes du grenier, Sandra et Lil s’occuperont seules de Ziggy et de Sahita ; on fera le point demain. J’enregistre de mon côté la seconde partie de l’introduction du Roud de Jaccottet.
Les clés qui ouvrent les armoires ignifuges du local de l’ancienne école de Corcelles, qui contiennent les archives communales, ont disparu. Je me rabats sur un document qui n’est pas sous clef, le registre des comptes – du milieu du XIXème siècle – de la moutonnerie de Corcelles-le-Jorat ; je peine à me faire une idée précise des tâches du berger et de la nature du bâtiment, ou des bâtiments qui abritaient son troupeau, puisqu’il est question aussi bien de la moutonnerie du Riograubon que de celle des Biolles. Ce qui est sûr c’est que le moutonnier de Corcelles avait à surveiller plus de 200 moutons et brebis, la moitié etrangeres, qu’il devait faire paître à l’intérieur des limites communales.
Valérie passe un peu avant 17 heures, on boit un thé, elle repart avec deux bouquins. Tout le reste ressemble à un dimanche d’hiver, avec le froid, la nuit et les loups tenus en respect derrière la porte de la maison.
Mais si l’un d’entre nous avait eu le courage d’aller jusqu’au fond du jardin avec les déchets ménagers qui débordent du petit seau vert, il aurait pu apercevoir de là-bas la maison éclairée de partout, la nuit pleine d’histoires merveilleuses et d’étoiles noires, de bois et de veillées hyvernales. Je sors du fond du frigo les restes d’une soupe, quelques tomates et quelques carottes, un peu de fromage et des poires.
Jean Prod’hom
La vie de nos morts est décidément trop courte

Cher Pierre,
Arthur a passé la nuit chez des amis à Lausanne et reviendra dans la matinée ; Jacques m’envoie une photographie trouvée, j’imagine, dans les affaires de Marc, Sandra et les filles sont descendues au marché. Je profite du silence dans la maison pour enregistrer la première partie de l’introduction du Gustave Roud de Philippe Jaccottet avant de prendre la Nissan et de me rendre aux Cullayes.

Je m’arrête au cimetière, l’hiver est à notre porte et l’arrosoir à l’abri. J’y croise Ginette accompagnée de son chien clopinant sur trois pattes ; elle rend visite à Georges dont les cendres reposent au jardin du souvenir, de sa mère et de son père qui ont vécu sur un petit domaine de la commune et qui disposent aujourd’hui d’un petit lopin de terre au fond du cimetière. Ginette hésite à reconduire la concession, je l’y encourage, la vie de nos morts est décidément trop courte.
Ginette marche avec une canne mais sourit du haut de ses 78 ans comme une gamine de 15. Elle se souvient de ses longues marches jusqu’à l’école de Mézières, de la tartine qu’elle croquait à midi, Elle se souvient du trou de la Bressonne qu’elle devait franchir dans la nuit avant de prendre le tram à Montpreveyres. Vendeuse à la Placette, elle aura les reins assez solides pour ouvrir, dans les années 70, une bijouterie au Grand-Saint-Jean. Sans enfant, sa nièce a repris la boutique en 2005 ; Ginette va s’y rendre après le cimetière, la soulager, lui donner un coup de main. Ce village, ce n’était rien il y a cinquante ans, à peine un village, 80 habitants ; je pense à Mazagran et aux Ardennes ; pas d’église, une poste ; il sonne deux coups au clocher de l’école.
J’entre sans frapper, personne à la réception ; je croise une blouse blanche puis la responsable de la cafétéria. Cinq minutes suffiront pour qu’on m’accepte. Les résidents arrivent goutte à goutte. Je parle à T, il est là depuis un mois. Je reviendrai le voir.
Je ne peux m’empêcher de manifester ma joie lorsque j’aperçois A ; il se souvient, nous étions allés sur les bancs de bois de son attelage, mon fils et moi, jusqu’à Peney, ça avait duré le temps qu’il fallait, c’est Fanny qui nous tirait.
J’ai assez vite l’impression de tous les connaître ou de les avoir croisés : je discute le coup avec un ancien employé des parcs et promenades de la ville de Lausanne ; il a toute sa tête. défend ses droits, écoute ses voisins, souffre d’arthrose.
Chacun boit un thé avant de retourner dans sa solitude, dans sa chambre ou au salon. J’offre mes services à la responsable de la cafétéria qui en parlera à la direction. Quoi qu’il en soit, je reviendrai.
Je fais au retour une halte au restaurant qui est comme une dépendance de l’établissement que je viens de quitter, mais avec un poêle. Y mange un vieux couple : lui vêtu d’un pull jaune canari ; elle anglaise, se souvenant de la reine Victoria. A côté, une dame qui offre pour ses soixante-dix ans un repas à ses trois grands enfants qui cherchent sans la trouver la clé qui autrefois les réunissait. Il est 17 heures quand je rentre au Riau, Sandra et Louise font des mathématiques, Lili et Arthur sont occupés dans leur chambre.
A moi de faire à manger, j’écoute la radio d’une oreille : Jean-Claude Biver parle avec une naïveté consternante des jeunes de 15 à 35 ans. La suffisance du bonhomme me dégoutte, je grogne. Arthur m’informe, pour me consoler, que Federer est riche d’un demi-milliard de dollars. Mais comment désormais va-t-il faire pour se débarrasser de ce fardeau et jouer enfin, avec une seule balle.
Jean Prod’hom
Renouer avec l'allégresse que la scolastique assèche

Cher Pierre,
Huit heures ! le feu brûle dans le poêle, la maison est vide, Oscar peu décidé à sortir. Je lis pour la seconde fois cette semaine la très belle introduction du Seghers que Philippe Jaccottet a consacré à Gustave Roud ; à haute voix, lentement, soigneusement, hésitant même un instant à en faire un enregistrement ; mais il me faut filer à Oron, acheter une ou deux choses à la COOP et revenir pour 11 heures 30.

Jean-Claude Sonney me fait visiter, malgré le travail qui le presse, l’ancien séchoir qui occupe le sous-sol de sa boucherie ; la bielle de l’antique compresseur, qui claquait des dents lorsque son père a repris le commerce en 1969, les claque encore. Le boucher se montre inquiet, parce que Noël arrive et parce que le beau temps va inciter les clients à différer leurs commandes jusqu’à la dernière minute. Les fêtes de fin d’année le mettent dans tous ses états ; heureusement, me dit-il, que je n’ai plus à abattre, j’aime mon métier mais j’ai tué bien trop de bêtes.
Je rentre au Riau avec dans les mains un bouquet de roses blanches pour Sandra ; deux bouquets de roses jaunes et de roses rouges pour Lili et Louise qui vont arriver ; je prépare le repas. Nous écoutons tout en mangeant la très belle chronique consacrée par Karim Karkeni sur Radio Vostok à Tessons, à Marges et à la rencontre au Café littéraire de Vevey la semaine dernière. Le temps passe trop vite, Lili et Louise repartent à l’école, je descends au Mont. Des couleurs de l’automne il ne reste rien, mis à part le vert tendre des épines des mélèzes virant à l’orange.
Les élèves de 9ème font encore beaucoup de théâtre, et cela va durer aussi longtemps qu’ils n’auront pas repris pied dans ce qu’ils rencontrent chaque jour et qu’ils traînent sous leurs souliers ; il faudra un mois avec certains, six mois ou une année avec d’autres, quelques-uns n’y parviendront jamais et continueront à jouer à l’école, avec le plus grand des sérieux, cherchant dans un désert d’images pauvres ce qu’on attend d’eux, une idée comme ils disent, ou imitant servilement ce qu’on leur propose en guise d'exemple, incapables de se réorienter vers une voie moins asséchante.
Je voudrais que les élèves se méfient des idées qui viennent toujours trop tôt, parasitant ce qu’ils aperçoivent étonnés, interdisant à ce qui leur échappe la possibilité d’aller de l'avant, de flotter, de dériver hors de la portée des idéologues que l’école a tendance à faire d’eux en les incitant à réduire tout ce qui tombe sous leurs mains aux dimensions des tiroirs qu’elle met à leur disposition. Il serait bon que les élèves renouent avec l'allégresse que la scolastique leur a dérobée et la confiance qui les habitaient avant d’y être admis.
Je crois que le dieu de l'enfance nous abandonne aujourd’hui aussitôt que nous nous installons sur les bancs de l’école, un dieu remplacé par celui qu'on connaît, mais qui dit à voix basse : « N’oubliez pas le dieu de votre enfance! »
On frappe à la porte, ce sont Catherine, Guillaume et leurs deux enfants qui viennent manger ; ce n’est pas encore ce soir que je récupérerai le sommeil qui me manque.
Jean Prod’hom
Seeland de Robert Walser et Sans alcool d’Alice Rivaz

Cher Pierre,
Avec une efficacité – dont les mauvaises langues devraient reconnaître qu’elle me caractérise parfois –, je corrige les quarante épreuves que les profs de français et moi-même avons infligées hier matin aux élèves de 9ème. C’est donc allégé que je monte à 14 heures dans le bus numéro 8 pour Lausanne où j’ai rendez-vous : les Editions Antipodes vernissent en effet, en fin d’après-midi chez Basta, leurs dernières parutions.

J’en profite pour faire un saut chez Payot, curieux de connaître le traitement qu’impose la grande librairie de la place à Marges et à Tessons ; Alain m’a raconté que Jacques Chessex descendait de Ropraz pour mettre un peu d'ordre chez les libraires lausannois, rappelant à ceux qui l’auraient oublié – ou l’ignoraient encore – que ses nouvelles parutions ne se satisfaisaient que des têtes de gondole. Je n’oserais intervenir dans ces affaires, les libraires connaissent bien leur métier ; ce qui m’amuse surtout, c’est de découvrir les voisins avec lesquels ils feront la fête, puis veilleront les yeux grand ouverts, lorsque la boutique sera fermée et les lumières éteintes.
Marges est à l’extrémité d'un rayonnage, à côté de Tessons qui l’attendait depuis l’hiver passé. Au-dessus, deux recueils de proses, balades et nouvelles, Seeland de Robert Walser et Sans alcool d’Alice Rivaz : plus loin les petits derniers de Pascal et de Jasmine.
« Pouvez-vous me jurer que l’ouvrage que voici est le plus vendu de l’année ? »
« Sans aucun doute. »
« Pouvez-vous affirmer que c’est le livre qu’il faut absolument avoir lu? »
« Absolument. »
« Ce livre est-il vraiment bon ? »
« Question superflue, parfaitement incongrue! »
« Et bien je vous remercie », dis-je avec froideur, préférant laisser tranquille ce livre qui sans conteste avait connu la plus vaste diffusion, puisque tout un chacun devait absolument l’avoir lu, et je m'éloignais sans autre, c'est-à-dire en faisant le moins de bruit possible. »
(Robert Walser, Seeland)
Il y a soudain de l’animation à la caisse, une dame d’un certain âge voudrait elle aussi faire entendre ses droits ; car enfin, une émission de radio lui a quand même été consacrée, à son livre aussi, le matin même ; sans compter un article important dans un journal genevois, la semaine passée. La dame a raison, son livre mérite une bien meilleure place, mais les deux libraires auxquelles elle s’adresse ne se laissent pas démonter, elles semblent connaître ces pressions. Je crains cependant que la dame soit, avec ces yeux noirs, aussi convaincante que Chessex, et que Marges flottant en tête de gondole ne doive en faire les frais. Je ne veux pas voir la suite et m’éclipse, emportant le recueil des nouvelles d'Alice Rivaz.
Je dispose d’un peu de temps libre encore, me laisse glisser le long du Petit-Chêne, me souvenant soudain d’un lieu et d’une personne que je voudrais rencontrer.
On ne sait pas trop ce que boutiquent, cachés derrière leur ordinateur, les écrivains libraires ; j’en profite pour faire discrètement le tour de son échoppe et choisir un livre avant de le saluer. Trop tard. On se présente. Il me parle d’Athènes et de Chardonne, de son amour pour les livres qu’il regarde avec les mains, prêt à les laisser filer pour une thune ou dix, mais pas à n'importe quel prix.
J’apprends à cette occasion qu'on peut vendre des livres et en écrire sans jamais se départir d’une gentillesse et d’une générosité qui m’ont sauté aux yeux une fois déjà, dans ceux de son frère dont j’ai fait la connaissance au Café littéraire de Vevey. Ce que boutiquent derrière leur ordinateur les écrivains libres ? Je n’en sais toujours rien lorsque je quitte Nicolas Verdan, avenue Fraisse, les mains vides. Sinon que je reviendrai.
C’est la fête à Basta, avec toute l’équipe d’Antipodes et des auteurs très savants. Chacun présente à tour de rôle son livre : Berlin, l’immigration, Claparède, le chômage, les banques et les jardins familiaux. Edouard passe en coup de vent, Alexandre reste très amicalement jusqu’à la fin, tout le monde est un peu fatigué, je lis trois textes à l’arrière du cortège.
Quelque chose semble se terminer, le bus numéro 8 me laisse à Coppoz où je récupère la Nissan, le pare-brise est givré. Chacun est sur le point de se coucher au Riau, je me mets à pianoter sur le clavier en pensant au visage de cette ancienne amie croisée aujourd’hui place Bel-Air, que je n’ai pas revue depuis trente ans et qui ne m’a pas reconnu ; la vieillesse est un masque, mais un masque qui pèse : un jour ou une ligne résume nos vies.
Jean Prod’hom


La lampe éteinte et la chanson perdue

Cher Pierre,
Il est un peu plus de six heures ce matin lorsque le cliquetis des chaînes et le grondement de l’acier raclant le bitume l’annoncent, c’est Pierrot. Avec à l’avant du tracteur bleu de la commune – qui est un peu le sien – une lumière crue qui creuse une poche orpheline s’éloignant dans la nuit. Il vient de loin, passe et repasse, poussant dans le pré de Freddy et de Jean-David les dix centimètres de neige tombés pendant la nuit. Tout est blanc de chaque côté du ruban noir, luisant, sur lequel je roule jusqu’au Mont.

Lorsque je rentre à 14 heures, la douceur a pris le dessus ; Sandra et Louise, méconnaissables dans leur veste et sous leur bonnet, terminent un imposant bonhomme de neige. Chacun vaque à ses occupations, je fais un feu dans le poêle et monte à la bibliothèque.
Je traverse pour la première fois les pages que Philippe Jaccottet a consacrées en 1968 à Gustave Roud, au pas de course, pour les relire bientôt.
Je feuillète le second volume du Journal du Joratois. Pas trace dans ses notes de 1956 des grands froids ; quelques rares mots en 1957, énigmatiques, sur le récit de son irruption dans l’éternel, que le poète dit avoir entrevu, si souvent, ébauché en pensée ; suivis de lignes sans âme sur son séjour d’une quinzaine de jours à Rome et Naples ; presque rien en 1958.
Il faut attendre 1959 pour que Gustave Roud se réveille, décide d’ouvrir un cahier neuf pour renouer avec la longue suite de notes intermittentes qui remplit tant d’autres cahiers anciens. Il écrit son angoisse de ne plus entendre la fauvette qui l’éveille depuis bien des jours déjà. A l’écriture la tâche de relayer ce vide béant et rappeler tout ce que signifiait ce petit oiseau et son chant. Ce texte trouvera une place, avec quelques variantes, dans « La lampe éteinte et la chanson perdue » de Campagne perdue.
Sandra s’est rendue aux Trois-Suisses de Vucherens avec Marinette et Nicole, on mange de notre côté une pizza ; les enfants se bagarrent ensuite avec un tel soin que j’en viens à croire qu’ils suivent une partition ; fort heureusement, la fatigue aura raison de leurs plans. Je cherche de mon côté, mais sans méthode, une ou deux choses qu’évidemment je ne trouverai pas, tout en prenant connaissance à la télévision de quelques-uns des aspects, sombres et lumineux, du monde du football : la fin de Sepp Blatter et le renouveau de la Juventus de Turin. Sandra rentre à un peu plus de 22 heures.
Jean Prod’hom
On appelle ça une révolution copernicienne

Cher Pierre,
La longue balade de ce matin a eu ceci de réconfortant qu’elle m’a rappelé que la terre pouvait aisément se passer des hommes et qu’en dehors de quelques lieux denses, elle demeure inhabitée.

Trente ans suffiraient pour qu’elle redevienne – nos déchets nucléaires mis à part – celle d’avant. Les hommes et leurs guerres comptent si peu à l’échelle de la terre que les premiers devraient raisonnablement se passer des secondes. Au cas où, les liquidateurs, s’il en reste, doivent savoir que, lorsque les hommes se seront entredétruits, le Léman suffira amplement à contenir dix fois les sept millards de victimes.
C’est pourtant un peu triste – n’est-ce pas ? – d’imaginer le filet d’eau du Riau de Corcelles, les fruits des fusains et les bras nus, levés ou pendants, des frênes et des saules en hiver, sans personne pour en témoigner. Je fais une halte chez Marinette qui m’offre une verveine ; elle me parle de la nécessité d’agir, moi des pages que Mankell consacre aux prochaines grandes glaciations. On s’étonne de n’avoir vu aucun chardonneret cette année, ni l’un ni l’autre.
Louise et Lili ont congé cette après-midi, je les laisse à la maison et m’en vais, un peu à contre coeur : ce qui me pèse dans ce métier, en définitive et toujours davantage, c’est la manière dont les portes se referment au moment même où on feint de les ouvrir pour préparer nos enfants à découvrir le monde, comme si ce qu’on leur demandait d’apprendre était arrêté et scellé dans des coffres, depuis longtemps déjà, bien avant même qu’ils en connaissent l’existence, qu’ils éprouvent le besoin de les ouvrir et de se saisir de leur contenu, chargeant ceux qui sont réputés savoir de leur préparer une pâtée indigeste qu’ils leur glisseront dans le gosier, comme on le fait avec des oies, cuillère après cuillère, selon un ordre et un rythme définis par des idéologues en manque de confiance. Ces pédagogies ont montré leur inefficacité et nos enfants hésitent à goûter à ces produits inertes et à tremper leurs lèvres dans ces eaux stagnantes.
Il ne sied pas d’anticiper ce que désireront ou ce dont auront besoin demain nos enfants, mais d’anticiper, approfondir, élargir et multiplier leurs besoins et leurs désirs, de leur fournir une assiette et de leur laisser à portée de main les outils dont ils auront immanquablement besoin. Lire, écrire, dire, écouter, calculer, se repérer, se souvenir n'ont nul besoin d'être encadrés par un programme pour faire la preuve de leur rôle essentiel, hormis pour les adultes oublieux. Tout le monde le sait, tout monde le dit, chacun l'ignore.
Disons le haut et fort, la refonte de l'école ne coûte rien, elle nécessite de remettre l’apprentissage à l’endroit, l’école sur ses pieds et de marcher avec la confiance dans le dos. On appelle ça une révolution copernicienne, elle prendra plusieurs décennies.
Sans vouloir généraliser, il conviendrait d’octroyer localement des moyens et un peu plus de liberté à ceux qui souhaitent faire la preuve de l’efficacité de pédagogies alternatives, au sein même de la maison, sans jamais fermer les portes. On sait depuis le naufrage du Titanic que les caissons étanches ne préservent pas du naufrage.
Je termine aujourd’hui la lecture des fragments (Sable mouvant) qu’Henning Mankell a rédigés en hiver 2014, instants de grâce sans lesquels la vie n’aurait pas de sens.
Jean Prod’hom



Je sors finalement du tunnel

Cher Pierre,
Du long couloir qui m’attend au réveil et que j’emprunte jusqu’au soir, il ne me reste rien, hormis une grande fatigue et deux images : celle du regard de quelques élèves qui écoutent bouche ouverte les chapitres V et VI du Grand Meaulnes. Celle de K, une gamine aux cheveux de jais et aux yeux noirs ; la gamine se lève tandis que ses camarades vaquent à leurs occupations, va jusqu’à la fenêtre et regarde, méditative, le plateau, les villages, le pied du Jura.

Mais il suffit que j’y songe encore pour que cette journée sorte de sa nuit avec d’autres images. Celle de trois garçons s’aventurant dans l’écriture, jouant librement des ressorts de la langue et du hasard de leurs trouvailles pour rendre compte de l’histoire d’un lavabo. Celle du soleil, à 10 heures, d’enfants glissant sur la fine couche de glace qui recouvre la cour que je suis chargé de surveiller. Celle de Z, 13 ans, qui rapporte à ses camarades le témoignage de sa grand-maman hongroise qui se trouvait à Berlin le 9 novembre 1989. Celle de ce tout jeune garçon timide, un peu perdu, silencieux à midi, au réfectoire secoué par le brouhaha. Celle de cet autre gamin qui ne veut rien entendre de ce que les adultes lui disent par crainte de devoir grandir, de ses parents que je rencontre en fin d’après-midi qui entendent l’affaire autrement. Il suffirait que je me penche sur ce qu’encadrent ces images pour qu’en apparaissent d’autres encore.
Lili se prépare au Riau, mais elle affûte si bien ses arguments pour combattre demain la volonté de certains de ses camarades d’habiller chaque écolier d’un uniforme, qu’elle se retrouve à 18 heures – d’avoir soigneusement examiné leur position pour mieux l’affaiblir – convaincue de la force de leurs arguments. Elle défendra donc demain matin l’uniforme à école, quand bien même au fond d’elle-même elle s’y refuse.
Je prépare à manger, Louise danse, Arthur marche sur ses mains. C’est en écrivant ces notes, alors que Sandra et les enfants dorment, que je sors finalement du tunnel, et avec moi le jour et ses vilaines heures. Sauvé une fois de plus.
Jean Prod’hom

C’est un soir à croquer des chips à l’apéro

Cher Pierre,
Tout a pris ce matin l’allure d’un vieux service à thé, soleil passoire, ciel bleu cassé, nuages rapiécés ; le drap mité ne recouvre qu’imparfaitement la terre retournée et le vieux mobilier cironné. Pas beau ! J’entoure de mes mains froides la tasse de porcelaine pour réchauffer mes pieds ; comme je ne parviens même pas à les consoler, je descends allumer un feu dans le poêle.

Sandra et les filles sont descendues comme chaque dimanche chez Marinette, elles remontent avec deux papiers à me faire signer : c’est déjà fait pour le référendum qui refuse que la loi du 4 juillet 2000 soit modifiée – au profit des grandes entreprises qui jouiraient, après réforme, de cadeaux fiscaux considérables ; quant à la pétition, je ne peux me résoudre à ce qu’on abolisse la chasse pour des raisons éthiques, écologiques et de sécurité, en raison de mon profond attachement aux hommes du paléolithique ; il serait regrettable qu’on se coupe d’eux.
Louise et Lili jouent dans la neige, Oscar disparaît dans les bois ; l’encre reste sur les doigts, le ciel est comme un buvard, marges et textes s’entremêlent. Il nous faudra encore patienter pour ouvrir la fenêtre sur l’immense page que la nuit blanche aura déposée et devant laquelle les enfants resteront muets, hésitant à faire le premier pas.
La nuit tombe, je descends faire à manger : je laisse en-haut Arthur et Louise qui jouent, couchés sur le lit du premier, jeux intelligents, m’assurent-ils. Lili met à jour sa correspondance sur le sien, même position. En-bas Sandra travaille d’arrache-pied, étendue sur le canapé avec Oscar sur les genoux.
C’est un soir à croquer des chips à l’apéro. Mais avant je nettoie des poireaux, les fait cuire avec des pommes-de-terre et des saucisses aux choux. Je leur proposerai après le repas un thé chaud.
Dehors, dans la soupière de la nuit, la vaisselle cassante tiendra jusqu’à demain, elle tient depuis des millions d’années, elle tiendra au moins, je l’espère, jusqu’à la prochaine glaciation.
Jean Prod’hom

Les Grangettes

Cher Pierre,
Sandra et les filles se réveillent à 5 heures 30 pour se rendre à Estavayer où Lili a une compétition. Je les entends à peine lorsqu’elles quittent la maison, bien décidé à rester au lit jusqu’à 8 heures. Arthur dort lorsque je sors. La nuit a fait tomber le mercure et a laissé une fine couche de neige sur le Niremont.

J’apprends par la radio que Bruxelles en état d’urgence se prépare au pire ; de son côté la préfecture de l’Yonne a mis en place un couvre-feu dans le quartier des Champs-Plaisants à Sens, interdisant la circulation piétonne et routière durant ce week-end, de 22 heures à 6 heures lundi matin. Tout va décidément très vite.
J’embarque François au boulevard Arcangier, dans la Nissan que je parque sur les hauts de Territet, avant de zigzaguer sous le soleil jusqu’à l’église et son cimetière. C’est le printemps. On longe le lac jusqu’à Villeneuve, par le clos de Chillon, la centrale de Veytaux et le château. On abandonne le lac à Villeneuve pour traverser la large plaine du Rhône jusqu’à Noville. Un gros nuage noir venu de l’autre bout du lac annonce le pire au-dessus des Evouettes, mais c’est à la chotte qu’il nous rejoint, alors que nous sommes confortablement installés au café des Etoiles où nous mangeons.
Il aura suffi d’un repas pour passer des vendanges aux pneus neige, on décide pourtant de continuer jusqu’au vieux Rhône, un bonnet sur la tête. Landes nues sans personne, quelques cris d’oiseaux, il neige et la nuit tombe. Nous devons revenir sur nos pas pour franchir le canal et rejoindre sa rive droite qui nous mène jusqu’au lac. Une petite heure de marche encore entre les roselières et les arbres que la nuit nous dérobe, sur un étroit tapis détrempé de feuilles mortes que la Grand-Rue de Villeneuve prolonge. Le bus nous ramène à Territet, je dépose François au Boulevard Arcangier, ramasse le sac que Sandra a oublié à Servion et rentre à la maison.
Jean Prod’hom


Qui n’a pas vécu deux fois n’a pas vécu

Cher Pierre,
Il pleut, la maison est vide lorsque je me réveille, mis à part Oscar qui fait le mort dans un fauteuil à côté du poêle. Cette nuit m’a fait du bien, commencée et finie tard, avec la pluie qui dégouline sur les carreaux et rince un peu de ma fatigue. J’ai changé l’autre jour les pierres ollaires du poêle, fait avant-hier une flambée de papier, je décide d’ajouter du bois aujourd’hui ; j’entends de la bibliothèque la tôle du poêle qui gonfle, picotée par le feu, premiers feux, premières châtaignes. L’hiver est annoncé pour ce soir ou demain matin ; en l’attendant, l’automne joue les prolongations.

Eric me téléphone à 8 heures 30, on renonce à la balade qu’on avait prévue mais pas au repas ; le rendez-vous est pris, devant la gare de Lutry à 11 heures.
Philippe Guerry m’envoie un mail pour me signaler qu’il a consacré ce matin un billet de son Bonheur portatif à l’un des miens, plus précisément à la molasse sur laquelle le Jorat est bâti. Je ne m’y retrouve pas seul, mais en bonne compagnie, heureux d’être aux côtés de Denis Montebello qui évoque de son repaire de la Rochelle lui aussi la molasse, cellede Hauterives.
Il y a un réel bonheur à se retrouver un jour, alors que nous l’ignorions, là où nous ne sommes pas, avec ceux qui auraient pu être nos amis. J’ai éprouvé ce sentiment une fois déjà, dans le Journal de Dante de Pascal Rebetez, qui m’y a ménagé une place que j’ai occupée de longs jours avant d’en être averti : nous vivons chacun dans d’innombrables mondes qui s’empilent et se chevauchent. Personne n’y a songé – Borges peut être dans son argument ornithologique – il y aurait là matière à lever un nouvel argument en faveur de l’immortalité de l’âme et de l’existence de Dieu.
Philippe me confie dans son mail qu’il s’est penché sur quelques-uns des textes de Marges consacrés à l’école, en amateur éclairé qu’il est, puisqu’il a décidé de garder ses trois enfants à la maison, pour leur éviter ce dont la plupart des partenaires de l’école se plaignent, le rythme de fantassins et l’incessante pression à laquelle nos enfants sont soumis, en s’en satisfaisant un peu lâchement. Mais il évoque aussi l’envie de l’ainée, de rejoindre aujourd’hui dans leur prison la cohorte des enfants de son âge.
Le blog de Philippe Guerry mérite un long séjour, ses haltes sont gaillardes, en raison d’abord des mots sur lesquels il bute, mais à cause, et peut-être surtout, de la manière toujours inédite, déroutante et caressante avec laquelle il les aborde, au risque de leur laisser un peu de jeu, sachant bien qu’il convient de ne pas les exténuer, il y a mieux à faire.
Je descends à Lutry, parque la Nissan au bord du lac et monte à la gare, quai direction Villeneuve. J’attends avec un sentiment étrange, si étrange que j’imagine d’abord que je n’ai, de ma vie, attendu quiconque sur un quai gare ; en y réfléchissant plus tard, l’inverse s’impose, c’est de retrouver une sensation déjà éprouvée autrefois, dans l’immédiateté et la stupeur, qui la rend si étrange aujourd’hui : Qui n’a pas vécu deux fois n’a pas vécu.
Eric me raconte, après avoir écouté la mienne, qu’il a fait le voyage de Lausanne en face d’une très belle femme, qui venait à l’évidence d’un autre pays, et qu’il s’est avisé alors, étonné, qu’il n’est jamais tombé amoureux d’une femme vivant hors de Suisse. Je crois pouvoir affirmer le contraire.
On marche jusqu’à la plage de Curtiaux battue par le vent, les galets roulés par les vagues, il pleuvine. On ne s’est pas revus depuis plusieurs mois, on raconte à tour de rôle ce qu’on a fait et ce qui nous a occupés, sous nos deux parapluies rose et noir, puis devant des filets de perches au Restaurant du Léman.
On se sépare à 14 heures, j’hésite à l’accompagner jusqu’à l’église de Lutry ; j’ai été assez proche du fils de la défunte, mais d’avoir appris ce décès par la bande me dissuade de m’y présenter,
Je longe les quais une seconde fois avant de remonter au Riau, m’arrête à Epalinges pour faire quelques courses : fruits, salade, pâte à gâteau, poireaux et saucisses aux choux. Plus de feu dans le poêle, je renonce à recommencer l’opération du matin ; s’il pleut, il ne fait pas si froid, l’hiver a pris un peu du retard, la nuit tombe, on attend la neige.
Je me souviens maintenant, je ne suis pas sur le quai mais dans le train ; j’ai une dizaine d’années et pars avec les Paolini que je connais à peine pour Castelfidardo près d’Ancona. Ma mère et mon père me disent au revoir sur le quai tandis que le train s’éloigne, je pleure.
Jean Prod’hom

Café littéraire

Cher Pierre,
Je prépare au Mont, entre 14 heures et 18 heures, la traversée de ce soir en me demandant, chaque fois que je lève la tête, si tout cela vaut bien la peine. Je parviens à convaincre assez facilement celui qui voudrait faire faux bond qu’il serait très inconvenant d’annuler le rendez-vous. Je bois un jus de pomme sur la terrasse du KJU, il pleuvine sur la toile qui la protège ; le lac semble avoir la tête ailleurs et ne pas faire grand cas de mes états d’âme.

Beaucoup d’amis sont là, quelques inconnus aussi. Je commence avec du lourd, deux des textes écrits pour Grignan : écrire c’est toujours revenir à ce qui a été, et le faire naître dans la langue, que ce soit l’enfant que nous avons été, les petites misères ou la terre qui bat sous nos pieds ; mais écrire c’est aussi rassembler tout ce bazar, avec en plus le coq et l’âne, le travail et la grâce, et les faire tenir ensemble sur la page.
Je résume les cinq chapitres de ce qu’aurait pu être ma vie jusqu’à aujourd’hui, et mentionne leur titre : l’unité, la double vue, la métaphore, la mine et l’écriture. Je traverse ensuite les 807 en lisant la préface de Franck Garot, puis quelques-uns de ceux que j’ai commis en prenant garde de ne pas rire : une belle aventure. Comme celle des vases communicants dont je rappelle le principe ; je lis les textes que Kouki Rossi et Joachim Séné ont accueillis sur leur site dans le cadre de ces échanges mensuels, et le post-scriptum que j’ai ajouté au texte que Nathanaël Gobenceaux m’a confié. Bientôt une heure. Je commente l’aveu sans appel selon lequel je n’aurais jamais rien écrit hors le numérique. ; je termine enfin en lisant et en commentant Sésame, un texte qui, me semble-t-il, fait voir bien des choses autour d’une histoire de clé. Je m’arrête-là.
Des petits groupes se forment autour d’une planchette et d’un coup de rouge, je ne quitte pas Karim, François et Claude, fais la connaissance de Sonia Zoran. Je jette de temps en temps un coup d’oeil du côté de tous ceux qui m’ont fait l’amitié de venir ; ils sourient, je leur souris. Un grand merci à toute l’équipe du Café littéraire.
Dernière halte sur la place de Vevey avant la nuit, Karim boit une camomille, Claude un café, je bois une verveine, tout au souvenir du Jour et Nuit, du Major Davel et du Tunisien : nous étions des foireurs.
On se quitte à minuit, la Veveyse est noire ; je rentre par Chexbres et Mézières, content d’en avoir terminé, de recommencer un jour peut-être, en connaissance de cause.
Jean Prod’hom

Photo | Emma et Diogo
Aller à contre-sens, du côté de l’accompli (4)

Cher Pierre,
Au-delà des pâturages qui prolongent la terrasse du Chalet des Enfants, le soleil allonge sa courbe à deux doigts de l’horizon. Deux femmes chuchotent les petites misères du monde à la table voisine ; deux hommes se font plus loin les hérauts de leurs exploits d’écoliers ; flatus vocis mourant aux flancs de la barque que la fatigue aujourd’hui m’alloue, clapotis témoins de notre condition et du manque qui nous habite, rumeur qui entoure l’esseulé comme une île nos embarcations : beauté.

Marc-André a terminé ce matin les travaux de terrassement, je lui téléphone pour le remercier et lui demander s’il a une solution pour parer au danger que constituent par temps de pluie les traverses de chemin de fer détrempées ; Arthur qui n’a fait qu’un passage éclair,redescend en ville, dont il découvre, depuis qu’il est au gymnase, les mystères et les attraits. Je vais faire le petit tour avec Oscar, réduis son rayon avant la Mussilly pour ne perdre aucune miette du soleil. Le pâturage de Jean-Paul a été retourné par les sangliers, je traîne les pieds dans les feuilles mortes.
Je monte à la bibliothèque, conscient de l’urgence de rassembler ce que j’ai éparpillé depuis quelques jours et sur lequel je fais souffler deux fois le Stabat Mater de Pergolèse. Louise me demande de lui lire les chapitres 6 et 7 des Dix Petits Nègres, je m’y colle avec plaisir ; ne comprends rien au 6, me régale du 7. Je reviens à jeudi, qui manque encore singulièrement d’une colonne vertébrale, et à Pergolèse, qui n’a besoin de rien.
Je n’ai pas vu grand chose jusqu’à mes 16 ans, embarqué sans jamais avoir à écoper, faisant d’abord un avec ma mère, avec le monde ensuite.
J’ai commencé à voir double à l’adolescence, s’est mis à exister ce qui était et ce qui aurait pu être. Et j’ai pensé que notre bonne volonté, celle de mes amis et la mienne, serait en mesure de transformer tout naturellement les conditions réelles de nos existences ; nous nous sommes mis à vivre de peu, de pain et de vin, beaucoup de vin, sans nous occuper de ceux qui avaient plus que nous.
J’ai fermement pensé à vingt ans que la philosophie convaincrait les plus réticents qu’il suffisait d’inventer le futur ; nous nous sommes mis à parler par métaphores et nous avons commencé à nous méfier des concepts à l’emporte-pièce.
J’ai payé mon passage 30 ans durant, sur les bancs de l’école que je n’ai pas quittée, l’école vaudoise que j’ai voulu changer, là où j’ai été, ou ailleurs, en concevant du matériel scolaire, ou en formant des adultes.
Il m’a semblé que nous avions, Sandra et moi, touché au Graal en 1998 et 1999, dans un petit collège au nord de Lausanne. Nous étions sur le point de changer le monde. L’enfant qui est né de ces noces a changé la donne.
Je n’ai renoncé pourtant à rien de tout cela : rien ne vaut en effet une volonté bonne, lire un peu, une balade souvent suffit. Pour aller à contre-sens, du côté de l’accompli. Et donner vie et donner sens à ce qui ne l’est pas encore, au passé et à l’avenir, dans le présent de l’écriture. Chaque jour.
Jean Prod’hom
Le site comme atelier (3)

Cher Pierre,
Il fait beau ce matin – mais frais aussi –, Marc-André est arrivé avec sa camionnette, il entame à 8 heures 30, avec un ouvrier et le jeune homme qui reprendra bientôt son entreprise, les travaux à l’entrée et au pied de la façade orientale de la maison, pendant que je choisis, au chaud – mais à l’ombre – quelques-uns des textes que je lirai jeudi à Vevey.

Le temps passe plus vite lorsqu’on en manque, si bien que je quitte le Riau à midi et demi, sans être venu à bout de ce que je termine à l’instant. Marc-André et ses deux collègues mangent à la véranda, j’aperçois sur le chemin Elsa, Louise, Lili qui rentrent à la maison.
J’ai remis à une élève et un élève de la 9P les commandes techniques de publication de leur site en fin d’après-midi, Raul leur remettra bientôt la clé qui leur permettra d’accéder au serveur sans déborder sur mes terres. Les autres élèves sont libres de lire ou d’écrire, j’en profite pour évaluer avec chacun d’eux l’abstract de leur présentation orale.
Claude m’envoie un message dans lequel il se propose, jeudi prochain, d’ouvrir les feux en racontant l’histoire de la fabrication de Marges, de me laisser la parole ensuite pour parler du site et faire quelques lectures. Il serait intéressant que JLK, s’il nous rejoint, parle de son expérience web, avant d’ouvrir une discussion en buvant un verre et en mangeant une soupe.
Je retourne à mes notes, là où je les ai laissées hier, mais tournées du côté de l’avenir ; ces deux livres ont changé en effet un peu la donne, depuis janvier 2014 déjà, lorsque Pascal Rebetez me propose d’écrire Tessons et de le lui remettre avant l’été avec un choix de photographies. En effet, pour alléger mes journées, mais pour que le site reste en vie, je ne rédigerai quotidiennement qu’un tercet quotidien accompagné d’une photographie (brimborion), jusqu’en janvier 2015.
Pris de court le 14 janvier 2015, Tessons en librairie et les 365 brimborions mis en boîte, je relance la rubrique Dimanches, ouverte en 2008, mais sous la forme d’une correspondance (fictive, semi-fictive, réelle) avec Pierre Bergounioux (Cher Pierre). Cette correspondance, qui s’achèvera le 14 janvier 2016, ne sera pas pour autant abandonnée. Mais le site retrouvera sa forme d’avant janvier 2014 ; dans une autre perspective pourtant, celle d’un atelier, d’un atelier analogue à celui du peintre ou du sculpteur : chaque texte jouissant d’une autonomie complète, mais un oeil ouvert sur les autres, pour constituer à terme un texte de textes : un livre.
Dans ce même ordre d’idée, je voudrais reconsidérer les 2000 billets des marges.net, non plus sous l’angle de l’écoulement des jours, ou de leur appartenance à telle ou telle catégorie, mais sous un angle dont je ne sais rien encore.
Il y a en outre un ensemble de 77 textes écrits en 77 jours (Avec Thierry Metz) que j’aimerais reprendre et dont quelques fragments réagencés ont paru dans une revue numérique.
Il y a aussi des plans-fixes,...
Il y a...
Mais il y a – et peut-être surtout –, cette invitation qui m’a été faite d’ouvrir un lieu pour qu’y soit déposé, l’année prochaine, ce qui aura été cueilli simultanément ici et là-bas. J’en saurai plus début décembre.
Jean Prod’hom
Nos vies sont inégalement partagées

Cher Pierre,
Le jour se lève, pâle, mais le soleil a tôt fait de lui donner des couleurs ; la haute pression tiendra jusqu’à la fin de la semaine, et de le savoir change la vie. Je lis aux élèves de 10ème le 4ème chapitre du Grand Meaulnes ; ils fouillent ensuite les sites mettant à disposition gratuitement les livres tombés dans le domaine public, en téléchargent quelques-uns ; Jules Verne tient le haut du pavé, beaucoup se mettent à lire, je dois leur rappeler l’heure. Devoir : choisir d’ici la semaine prochaine le texte téléchargé qu’ils liront.

L’effondrement des arrière-mondes, et avec eux les promesses qui faisaient patienter ceux qui manquaient de tout, ont laissé des ruines que des prêtres orphelins et analphabètes ont décoré de babioles empoisonnées, que des enfants viennent cueillir ; les boniments se sont substitués à la légende dorée pour de mortelles transsubstantiations.
Nos vies sont inégalement partagées, toutes acquises au positivisme qui fait reculer notre ignorance, cédant à la fin, lorsque les connaissances ne nous satisfont plus, à la rêverie, aux enchantements de la rose et aux fragrances du lilas. Les grands ensembles sont si fragiles, quelques-uns des adolescents que je croise semblent si démunis, si nus, avoir déjà tellement perdu qu’ils semblent bien mal armés pour résister aux chants des sirènes.
Les actions de ces tout jeunes assassins endoctrinés débordent de beaucoup ce qu'on peut imaginer ; leur donner des noms d’oiseaux suppose qu'ils soient des nôtres, les injurier suppose qu’ils parlent notre langue et puissent, rentrés au bercail, payer leur forfait. Leur cerveau est vide.
Il est urgent d’affamer les marionnettistes ; les politiques sont prêts, condamnés à l’être s’ils veulent garder quelque crédit ; mais ils se doivent de reprendre la main sur les marchands d'armes et les vendeurs de pétrole ; il faudra alors, de notre côté, réduire notre voilure.
A 15 heures 30, le soleil est déjà loin à l’ouest, je file jusqu’à Cossonay où je fais quelques courses. Retour à la maison, Lil fait ses devoirs ; je prépare un bircher et tartine des tranches de pain avec les restes du vacherin.
Je ne voudrais pas, au fond, qu’aux fêtes de saint Raymond, de sainte Théodora et de saint Brice, martyrs oubliés du calendrier des saints, se substituent pour rythmer nos vies les seules commémorations du 7 janvier, du 11 septembre et du 13 novembre. Je voudrais que ceux qui viendront après nous puissent encore danser à la Saint-Jean et à la Saint Valentin.
Jean Prod’hom
Ecrire quotidiennement (2)

Cher Pierre,
Arthur est rentré hier à minuit, j’ai terminé mon billet entre 2 heures et 3 heures ce matin. La douleur au genou qui m’inquiétait hier s’est atténuée au réveil, la brume matinale s’est levée. On déjeune sur la véranda, Oscar s’enfonce dans le coussin du fauteuil en osier, quelques roses et de généreux dahlias prolongent les beaux jours dans la plate-bande. Je reprends mes notes de la veille.

L’idée de Marges date de 2012, on en retrouve les traces dans les billets du 4 et du 31 octobre 2012 ; il faudra 3 ans pour qu’il se réalise. On retrouve les moments de sa fabrication dans un ensemble de billets regroupés dans le dossier : Faire des livres.
Claude Pahud des éditions Antipodes a choisi 70 textes et une cinquantaine de photographies, extraits d’un ensemble publié sur le site lesmarges.net entre 2008 et 2014. La plupart des 2000 billets ont été rédigés et la plupart des photos prises le même jour. Ce qui motive le lien entre chacune des photographies et chacun des textes, ce sont leurs racines ; ils se nourrissent de ce qui s’est passé pendant la journée, un événement, une pensée, une interrogation, une succession de faits, un enchaînement, une boucle.
Que je me penche sur un tesson, la main de Ramuz, une échelle dans un verger ou d’un vagabond, ou de tout cela en même temps, c’est toujours, je crois, avec une seule intention, celle de donner un peu de sens à ce qui en manque, une allure à mes journées, un rythme, un chiffre, une couleur, en faisant monter dans le langage ces petites ou grandes choses que nous croisons, en les faisant tenir ensemble, dans la phrase, comme le bazar qui coexiste sur un vieux bahut ou le rebord d’une fenêtre.
C’est dire, je crois, que je ne vois pas au-delà du soir – il nous faut trop souvent renoncer à ce qui nous entoure – avec pour tâche, en définitive assez modeste, de retenir quelque chose, de lui donner une forme, et de le publier avant d’aller me coucher. Me voici en règle, – les dimanches chez les darbystes de Lausanne n’auront pas été pour rien dans cette affaire, je leur en sais gré. Voici mon obole, je peux m’endormir tranquille. Et recommencer.
Notre regard est aimanté par ce quelque chose avec lequel nous ne faisons qu’un. L’écriture est ce lieu où non seulement je retiens et rassemble une ou deux choses qui me sont apparues entre l’aube et le crépuscule, mais où je rassemble ces deux êtres que j’héberge, celui qui est embarqué sur le fleuve et celui qui longe sa rive, l’enfant et l’adulte que je suis devenu, pour n’en faire qu’un, momentanément – on ne retient pas le fleuve.
L’écriture, nourrie par la langue et le collectif, est le lieu par lequel quelque chose advient une second fois, tremblant, se nourrissant de ce qui a été, mais aussi ouvrant des voies inédites en direction de qui est sous nos yeux mais qu’on ne voit pas. La langue ouvre d’innombrables galeries. Et le texte finit par se détacher et par aller pour son compte, vers l’autre.
L’internet et Rapidweaver ont joué un rôle central dans mon rapport à l’écriture ; je n’aurais sans eux jamais écrit. Les suppressions, les ajouts, les modifications, les déplacements, les retouches que je suis amené à faire sont si nombreux et parfois si lourds que, sans la machine qui facilite ces opérations, j’aurais renoncé avant d’avoir commencé.
Dans Sésame, il y a au centre, bien-sûr, la clé échangée sur le Niremont ; nous nous baladions François et moi, il neigeait, c’était le 3 janvier 2003. J’ai su au moment même de cet échange qu’il donnerait lieu au billet du jour, convaincu aujourd’hui que cette certitude a joué un rôle essentiel dans l’attention que j’ai portée, dès ce moment, à ce qui s’est passé par la suite.
Sitôt rentré, j’ai déposé sur un nouveau post de Rapidweaver tout ce qui de près ou de loin était en relation avec cette clé, sans présumer de quoi que ce soit, sachant par ailleurs que je ne serais pas exhaustif, que d’autres choses viendraient, plus essentielles encore, délivrées par ce que recèle la langue et son usage, les phrases, leur rythme, leur mélodie, mais aussi leurs sutures.
La dépose de tout ce matériau hétéroclite, le tas obtenu, je n’oserais le montrer à quiconque. Mais c’est précisément en réécrivant l’illisible, en essayant de faire un peu de lumière dans ce chaos, en déplaçant un mot ou un bloc, en lisant à haute voix, en regroupant des éléments disjoints, que quelque chose qui me dépassait jusque-là, mais soutenait mon étonnement, trouve un milieu qui lui permet de se déployer et de fédérer de proche en proche les éléments importés, mais également de lever des dessous de la langue et des événements, des éléments auxquels je ne songeais pas.
Je pense volontiers que l’écriture est le lieu d’une transformation, d’une métamorphose, d’une transsubstantiation, un alambic ; mais je pense aussi que les moyens techniques mis à notre disposition sont essentiels dans nos manières d’écrire ; j’ai essayé d’en dire quelques mots à Vincent Motard-Avargues qui me le demandait.
Je monte avec Oscar à la Moille-aux-Blanc puis redescends sur la Moille-Cucuz ; Jean-David m’informe que les membres de la société de fromagerie ont commandé une nouvelle chaudière, un peu meilleur marché que prévu. Je descends au village puis remonte par le Torel. Lucie nous ramène les filles, on mange une salade et des lasagnes à la viande végétale avant de nous retrouver devant la télévision. Ce qu’on n’imaginait pas demeure inimaginable, mais il est aujourd’hui bien réel.
Jean Prod’hom
Mais aussi vous, arbres, veillez sur nous.

Arthur est parti ce matin à vélo, avec un pote, puis en bus et en train. Des amis les ont invités à découvrir quelques-uns des spots de Neuchâtel. Sandra m’explique que les spots, ce sont des lieux qui présentent un ou plusieurs obstacles, permettant aux adeptes du Parkour d’exercer l’une ou l’autre de leurs techniques de déplacement. J’ai trouvé sur le site du groupe de Lausanne une carte d’une trentaine de spots bien identifiés, qui se superpose au plan de la ville ; ils nous la font voir sous un autre angle : Little paradise, Arbre de l’Hermitage, Arbre métallique du Flon, Saut de bras gris bleu, Chapelle, Poisson, English style ; ces désignations se mêlent à celles des places que l’on connaît trop bien, des écoles et des gymnases où la plupart d’entre eux étudient. Une appellation pourtant inquiète le père que je suis : Escaliers du pigeon suicidaire, situé dans une cour intérieure discrète, précise un commentaire, entre la rue de la Mercerie et la rue Centrale.

Nous descendons, Sandra, les filles et moi au marché. On retrouve sur la terrasse de la Palud Lucette et Michel, une cousine de Sandra et son mari. On parle de choses et d’autres en évitant le nom de Paris, devenu soudain un mot tabou. Ce qui s’est passé semble inimaginable si bien qu’on n’en pipe mot. Quant à ceux qui voudraient voir et savoir, ils sont si troublés qu’ils détournent le regard et se taisent ; où qu’ils regardent ils aperçoivent des morts, leurs proches ou leurs amis, leur propre peur aussi.
Les rues sont sans mémoire mais n’oublient rien. Le récit de ces horreurs indicibles – refoulées dans des ellipses – est devenu réalité. Le sang et le venin coulent de la boîte sans fond de Pandore, qui n’a plus de couvercle. On devine le possible retour de la guerre de tous contre tous, la ville se vide, l’ennemi est partout. Chacun rêve quelque part de prendre le large en se coupant de l’avenir. Mais où aller désormais ? Les rues Alibert, Charonne, Fontaine-au-Roi, Bichat, mutiques et innocentes, vont endurer les pires maux, seules, abandonnées dans la nuit ; elles devront supporter la méfiance, endurer le reproche de n’avoir rien fait, coupables d’être là, encore vivantes.
Lieux abandonnés par force ou volontairement, champs de ruines, terres arides, déserts, environs de Tchernobyl, friches industrielles, mais aussi vous, arbres, veillez sur nous.
Rue Bichat,
rue Alibert,
boulevard Voltaire,
rue de Charonne,
rue de la Fontaine-au-Roi,
priez pour nous.
Stéphane m’envoie un mot ; son fils était à Charonne cinq minutes avant la fusillade ; il y est encore, chez un copain. J’apprends dans le journal que la femme dont j’ai vu hier le visage ensanglanté sur les bas-côtés de la route du golfe, réchauffée par un samaritain de fortune, attendant l’arrivée de l’ambulance, est morte ce matin. Son enfant est en vie.
Nous rentrons, mon mal de tête persiste, je boîte à cause d’un genou ; Sandra se met au travail, je vais dormir une grosse heure. Nous allons manger au café du Jorat, tous les deux, rien que tous les deux.
Jean Prod’hom
Retour sur les 807 et les vases communicants (1)

Cher Pierre,
Moins d’une semaine me sépare de la rencontre agendée au Café littéraire de Vevey. Je commence à rassembler ce qui pourrait intéresser ceux qui nous feront le plaisir de passer la soirée avec nous, et à choisir quelques textes.

Il me faudra préciser d’abord que Tessons (2014) et Marges (2015) sont des tard venus ; j’aurais pu, autrement dit, me passer d’eux. S’ils sont là, c’est que des éditeurs m’y ont encouragé, ce n’est – je crois –, pas courant et ça change la donne. Même si, comme les enfants non désirés, on s’y attache vite.
Au commencement, il y a donc le site, lesmarges.net, sans lequel ni Marges ni Tessons n’auraient vu le jour. Le premier billet date du mercredi 29 octobre 2008. Suivront jusqu’à l’été 2012 un millier de textes rédigés chaque jour, hors les week-ends ; un autre millier depuis, tous les jours, samedis et dimanches compris, qui s’entassent dans les soutes : lectures, voyage, emmerdes et ravissements, réflexions, déprimes, dimanches, tessons, école, plaisanteries, disparus, brimborions, journal, colères, morceaux d’enfance, vie quotidienne, Riau,... glissés dans l’une ou l’autre de la quarantaine de catégories bricolées, ajoutées, modifiées, supprimées.
Il me faudra revenir également sur les 807, l’aventure web initiée par Franck Garot en 2009, qui rassemble autour de lui plusieurs dizaines de personnes, du beau linge dans lequel je me retrouve : Eric Chevillard d’abord, François Bon, Denis Montebello, Emmanuelle Urien, Thomas Vinau, Eric Poindron, Martine Sonnet,... La courte préface de Franck Garot résume l’essentiel de cette belle aventure. Je propose une cinquantaine de textes qui figureront dans Les 807 (collection bleue, éditions du transat, 2010) et dans Les 807, saison 2, (éditions publie.net, 2012).
Il me faudra revenir aussi à ma participation – irrégulière – depuis 2010 aux vases communicants, opération initiée par Jérôme Denis et François Bon en juillet 2009 : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre. Six de la quinzaine de textes écrits dans le cadre de ces échanges figurent dans Marges.
Juste capable de m’en réjouir, p.13 chez Kouki Rossi
Revenir là où on n’en a pas fini d’aller, p 49, chez Joachim Séné
Friedrich Heinze de Rendsburg, p 79, chez Marianne Jaeglé
Aurait-il pu en être autrement ?, p 140, chez chez Isabelle Pariente-Butterlin
Le chemin des Meilleries, p. 142 chez chez Nathanaël Gobençaux
Cette route sur la carte il n’y avait rien au-delà, p 146, chez François Bon
J’interromps cet inventaire, descends au Mont déposer le Nissan au garage, embarque Sandra. Je rencontre Philippe Verdan à 11 heures, on s’installe avec une verveine sur la terrasse ; l’endroit est tout à fait extraordinaire, les cerisiers une fois encore en fleurs. Nous disposons d’une demi-heure pour faire connaissance et pour évoquer la rencontre de jeudi prochain ; je lui fais part de mes réflexions qui semblent ne pas l’effrayer. Sans compter que nos hôtes pourront boire un coup de chasselas ou de pinot noir, goûter à une soupe, manger un morceau de pain et de fromage. Ce bref échange m’apaise ; son sourire, sa voix me font du bien.
Je rejoins Sandra qui est allée chez le médecin, tout va bien. Elle me dépose au Mont, je mange au réfectoire, puis travaille individuellement avec chaque élève tandis que les autres voyagent sur un ipad dans le Grand Nord avec les Inuits, s’interrogent sur leur alimentation, leur habitat, leur implantation, leur commerce avec la mort, leur langue, leur passé, leur avenir.
Je remonte au Riau sitôt l’école terminée, envoie quelques précisions de cette rencontre aux amis proches et lointains dont j’ai les adresses. On pique-nique. Sandra et les enfants descendent en début e soirée à l’EPFL pour une conférence-spectacle exceptionnelle, avec Buzz Aldrin, le pilote du module lunaire d’Apollo11 en 1969, Alexey Leonov qui a effectué le premier une sortie dans l’espace en 1965, et de Claude Nicollier. Je regrette soudain de ne pas les accompagner, mais je suis très fatigué. Je boucle ce billet à 20 heures 30, prends un bain et lis Mankell.
Il y a 91 ans exactement, ma mère naissait.
Jean Prod’hom


Le Riau qui aurait pu être ailleurs

Cher Pierre,
Cette journée du jeudi, dite JOM, que les élèves de 9ème consacrent à la découverte du monde professionnel, annule, belle pioche, trois de mes cinq périodes habituelles. Je m’en réjouis naturellement, mais le nouveau règlement veut que les enseignants, même si le soleil les invite à tout autre chose, restent sur leur lieu de travail. Je regarde par la fenêtre les arbres qui sont en droit de se faire du mauvais sang : les feuilles ont perdu leurs couleurs, se froissent, se tordent et se plissent comme dans un séchoir à tabac

Je lis aux élèves de 10ème le troisième chapitre du Grand Meaulnes, que je leur propose ensuite de télécharger sur leur ipad, avec Les Histoires et Les Nouvelles Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe. Quelques-uns profitent de télécharger d’autres textes tombés dans le domaine public : Les Misérables, Les Dix Petits Nègres, d’autres livres encore. C’est un monde qui semble s’ouvrir à certains. D’un clic à portée de main.
Je remonte au Riau à 14 heures, lis les belle pages que Mankell consacre aux conséquences des périodes glaciaires sur la pérennité de notre espèce, aux limites de la mémoire, à l’épineuse question du présent lorsqu’il devient, avec le temps, le passé d’un futur auquel personne n’avait songé.
Dany Schaer – du Journal de Moudon – frappe à la porte, elle vient me poser quelques questions sur la parution de Marges, le choix des textes et des photos, leurs relations. Sur ce qui m’a amené à écrire, à vouloir retenir ce quelque chose sans lequel il n’y aurait rien. Sur mon commerce avec le temps ; je lui bégaie alors le piège qu’il nous tend, mais aussi la liberté qui nous est laissée de sortir de ses ornières et d’adoucir sa pente, d’aménager des chemins de traverse jusqu’à ces aires de repos qui ne manquent pas, désertes, bois ou vergers. Je parle de la mort aussi, qui se venge d’être écartée ou tue ; je lui parle d’ici, du Riau qui aurait pu être ailleurs ; des années qui viennent, de ce site dont je voudrais faire un atelier ouvert,...
Nous allons, Sandra, Oscar et moi, faire le petit tour. On se quitte à 17 heures 30, le brouillard m’attend au village, j’en sors à Peney, y rentre à Villars-Mendraz pour ne plus en sortir jusqu’à Thierrens. Je fais une courte halte à Saint-Cierges, bois une verveine avec Claude au café du Cerf ; Marie-Lise qui nous rejoint peu après me montre un beau tesson trouvé à Lutry. J’imaginais qu’elle allait me l’offrir, elle m’autorise à en faire une photographie. Je suis à la fois étonné et soulagé qu’elle veuille le garder.
Dans un box, utilisé désormais comme sellerie, Delphine et Louise se parlent comme deux amies, je me joins à leur conversation, Gwenaëlle a une sciatique, la vie n’est pas toujours facile. Retour au Riau où Lili nous attend ; on mange du vacherin et des miettes de merveilles ; Sandra remonte à 20 heures des portes ouvertes du Bugnon ; Arthur à 21 heures, en bus puis à pied : il a vu une histoire filante.
Jean Prod’hom
La mort nous confie le vivant du mort

Cher Pierre,
L’obscurité ne me permet pas au réveil de déterminer si le jeune chevreuil aperçu hier matin a passé la nuit près de la maison ; et lorsque je m’en vais, aucune forme ne se détache dans le pré que rosit le brasier derrière Brenleire et Folliéran.

Je l’oublie très vite en me retrouvant face à mes obligations. Sandra m’envoie pourtant un message à 8 heures, elle est allée se promener avec Oscar à la Moille-aux-Blanc. J’ai vu à l'orée du bois deux chevreuils, une mère et sa petite. J'ai espéré que notre orphelin avait retrouvé les siens. Plus loin, dans le bois, une famille de trois. J’ai encore vu la petite et sa mère dans les broussailles de la Mussilly, immobiles. Plus que trois jeudis et la chasse sera interdite.
J’enchaîne cinq périodes successives, avec la sensation heureuse que les jours, toujours plus courts mais gorgés de soleil et de fraîcheur, avivent l’attention des élèves, la mienne aussi.
Je prends rendez-vous au garage de la Croix blanche avant de remonter au Riau. Louise a déjà glissé une pizza au four, on la mange sur le pouce. Elle est Lili me demandent de tendre la slickline qu’elles ont ressortie et déroulée entre l’érable et le foyard.
L’église des Croisettes rayonne sur la colline, venez à moi ! Nous y sommes, nous y sommes, par la route de l’ancien cimetière, celle du nouveau ; quelques-uns traversent le pré mouillé, d’autres attendent déjà sous le porche, bras ballants.
Les gens se mêlent, les voix aussi, celle de Pierre Jean Jouve et de Corinna Bille, celle de François Rossel, de Jean Grosjean et de Paul Celan, de Jean-Luc Goldmann et de Philippe Jaccottet, sans discordance, creusant leurs aubes et leurs saisons, leurs crépuscules et leurs chemins de traverse, pierres rondes d’encres et de lumière qu’on aperçoit sous les pieds du crucifié aux stigmates dressé derrière le cercueil.
Il nous reste à la fin leurs noms, qui sont à eux seuls des paysages, et leurs poèmes qui désormais nous appartiennent. Il n’est pourtant pas besoin d’écrire ou de lire, rappelle Paul Celan, une poignée de main suffit pour que ne périsse pas le vivant allégé du mort ; j’imagine ces nuits qui auront été les leurs et les miennes, j’entends la voix qui a fait se lever un coin du voile et devine la main qui en a tracé l’ombre.
La mort nous confie le vivant du mort, François aurait pu être là parmi nous, à nos côtés, ça n’y aurait rien changé. Il n’y a pas de vaincu, la mort est un tamis qui laisse l’essentiel ; celui-ci vient se joindre au meilleur de nous. Dehors les cloches sonnent, le soleil claire novembre, on aurait aimé les entendre de très loin ; le corbillard s’en va à Montoie. Je bavarde avec Elodie et Monique, avec Pascal et Antoine.
La maman de François me parle de Bursins dont nous sommes tous les deux originaires, je lui parle de Lili Prod’hom, sa cousine, sans laquelle notre Lili ne s’appellerait pas Lili, de Marinette Defrancesco. Elle se souvient de l’invitation que son mari nous avait fait parvenir, à François, moi et quelques autres. Il voulait connaître les raisons pour lesquelles nous nous étions éloignés de l’Assemblée des Trois Rois. C’est lui aussi qui a dit quelques mots à l’occasion de la mort du mien. On n’a pas parlé de François. Tout ce qu’on voit, tout ce qui bruit, tout se tait, mais derrière le mutisme il y a ce silence de quelqu’un qui est sur le point de parler.
Je passe au nouveau cimetière d’Epalinges avant de rentrer ; quelqu’un a fleuri les tombes de maman et de papa ; Françoise vraisemblablement, ou Marcelle. Je remonte au Riau, écris les premières lignes de ce billet en écoutant en boucle le requiem de Fauré dont nous avons entendu cet après-midi l’ In pardisum.
Il est 19 heures, je redescends en vitesse à Lausanne, monte les grands escaliers du gymnase du Bugnon, désert. La journée des portes ouvertes, c’est demain, j’ai la tête en l’air, je remonte, personne n’a revu le chevillard, je rédige la seconde partie des ces notes.
Jean Prod’hom
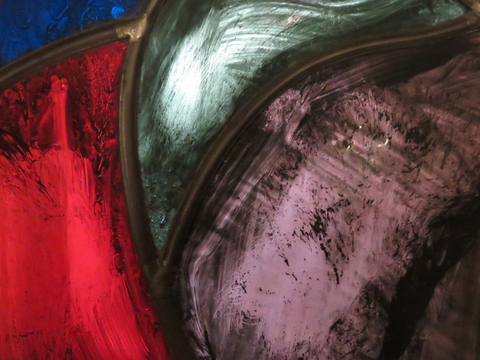


J’ose espérer qu’il dort

Cher Pierre,
Les spécialistes avaient annoncé le beau jusqu’à aujourd’hui, voilà qu’ils le promettent jusqu’à vendredi, personne ne s’en plaint. Je conduis Arthur au bus avant d’aller faire le petit tour avec Oscar. C’est lorsque je remonte dans la Nissan pour me rendre à Vevey que j’aperçois devant chez nous un chevrillard. Il ne bouge pas, moi non plus ; je décide alors de tirer de ma poche mon appareil de photos, avec le risque qu’il s’enfuie et que notre rencontre s’arrête là. Il me regarde sans broncher, je m’approche encore, fais une nouvelle photo, si près que je pourrais le toucher ; il s’éloigne enfin en trottinant. Nous répétons plusieurs fois le manège, je le filme.
Cette année dans le canton de Vaud, la chasse au chevreuil, au lièvre, au sanglier, au ragondin, au blaireau,... est ouverte du 1er au 30 octobre. Il est vraisemblable que la mère du chevillard a été tirée. Je me vois pourtant mal la remplacer et l’héberger. Le chevrillard me regarde, immobile.
Je décide de téléphoner à la Société vaudoise pour la protection des animaux ; la responsable du service regrette, elle ne peut rien pour moi, mais c’est très volontiers qu’elle me communique le numéro de téléphone de la direction de la division biodiversité et paysage, section chasse, pêche et surveillance du canton de Vaud auquel je m’empresse de téléphoner.
La responsable du service écoute mes explications, mais pas plus que la première ne peut quoi que ce soit pour moi, sinon m’envoyer par sms le numéro de téléphone du surveillant permanent de la faune de la 6ème circonscription Gros de Vaud-Jorat.
Le jeune chevreuil me regarde, il attend. Moi aussi, assis sur une traverse de chemin de fer. Je crains que l’un des chiens du quartier, si je m’en vais, lui mène la vie dure ; je réitère donc, après un petit quart-d’heure, mon appel. La responsable du service division biodiversité et paysage me reçoit un peu sèchement lorsque je lui demande timidement si elle m’a oublié. Elle n’a pas pu atteindre le garde-faune local, il est à Savatan où il participe à un cours, un cours de tir. Elle lui a laissé mon numéro de téléphone, son remplaçant prendra contact avec moi.
Je salue la bête et file à Vevey : café, thé et biscuits dans le jardin avec Edouard et Françoise, devant une vigne vierge couleur de miel et des capucines rouge coquelicot. Lorsque je quitte mes hôtes à un peu plus de midi, je n’ai reçu aucun signe du remplaçant du garde-faune,
Petite cérémonie à 14 heures dans la cour du collège en présence du directeur et du doyen, la capsule temporelle est mise sous clef jusqu’en 2035. Je corrige quelques copies à la fin des cours, puis descends en ville à 18 heures, j’ai rendez-vous avec C ; on mange une pizza à la Tour, on parle et ça fait du bien, une heure, une heure belle et triste. Je la ramène à la maison ; sa maman et son petit frère, comme elle, ont besoin de courage. C’est comme s’ils devaient apprendre à recompter le temps, à tout reprendre depuis le début, à tout réagencer, autrement.
Aucune nouvelle à 20 heures du service division biodiversité et paysage, section chasse, pêche et surveillance, aucune non plus du garde-faune local, ni de son remplaçant. Louise et Lili ont vu le jeune chevreuil à midi, hébété. On hésite à rappeler le garde-faune ; car si les chasseurs n’ont pas hésité à tirer la mère, on peut craindre qu’avec le cours de tir qu’il a pris à Savatan, le garde-faune ne manque pas le chevrillard.
Maintenant il fait nuit, j’ose espérer qu’il dort. On verra demain.
Jean Prod’hom

Nous préférons goûter à la mousse aux fraises

Cher Pierre,
Nous avons lu la semaine passée, les élèves de 10ème et moi, les premières pages du Grand Meaulnes ; j’ai risqué quelques observations. Je leur ai lu le second chapitre aujourd’hui, lento, bien décidé à poursuivre ces prochains jours, aussi longtemps qu’ils le voudront. A eux de continuer à voix silencieuse la lecture de cette merveille lorsqu’ils en émettront le souhait.

Je passe ensuite dix fois dix minutes en tête à tête avec dix d’entre eux, autour de l’abstract qu’ils auront à distribuer avant de lancer leur présentation orale. Pendant ce temps, les autres font vivre Cocktail, animé cette année par une soixantaine d’élèves qui lisent, écrivent, éditent et publient. Une dizaine sont désormais capables d’utiliser Rapidweaver et d’assurer, techniquement, la vie de ce site.
C’est encore difficile de diversifier, dans le même lieu, les activités avec les petits de 9ème, mais ils sont sur le bon chemin, et la manière dont ils s’adressent à leurs camarades est déjà remarquable. Je vérifie encore et toujours l’idée, somme tout évidente, que le principal obstacle aux apprentissages sérieux, c’est le maître. Dont la tâche la plus haute, vraisemblablement, est d’être aussi absent que possible et donc, d’abord, de se taire, d’entendre là où ils sont, ceux qui s’essaient à parler, en leur faisant voir sans rien leur montrer que tout est déjà là, à portée de leurs mains.
Je fais quelques courses à Mézières avant de rentrer : des fruits, de la pâte brisée, des épinards congelés et un gâteau de chez Ronny. Lili a fait son test d’histoire sur la fondation de Rome, elle espère que son prof n’y verra que du feu, car enfin, le Tigre et le Tibre c’est du pareil au même. Quant à la question de ce qui distingue l’histoire et la légende, je dois confesser à ma Lili que je serais bien emprunté de répondre à une telle question, les légendes ne sont-elles pas toujours des histoires ? Et au lieu de la renvoyer, elle qui a 11 ans, au legenda qui en dit tant, nous préférons goûter à la mousse aux fraises. On fête par la même occasion Louise qui a fait zéro faute à sa dictée, et Arthur qui a eu l’honneur de s’entraîner avec le roi du parkour à Lausanne, sous les feux de Couleur locale : Jesse Perveril.
Je lis, avant de reprendre Mankell, le 92ème chapitre que Jean-Louis Kuffer publie ce soir dans ses Riches Heures de lecture et d’écriture. Ses mots, où se croisent les deux enfants que nous avons été, réjouissent naturellement l’adulte que je suis devenu.
Jean Prod’hom
Brunch chez Gustave Roud

Cher Pierre,
Brunch ce matin dans une salle attenante au musée de Pully, à côté de La Muette ; mais avant les petits fours, une causerie autour de Gustave Roud, ce personnage au chapeau de contremaître, égaré entre la Gotte et la chapelle de Vucherens, manteau de ville sur les épaules, visage labouré par l'écriture et pentax à la main.

La salle est pleine : amis, curieux, poètes et savants, Pierre Fankhauser, Julien Burri, Sylviane Dubuis, Daniel Maggetti et Bertrand Schmidt. Mais film d’abord, qui met en scène et fait parler ceux qui ont côtoyé Gustave Roud à Carrouge, Ferlens ou Mézières ; ils ne savent pas très bien que dire à ces gens de la ville, ce qu’on attend d’eux ; ils le disent finalement, dans leurs habits du dimanche, sans décevoir, avec soin, comme à l’école. Ils disent juste, le public en rit, j’aurais voulu m’en aller. Il y a dans l’art documentaire – lorsque ses acteurs sont pris en otages et livrés, sans précaution, à des publics trop sûrs d’eux – quelque chose de diabolique.
Gustave Roud devait inquiéter, parlant comme il parlait, habillé comme il l’était sur les chemins de terre d'avant le remaniement parcellaire ; à surprendre les paysans au champ, à les photographier après les avoir mis en scène, ou à les photographier par surprise avant de leur demander la permission.
Tonnerre ! Yves m’apprend que François est mort. La dernière fois, c’était au Salon du livre de Genève, il était responsable du stand d'Empreintes. Je lui ai acheté les deux tomes du Journal de Roud, on s’était promis qu’on se reverrait. Trop tard. Ce sera donc pour plus tard et de l’autre côté.
Sa mort m’éloigne de la causerie, m’amène à écouter de travers des propos devenus soudain un peu fades, j’entends à deux reprises le mot de ressenti, je n’y puis rien, ce mot me donne l’envie de vomir.
Oui, François, le chant de Gustave Roud est d’abord chant de douleur, douleur distillée et continue ; sa teneur en poison est haute, mais le mouvement de la phrase est tel qu’il parvient à en tirer quelques paillettes précieuses qui éclairent en retour l’obscurité qui les a fait naître. Les cloches sonnent au Prieuré.
Je m'arrête à Rivaz, sonne à la porte de la maison dans laquelle Ramuz habita entre 1914 et 1916. Anne-Hélène est absente. Je m'installe sous la glycine qui n'a perdu que quelques feuilles, le lac n'a pas changé et le soleil l’innonde. Je lis les quelques mots que Jean-Louis Kuffer a écrits dans le Matin dimanche, ravi d'être en de si bonne compagnie : Nicolas Verdan et Frédéric Pajak. J'avais collaboré, oh si peu et si mal, avec le second dans Nous n'avons rien à perdre, un des nombreux journaux qu'il avait lancés, c'était au milieu des années 70. Nous ne nous sommes plus parlé depuis, croisés quelquefois, brièvement.
Sandra m'envoie un message, Lili m’attend pour revoir son histoire : la fondation de Rome. Je relis avant de me coucher Le phare, ici.
Jean Prod’hom

Ces jours où les mots ne veulent pas se mettre ensemble et on n’arrive pas à les y forcer.
Devant cette grandeur, impossible d’avancer, je n’ose pas.
Ce grand beau temps, ces nuits de lune, ces soirs de bise ; – mais le milieu de la journée noblement immobile sous l’inondation du soleil.
C.F. Ramuz, Rivaz, 1915-2015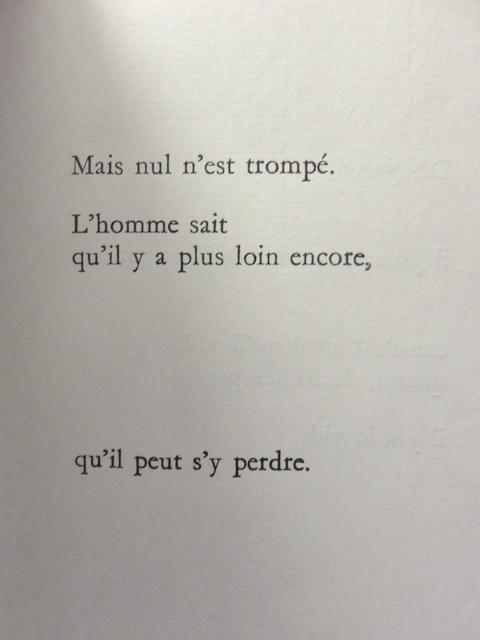
François Rossel, Le Phare, ici, éditions Empreintes, 1982
Au fond du couloir des mots d’avant le langage

Cher Pierre,
Sandra mène les filles à Thierrens puis descend au marché. Guillaume passe boire un café, je règle ce que nous lui devons ; il vérifie les mesures de la bibliothèque que nous lui avons commandée, celles des armoires de l’entrée et des combles ; Arthur fait le petit tour avec Oscar. Je me lance alors, à contre coeur, dans la correction d’une pile de travaux d’élèves, leur qualité me donne la force de terminer. Mais trois piles m’attendent encore, que je me promets de laisser derrière moi d’ici demain soir.

Claude me signale qu’une présentation de Marges aura lieu le 19 novembre au Café littéraire de Vevey. Il serait judicieux, je crois, que je revienne sur les circonstances qui m’ont amené à publier sur le web, à éditer ensuite sur papier ; à présenter aussi les deux expériences collectives auxquelles j’ai participé, les 807 et les vases communicants. Pour le reste c’est à voir.
Stéphane m'envoie un mot dans lequel elle me propose qu’on fasse quelque chose ensemble ; la manière dont elle parle de ce qui l’entoure et lui advient me réjouit, sa proposition aussi ; on décide de se voir en début décembre.
Je laisse la Nissan devant le Brico d’Epalinges, achète à la pharmacie deux flacons de shampoing contre les poux que Lili a, peut-être, ramenés de chez sa copine de Mézières ; passe derrière le collège et descends jusqu’au chemin qui longe le Flon ; je traîne les pieds dans les feuilles mortes, par la Clochatte jusqu’à Tridel, passant outre l’interdiction d’emprunter le chemin après le Vivarium, taillé dans la molasse, qui s’est effondré sur quelques mètres ; il me faut avouer que je ne sais rien de ce qui fait tenir les choses ensemble, hormis les phrases. Le Flon, qui serpente tout au fond du vallon, donne le vertige.
Belle soirée à la Datcha ; les amis de Claude sont là pour le fêter, il est à la tête d’Antipodes depuis 20 ans et aura fait paraître, avec ses collaboratrices et ses collaborateurs plus de 200 titres. J’y retrouve Murielle, Michel et François ; fais aussi la connaissance du 8ème conseiller fédéral – il joue de la contrebasse. Dans le mot qu’il adresse à ses hôtes, Claude se demande s’il est bien judicieux d’éditer des livres ; je ne peux m’empêcher, de mon côté, de me demander si, à côté de gens si savants et si enthousiastes, je ne ferais pas mieux de faire des choses un peu utiles : maintenir hors du langage ce qui tient tout seul, ensemble et séparément.
François me remonte au Brico d’Epalinges où je récupère la Nissan. Tout le monde dort au Riau ; j’entends pourtant, tandis que je rédige ces notes à la bibliothèque, ici un soupir, un peu plus loin le froissement d’un drap, au fond du couloir des mots d’avant le langage.
Jean Prod’hom
J'ai cru voir un chardonneret

Cher Pierre,
Ce vendredi de congé est le bienvenu, j’en profite pour faire un grand tour dans les bois avec Oscar, une piéride nous accompagne sur le long chemin de traverse entre le refuge de Corcelles et l’ancien étang. Je lis à la Mussilly les premiers fragments de la vie de Henning Mankell, bouleversants. Une seconde génération de pâquerettes se mêle, ici et là, aux tapis de feuilles mortes, j’ai cru voir un chardonneret.

Je reviens à René Girard ; les universitaires n'étaient pas très nombreux, dans les années quatre-vingts, à le prendre au sérieux. J’étais à l'université de Lausanne et m'en rappelle bien. Ce qui ennuyait les intellectuels de ces années-là, c’étaient, je crois, les propriétés de symétrie et de réflexivité de sa théorie : les mêmes types de causes doivent expliquer les croyances « vraies » et les croyances « fausses »; les modèles explicatifs doivent s’appliquer à la sociologie elle-même.
Et lorsque j'ai évoqué la possibilité de faire une thèse de philosophie autour de l'idée de conversion, à la lumière des réflexions de René Girard et de celles de Thomas Kuhn sur les révolutions scientifiques, alors que je suivais en fin de semaine les cours de Michel Serres à la Sorbonne – qui fut l'un des seuls à soutenir le sociologue –, juste avant qu’il entreprenne une lecture girardienne du Ab urbe condita de Tite-Live, j'ai eu soudain le sentiment, au milieu de la ville, d'être un étranger parlant une autre langue. J'ai vite renoncé à la thèse, terminé mon mandat d'assistant, décidé à prendre une autre direction, là où il n'y a personne, là où les médiations sont lointaines, sur les bords de mer. Je me réjouis encore aujourd’hui de cette conversion.
Vincent passe en début d’après-midi, on glisse sous le poêle une plaque de tôle noire. Je profite de changer les pierres ollaires du foyer. Je descends à 19 heures 30 au village rejoindre le comité du TCPM, c’est la fin de saison. Je remonte au Riau un peu avant minuit.
Jean Prod’hom
René Girard est mort : petit exercice d'admiration

Cher Pierre,
René Girard est mort en début de semaine, mais sa pensée demeurera vivante, c’est sûr, longtemps encore. Lorsque j’entre dans la classe 101, les élèves montent au milieu de chacune de leur table des murs de classeurs, à défaut de parpaings, qui les isolent, prévenant ainsi tout au long de l’épreuve leur désir d’aller brouter l’herbe du voisin.

Et ces contrôles de connaissances, aux formes très ritualisées, que l’institution nous enjoint d’organiser et qui, je le sais d’expérience, font plus de mal que de bien, engendrent davantage d’opacité que de clarté. Ils ont en réalité pour seule vertu celle de repérer ceux des élèves qui sont le plus à l’aise avec les langages de l’institution – ceux qui précisément pourraient se passer de ces contrôles – et à stigmatiser ceux qui ne saisissent pas les attentes de l’école, parce qu’ils ne parlent pas son jargon, se méfiant de ces épreuves qui leur rappellent, rituellement, qu’ils ne seront pas invités au grand raout.
J’interdis aux élèves de monter ces murs de la honte, leur autorise tout leur matériel, leurs notes, leur travail. En encourageant ainsi les échanges, quels qu’ils soient, l’enfant apprend vite qu’il est parfois mieux servi par lui-même que par autrui, et qu’il est souvent préférable de ne pas suivre aveuglément son voisin. Il sied que cette expérience soit faite par chacun. La mise en quarantaine régulière que mettent en place ceux qui croient bien faire, pour s’assurer que la connaissance est piégée dans la tête de l’enfant, la stérilise en la coupant de la circulation qui la nourrit.
Et, tandis que des enfants élèvent des forteresses pour prévenir le partage et jeter le discrédit sur le mimétisme qui donne vie à soi, à l’autre et à la connaissance, une moraliste fait un très beau prêchi-prêcha dans la classe voisine, rappelant mythes à l’appui la traditionnelle hospitalité des Européens. Elle évoque aussi le gâchis du mur grec, puis raconte l’apartheid sud-africain et les combats de Mandela, montre enfin un morceau du mur de Berlin acheté aux puces. On ne peut demander à nos enfants à la fois d’aimer leurs voisins et de garder pour eux-mêmes ce qui est à tout le monde. Partager s’apprend, en premier lieu sortir du double bind.
Ce matin, les employés communaux ont posé les pare-neige au-dessus de la Mellette. Je trouve en rentrant, dans la boîte à lait, Sable mouvant de Henning Mankell, Lettrines, Lettrines 2 et Liberté Grande de Julien Gracq. Me rends à 19 heures au comptoir d’Echallens pour signer quelques livres.
Jean Prod’hom

Nous ne faisons jamais ce que nous pensions faire

Cher Pierre,
Une large bande bleue, irrégulière, rampante, se glisse à l'est entre la chaîne des Vanils et la couverture nuageuse ; elle restera stable toute la journée. A l’ouest il pleut, les élèves se précipitent à la fenêtre, un arc-en-ciel tire sa courbe depuis Jouxtens-Mézery jusqu’à très haut, du côté de Cossonay, où il disparaît ; le soleil, invisible, a bouté le feu au pied du Jura, laissant une poudre d'or qui se mêle à une bruine fine, qui font scintiller les villages, les bois et les prés.

La responsable des 4 Coins du Mont m'a demandé hier soir quelques photos de l'inauguration des nouveaux collèges, j'en trouve trois ou quatre qui, je l'espère, feront l'affaire. J'exporte en outre les pages du site Cocktail qui figureront dans la capsule temporelle.
Je remonte à 13 heures au Riau, les filles se sont fait une pizza, à moi les restes. Je conduis à 15 heures Lili chez une amie de Mézières, puis remonte pour visionner sur youtube la fin d'une belle conférence de Gilles Clément signalée par Alexandre. Les enseignants auraient tout intérêt à en prendre de la graine, les jardiniers ont beaucoup de choses à leur apprendre, l’essentiel peut-être.
Car enfin, nous ne faisons jamais ce que nous pensions faire, et personne ne s’en plaint ou s’en vante. Et il ne nous en coûte pas trop de renoncer à ce qu’on avait imaginé. Il vaudrait mieux souvent ne rien faire pour être utile à des enfants qui n’ont besoin de rien, sinon d’avoir près d’eux un maître que l’imprévisible ne désoriente pas mais réjouit.
Il est d’une certaine manière inutile de concevoir des programmes d’études, toujours trop étroits, conçus pour éloigner ce qu’on n’y a pas mis et nous protéger de notre ignorance. La partition du savoir, les columbariums, les disciplines et leurs frontières sont des fables qu’on a fait passer pour la réalité, elles pèsent sur nos manières de vivre, de connaître et stérilisent les recherches.
Je passe deux heures avec Xavier au café de la Poste, notre aventure à Rue, Entre terre et mer, aura vraisemblablement lieu en mars 2016, si Dieu le veut.
Jean Prod’hom
Quelque chose s’est refroidi

Cher Pierre,
Il reste sur pied, ici au Riau, un peu de maïs et des betteraves. Ce matin, Jean-David en déchintre un champ à la Moille-aux-Blanc, pour ne pas avoir à rouler avec son tracteur sur le pré voisin, en bordure duquel il entasse les fanes. Il en décollette deux rangées, qu’il viendra charger ce soir dans une vieille bennette.


Les sangliers ont sérieusement labouré le pré, ils sont partout, me dit Jean-David ; Jean-Paul a vu une mère et ses petits traverser la route en-dessous de la déchèterie, d’autres ont été aperçus du côté du chalet d’Orsoud. Les gens avisés de la commune estiment qu’ils sont plus de trente à écumer la région, il va falloir les tirer. On parle, on parle, mais Jean-David veut terminer ses deux rangées de betteraves avant de descendre à la laiterie ; la société de fromagerie dont il est le président se réunit en effet tout à l’heure pour une réunion extraordinaire. Il y a eu un pépin, la chaudière de 6600 litres, étamée de cuivre, est fendue. Les sociétaires devront décider s’ils la rapetassent ou s’il en achètent une neuve. La seconde solution serait préférable mais coûterait à la société 160’000 francs.
A l’autre bout de la journée, une conférence des maîtres ; ce sont d’autres soucis qui sont évoqués par le directeur, pendant plus d’une heure : la population qui croît, les règlements qui se multiplient, les budgets qui explosent, le ton qui se durcit ; les procéduriers en appellent au cahier des charges, les plus confiants bâillent. On dirait que le bon sens a pris la clé des champs, nous laissant avec un chaudron fendu ; on tente d’allumer ici et là des foyers, d’en étouffer ailleurs ; mais quelque chose s’est refroidi, quelque chose ronge l’intérieur du chaudron. On rapetasse en continu, avec du neuf ; on ajoute des couches supplémentaires qui ont pour seul effet d’alourdir l’édifice. Il ne restera bientôt, à l’intérieur, plus rien qu’un feuilletage d’enduits qui s’écaillent.
Jean Prod’hom
On se doit d’apprendre à vivre sans coupe-feu

Cher Pierre,
On se réveille au-dessus du brouillard, mais il m’avale, moi et la Nissan, à l’extrémité du plateau de Sainte-Catherine. J’en ressors au Mont, dessous ; la couverture nuageuse ne se déchirera pas.

Je prépare ma journée à la volée, enchaîne cinq périodes, mange à la Châtaigne un vol-au-vent ; enseigne à nouveau jusqu’à 15 heures 30, avant de monter au Chalet-des-Enfants : là-haut le soleil se couche.
Alors que les difficultés, innombrables je le crains, s'amoncèlent aux quatre coins de la terre, aussi bien du point de vue de la gestion de nos besoins que de nos relations au sein de notre espèce, que certains états essaient de tirer les marrons du feu, alors que deux ou trois groupes dictent les règles du jeu et que les individus les plus habiles jouent les premiers rôles, j’imagine que les innombrables chicanes qui nous attendent au réveil se sont dissipées pour toujours, comme ces fumées à l'arrière des pipers et des gros-porteurs qui sillonnent le ciel, à nouveau bleu, bleu ciel, ciel sans nuage ; j’imagine la paix perpétuelle le jour de sa signature, j’imagine l’humanité au matin de ce jour, effrayée, ne désirant en réalité pas plus l’établissement de son règne que celui de l’éternité, désemparée devant les heures creuses.
Paix et éternité, l’homme les craint, repoussant à plus tard ces images qui sont celles de sa ruine ; elles lui rappellent sous le soleil et les mauvaises herbes que la terre peut faire sans lui ; et s’il s’affaire autour des conditions de son existence, c’est pour mieux passer à côté de celle-ci et s’en plaindre. Plus rien ne nous protège de nous-mêmes, ni l’étendue qui nous entoure, ni le rien qui nous enveloppe et nous pousse. On se doit d’apprendre à vivre sans coupe-feu en s’écartant du tintamarre des nations.
JLK me fait savoir que Le Matin Dimanche lui a demandé de présenter trois livres de la rentrée hors-rentrée, Marges sera le premier. Il termine son mot par des condoléances amicales. Je monterai un de ces quatre à la Désirade, en voisin ; je l’ai aperçu à l’Estrée l’année dernière, à l’occasion de la remise du prix Edouard-Rod, je crois me souvenir de sa voix.
Sandra et Louise sont allées au CHUV cet après-midi, elles reviennent avec de bonnes nouvelles. Mais Louise a oublié une fois encore d’offrir à Xavier un exemplaire de Marges ; j’aurais voulu qu’il le feuillète avant qu’on se voie mercredi prochain à Oron. Je prépare deux quiches et une salade.
Jean Prod’hom
Voici la clé, nous sommes au milieu du chemin

Cher Pierre,
On pleure et prie à la Toussaint, et cet immense dimanche de novembre en donne envie. Mais comment s’y prendre et quoi dire. Se taire est aussi un verbe intransitif, alors je marche de Froideville – où j’ai laissé la Nissan – jusqu’au Riau.

Je fais une halte sur la terrasse de la Poste où je bois une verveine, à côté d'un gars du coin qui boit un verre de blanc ; heureux d'en être tous les deux, du bon coup que le ciel a joué aux morts. Et cette terrasse sur laquelle nous nous sommes embarqués, nous ne voudrions l'échanger contre aucune éternité ; le dénuement se confond avec l’abondance, la laine et le soleil picotent la peau ; dans le le ciel dansent des ballons multicolores, ceux qui les ont lâchés leur tournent le dos ; les cloches sonnent la demi de deux, ça tient ensemble.
C'est la conscience qu'il ne peut en aller tout le temps ainsi qui m'oblige à me lever et laisser ce qui ne fait jamais faux bond. Je reviendrai et me remettrai à la cape. Faut-il vouloir plus ?
Ne pas choisir entre raison et poésie, ne céder ni à l’une ni à l’autre. Je n’aime pas parler de la mort ; mais j’écris, je crois, avec elle, ou à côté d’elle. Lointaine ou proche, elle veille lorsque je lis théorèmes ou poèmes.
J’entre dans le bois des Orgires, j’entends bientôt Oscar, aperçois Louise et embrasse Sandra. Voici la clé, nous sommes au milieu du chemin. A tout à l’heure.
Jean Prod’hom
